……………………………………………………………………
Ceilin Poggi, une voix chaleureuse et lumineuse

Ceilin Poggi est connue pour sa reprise du standard « Bewitched » de Richard Rodgers. Photo Larcher Félix
Ceilin Poggi, une voix chaleureuse et lumineuse
Ceilin Poggi est une chanteuse et interprète au parcours singulier, dont l’univers musical s’inscrit dans un entrelacs subtil de jazz, de ballades douces et de poésie sonore.
L’approche artistique de la chanteuse Ceilin Poggi, à la fois intimiste et raffinée, s’ancre dans une recherche constante d’authenticité et de nuance. Chez elle, chaque note, chaque inflexion vocale semble murmurée avec soin, portée par un souffle de délicatesse qui invite à l’écoute profonde.
Son style se distingue par une sensibilité rare, capable de transformer les silences en moments de respiration musicale. Loin des effets de virtuosité, elle privilégie l’émotion juste, l’harmonie feutrée, la connivence discrète entre la voix et les instruments. Cette esthétique immersive crée un univers sonore enveloppant, presque cinématographique, où la mélodie devient un espace de contemplation.
Ceilin Poggi s’est illustrée dans des projets artistiques qui reflètent cette exigence de douceur et d’intensité, notamment en collaboration avec le pianiste Thierry Eliez, figure reconnue du jazz français. Ensemble, ils ont donné naissance à plusieurs albums remarqués, parmi lesquels Balladines et Chansons Douces et Berceuses et Balladines Jazz, parus chez Didier Jeunesse.
Ces disques, à la croisée du jazz, de la chanson française et du répertoire enfantin revisité, sont porteurs d’un univers apaisant et poétique, pensé aussi bien pour les enfants que pour les adultes en quête de sérénité musicale. La voix caressante de Ceilin Poggi, conjuguée aux harmonies aériennes du piano de Thierry Eliez, y trace un chemin d’écoute où le rêve et la tendresse s’entrelacent.
Interprète inspirée, elle possède une voix à la fois chaleureuse et lumineuse, capable d’exprimer les moindres nuances d’un texte ou d’une mélodie. Sa reprise du standard Bewitched de Richard Rodgers, qu’elle revisite avec une pudeur sensible, illustre à merveille sa capacité à insuffler une âme nouvelle aux grandes pages du jazz vocal. Sans jamais forcer l’émotion, elle tisse un lien direct avec l’auditeur, nourri d’élégance, de retenue et d’intensité.
Mais Ceilin Poggi ne se limite pas à l’interprétation. Elle s’investit pleinement dans la création musicale sous toutes ses formes.
Ceilin Poggi collabore notamment avec le label Dood Music Record, où elle prend part à la direction artistique, à la stratégie digitale et à l’accompagnement de projets. Son implication dans les coulisses de la production lui permet de porter un regard global sur le processus créatif, depuis la genèse d’une œuvre jusqu’à sa diffusion. En cela, elle incarne une figure d’artiste complète, soucieuse de défendre le jazz dans toute sa richesse contemporaine et de contribuer activement à son rayonnement.
Curieuse et ouverte à l’expérimentation, Ceilin Poggi explore également des formats originaux qui dépassent le cadre traditionnel du concert. Elle a notamment conçu Balladines, un spectacle mêlant musique live et illustration en direct, coproduit par la Philharmonie de Paris et le Festi’Val de Marne. Ce concert dessiné, pensé comme un voyage sensoriel, croise le chant, le piano et l’univers graphique pour proposer une expérience immersive et accessible à tous, enfants comme adultes. Ce projet reflète parfaitement son désir de créer des passerelles entre les disciplines et d’élargir les formes de narration musicale.
Enfin, Ceilin Poggi attache une grande importance aux enjeux d’accessibilité et d’inclusion, en particulier à destination des publics en situation de handicap. Convaincue que la musique peut être un outil de lien social, elle œuvre à rendre ses projets accessibles et à faire entendre, à travers son art, des voix souvent laissées en marge. Son engagement dépasse ainsi le domaine artistique pour s’ancrer dans une démarche humaniste, où la création devient vectrice de sensibilisation, de dialogue et de transformation sociale.
Brahim Saci
Diasporadz.com
Le 3 mai 2025
www.youtube.com/watch?v=sKv87cfBntA&t=1s
……………………………………………………………
Lielie Sellier : « Virginia Woolf m’a transmis le goût de capter l’éphémère »

L’autrice Lielie Sellier revient dans cet entretien sur les inspirations qui nourrissent son travail, la construction de ses personnages et le message transmis à travers ses récits.
Son approche de l’écriture ainsi que son engagement dans l’éducation offrent une perspective intéressante sur le rôle de la littérature dans la transformation personnelle.
Diasporadz : Dans vos romans, vous explorez souvent des thèmes forts comme la résilience, la maltraitance et la quête de sens. Qu’est-ce qui vous inspire particulièrement dans ces sujets, et pourquoi les abordez-vous de manière aussi intime et émotive ?
Lielie Sellier : Parce que je les ai traversés. Il me semble que, même si certains s’en défendent, tout écrivain insère un fragment de son intimité dans ses textes. À travers mes récits, je cherche à dire que même les êtres cabossés peuvent retrouver la lumière. Parfois au détour d’une rencontre humaine, animale, d’une ruelle, d’un matin pluvieux, d’une journée ensoleillée… ou simplement en se reconnectant à la nature, en puisant au fond de soi la force de continuer.
Diasporadz : Dans Murmurations, les personnages de Mathias et Charlotte font face à des défis émotionnels et sociaux importants. Pouvez-vous nous parler de la manière dont vous avez développé leur relation et ce qu’elle représente pour vous ?
Lielie Sellier : Mathias est né d’un souvenir d’enfance. Dans le quartier où je vivais enfant, il y avait ce garçon — un peu plus âgé que moi, mis à l’écart à cause de sa différence physique, ce qu’on appelait alors un « bec de lièvre ». Nous partagions des goûters, des confidences, des courses effrénées. Il était d’une douceur incroyable, toujours digne malgré les moqueries. Après un déménagement, nous nous sommes perdus de vue, je ne l’ai jamais revu. J’ai souhaité lui rendre hommage.
Charlotte, elle, s’inspire d’un ancien compagnon, artiste, aujourd’hui disparu.
Ce qui m’intéressait, c’était de raconter l’histoire de deux êtres que tout oppose, et qui pourtant, par une forme de simplicité essentielle, parviennent à créer un lien indéfectible.
À travers eux, je parle de l’acceptation de l’autre, de la différence – un thème central dans mon écriture, d’autant plus nécessaire dans le monde actuel, en perpétuelle mutation.
Diasporadz : Vous avez évoqué l’importance de l’amitié et des liens humains pour guérir. Est-ce un message personnel que vous cherchez à transmettre à vos lecteurs à travers vos personnages ?
Lielie Sellier : C’est un message en filigrane, oui. Mais je préfère laisser chaque lecteur en faire sa propre lecture, selon les amitiés qu’il a connues, les blessures qu’il porte. Chacun reconnaît ou non ces liens dans les pages, à son propre rythme.
Diasporadz : Votre écriture allie simplicité et profondeur. Comment parvenez-vous à trouver cet équilibre, et est-ce un style qui vous est venu naturellement ou avez-vous dû travailler pour l’atteindre ?
Lielie Sellier : C’est un style qui m’est naturel. Je crois que la simplicité, quand elle est sincère, peut toucher profondément. L’émotion, l’humanité passent souvent par des mots justes, pas forcément par des effets de style.
Diasporadz : Vous puisez votre inspiration dans des auteurs comme Virginia Woolf et Raymond Carver. Quel est l’impact de ces influences sur votre propre écriture et comment les intégrer-vous dans vos récits ?
Lielie Sellier : Virginia Woolf m’a transmis le goût de capter l’éphémère, les sensations du temps qui passe, des saisons qui glissent. Carver, lui, m’a appris à scruter les failles, à rendre visible la vulnérabilité des êtres. Dans mes textes, ces influences se mêlent au souffle de mes propres émotions.
Diasporadz : En plus de votre carrière d’écrivaine, vous vous impliquez dans des ateliers d’écriture et des interventions scolaires. Quel rôle attribuez-vous à la littérature dans l’éducation et la transformation personnelle, en particulier auprès des jeunes générations ?
Lielie Sellier : La littérature est un passage, un pont entre soi et les autres, entre les mondes. Elle permet l’empathie, la découverte, l’éveil. Elle ouvre des espaces de dialogue, de questionnement, parfois de consolation. Pour les jeunes, elle peut être ce miroir qui rassure, ce tremplin qui libère.
Diasporadz : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Lielie Sellier : Mon dernier roman Dédales Intimes poursuit sa route, à la rencontre de ses lecteurs. Je prépare la publication d’un recueil de poèmes illustré de mes collages, Le grain du temps : chaque poème y dialogue avec une image, pour une expérience sensorielle entre mots et matières.
Un nouveau roman dort dans un dossier de mon ordinateur… Il attend que je le relise à nouveau avec un œil neuf.
Côté collages : je participerai à deux expositions collectives, The Collage Temple les 10 et 11 mai à Manzana, en Italie, et Fils et Feuilles du 30 mai au 7 juin 2025 à la Galerie Étienne de Causant à Paris 75006.
Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?
Lielie Sellier : Je laisserai la parole à Jean de La Fontaine :
« On rencontre sa destinée souvent par les chemins qu’on prend pour l’éviter. »
Entretien réalisé par Brahim Saci
Le site de l’artiste Lielie Sellier : www.lieliesellierauteure.com
Voir aussi : www.womenunitedartmovement.com/artistdirectory/lielie-sellier
Le 02 mai 2025
diasporadz.com
……………………………………………………………………………..
Lielie Sellier : la littérature comme espace de réconfort et de réparation

L’autrice Lielie Sellier aborde des thématiques poignantes telles que la résilience, la quête de sens et l’introspection. Photo DR
Lielie Sellier : la littérature comme espace de réconfort et de réparation
Lielie Sellier est une autrice française contemporaine qui se distingue par sa plume délicate et son approche émotive des réalités humaines.
À travers ses récits, l’autrice Lielie Sellier aborde des thématiques poignantes telles que la résilience, la quête de sens et l’introspection, tout en tissant des liens intimes entre ses personnages et ses lecteurs. Son écriture s’attache à traiter des sujets parfois complexes ou douloureux, tout en laissant une place importante à l’espoir et à la réconciliation.
Parmi ses œuvres les plus marquantes, le roman Murmurations s’impose comme un véritable chef-d’œuvre. Ce livre raconte l’histoire de Mathias, un jeune garçon confronté à des violences familiales et à l’isolement provoqué par le harcèlement scolaire, ainsi que celle de Charlotte, une nouvelle arrivante dans son village. Leur rencontre devient un phare dans un quotidien sombre pour Mathias. Charlotte incarne un refuge et une figure d’espoir, offrant une lueur de solidarité et de lumière dans un monde difficile. À travers cette histoire, Lielie Sellier aborde des thèmes universels comme la douleur des blessures invisibles, l’importance des liens humains pour guérir et la redécouverte de soi grâce à l’amitié. Son écriture, empreinte de sensibilité, permet de traiter des sujets lourds comme la maltraitance ou l’exclusion sociale avec une justesse remarquable.
Un autre récit significatif dans son répertoire, « Rejoins-nous », adopte une approche plus réaliste tout en préservant cette touche d’espoir qui définit l’ensemble de son œuvre. Ce livre, inspiré de faits réels, met en lumière les luttes intérieures de personnages authentiques et fragiles, qui se battent pour se reconstruire malgré les épreuves de la vie. Lielie Sellier y déploie un talent exceptionnel pour peindre des portraits psychologiques détaillés et touchants, capturant l’essence de l’expérience humaine dans toute sa complexité, entre contradictions et aspirations.
Simplicité et sophistication
Ce qui distingue particulièrement l’autrice Lielie Sellier, en plus de ses intrigues captivantes, c’est son style d’écriture unique. Elle allie simplicité et sophistication, rendant ses récits à la fois accessibles et enrichissants. Elle excelle dans la création d’ambiances immersives et de dialogues sincères qui ancrent le lecteur dans le quotidien de ses personnages. Son langage, fluide et à la fois direct et poétique, s’adapte à merveille aux émotions qu’elle souhaite transmettre, conférant à ses récits une dimension introspective et universelle. Ses personnages ne sont pas de simples personnages de fiction ; ils sont des miroirs dans lesquels les lecteurs se reconnaissent, peu importe leur âge ou leurs expériences personnelles.
Publié en septembre 2024 aux éditions 5 Sens, Dédales intimes est le dernier roman de Lielie Sellier. Ce récit captivant, à la croisée du thriller psychologique et du fantastique, tisse avec finesse une intrigue où l’enquête criminelle se mêle à des éléments surnaturels. À travers cette histoire troublante et poignante, l’autrice explore les liens mystérieux qui unissent les vivants aux disparus, tout en questionnant la mémoire, le deuil et la présence invisible de ceux que l’on croit perdus.
Lielie Sellier trouve son inspiration dans la nature, les relations humaines et les œuvres littéraires de figures majeures telles que Virginia Woolf et Raymond Carver. Cette combinaison d’influences enrichit son univers littéraire et lui permet de naviguer habilement entre différents genres et tonalités, tout en conservant une identité littéraire propre. Elle considère la littérature comme un espace de réconfort, de questionnement et de réparation, et invite à réfléchir sur la manière dont nous nous reconnectons à nous-mêmes, aux autres et au monde qui nous entoure.
Au cœur de son écriture réside la résilience, cette capacité humaine à transformer les épreuves en forces. Ses personnages, souvent marqués par des traumatismes, trouvent en eux-mêmes une force insoupçonnée pour se relever grâce à des rencontres, des amitiés ou des gestes d’amour, même discrets. Lielie Sellier illustre ces parcours de renaissance, bien que semés d’embûches, ce qui donne à ses récits une dimension profondément humaine et universelle.
Outre la fiction, Lielie Sellier s’engage également dans des activités qui élargissent son impact littéraire, telles que des ateliers d’écriture ou des interventions en milieu scolaire. Elle y partage son amour des mots et encourage les jeunes à s’exprimer, contribuant ainsi à faire de la littérature un outil de transmission et de transformation.
En somme, Lielie Sellier s’impose comme une voix incontournable dans la littérature contemporaine. Sa capacité à explorer les méandres de l’âme humaine, tout en abordant des thématiques sociales sensibles, lui permet de marquer durablement ses lecteurs. Ses récits ne se contentent pas de raconter des histoires, mais résonnent profondément, interrogeant et apaisant à la fois. Alors que son œuvre continue de se développer, elle promet de laisser une empreinte significative dans le cœur de ceux qui prennent le temps de s’y plonger.
Brahim Saci
Diasporadz.com
Le 01 mai 2025
…………………………………………………………………………….
Ahmed Amzal : un répertoire riche en couleurs

Le chanteur kabyle Ahmed Amzal est très apprécié dans les milieux de l’émigration. Photo DR
Ahmed Amzal : un répertoire riche en couleurs
Ahmed Amzal est un chanteur kabyle originaire du village de Djebla, niché dans la région d’Aït Ksila, en Kabylie maritime, en Algérie. Ce village, perché au-dessus de la mer et reconnu pour sa beauté naturelle, a fortement influencé sa sensibilité artistique.
Artiste discret et humble, le chanteur kabyle Ahmed Amzal est admiré pour l’excellence de ses compositions, qui touchent profondément son public.
Son inspiration provient des paysages, des traditions et des émotions de sa région natale. Sa musique, profondément authentique, reflète les valeurs kabyles tout en explorant des thèmes universels comme l’amour, l’exil et la vie en société. Sa voix, souvent décrite comme apaisante et envoûtante, dégage une intensité émotionnelle qui marque durablement ses auditeurs.
Bien qu’il ait commencé à composer et chanter dès l’adolescence, Ahmed Amzal a dû jongler avec ses responsabilités quotidiennes dans un contexte où la carrière musicale n’était pas toujours valorisée. C’est pendant son exil qu’il s’est pleinement consacré à sa vocation artistique, faisant de la musique un moyen d’exprimer ses émotions et ses pensées.
Il a su créer un style distinctif, s’inspirant de grandes figures de la musique kabyle qui ont su marier tradition et modernité tout en véhiculant des messages puissants. Parmi ses influences figurent Mouhoub Ali, Slimane Azem, Lounès Matoub et Idir, qui ont enrichi son répertoire avec une poésie et une profondeur mémorable. Ces artistes lui ont transmis le goût d’une musique porteuse de mémoire et d’identité, tout en lui permettant d’affirmer sa propre sensibilité.
Ce qui rend Ahmed Amzal unique, c’est son attachement à l’authenticité et à la sincérité dans sa démarche artistique. Ses chansons, empreintes de poésie, expriment à la fois son vécu et les valeurs qu’il chérit. Malgré de rares apparitions sur scène, il reste profondément actif, livrant des créations musicales qui allient harmonie et émotion.
L’univers d’Ahmed Amzal célèbre la culture kabyle et la richesse de la vie, il transmet un message d’élévation et de connexion humaine. Son œuvre, bien que discrète, est largement saluée pour sa capacité à évoquer des émotions universelles et intemporelles.
L’influence d’Ahmed Amzal sur la musique kabyle et la culture amazighe est incontestable. Il contribue à préserver et à transmettre cette culture riche, souvent mise à l’écart. Ses chansons, marquées par leur sincérité et leur profondeur poétique, mettent en lumière les traditions et les valeurs de son peuple. En explorant des thématiques universelles comme l’amour, l’exil, il renforce une identité culturelle précieuse et vivante.
Apprécié pour son authenticité, il établit un lien fort avec son public, grâce à des compositions enracinées dans les traditions kabyles. Sa voix, à la fois apaisante et intense, inspire profondément et continue de fédérer les générations.
Pour la diaspora kabyle, notamment les exilés en France, sa musique agit comme un ancrage identitaire et un espace de réconfort face aux défis de la vie loin de la terre natale. En reliant les générations, Ahmed Amzal incarne une figure culturelle emblématique et intemporelle.
Son héritage repose sur sa capacité à enrichir la musique kabyle en restant fidèle à ses racines tout en l’ouvrant au monde. Sa quête artistique sincère a laissé une empreinte indélébile, garantissant à la musique kabyle une résonance qui transcende les époques.
Brahim Saci
Diasporadz.com
Le 29 avril 2025
……………………………………………………………………………

Adeline Baldacchino : « J’ai confiance dans le pouvoir salvateur des œuvres»
Adeline Baldacchino a construit une œuvre riche et diversifiée, qui reflète ses multiples facettes d’écrivaine, poétesse, essayiste et penseuse engagée. Adeline Baldacchino est avant tout une poétesse dont les œuvres célèbrent l’éveil émotionnel et philosophique, « 33 poèmes composés dans le noir (pour jouer avec la lumière) » (2015), ce recueil publié aux Éditions Rhubarbe, joue avec les paradoxes du noir et de la lumière, explorant la manière dont la poésie peut illuminer les instants sombres.
« 13 poèmes composés le matin (pour traverser l’hiver) » chez Rhubarbe, ce recueil dédié à sa mère révèle une approche tendre de la poésie, avec des thèmes universels comme la résilience et l’amour.
Ses recueils expriment un dialogue constant entre les forces opposées, ombre et lumière, douleur et espoir. Sa poésie
interroge le sens de l’existence à travers des images évocatrices.
Dans ses essais, Adeline Baldacchino mêle critique sociale et exploration philosophique. « La Ferme des énarques » (2015, Michalon), inspiré de l’œuvre satirique de George Orwell,
« Notre insatiable désir de magie » (Le Passeur Éditeur), Adeline Baldacchino propose une critique des institutions et de la société contemporaine, tout en appelant à une révolution de la pensée et de l’action, elle remet en question les structures de pouvoir et plaide pour davantage de créativité et d’imaginaire dans la sphère publique, une quête de sens face à un monde souvent dominé par le pragmatisme, en appelant à une réintroduction de la magie et de l’authenticité dans nos vies.
Adeline Baldacchino explore également des vies qui ont marqué l’histoire et la culture, « Le Feu la Flamme » (2013, Michalon), une biographie poétique de Max-Pol Fouchet qui met en lumière son engagement humaniste et sa passion pour l’art et la culture.
« Celui qui disait non » (2018, Fayard), un roman poignant, elle explore le courage individuel à travers l’histoire d’August Landmesser, l’homme qui refusa de faire le salut nazi en 1936. Ce roman, largement salué, a remporté le prix Mottart de l’Académie française, ainsi que le prix Louis-Marin de l’Académie des sciences morales et politiques, met en avant la puissance des convictions personnelles face à la pression collective, elle propose une réflexion sur la mémoire et le devoir de transmission des leçons historiques.
« Fragments inédits, de Diogène de Sinope » (2014, Autrement), est une exploration des pensées cyniques et des transmissions culturelles de Diogène, marquant son intérêt pour la philosophie antique et ses implications modernes.
Adeline Baldacchino a apporté une contribution littéraire riche et multidimensionnelle, mêlant poésie, essais, roman et biographie. Son œuvre, imprégnée de philosophie, de réflexion sociale et d’une sensibilité poétique exceptionnelle, se distingue par son exploration des thèmes universels tels que la lumière et l’obscurité, l’engagement humaniste, la mémoire collective et la quête de sens.
Le Matin d’Algérie : Votre parcours littéraire est très diversifié. Qu’est-ce qui vous a poussé à explorer autant de genres différents, de la poésie aux essais en passant par le roman et la biographie ?
Adeline Baldacchino : La curiosité sans aucun doute, un élan naturel vers des formes de langage complémentaires, chacune attachée à éclairer d’une manière différente notre rapport au monde. La poésie est ma « langue maternelle », celle de l’émotion, de l’exploration sensible du temps qui passe. Les essais correspondent à une « langue construite » par les études, le travail, la réflexion philosophique, une langue qui s’efforce de penser avant de traduire un état du corps.
Le roman est quant à lui la voix de l’empathie universelle, une manière de se mettre à la place des autres et donc aussi de chercher les fondements de la morale, de comprendre ce qui fabrique des valeurs partagées. La biographie enfin est une quête de soi dans le miroir des autres : de ce que l’on n’a pas su ou pas voulu être, de ce que l’on veut ou ne veut pas devenir, de ceux qui, nous ayant précédé, nous promettent que d’autres nous succéderont. Une façon de jouer avec l’immortalité des autres pour supporter notre destin de mortels, tout en réfléchissant à ce que l’on peut faire d’une vie.
Mais j’aime aussi écrire des articles, de longs portraits, répondre par des textes de commande à des questions, bref, utiliser tous les registres pour tourner autour du même « infracassable noyau de nuit » (André Breton) qui nous habite et nous hante, mais nous met en mouvement, aussi, puisque c’est de la lutte contre l’absurde que peut naître le sentiment océanique de la joie.
Le Matin d’Algérie : Dans votre essai « Notre insatiable désir de magie », vous plaidez pour réenchanter le monde politique. Quels sont, selon vous, les premiers pas concrets à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif ?
Adeline Baldacchino : Je n’oppose pas la magie comme utopie au pragmatisme comme visée concrète. Je considère au contraire que l’horizon du pragmatisme le plus concret réside dans l’utopie, c’est-à-dire dans l’imaginaire le plus net possible de ce qui serait désirable pour une société. Il s’agit donc de recréer sans cesse des espaces propices à l’accueil d’une rêverie de l’horizon, puis de construire les ponts, les chemins, les cartes mentales et finalement les programmes qui permettent un jour de rallier cet horizon.
Concrètement : multiplier les espaces de dialogue réel entre chercheurs, artistes, intellectuels et monde politique et administratif, fondés sur une estime et une confiance mutuelle. Il y a des conditions pour que cela ne soit pas un vœu pieux : d’abord modifier de fond en comble les parcours de formation des hauts fonctionnaires et responsables politiques pour y renforcer la place de l’imagination, de la création, de l’humilité, sans lesquelles il n’y a ni innovation, ni solidarité, ni audace. Redonner ses lettres de noblesse au goût de changer le monde, qui n’est pas seulement un mantra, laisser croire et prouver qu’il y a toujours des alternatives : d’autres manières de voir et de faire, ce que j’appelle la bonne magie, qui doit être exotérique, c’est-à-dire transparente et partageable (révélons nos « trucs ») par opposition à une magie noire fondée sur l’ésotérisme (le culte du secret, l’élitisme et la manipulation).
Je veux de la magie pour tous comme je crois à la poésie pour tous. Autre condition des plus concrètes : rouvrir le débat constitutionnel – en révisant complètement notre conception du pouvoir, aujourd’hui beaucoup trop centralisé entre les mains d’un monarque-président alors qu’il devrait être dispersé, neutralisé, réparti par des mécanismes de collégialité et de contre-pouvoirs ; en explorant les vertus du fédéralisme politique, profondément lié à l’histoire de la pensée anarchiste qui me passionne ; et en démultipliant, cela va de pair, les processus d’implication citoyenne dans tous les sujets qui relèvent de notre vie en commun : renforcer les tirages au sort, rendre les mandats électifs non renouvelables, fonder l’essentiel de nos choix sur un principe de subsidiarité (la responsabilité d’une action doit revenir aux personnes concernées par cette action). Il s’agit donc de rendre tout son sens à la démocratie en allant chercher du côté de l’autonomie – c’est tout l’intérêt de la pensée d’un Cornelius Castoriadis qui, aux côtés de Raoul Vaneigem et de David Graeber, constitue ma « sainte trinité » de philosophes politiques trop souvent passés sous le radar…
Le Matin d’Algérie : Vos poèmes comme « 33 poèmes composés dans le noir » mettent souvent en avant les contrastes entre la lumière et l’obscurité. Que représentent ces oppositions dans votre écriture et dans votre vision du monde ?
Adeline Baldacchino : Je n’y avais pas pensé de cette manière mais c’est absolument vrai, et je me demande s’il ne faut pas aller chercher une réponse, plus ou moins inconsciente, du côté de mes origines iraniennes : j’ai beaucoup travaillé en particulier sur le zoroastrisme, qui a précédé les trois grandes religions monothéistes mais qui a surtout inventé d’une certaine manière le dieu unique, Ahura Mazda, tout en l’opposant sans cesse à Ahriman, esprit du mal. Il y a là quelque chose d’un dualisme primitif qui irrigue aussi tout l’imaginaire littéraire, jusque dans la fantasy dont je me nourris (je pense en particulier à Tolkien) et qui reflète au fond cette éternel étonnement devant la possibilité du pire.
La même question revient toujours : comment, dans un monde si beau, sommes-nous collectivement amenés à susciter tant de malheur par nos actions – ou notre inaction ? Pourquoi la guerre, la cruauté, la torture, où pourraient régner la paix, la douceur, la caresse ? Evidemment, il y a une réponse ethno et éthologique – nous sommes des animaux à l’instinct carnassier, dominateur, avide de conquêtes et de territoires nouveaux à piller. Mais on a pourtant appris il y a un moment qu’ « un homme, ça s’empêche » (Camus). Et pourtant, l’on ne sait pas s’empêcher. Et le mystère qui m’obsède encore plus, car il me terrifie, c’est que la culture elle-même n’empêche rien : c’est du cœur des civilisations les plus avancées intellectuellement aussi bien qu’économiquement que resurgit toujours la barbarie. Je ne m’en remets pas.
C’est donc à l’intérieur de la nuit qu’il faut fouiller pour en ressortir avec l’espoir d’une étincelle, et quand brûle une flamme de joie, a contrario, n’oublier jamais qu’elle se consumera. Lumières et obscurité, ferveur et stupeur, espérance et désespoir n’en finissent pas de nous balloter à la manière de ces balanciers à bascule montés sur ressorts. La vie est une aire de jeux, on s’y fait forcément mal un jour ou l’autre ; et pourtant, on en redemande. C’est ce paradoxe qui m’intéresse.
Le Matin d’Algérie : Avec des œuvres comme « Celui qui disait non », vous revisitez l’Histoire à travers des récits individuels. Que vous inspire la mémoire collective dans l’écriture de tels récits ?
Adeline Baldacchino : J’aime redécouvrir l’Histoire à travers des destins individuels qu’on dit à tort « marginaux ». Une de mes plus grandes admirations littéraires concerne le roman de Michel Ragon consacré aux grandes figures de l’anarchisme, La mémoire des vaincus, ou encore, de Gore Vidal, Création, qui raconte l’Antiquité comme nul autre. Les romans historiques me semblent fondamentaux pour la construction d’une mémoire collective, c’est-à-dire aussi d’un avenir commun : ils sont source d’inspiration, manière d’exorciser ou de conjurer le passé en le relisant, le réinterprétant, le rejouant.
Raconter, c’est à la fois recommencer et, par d’infimes variations, réinventer sans cesse. J’aime cette injonction du Montaigne croate, Petar Hektorovic, qui avait fait graver sur les murs de sa maison de Hvar cette devise en fait tirée de l’Ecclésiaste, un livre de la Bible – Memorare novissima. Se souvenir de ce qui viendra. C’est-à-dire se souvenir, pour qu’autre chose (novissima, de l’infiniment nouveau) advienne, et voici la boucle de la magie refermée sur elle-même. Raison pour laquelle, aussi, la naissance en tant qu’évènement me fascine, comme d’ailleurs elle fascinait Hannah Arendt – c’est l’avènement de quelque chose, ou de quelqu’un, qui s’en vient changer totalement la donne, tout en en héritant forcément.
Comment resurgir de nos cendres, se faire phénix, fabriquer du désirable avec, sur nos épaules, tout le fardeau mortel de l’indésirable ? Il me semble que, dans cette histoire comme dans celle d’August Landmesser d’ailleurs, mon homme-qui-disait-non, la réponse est presque toujours la même : l’amour. C’est en son nom qu’on résiste, qu’on survit, qu’on vieillit, qu’on transmet, qu’on demeure. D’un être ou d’une idée, d’un enfant et de la liberté, peu importe au fond. En son nom seulement, on s’aperçoit un jour qu’on n’avait rien compris à la vie tant qu’on la croyait mue par quoi que ce soit d’autre.
Même la vengeance est trop souvent une histoire d’amour – qui a mal tourné, certes. Tant qu’on n’a pas compris cela, même pour le contester ou le récuser, on s’interdit de comprendre comment fonctionne le moteur même de notre existence, cette mécanique du désir et du manque par laquelle nous sommes presque magnétiquement, inéluctablement, mus. Les meilleurs romans mettent à nu les ressorts répétitifs et toujours surprenants de ces trajectoires par lesquelles la vie de l’individu entre en collision, j’allais dire collusion, avec la grande Histoire de de l’humanité.
Le Matin d’Algérie : Votre biographie poétique de Max-Pol Fouchet, « Le Feu la Flamme », est une œuvre empreinte d’admiration et de réflexion. Quels éléments de la vie de Max-Pol Fouchet résonnent particulièrement avec votre propre parcours ?
Adeline Baldacchino : Je ne sais pas si l’on peut dire que nos parcours résonnent, mais ce livre fait clairement partie de ceux que j’ai écrits pour exorciser – plusieurs choses, à vrai dire : la peine d’un amour disparu, la peur de passer à côté d’une œuvre, la crainte d’être dans l’incapacité de concilier le goût de l’action, des êtres et des idées. Max-Pol m’a permis de regarder en face l’abîme, et de danser sur sa margelle. Je l’ai aimé sans le connaître ou en le connaissant mieux que si je l’avais connu véritablement ; j’ai dit à son fantôme qu’il avait eu la vie qu’il rêvait d’avoir alors même qu’il était persuadé de vouloir celle de Camus ; je me suis ainsi expliqué à moi-même qu’il faut construire son destin en embrassant les cahots de l’Histoire plutôt qu’en regrettant toutes les routes que l’on n’a pas su emprunter. C’est le touche-à-tout que rien ne comblait qui m’a touchée et c’est finalement le poète épuré de Demeure le secret qui m’aura sauvée, comme plus tard, à un autre moment de deuil, ce fut la lecture de Christian Bobin qui me rendit goût à la vie.
J’ai confiance dans le pouvoir salvateur des œuvres, et celle de Max-Pol, par sa diversité, son élan d’ogre affamé de poésie, de philosophie, de musique, de peinture, d’archéologie, est exemplaire à cet égard : elle donne envie de (re)vivre pour apprendre. Et puis, ce fut à la fois un créateur et un passeur, témoin, critique, maître ès admiration, et cela m’importe aussi, de vivre littérairement selon ces deux registres, celui de la création d’une œuvre propre et celui du partage passionné des œuvres que l’on aime.
Le Matin d’Algérie : Vous parlez souvent d’imaginaire, de poésie et de lumière comme moteurs essentiels pour mieux comprendre et changer le monde. Comment voyez-vous l’avenir de la littérature dans ce rôle de transformation ?
Adeline Baldacchino : Il est probable que je surestime ce rôle, par un biais que je ne saurais ignorer : la littérature ayant sauvé mon monde, j’ai tendance à penser qu’elle peut sauver le monde, « si rien ne le sauve » comme dit le poète Jean-Pierre Siméon. Toutefois, dans mes moments de lucidité forcée, je suis moins optimiste et je vois venir l’effacement de l’objet livre, futur délire de collectionneur bibliophile ; voire du contenu des livres qui sera profondément transformé par l’apparition de l’IA, capable d’en générer, peut-être de très bons, des centaines par minute. Or, que sera une littérature sans rareté, sans singularité, sans surgissement stellaire, improbable et par là-même miraculeux ? Comment définir le génie s’il sort d’une machine ? Et où placer la ligne de démarcation entre ce qui vaut et ne vaut pas d’être lu, relu, médité ? Je suis d’autant plus curieuse de savoir ce que deviendra la littérature que je suis plutôt technophile, et enthousiaste devant les possibilités nouvelles, apparemment infinies, que nous offre l’IA ; mais j’avance totalement à l’aveugle sur ce terrain pour l’instant, sans aucune certitude préconçue sur le sujet.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Adeline Baldacchino : J’en ai toujours tant que le vrai problème est celui de la priorité à accorder à l’un ou l’autre. Disons qu’en ce moment, je travaille vraiment sur deux grands projets romanesques (une trilogie de fantasy et un roman sur le croisement des trajectoires individuelles, de la mythologie iranienne et de la grande Histoire), deux recueils de poésie, un essai plus politique. Il faut ajouter à cela une liste sans cesse croissante d’idées, de destins à raconter, de formes à explorer. Et la somme que j’aimerais un jour finaliser, un livre autour des rapports entre poésie et politique. Si, de cet inventaire, je tire quelques vrais beaux livres, je serai déjà heureuse d’avoir accompli ce chemin. Mon angoisse est d’avoir bien plus de désirs d’écriture que de temps pour les réaliser, comme d’autres ont l’angoisse des piles à lire. Moi, c’est la hauteur de l’invisible pile à écrire qui me taraude la nuit !
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Adeline Baldacchino : Je préfère penser que les derniers mots d’un soir sont les premiers d’un autre matin.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Mercredi 30 avril 2025
lematindalgerie.com
……………………………………………………………………………..

Cécile Palusinski : « La nature nous enseigne la lenteur »
Cécile Palusinski, auteure, éditrice et présidente de l’association La Plume de paon, se consacre à la promotion du livre audio et de nouvelles formes de narration, elle est reconnue pour son influence dans les domaines de la littérature et de projets artistiques novateurs.
Parmi ses publications marquantes figure Pages d’arbres, un recueil de poésies illustrées publié en 2021 par le Centre de créations pour l’enfance, où elle célèbre avec une grande sensibilité la force et la symbolique des arbres.
Cécile Palusinski est l’initiatrice de projets transmédia tels que Arbres Mondes et Nord Sud.
Ces projets repoussent les limites du récit classique en introduisant de nouvelles dimensions interactives et immersives.
Son dernier ouvrage, Socotra : Des dragonniers et des hommes, publié le 16 novembre 2023 par Melrakki, explore avec Benoît Palusinski la majesté des dragonniers de l’île de Socotra. À travers des textes poétiques traduits en trois langues (français, arabe, anglais) et des photographies en noir et blanc saisissantes, ce livre allie réflexion culturelle et préservation écologique. Préfacé par Michel et Vincent Munier, figures emblématiques de la photographie, il constitue un hommage vibrant à l’histoire et à la nature.
En combinant art et technologie, Cécile Palusinski s’affirme comme une artiste multidimensionnelle. Avec Pages d’arbres, elle propose une immersion visuelle et poétique. Avec Socotra, elle sensibilise à la richesse du patrimoine naturel et culturel. Enfin, grâce à ses projets transmédia, elle repousse les frontières de la littérature traditionnelle, offrant des expériences où l’interactivité et la modernité se rejoignent.
En outre, son rôle de présidente de La Plume de Paon illustre son engagement en faveur d’une littérature accessible à tous. En mettant en lumière le potentiel du livre audio, elle contribue à ouvrir la littérature à des publics diversifiés, comme les malvoyants ou ceux souffrant de troubles de lecture. Cet engagement inclusif reflète sa volonté de démocratiser l’art et la culture.
L’œuvre et les projets de Cécile Palusinski, en constante évolution, incarnent une synthèse entre tradition et modernité. À travers des créations variées, elle célèbre la poésie, l’écologie et l’innovation, tout en sensibilisant ses lecteurs et spectateurs à la richesse des récits enracinés dans la mémoire humaine et la nature. En mêlant mots, images et sons, elle propose une vision artistique qui embrasse à la fois l’émotion, la technologie et la transmission culturelle.
Cécile Palusinski donne une nouvelle dimension à la littérature contemporaine, en l’enrichissant. Sa contribution transcende les formats traditionnels et les frontières culturelles, et elle inspire de nouvelles manières de penser et de partager les récits. Ses travaux, aussi bien littéraires que technologiques, laissent une empreinte durable dans le monde de la création.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes à la croisée de la poésie, de la technologie et de l’engagement écologique. Comment ces dimensions s’entrelacent-elles dans votre processus créatif ?
Cécile Palusinski : La nature nous enseigne la lenteur, elle nous invite à prendre le temps d’exister pleinement dans un monde qui semble parfois nous échapper, avec la sensation d’accélération du temps induite par les usages numériques. Mon processus créatif est profondément marqué par la rencontre entre ces deux temporalités qui semblent a priori opposées : le temps long de la nature, celui de la contemplation, de l’observation silencieuse et patiente des cycles naturels, et le temps accéléré des technologies. En tant que poète, je m’efforce, dans mes œuvres, d’explorer cette tension. Dans mon projet Arbres-Mondes, par exemple, créé en collaboration avec l’artiste Elsa Mroziewicz, le temps de l’interaction numérique permet une immersion presque instantanée dans la nature, tout en donnant à entendre des contenus sonores et musicaux qui requièrent une écoute longue et attentive. Ce contraste me fascine : comment faire en sorte que la technologie enrichisse notre perception du temps long de l’expérience contemplative qu’offre la nature ?
Le Matin d’Algérie : Votre dernier ouvrage, Socotra : Des dragonniers et des hommes, mêle texte poétique et photographie. Comment s’est déroulée cette collaboration avec Benoît Palusinski et pourquoi avoir choisi cette île méconnue comme sujet ?
Cécile Palusinski : Il y a 15 ans, une amie, Elsa, m’a envoyé la photographie d’un arbre, le dragonnier de Socotra, une merveille de la nature à la résine rouge connue sous le nom de « sang de dragon ». Avec la guerre au Yémen et la suspension des vols pour Socotra, il aura fallu que j’attende 10 ans pour pouvoir aller à la rencontre de cet arbre et de cet archipel exceptionnel, patrimoine naturel mondial de l’UNESCO. Une île où la poésie est omniprésente au quotidien : sur les moins de 100 000 habitants, bédouins et pêcheurs, qui peuplent l’île, il y a une association de plus de 100 poètes qui organise chaque année un festival sur ce petit morceau de terre qui semble se tenir à l’écart du tumulte du monde !
Quand ce projet de livre est né, après plusieurs voyages à Socotra, j’ai tout de suite pensé à mon frère photographe Benoît Palusinski qui porte un regard sensible et poétique sur la nature et dont je savais qu’il saurait, mieux que quiconque, saisir l’âme de Socotra. Nous avons exploré ensemble l’île, fascinés par ses paysages lunaires et ses arbres emblématiques, et les photographies en noir et blanc et la poésie se sont imposées pour capturer l’essence de cette île mystique, aux paysages irréels… Et je suis très reconnaissante d’avoir pu vivre cette aventure photographique et poétique avec mon frère, comme un retour à l’Essentiel…
Le Matin d’Algérie : Vous explorez des formats immersifs à travers des projets comme La forêt universelle ou Arbres Mondes. Qu’est-ce que ces narrations hybrides apportent de nouveau à l’expérience littéraire ?
Cécile Palusinski : Ces projets hybrides offrent une expérience sensorielle enrichie, où le texte, le son et l’image se rencontrent pour créer une immersion totale. Arbres-Mondes, par exemple, est un livre numérique interactif qui intègre des haïkus sonores, des illustrations animées et un arbre pop-up géant en réalité augmentée, invitant le spectateur à une exploration poétique et interactive de la nature. Ces formats permettent aussi de toucher un public plus large, notamment les jeunes générations, adeptes des nouvelles technologies, en rendant la littérature plus accessible.
J’aime aussi beaucoup cette idée de pouvoir faire dialoguer les différents champs de la création et de pouvoir penser des expériences de lecture non linéaires, où le lecteur vagabonde au cœur de l’œuvre et choisit son propre chemin… Cela résonne sûrement avec ce qui, pour moi, est fondamental : la liberté…
Le Matin d’Algérie : En tant que présidente de La Plume de Paon, vous militez pour le livre audio. Selon vous, en quoi ce format transforme-t-il notre rapport à la lecture et à la littérature ?
Cécile Palusinski : Le livre audio ravive la tradition ancienne de la narration orale, où les histoires étaient transmises de bouche à oreille. Cela nous ramène à une époque où l’acte de raconter était un art. Le narrateur devient un interprète du texte, un médiateur qui donne vie aux mots, transformant la lecture en une performance qui lie l’auditeur à l’histoire d’une manière singulière, à travers la voix d’un tiers. La lecture devient un acte d’écoute, un engagement différent avec le texte qui sollicite l’imagination autrement. Un bon lecteur peut amplifier l’impact émotionnel du texte, avec des variations de voix, de rythme, et de style. Cette dimension peut rendre le texte plus vivant, renforcer l’attachement émotionnel au récit. L’écoute d’un livre audio nécessite aussi un temps d’attention long et continu. Elle invite à ralentir, à prendre le temps de savourer chaque passage. Une invitation à renouer avec le temps long de la slow littérature…
Le Matin d’Algérie : Vous avez publié aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse. Qu’est-ce qui vous attire dans ces différents registres et comment abordez-vous l’écriture selon le public ?
Cécile Palusinski : Bien que j’écrive aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse, je n’aborde pas fondamentalement l’écriture de manière différente. Pour moi, il ne s’agit pas de simplifier le propos ou même le vocabulaire selon l’âge, mais plutôt de rendre l’histoire vivante et porteuse de sens. Je pense que les enfants comprennent beaucoup plus que ce que l’on imagine souvent, qu’ils sont capables de saisir les nuances et de comprendre des messages complexes.
J’aime l’idée que les livres se « livrent » peu à peu avec l’âge. Ce que l’on perçoit d’un livre à un moment donné, à un certain âge, n’est pas nécessairement ce que l’on en percevra des années plus tard. Un livre pour enfants peut offrir plusieurs niveaux de lecture et, à chaque étape de la vie, de nouvelles couches de compréhension et de réflexion. C’est ce rapport évolutif au texte que je trouve intéressant…
Le Matin d’Algérie : Quels sont les territoires artistiques ou thématiques que vous aimeriez encore explorer dans vos prochaines créations ?
Cécile Palusinski : Actuellement, je travaille sur une fresque sonore monumentale Villes flottantes, co-réalisée avec Elsa Mroziewicz, qui propose une vision poétique de villes flottantes imaginaires, tout en découvrant des solutions pour faire face aux enjeux climatiques. Ce projet s’inscrit dans la continuité de mes précédents projets qui questionnent le rapport que nous entretenons avec notre environnement. Par ailleurs, nous travaillons aussi avec Elsa Mroziewicz à un projet autour des oiseaux, où nous créerons une fresque brodée sonore en réalité augmentée. Ce projet permettra de tisser des liens entre des techniques artisanales traditionnelles, qui s’inscrivent une fois encore dans un temps long, et les technologies numériques.
Dans un futur proche, j’aimerais aussi explorer davantage la captation sonore des « voix de la nature ». Mon objectif est d’enrichir les poésies sonores avec ces sons enregistrés dans des environnements naturels pour offrir une expérience plus immersive encore. J’ai eu la chance de suivre une formation avec Marc Namblard, un expert dans ce domaine, et cela a renforcé mon désir de continuer à explorer cette dimension dans mes prochains projets.
Le Matin d’Algérie : un dernier mot peut-être ?
Cécile Palusinski : Prenons le temps…
Entretien réalisé par Brahim Saci
lematindalgerie.com
Lundi 28 avril 2025
………………………………………………

Hamsi Boubeker : « L’âme kabyle parle à l’âme humaine, sans frontières»
Hamsi Boubeker est un artiste pluridisciplinaire d’origine kabyle, né à Bejaïa, en Algérie. Installé en Belgique depuis 1979, peintre, musicien, conteur et écrivain, il s’impose comme une figure artistique internationale, tout en restant profondément enraciné dans la culture berbère. Son œuvre rend hommage à ses origines kabyles et cherche à faire vivre et rayonner un patrimoine ancestral à travers une démarche contemporaine.
Hamsi Boubeker développe une approche artistique riche, sa peinture, souvent inspirée des motifs traditionnels kabyles que l’on retrouve dans les tapis, poteries, transforme ces symboles en langages visuels modernes. À travers ses œuvres, il célèbre la vie quotidienne en Kabylie, les paysages de son enfance, les gestes du quotidien, tout en mettant en valeur le rôle central des femmes dans la transmission culturelle.
Hamsi Boubeker qualifie son style d’« art de l’émerveillement ». Il ne s’agit pas simplement de représenter, mais de transmettre une émotion, une vision poétique. Ses œuvres ont été présentées dans des institutions prestigieuses comme l’Institut du Monde Arabe à Paris ou le Parlement Européen de Strasbourg. Il fait découvrir au monde la richesse de la culture kabyle, tout en agissant comme un passeur de mémoire, d’un patrimoine souvent méconnu.
Hamsi Boubeker est un homme engagé, il participe à des projets humanitaires, notamment avec l’UNICEF, il considère l’art comme un outil pour rassembler, pour éduquer, pour semer des graines d’humanité.
En valorisant les savoirs artisanaux et les symboles hérités des femmes kabyles, il rappelle l’importance de la mémoire collective et des traditions vivantes. Son travail contribue à renforcer les liens entre les générations et à faire dialoguer les cultures dans un monde en constante mutation.
Reconnu pour son apport culturel et artistique, il est fait Officier de l’Ordre de la Couronne en Belgique en 2009. Cette distinction salue non seulement son talent, mais aussi son engagement en faveur du dialogue interculturel, de la paix et de la transmission.
Le 31 mai 2023, Hamsi Boubeker a offert au pape François une œuvre intitulée « La Paix fraternelle », réalisée à partir de l’empreinte de la main du pape, un geste inédit. Cette œuvre, symbolisant la paix, le dialogue et l’unité des peuples, montre une main libérant une colombe portant un rameau d’olivier. Elle s’inscrit dans le projet « Les Mains de l’Espoir », qui rassemble des empreintes de personnalités engagées pour la paix.
Hamsi Boubeker n’est pas simplement un artiste. Il est un bâtisseur de ponts entre passé et présent, entre l’intime et l’universel. Son œuvre, accessible et profondément ancrée, nous invite à l’émerveillement, à la découverte et à la réflexion.
Artiste complet, Hamsi Boubeker navigue donc entre peinture, musique, conte et engagement humaniste. Son œuvre, à la fois profondément ancrée dans la culture kabyle et ouverte sur le monde, touche par sa richesse symbolique et son message universel de paix.
Cette interview explore les racines de son inspiration, la portée de son art, ainsi que son rôle de passeur entre les cultures et les générations.
Le Matin d’Algérie : Votre œuvre est profondément enracinée dans la culture kabyle, comment réussissez-vous à la faire dialoguer avec des publics internationaux ?
Hamsi Boubeker : Mon œuvre est un pont. Elle puise son énergie dans la culture kabyle, avec sa richesse, sa symbolique et son humanité, mais elle parle une langue universelle : celle de la couleur, de la lumière et des émotions. Lorsque je crée, je ne cherche pas à “traduire” ma culture, je l’offre telle qu’elle est, avec authenticité et générosité. C’est ce respect pour mes racines, combiné à une vision profondément humaniste, qui touche les publics d’ailleurs. L’âme kabyle parle à l’âme humaine, sans frontières.
Le Matin d’Algérie : Vous parlez souvent de « l’art de l’émerveillement », que signifie pour vous cette expression ?
Hamsi Boubeker : L’art de l’émerveillement, c’est garder vivant ce regard d’enfant capable de s’étonner devant la beauté du monde, même dans les choses les plus simples. C’est une manière de résister à la dureté de la vie en cultivant l’espoir, la poésie et la lumière intérieure. À travers mes œuvres, je cherche à éveiller ce souffle d’émerveillement en chacun, car il est pour moi le premier pas vers la paix, le respect et la fraternité entre les êtres.
Le Matin d’Algérie : Qu’avez-vous ressenti en offrant votre œuvre « La Paix fraternelle » au pape François ?
Hamsi Boubeker : Ce fut un moment de profonde émotion. Le rencontrer au Vatican pour lui offrir l’œuvre que j’ai réalisée à partir du calque de sa main, La Paix Fraternelle, c’était déposer entre ses mains un message de paix et de fraternité entre les peuples. J’ai ressenti une grande humilité, mais aussi une immense joie, car à travers cet acte symbolique, je portais la voix de tous ceux qui croient que l’art peut être un chemin de dialogue et de paix. Cette rencontre restera pour moi l’un des moments les plus lumineux de mon parcours.
Paix à son âme, il restera pour l’humanité entière un homme de bonté, de dialogue et d’espérance.
Le Matin d’Algérie : Comment votre parcours personnel entre l’Algérie et la Belgique influence-t-il votre création ?
Hamsi Boubeker : Mon parcours entre l’Algérie et la Belgique est comme un tissage entre deux rives. L’Algérie est ma source : elle nourrit mon imaginaire avec ses couleurs, ses traditions, sa terre. La Belgique, elle, m’a offert l’espace pour faire éclore cette richesse intérieure et la partager avec d’autres cultures. Ce double enracinement m’a appris à être un passeur, à rester fidèle à mon identité tout en l’ouvrant au monde. Chaque œuvre que je crée porte en elle cette traversée : un hommage aux racines et une invitation au voyage.
Le Matin d’Algérie : Vous travaillez souvent avec des enfants et des jeunes, pourquoi cet engagement vous tient-il tant à cœur ?
Hamsi Boubeker : Travailler avec les enfants et les jeunes, c’est semer des graines d’espérance. Ils portent en eux une pureté, une capacité d’émerveillement et de création que le monde adulte oublie parfois. Leur transmettre l’amour de l’art, c’est leur donner une clé pour rêver, pour s’exprimer, pour construire un monde plus beau. C’est aussi un devoir de mémoire : à travers eux, les cultures, les valeurs de paix, de respect et de fraternité peuvent continuer à vivre et à grandir. C’est un engagement qui donne du sens à toute ma démarche.
Le Matin d’Algérie : Quels messages espérez-vous que votre art transmette aux générations futures ?
Hamsi Boubeker : À travers mon art, j’espère transmettre aux générations futures un message de lumière, de dignité et d’ouverture. Leur dire que nos racines sont des forces, que la beauté est un langage universel, et que le respect de l’autre est la clé de la paix. J’aimerais qu’ils retiennent que l’émerveillement, la tendresse et la création sont des chemins possibles pour rester debout dans un monde souvent tourmenté. Mon vœu est que mon art continue à semer de la joie, de l’espoir et du lien entre les êtres.
Le Matin d’Algérie : La musique et le chant occupent aussi une place importante dans votre parcours : en quoi complètent-ils ou prolongent-ils votre travail de peintre ?
Hamsi Boubeker : Pour moi, la peinture, la musique et le chant sont les battements d’un même cœur. Ils naissent tous du même besoin de transmettre des émotions, de relier les êtres humains à travers la beauté et l’harmonie. La musique et le chant prolongent mes couleurs sur un autre plan : ils rendent audible ce que mes peintures racontent en silence. Ils permettent d’atteindre l’âme autrement, avec d’autres vibrations, d’autres lumières. Ensemble, ils tissent une seule et même quête : celle de l’émerveillement, de la mémoire et de la fraternité.
Le Matin d’Algérie : Pensez-vous que des artistes comme vous, ayant trouvé une reconnaissance à l’étranger, peuvent jouer un rôle dans l’émancipation de la société algérienne ?
Hamsi Boubeker : Je le crois profondément. Chaque artiste qui porte haut sa culture au-delà des frontières devient un témoin vivant de sa richesse et de sa vitalité. Cette reconnaissance ne doit pas être une fin en soi, mais un levier pour inspirer, pour ouvrir des chemins, pour montrer que l’émancipation passe par la création, par la transmission de la beauté et de la dignité. Si mon parcours peut donner envie à d’autres de croire en leurs rêves, de se battre pour l’art, la liberté et la lumière, alors j’aurai humblement contribué à faire avancer notre société.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Hamsi Boubeker : Oui, l’aventure continue ! Je travaille actuellement sur plusieurs projets qui me tiennent à cœur. À très court terme, une exposition intitulée Contes de mon enfance, en collaboration avec Chafiaa Khemsi, se tiendra du 5 au 25 mai 2025 au Bip Josse à Bruxelles, et réunira mes œuvres inspirées de l’univers des contes. Ensuite, je prépare une grande exposition rétrospective de l’ensemble de mon parcours artistique, qui sera présentée dans un lieu prestigieux, le B3 de la ville de Liège, de juin à septembre 2025.
Mais le projet le plus fascinant est celui de la nouvelle illustration de la future station de tram Lemonnier à Bruxelles : une station dédiée à la paix et unique au monde. Les œuvres qui orneront les murs de la station ont été réalisées à partir de calques de mains et de messages de paix de célébrités mondiales, ainsi que de personnalités du monde artistique, humanitaire, sportif, spirituel, sans oublier des anonymes qui ont œuvré pour les droits humains. Khaled Ben Tounes et Hassiba Boulmerka font partie de ces personnalités que j’ai choisies.
La réalisation de ce grand chantier est en cours.
En parallèle, je poursuis la création de livres d’art, de projets destinés aux enfants, et de nouvelles œuvres.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Hamsi Boubeker : Mon dernier mot sera un mot de cœur : gardons vivante la flamme de l’émerveillement, restons fidèles à nos racines tout en tendant la main au monde. L’art, la culture et la fraternité sont des chemins puissants pour construire un avenir plus lumineux. À travers chaque geste de création, nous pouvons semer des graines d’espoir.
Je souhaite aussi que la télévision algérienne soit plus présente à l’étranger pour mieux faire connaître ses artistes, non seulement auprès des Algériens établis ailleurs, mais aussi auprès de ceux qui vivent en Algérie, afin de renforcer ce lien vital entre la culture d’origine et son rayonnement dans le monde.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Dimanche 27 avril 2025
lematindalgerie.com
…………………………………………………….
Chevallier et Laspalès : une séparation qui laisse le public dans l’incompréhension
.png)
Philippe Chevallier est un humoriste, acteur et photographe français, né à Redon, en Ille-et-Vilaine. Sa carrière a été marquée par son duo comique avec Régis Laspalès, formé en 1981. Ensemble, ils ont conquis le public avec des sketches mémorables tels que Le train pour Pau et des spectacles comme C’est vous qui voyez ! Leur style humoristique, sur des caricatures du quotidien, a fait d’eux des figures incontournables de la scène française.
Cependant, après 33 ans de collaboration, le duo s’est séparé en 2016. Cette décision a surpris leurs fans. Selon Philippe Chevallier, Régis Laspalès souhaitait se consacrer au cinéma en solo, ce qui a marqué la fin de leur partenariat. Chevallier a exprimé une certaine tristesse face à cette séparation, mais il a également vu cela comme une opportunité de renouer avec ses aspirations personnelles.
Depuis, Philippe Chevallier a poursuivi sa carrière en solo, explorant de nouveaux horizons artistiques. Son dernier spectacle, Mozart au Paradis, est une œuvre originale mêlant musique et théâtre. Dans ce concert-lecture, il incarne un personnage désabusé qui découvre la joie et la lumière à travers la musique de Mozart. Accompagné par des musiciens talentueux, il interprète des œuvres emblématiques du compositeur, telles que, Une petite musique de nuit et La Marche Turque.
Son nouveau spectacle Mozart au Paradis, est une célébration de la beauté et de la grandeur de Mozart, offrant au public une expérience à la fois poétique et musicale.
Ce spectacle explore plusieurs thèmes principaux, inspiré par les écrits de Fabrice Hadjadj, mêlant musique, philosophie et spiritualité, le spectacle met en lumière une joie profonde et bouleversante, souvent associée à la musique de Mozart. Une joie décrite comme une préfiguration de la félicité céleste, la beauté et la grâce, à travers les œuvres emblématiques de Mozart, telles que, Une petite musique de nuit ou La Marche Turque, le spectacle célèbre la beauté intemporelle de sa musique, perçue comme un écho de la création divine.
Ce spectacle explore également les thèmes de la spiritualité et le salut, en établissant un lien entre la musique de Mozart et une quête spirituelle, suggérant que ses compositions incarnent une forme de grâce divine et une ouverture vers le paradis.
Philippe Chevallier, avec son talent d’humoriste, apporte une légèreté et une espièglerie qui rendent ces thèmes profonds accessibles à tous, brisant les barrières souvent associées à la musique classique.
En incarnant un personnage désabusé qui redécouvre la joie à travers Mozart, le spectacle invite à réfléchir sur la capacité de l’art à transformer et à élever l’âme humaine.
Un mélange unique de musique, de poésie et de philosophie qui fait de Mozart au Paradis une expérience à la fois intellectuelle et émotionnelle, célébrant la puissance de l’art pour toucher les cœurs et les esprits.
Le public a particulièrement apprécié la manière dont Philippe Chevallier a réussi à rendre accessible la musique classique de Mozart grâce à son approche humoristique et poétique. L’équilibre entre la profondeur des thèmes abordés, tels que la joie transcendante et la spiritualité, et la légèreté de son interprétation a été salué. Ce spectacle a attiré à la fois les amateurs de musique classique et ceux qui aiment l’humour, créant une expérience artistique unique et fédératrice.
Les critiques ont également noté la qualité de l’accompagnement musical. Les musiciens qui partagent la scène avec Chevallier ont su magnifier les œuvres de Mozart, leur donnant une intensité émotionnelle particulière. Le mélange entre textes philosophiques et musique classique a été perçu comme une célébration de la beauté et de l’art sous toutes ses formes.
Enfin, le spectacle a été reconnu pour son originalité et son caractère inspirant, permettant aux spectateurs de réfléchir sur le rôle de l’art dans la transformation intérieure et la recherche de sens.
Dans Mozart au Paradis, Philippe Chevallier est accompagné par les musiciens de l’Ensemble Bagatelle. Parmi eux, on retrouve Vincent Laissy au piano, qui est également le créateur du spectacle et responsable des arrangements musicaux. Il est rejoint par Lucile Dugué au violon et Aurore Alix au violoncelle.
Vincent Laissy, lauréat du Conservatoire de Paris, est un artiste accompli. En plus de son rôle dans Mozart au Paradis, il a composé des œuvres telles que Salve Regina et dirigé des productions musicales prestigieuses, notamment au Théâtre Traversière à Paris.
Philippe Chevallier continue de démontrer sa polyvalence et son amour pour l’art, que ce soit à travers l’humour, le théâtre ou la musique.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes photographe, humoriste, comédien, qui est Philippe Chevalier ?
Philippe Chevallier : Si je savais vraiment qui je suis je serais le premier à en être informé en principe ! « Connais-toi toi-même » disait Socrate. J’avoue que je suis toujours en quête, l’écrivain franco-américain Julien Green disait : « Les grands événements sont intérieurs. » En réalité les événements nous portent sans que l’on ait vraiment son mot à dire et l’on essaie simplement d’agir personnellement en vue de notre bien-être ou tout au moins pour apaiser notre difficulté d’être.
Plus précisément, le rôle de l’humoriste et du comédien n’est pas éloigné de celui du photographe : le sens de l’observation au service de celui ou de ceux qui à leur tour nous observent afin de rentrer en relation, tout simplement.
Le Matin d’Algérie : Comment décririez-vous votre rencontre avec Régis Laspalès et la naissance de votre duo ?
Philippe Chevallier : Une rencontre au cours de théâtre, le cours Simon a suffi pour sceller d’abord une amitié et ensuite une envie d’écrire et de jouer ensemble : il y a chez nous une « complémentarité » qui était comme une évidence ! Nous avions ce que j’appelle un fond commun de placement : une éducation qui nous rapprochait dans notre attachement réciproque à ce que j’appellerais la pesanteur familiale.
Des parents très ouverts d’esprit mais attachés à certaines traditions qui pouvaient l’un et l’autre nous inhiber mais qui nous poussaient à en rire. Un exemple, la grand-mère de Regis lui tricotait des pulls qu’il n’osait pas porter en allant au lycée, idem pour moi avec ma chère mère. Nous étions les seuls adolescents au lycée, lui à Paris et moi à Nantes à porter des vêtements qui ne nous plaisaient pas forcément mais que l’on mettait quand même pour faire plaisir à grand-mère et à maman.
Croyez-moi, quand on se rencontre 10 ans après sur les bancs d’un cours de théâtre, ça crée des liens. Ensuite la complémentarité, un introverti et un extraverti, un taiseux et un bavard, on a joué pendant 35 ans le mythique duo de l’Auguste et du clown blanc.
Le Matin d’Algérie : Quel est le sketch ou spectacle qui vous tient le plus à cœur dans votre carrière avec Régis Laspalès ?
Philippe Chevallier : J’aime tous les sketches que nous avons écrits et joués ensemble, le plus populaire est sans doute celui du train pour Pau, mais il y a aussi celui du week-end chez les amis ou des patelins. Notre passage chez Philippe Bouvard, après avoir écrit un premier spectacle intitulé, Pas de fantaisie dans l’orangeade, nous a appris que lorsqu’on veut glisser sur le terrain de l’absurde il faut partir de la réalité afin de se faire comprendre. C’est seulement après que l’on peut amener le public où on veut.
Le Matin d’Algérie : Quels défis avez-vous rencontrés en tant que duo humoristique et comment les avez-vous surmontés ?
Philippe Chevallier : Le « défi » comme vous dites est permanent , il ne vient pas de l’extérieur, de telle ou telle circonstance mais plutôt de l’intérieur, j’en reviens à la phrase de Julien Green, il s’agit pour l’artiste qui écrit de travailler comme un artisan et de créer des choses qui lui plaisent avec l’espoir que cela plaira aussi au plus grand nombre. Mais l’on est soi-même son baromètre. Il y a le travail et aussi un état de grâce qui fait que, malgré vous, vous plaisez au public, c’est là qu’il faut être fidèle à soi-même et à ceux qui vous regardent.
Le Matin d’Algérie : Pourquoi avez-vous décidé de vous séparer en 2016, et comment cette décision a-t-elle impacté votre carrière ?
Philippe Chevallier : Notre séparation a malheureusement été unilatérale, elle est le fait de Regis et c’est un choix qu’il assume tout seul. Je le regrette profondément mais je n’y puis rien.
La raison profonde de cette décision, je ne la connais ni ne la comprends, Regis était désireux de faire du cinéma et c’est vrai que nous en avons fait assez peu, or il attribuait cette déficience de notoriété quant à l’image au fait que l’on nous associait en permanence, ce qui d’après lui était un handicap auprès des réalisateurs et producteurs, résultat, on est obligés de faire du théâtre chacun de notre côté, c’est une hypothèque sur notre popularité !
À chaque fois que je monte dans un taxi, le chauffeur, souvent algérien, marocain ou tunisien me dit à quel point nous sommes appréciés dans les pays du Maghreb et combien le public regrette de ne plus nous voir. Cela me touche beaucoup : nous sommes Régis et moi très « français » et de ce fait avons vocation à une sorte d’universalité ! Je dis ça évidemment en toute modestie et comme disent les juristes « toutes choses égales par ailleurs ! » L’universalisme de la rigolade, c’est extrêmement flatteur et c’est un immense compliment.
La décision de mon partenaire de casser le duo au prétexte qu’il ne trouvait pas complètement dans notre carrière la satisfaction désirée me fait penser à un nageur qui partirait du Havre pour aller à New York à la nage, arrivé épuisé devant la statue de la Liberté il se dit, c’est vraiment épuisant cette traversée, je retourne au Havre, quel gâchis !
Le Matin d’Algérie : En dehors de l’humour, vous êtes également photographe. Comment cette passion influence-t-elle votre créativité ?
Philippe Chevallier : La photographie a été pour moi une bulle d’air, un espace d’aération artistique qui me permettait de concrétiser, de rendre tangible un univers intérieur fantasmatique. Cette image de la femme que j’avais en tête devenait une réalité accessible à mon propre regard et à celui des autres. C’est là que je vois une différence essentielle entre la peinture et la photographie, la peinture est la translation de l’extérieur vers l’intérieur, c’est à dire la vision personnelle de l’artiste alors que la photo est une objectivisation de son univers intérieur, le parcours est inversé en quelque sorte.
Quant au mélange des genres il est difficile à pratiquer en France, contrairement aux pays anglo-saxons. En outre j’ai toujours pensé que l’érotisme et l’humour ne font pas toujours bon ménage ! Je serais donc un artiste bicéphale.
Le Matin d’Algérie : Mozart au paradis est votre nouveau spectacle, c’est un succès, Comment est né ce spectacle ?
Philippe Chevallier : Le spectacle Mozart au Paradis est une idée du pianiste Vincent Laissy. Quand il m’a sollicité pour illustrer le récital de son trio Bagatelle sur Mozart avec des textes du philosophe Fabrice Hadjadj, j’ai dit oui tout de suite. Je ne connaissais pas Fabrice Hadjadj mais le concept du spectacle m’a tout de suite emballé. Après avoir lu le texte, mon enthousiasme a redoublé.
Le texte est très beau et surtout surprenant par son écriture syncopée qui, à mes yeux, va à l’encontre de l’harmonie mozartienne telle qu’on peut communément l’entendre. Normal, puisque le philosophe nous explique sa « conversion » au grand compositeur qu’il considérait comme le fabricant d’une musique chichiteuse et gentillette, superficielle et artificielle avant d’en prendre la mesure profonde, mystique, religieuse et métaphysique.
C’est un bonheur de travailler avec des musiciens, ils sont tous les trois aussi légers et profonds que le grand Mozart dont la musique a bercé mon enfance puisque mes parents écoutaient beaucoup de musique dite classique.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur votre collaboration avec Vincent Laissy et l’Ensemble Bagatelle ?
Philippe Chevallier : Notre entente est cordiale, c’est une ambiance de gaieté qui nous réunit, à laquelle se mêle une volonté affirmée de travail et de sérieux. J’ai l’habitude de travailler avec des comédiens, ces derniers sont souvent dilettantes et se prennent au sérieux, « Mes » musiciens » travaillent énormément et ont un esprit aérien !
Le Matin d’Algérie : Parlez-nous de la rencontre avec Fabrice Hadjadj ?
Philippe Chevallier : J’ai vu Fabrice trois fois, beaucoup de mes amis qui s’intéressent à la philosophie le connaissent ainsi que les catholiques pratiquants. Les échos à son sujet sont toujours élogieux et admiratifs, j’étais donc très impressionné la première fois que je l’ai rencontré et j’ai vu un homme d’une simplicité désarmante et d’une grande gentillesse, éloigné de toute pédanterie et sophistication démonstrative.
J’ai aussi eu l’occasion de rencontrer Fabrice avec une partie de sa famille, sa fille aînée et quatre autres enfants sur les dix qu’il a eus. Après j’ai rencontré son épouse lors d’un concert à Paris, ce qui frappe quand on le voit avec les siens, c’est ce sens de la famille, cette attention portée à chaque instant à tous les membres de la fratrie qui ne l’empêche pas de continuer à vivre sa vie d’intellectuel, de discuter en évoquant des problématiques théoriques tout en demandant à l’une de ses filles de donner le biberon au plus jeune. Il y a chez lui une osmose totale entre le pragmatisme des tâches liées à son devoir de père et la continuation de sa pensée philosophique. Ce qui, somme toute est très normal pour lui puisque ce catholique convaincu met en pratique quotidiennement sa foi religieuse en faisant de la famille un repère et un axe de pensée.
Le Matin d’Algérie : Quels sont vos projets actuels et futurs dans le domaine artistique ?
Philippe Chevallier : Je termine en ce moment une tournée dans toute la France avec Bernard Mabille pour une pièce de théâtre intitulée Le cake aux olives, et j’ai un projet en cours avec trois autres comédiens, L’Apollon de Bellac de Jean Giraudoux que nous allons présenter au festival d’été Les Bourbons qui a lieu chaque année dans l’Allier.
Et bien sûr Mozart au Paradis pendant tout le Festival off d’Avignon du 5 au 26 juillet. Il se pourrait aussi que cet automne nous puissions donner notre spectacle à Paris, mais pour l’instant, chut, on ne dit rien. Je devrais aussi également partir en tournée avec « Les Grands Ducs » à la rentrée. Cette pièce se joue actuellement au théâtre de Passy à Paris. C’est l’adaptation du film de Patrice Leconte au théâtre.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Philippe Chevallier : Puissent la musique, le théâtre et l’Art en général contribuer à faire régner sur notre planète un climat de sérénité et d’apaisement entre les peuples et les nations. Cela peut paraître naïf de formuler un tel souhait, que les hommes politiques, s’ils ne sont pas des artistes, soient inspirés en écoutant et en respectant la parole de ceux qui par leur imagination et leur créativité essaient d’établir un monde plus fraternel et ils verront que nous avons tous à y gagner !
Entretien réalisé par Brahim Saci
lematindalgerie.com
Lundi 21 avril 2025
……………………………………………………..
Kamel Mezani : préserver l’âme de la musique kabyle

Le chanteur kabyle Kamel Mezani. Photo DR
Kamel Mezani est un chanteur kabyle originaire de Tibecharine, un village niché dans les montagnes de Mizrana, en Kabylie, au nord de l’Algérie.
Artiste discret, le chanteur kabyle Kamel Mezani s’est imposé comme une voix authentique et profondément respectée de la culture amazighe. À travers ses chansons, il exprime les valeurs, les douleurs et les espoirs de la jeunesse kabyle, mettant en lumière la poésie de la langue et l’importance de la transmission de la mémoire collective.
Sa musique est une fusion élégante entre tradition et modernité. Elle puise dans les rythmes ancestraux et les mélodies kabyles tout en intégrant des arrangements contemporains, donnant à ses œuvres une intemporalité qui touche toutes les générations. Kamel Mezani réussit à préserver l’âme de la musique berbère tout en y insufflant une fraîcheur qui lui permet de résonner auprès des anciens comme des jeunes, notamment dans la diaspora.
Les textes de Kamel Mezani sont profondément poétiques et engagés. Ils explorent des thèmes universels comme l’amour, l’exil, l’identité ou encore la résistance culturelle. Chargées d’émotion et de réflexion, ses paroles font de ses chansons des récits à la fois intimes et collectifs. Il ne cherche pas seulement à divertir, il invite son auditoire à ressentir, réfléchir et se reconnecter à ses racines kabyles.
Kamel Mezani, un passeur de mémoire
Pour les Kabyles vivant loin de leur terre natale, ses chansons jouent un rôle fondamental. Elles tissent un lien précieux entre les générations et permettent de préserver une langue et une culture parfois en danger, tout en nourrissant un sentiment de fierté et d’appartenance. Kamel Mezani agit ainsi comme un passeur de mémoire, rapprochant les jeunes de la diaspora de leur héritage culturel tout en affirmant la richesse de l’identité amazighe.
Kamel Mezani est souvent associé à des figures emblématiques de la chanson kabyle telles que Hamidouche et Rahim, qu’il honore dans ses interprétations. Cette filiation musicale dépasse le cadre de l’art pour devenir un engagement profond en faveur de la langue, de l’identité et des droits culturels amazighs.
L’œuvre musicale de Kamel Mezani demeure essentielle dans la préservation de la culture kabyle. Par ses chansons, il contribue à sauvegarder la langue, les traditions et l’histoire de son peuple. Il joue un rôle de gardien culturel, reliant les générations à travers une musique profondément ancrée dans l’histoire de la Kabylie.
L’un des traits marquants de son art réside dans sa capacité à moderniser les structures musicales traditionnelles sans les altérer. Il intègre avec finesse des sonorités contemporaines, ou des arrangements modernes, tout en restant fidèle aux rythmes kabyles. Cette démarche lui permet de séduire un large public, des plus âgés aux plus jeunes, notamment ceux de la diaspora.
Pour les Kabyles établis à l’étranger, ses chansons constituent un pont culturel et émotionnel. Elles permettent de maintenir un lien vivant avec leurs origines, surtout pour les jeunes générations qui, souvent, n’ont pas grandi dans un environnement imprégné de la langue ou de la musique kabyle. L’apport de Kamel Mezani à cette diaspora est inestimable, il entretient le sentiment d’appartenance et ravive une identité souvent mise à l’épreuve par l’éloignement géographique et l’assimilation.
Défense des traditions
Kamel Mezani est également une figure d’inspiration pour les générations futures. En tant qu’héritier des grands noms de la musique kabyle, il incarne une continuité culturelle, mais aussi une capacité d’innovation. Son engagement pour la défense des traditions, allié à son sens de l’adaptation, fait de lui un modèle pour les jeunes artistes qui cherchent à conjuguer authenticité et modernité.
Il incarne aussi un rôle symbolique dans la défense de l’identité kabyle. À travers ses textes, il promeut un message de résistance culturelle face aux défis politiques et sociaux que connaît la Kabylie. Sa musique, bien au-delà du divertissement, devient un espace de prise de conscience, de dialogue et de réflexion sur les droits culturels amazighs.
L’apport de Kamel Mezani à la musique et à la culture kabyles reste fondamental. Il a su donner à son art une portée universelle, tout en renforçant l’attachement de son public à son identité, à sa langue et à sa mémoire collective. Son œuvre continue de faire vibrer, d’inspirer et de rassembler, bien au-delà des frontières de la Kabylie.
Brahim Saci
diasporadz.com
Le 25 avril 2025
……………………………………………..
Sadia Tabti : « Mes origines franco-algériennes sont une source inépuisable d’inspiration »

La Franco-algérienne Sadia Tabti se veut une passeuse des valeurs collectives et de mémoire. Photo DR
Sadia Tabti revient, dans cette interview, sur son parcours, ses origines franco-algériennes, ses inspirations et les valeurs qui façonnent son œuvre.
Sadia Tabti partage avec sensibilité son engagement pour la promotion du patrimoine algérien, soulignant l’importance de raconter des histoires enracinées dans les traditions pour en assurer la pérennité.
Elle aborde également son rapport à la littérature jeunesse, qu’elle considère comme un moyen puissant de transmettre des valeurs et de sensibiliser aux enjeux contemporains.
Un échange riche et captivant qui célèbre la mémoire, la poésie et le pouvoir de la transmission dans la construction d’un avenir respectueux de la diversité culturelle.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Diasporadz : Votre écriture met en lumière la richesse de vos origines franco-algériennes. Comment cette double culture influence-t-elle vos récits ?
Sadia Tabti : Née de mère française, les classiques de la littérature française ont façonné ma manière de voir le monde et d’appréhender les complexités humaines, et, de père algérien. L’Algérie source d’inspiration et de résilience est un patrimoine tout aussi riche. Les contes et légendes berbères, les chants de l’Andalousie et les récits de notre résistance à la guerre d’indépendance sont autant de sources qui nourrissent mon imaginaire.
Ce métissage culturel se traduit par des histoires croisées où se mêlent les influences françaises et algériennes. Double attachement filial et culturel qui se lit dans ma préoccupation constante pour l’artisanat où je me suis spécialisée.
En somme, mes origines franco-algériennes sont une source inépuisable d’inspiration et de créativité et d’émotions variées car un de mes ouvrages CommUn-CommUne – Insurgés Algériens 1871 et communard 1871 Ed. L’Artmemoire, faisant une mosaïque culturelle unique et précieuse. Mon écriture vise à créer un pont entre les cultures française et algérienne.
Par cette double culture, j’ai une mission : mettre en lumière nos auteurs francophones algériens en tant qu’ambassadrice de l’antenne Algérie du réseau, Rencontre des Auteurs Francophones, composé de 54 pays et 5 continents.
Diasporadz : Les personnages de Tassadit, la petite potière et Tassadit, la petite bijoutière sont très attachants. Qu’est-ce qui vous a inspirée pour créer ces héroïnes ?
Sadia Tabti : Après près d’une dizaine d’années de céramique, j’ai organisé et mis en place un parcours itinérant « résidence autour de l’argile » en Kabylie chez une mère potière pour des céramistes professionnelles de la région Rhône-Alpes, intéressées par cet art millénaire qu’est la poterie modelée à fond plat (néolithique).
L’attachement à cette culture ancestrale, celle de mon père Mohand, m’a fait prendre conscience de la disparition progressive de la poterie réalisée par les femmes. Une idée a germé dans ma tête : « perpétuer cet art millénaire par le biais du conte ».
J’aime à penser que je peux offrir aux jeunes lecteurs la transmission de ce savoir-faire afin de maintenir le maillon de cette chaîne.
Diasporadz : Vos contes rendent hommage aux savoir-faire artisanaux kabyles. Pourquoi était-il important pour vous de les mettre au cœur de vos histoires ?
Sadia Tabti : Si la perpétuation de ces arts millénaires a continué par on ne sait quel miracle jusqu’à ce jour, en conservant les secrets, les rites et rituels de ces savoir-faire, spécificité de la culture amazighe, laquelle appartient depuis la nuit des temps aux régions rurales et montagneuses, nous déplorons hélas depuis quelques décennies sa tendance actuelle à se raréfier pour ne pas dire disparaitre.
Cet hiver, j’ai accompagné des chasseuses de trésor, amoureuses de notre savoir-faire, j’ai pu constater le véritable désastre à travers notre chère Kabylie.
La réalité m’a frappée en pleine figure ! Il est urgent de se préoccuper de ce patrimoine immatériel.
Je me suis rendue chez les potières, les tisserandes, la majorité ont plus de 70 ans et certaines ne peuvent plus pratiquer cet art, les jeunes filles restées au village ont délaissé cette pratique ancestrale en cessant pour ainsi dire de poursuivre cette tradition.
Ce triste constat est ma préoccupation première, plusieurs facteurs socio-économiques expliquent cette tendance, qui menace la diversité culturelle et le savoir-faire ancestral.
Il y a la réticence des jeunes générations à acquérir les connaissances et les compétences traditionnelles car elles préfèrent souvent les emplois urbains, considérés comme plus lucratifs et moins exigeants que ceux de l’artisanat. La mondialisation a intensifié la concurrence internationale, favorisant les produits manufacturés à grande échelle. De plus, la reconnaissance sociale des artisans est insuffisante, ce qui décourage les jeunes de se lancer dans ces carrières.
Diasporadz : La mémoire, la transmission et l’héritage sont des thèmes récurrents dans vos livres. Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre à travers votre travail ?
Sadia Tabti : A travers la littérature jeunesse et le rêve, je souhaite transmettre non seulement ce savoir-faire aux jeunes générations mais aussi être passeuse des valeurs collectives et de mémoire : « Nous n’aurons plus ce sentiment d’identité et de continuité si nous ne prenons pas conscience que notre patrimoine est en péril et que nous perdons l’héritage que nous ont transmis nos ancêtres. »
Tassadit est plus qu’un personnage, elle est née d’un désir profond de préserver les techniques artisanales, de valoriser les racines culturelles, de rendre hommage aux femmes artisanes qui ont su préserver ces pratiques avec passion et savoir-faire, à travers les âges.
Diasporadz : Vous participez régulièrement à des événements culturels. Quel rôle pensez-vous que la littérature peut jouer dans la préservation du patrimoine amazigh ?
Sadia Tabti : La littérature joue un rôle fondamental dans la préservation du patrimoine culturel et historique de notre culture. Elle permet de transmettre les savoirs, les traditions et les valeurs d’une génération à l’autre, assurant ainsi la continuité et l’évolution de notre identité culturelle.
Ces œuvres littéraires permettent de sauvegarder les récits et les légendes qui ont été transmis oralement pendant des siècles. Les contes, les mythes et les légendes étaient autrefois racontés autour d’un feu ou lors des rassemblements communautaires, ils trouvent une nouvelle vie lorsqu’ils sont consignés dans des livres. Chercheurs et historiens peuvent ainsi étudier et comprendre les croyances, les valeurs et les coutumes d’une culture.
Nos écrits restant, les traditions orales ne disparaissent pas avec le temps, mais se perpétuent et évoluent.
La littérature devient ainsi un outil de résistance contre l’homogénéisation culturelle et linguistique, et joue un rôle clé dans la diversité culturelle.
Diasporadz : Comment voyez-vous l’avenir de la littérature jeunesse engagée culturellement, et quels conseils donneriez-vous aux jeunes auteurs issus de cultures multiples ?
Sadia Tabti : Le besoin de diversité et d’inclusion dans la littérature jeunesse n’a jamais été aussi pressant. Les jeunes lecteurs cherchent des histoires qui reflètent leur propre réalité, leurs luttes et leurs triomphes.
Cette prise de conscience se traduit par une augmentation des publications mettant en scène des personnages issus de minorités et des thèmes célébrant la diversité.
Les livres pour enfants et adolescents explorent des sujets tels que les droits civiques, l’égalité des genres, la protection de l’environnement, et le combat contre le racisme et la discrimination.
Diasporadz : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Sadia Tabti : Oui, j’ai différents projets dont un qui me tient particulièrement à cœur, je viens de mettre en place et j’anime un atelier de lecture à voix haute pour de jeunes algériens s’intitulant « La Nouba des mots » en hommage à Assia Djebar, figure emblématique de la littérature algérienne francophone (académicienne) en partenariat avec la Grande Mosquée de Paris, cet atelier se déroule dans leur Bibliothèque.
Nous souhaitons transmettre aux jeunes générations l’héritage culturel et littéraire de nos auteurs algériens francophones tout en prenant du plaisir à lire et en renforçant leur confiance en eux.
Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?
Sadia Tabti : Mon dernier mot sera pour la publication de mon dernier ouvrage, d’Arachné à Tassadit ou l’Odyssée du Tissage, qui vient d’être publié aux Editions Rencontre des Auteurs Francophones, conte pour enfants et adultes. L’Odyssée du Tissage est un symbole des destinées humaines. Les femmes dans la mythologie grecque filent, tissent et coupent les fils représentant les vies des mortels.
Par le biais de la mythologie, des légendes, mythes, rites, ce conte met en lumière le savoir-faire de nos tisserandes, fruit d’une riche culture traditionnelle portant le témoignage des croyances ancestrales.
Tassadit remarque un long fil de soie d’une extrême finesse, elle aperçoit à ses pieds l’araignée Arachné qui lui propose de suivre ce fil de soie, de plusieurs kilomètres, qu’elle a laissé porter par le vent jusqu’au Mont Tamgout (Algérie). Tassadit va parcourir la région agrémentée de plusieurs obstacles en passant par différentes étapes. Sur chaque site oublié, elle croisera des gardiennes, des êtres mythiques bienveillants qui apparaîtront sous différentes formes et lui conteront l’histoire fascinante de l’univers du tissage.
Entretien réalisé par Brahim Saci
diasporadz.com
Le 24 avril 2025
…………………………………………………..
Sadia Tabti : un pont poétique entre les générations et les cultures

L’écriture de Sadia Tabti est à la fois poétique et immersive. Photo DR
Sadia Tabti est une écrivaine talentueuse dont l’univers littéraire puise sa force dans la richesse de ses origines franco-algériennes.
Sa double appartenance culturelle lui permet de tisser des récits empreints d’émotion, de finesse et de profondeur, où tradition et modernité cohabitent harmonieusement. Cette dualité traverse toute son œuvre, qui explore avec sensibilité les notions d’héritage, de transmission et de mémoire.
Parmi ses créations les plus marquantes figurent des contes comme Tassadit, la petite potière et Tassadit, la petite bijoutière. Bien plus que de simples récits pour la jeunesse, ces histoires mettent en lumière le savoir-faire artisanal, les gestes ancestraux et les traditions locales qui façonnent l’identité kabyle.
À travers le personnage de Tassadit, elle donne vie à des héroïnes à la fois fortes, sensibles et profondément ancrées dans leur environnement.
Ces figures féminines évoluent dans des univers façonnés par l’histoire, où chaque objet, poterie, bijou, outil, devient le symbole vivant d’un patrimoine à préserver.
Une écriture poétique
L’écriture de Sadia Tabti est à la fois poétique et immersive. Elle entraîne le lecteur dans un voyage sensoriel à travers les paysages algériens, les montagnes majestueuses de la Kabylie, les villages suspendus, les ruelles vivantes des villes. Elle peint avec des mots une Algérie lumineuse et profonde, où la vie quotidienne se mêle à une certaine forme de magie, de nostalgie et de spiritualité. Chaque conte devient ainsi un hommage vibrant aux racines amazighes, tout en posant un regard universel sur les enjeux de la préservation culturelle dans un monde en perpétuel changement.
Mais Sadia Tabti ne s’arrête pas à la création littéraire. Elle s’illustre également par son engagement actif en faveur de la valorisation du patrimoine algérien. Présente dans des événements culturels comme les Salons du livre, elle partage avec conviction ses réflexions sur la mémoire collective et la transmission des cultures ancestrales. Son implication fait d’elle une passeuse de mémoire, une médiatrice entre les générations, œuvrant à la continuité vivante des traditions amazighes et kabyles.
Ses contes, bien que destinés à un jeune public, parlent aussi aux adultes. Ils deviennent des vecteurs de sensibilisation à la beauté et à la richesse des cultures qu’ils mettent en scène. À travers l’artisanat, la langue, les valeurs familiales et communautaires, elle offre aux lecteurs une fenêtre ouverte sur une Algérie plurielle, vibrante et profondément humaine. Son œuvre rappelle combien il est essentiel de préserver, valoriser et faire rayonner les identités culturelles face aux risques d’uniformisation.
Richesse de l’héritage linguistique de l’Algérie
L’apport de Sadia Tabti à la culture kabyle et amazighe est à la fois littéraire, artistique et militant. À travers ses textes, elle révèle la richesse de l’héritage linguistique et artisanal de l’Algérie, en particulier celui de la Kabylie, en le rendant accessible, vivant et touchant. Elle contribue à faire redécouvrir des savoir-faire anciens, porteurs de sens, d’histoire et de fierté.
Les contes de Sadia Tabti – notamment Tassadit, la petite potière et Tassadit, la petite bijoutière – célèbrent avec délicatesse et puissance les métiers manuels, en y associant des valeurs essentielles, l’ancrage culturel, la transmission intergénérationnelle, l’autonomie et la créativité. Sa plume, à la fois douce et engagée, nourrit le sentiment d’appartenance à une culture unique, et invite à s’en inspirer pour mieux la transmettre.
Au-delà de la littérature, elle incarne une voix précieuse dans la promotion de la culture algérienne contemporaine.
Par sa participation à des rencontres littéraires et culturelles, elle sensibilise un large public à la richesse des traditions amazighes et kabyles. Sadia Tabti s’impose ainsi comme une figure essentielle, à la croisée de la mémoire et de l’innovation, faisant de ses contes un pont poétique entre les générations, entre les cultures, et entre les mondes.
Brahim Saci
diasporadz.com
Le 24 avril 2025
……………………………………..
Farid Goudjil : une figure incontournable de la scène culturelle berbère et française

Farid Goudjil est plus connu sous le pseudo de Farid Galaxie. Photo DR
Farid Goudjil, également connu sous le pseudonyme Farid Galaxie, est une figure incontournable de la scène culturelle berbère et française.
Le parcours de Farid Goudjil est marqué par une diversité impressionnante d’activités dans les domaines de la littérature, des médias, du théâtre et du cinéma.
Farid Goudjil s’est affirmé comme écrivain avec des œuvres qui reflètent des préoccupations sociales et identitaires. Son livre L’autre C ouam (2010), rebaptisé par la suite Je suis, tu es, nous sommes la France, est un ouvrage introspectif qui traite des questions d’identité et de multiculturalisme en France. Par son style narratif, il questionne les tensions et les espoirs d’une société riche en diversité.
En 2024, il a publié Infiltré pour un meilleur, un roman policier captivant qui mêle suspense et exploration des complexités humaines. Ce livre met en évidence son talent pour naviguer dans des genres littéraires variés tout en offrant une réflexion sociale.
Farid Goudjil est également un animateur accompli qui a marqué les esprits grâce à ses émissions axées sur la culture berbère, à la télévision. Il animait Galaxie Berbère sur Berbère Télévision, où il recevait artistes et intellectuels pour discuter d’enjeux culturels et artistiques. Cette émission a joué un rôle clé dans la promotion de la culture amazighe. À la radio, il a lancé Galaxie Import, une émission qui reflétait son style dynamique et engagé.
Sur les planches, il a démontré un véritable talent d’acteur dans des pièces comme Le chant des roseaux et Timoura. Ces œuvres théâtrales explorent souvent des thématiques sociales, telles que la mémoire, la migration et les relations intergénérationnelles.
Farid Goudjil a également fait des incursions dans le monde du cinéma, jouant dans des films comme 24 jours, un drame poignant basé sur une histoire vraie, Voyoucratie, un film qui met en lumière des problématiques de marginalisation et de criminalité dans un contexte urbain.
Tout au long de sa carrière, Farid Goudjil a montré une passion inébranlable pour la préservation et la promotion de la culture berbère, à travers ses œuvres littéraires, ses productions théâtrales et ses projets audiovisuels. Ses engagements reflètent une vision inclusive et humaniste, qui cherche à construire des ponts entre les cultures.
Un talent de romancier
Le dernier livre de Farid Goudjil, intitulé Infiltré pour un meilleur, est paru le 2 juillet 2024. Ce roman policier captivant suit les enquêtes de Djamel, un policier passionné et bienveillant, qui navigue sur la fine ligne entre le bien et le mal. Perturbé par ses missions d’infiltration et les dilemmes éthiques qu’elles impliquent, Djamel s’efforce de faire le bien autour de lui, notamment en tentant de détourner de jeunes malfrats du trafic de drogue.
Le récit explore des thèmes profonds tels que la justice, les limites morales et les impacts sociaux du trafic de drogue. Djamel, hanté par la perte de jeunes victimes de ce fléau, se donne pour mission de combattre ce phénomène tout en cherchant à convaincre les décideurs d’agir. Cependant, il est confronté aux limites de son rôle et aux sacrifices personnels qu’exige sa quête.
Djamel est confronté au trafic de drogue, un fléau qui détruit des vies et alimente la criminalité. Ses missions l’amènent à agir dans l’ombre, à infiltrer des réseaux criminels pour mieux les démanteler. Cependant, cette immersion dans le monde du crime met son humanité à l’épreuve, l’obligeant à jongler entre la nécessité d’agir pour le bien commun et les sacrifices personnels qu’exige son métier.
Le roman aborde des thèmes cruciaux et réfléchis, Djamel doit souvent faire face à des décisions où la ligne entre le bien et le mal devient floue. L’auteur met en lumière les dégâts causés par cette activité criminelle, en insistant sur ses conséquences tragiques pour les jeunes générations. Le roman explore les luttes internes et les sacrifices de Djamel pour concilier son engagement professionnel et son humanité.
À travers ce récit, Farid Goudjil pose des questions sur les responsabilités des institutions et des individus dans la lutte contre le crime.
Dans Infiltré pour un meilleur, l’intrigue est construite avec des éléments de suspense qui captivent le lecteur tout au long du récit. Le style narratif de Farid Goudjil invite également à une réflexion sur les défis auxquels sont confrontés les policiers infiltrés, notamment leurs liens avec la société qu’ils cherchent à protéger.
Ce roman témoigne de l’engagement de Farid Goudjil envers des thématiques sociales importantes, tout en offrant une immersion dans les complexités humaines et professionnelles. Il renforce l’image de l’auteur en tant que créateur engagé, capable de traiter des sujets sensibles avec profondeur et authenticité.
Brahim Saci
diasporadz.com
Le 22 avril 2025
…………………
Farid Goudjil : « Je voulais mettre l’accent sur la prévention et pas simplement sur la répression »

Farid Goudjil, dit Galaxie, auteur du roman « Infiltré pour un meilleur ». Photo DR
Farid Goudjil partage avec nous, dans cetentretien exclusif, sa réflexion sur son nouveauroman Infiltré pour un meilleur.
Farid Goudjil s’est confié avec une grande sincérité, en dévoilant non seulement les coulisses de la création de son roman Infiltré pour un meilleur, mais également sa vision en tant qu’auteur engagé. À travers cet échange, il a mis en lumière les thèmes forts de son livre, tout en exposant sa pensée sur les défis sociaux et humains qu’il explore dans ses écrits.
Farid Goudjil a abordé les motivations qui l’ont poussé à écrire Infiltré pour un meilleur, un roman policier captivant, tout en s’attardant sur les dilemmes moraux auxquels sont confrontés ses personnages. Une conversation enrichissante avec un écrivain qui mêle habilement suspense et réflexion sociale.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Diasporadz : Votre roman Infiltré pour un meilleur plonge dans les dilemmes d’un policier infiltré. Qu’est-ce qui vous a inspiré pour écrire sur ce sujet ?
Farid Goudjil : Ce personnage, ce policier infiltré, prend naissance dans mon premier roman Je suis, tu es, nous sommes la France. Il traverse l’adolescence avec ses acolytes Osman et Caroline, et par la force des choses il deviendra policier. Ce flic, qui est avant tout un jeune, prône comme son frère Mohamed la bienveillance, il essaye de faire le bien autour de lui, ce qui est loin d’être simple.
Le policier est à mon sens une personne qui a un pouvoir, nous en avons tous un tant soit peu, et si nous pouvions influer et faire le bien, c’est la mission qui est donnée à ce personnage. Je pense avoir été inspiré par l’actualité, la réalité… et la fiction nous amène à donner vie au personnage, comme il peut en exister dans la vraie vie. Je voulais mettre l’accent sur la prévention et pas simplement sur la répression, il est vrai comme le dit le proverbe il vaut mieux prévenir que guérir. Le protagoniste garde en lui cet esprit de liberté, il fait les choses comme il les ressent, et ce n’est pas sans conséquences.
Diasporadz : Djamel, le personnage principal, fait face à des défis moraux intenses. Avez-vous puisé dans des expériences réelles ou des témoignages pour construire son histoire ?
Farid Goudjil : On m’a souvent posé cette question, nous sommes là dans une fiction, j’ai construit mon personnage, je me suis projeté, je l’ai imaginé au fin fond de moi. Mon éditeur me disait que mes personnages avaient de l’épaisseur, j’ai voulu leur donner une âme.
Je m’inspire de la vie, de ce qu’elle apporte, de ce que je vois. Lorsque j’étais en période écriture, je me baladais en scooter, il faisait beau, je me laissais guider par la vague, tout en restant concentré sur la route bien sûr, sécurité oblige. En circulant sur un boulevard je saluais des amis au passage, et là, d’un coup, quelques idées d’écriture sont apparues. Je me suis alors posé un instant pour noter et ne pas perdre le fil et, dans la soirée, j’étais en mode écriture, les idées défilaient.
Il y a des expériences plus ou moins réelles, des mots clés qui résonnent, je les recrée comme je le ressens. Dans le roman, il y a une scène marquante, celle de Jugurtha qui, par la force des choses et de par la bêtise, retournera en Algérie, dans son village qu’il connaît à peine. Il devra alors renouer avec ses origines, se faire accepter par les villageois, ce qui n’est pas une mince affaire. C’est la double peine qui frappe à sa porte.
Diasporadz : Le trafic de drogue, thème central de votre livre, est une problématique mondiale. Comment espérez-vous que votre roman sensibilise les lecteurs à cette réalité ?
Farid Goudjil : Le trafic de drogue est un phénomène qui dépasse la fiction, comment redonner espoir à une jeunesse en perdition ? J’ai été invité par le Centre de Loisirs Jeune de la Police nationale de St Etienne (CLJ 42) pour échanger autour de mon 1er roman Je suis, tu es, nous somme la France. Il souhaitait adapter quelques scènes du livre pour les jouer au théâtre. C’est une manière de sensibiliser le lecteur. La rencontre était enrichissante, les jeunes s’exprimaient à l’image de mon roman, Djamel le protagoniste va à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser. D’ailleurs, je suis de nouveau invité par le CLJ 42 pour la sortie de mon roman infiltré pour un meilleur.
Mon ouvrage reste une fiction qui n’a pas vocation à donner de leçon, mais peut être un espoir pour certains, quand on veut on peut, faut-il encore s’en donner les moyens, on pourrait s’identifier au protagoniste comme peut le faire sa nièce dans le livre.
Il est vrai que le chemin est tout tracé dans ce milieu néfaste et il est facile de se laisser guider par la couleur de l’argent, comme je l’explique dans le roman. Il n’y a pas qu’une seule route à emprunter, il y en a d’autres, certes plus complexes car le jeune est parfois stigmatisé en fonction de la couleur de sa peau, de ses origines, de son lieu de vie. Ce n’est pas une généralité mais il faut y faire face et s’en défaire, il faut pouvoir croire en soi, en ses projets.
Diasporadz : Vous êtes également acteur et animateur. Comment vos expériences dans ces domaines enrichissent-elles votre approche en tant qu’écrivain ?
Farid Goudjil : Certes, je puise dans mes expériences pour écrire, pour imaginer mes personnages, je pars d’un constat, d’une difficulté récurrente. Je suis pensif, observateur, j’aime regarder les gens, leur manière d’être, de faire. Dans mon roman, je parle du Centre de Loisirs Jeunesse de la Police nationale, j’ai travaillé à leur côté, je les ai côtoyés, je m’en suis en partie inspiré. J’ai travaillé auprès des jeunes de quartiers durant quelques années, et puis je me laisse guider par mes pensées.
Diasporadz : Vos œuvres explorent souvent des tensions sociales et identitaires. Pensez-vous que la littérature peut jouer un rôle actif dans la transformation des sociétés ?
Farid Goudjil : La littérature joue d’une certaine manière un rôle, peut-être pas assez actif, elle contribue à l’amélioration de la société, elle nous raconte des histoires, nous fait voyager à travers l’imaginaire, elle permet de développer l’esprit critique.
Dans la chanson, nous avons les auteurs qui font passer des messages comme dans le cinéma, le théâtre, et nous avons la littérature, qui est peut-être moins accessible. Il faut donner l’envie de lire, il y a certainement plus de consommateurs d’images que de lecteur.
Il existe dans les villes, dans les quartiers des boites à lecture, ce qui permet à toute personne d’emprunter des livres, de les échanger comme dans les médiathèques, mais avec plus de simplicité.
Diasporadz : Quels projets avez-vous pour l’avenir, que ce soit dans la littérature, le cinéma ou l’engagement culturel ?
Farid Goudjil : Je réfléchis au troisième volet de ma série, il y a eu Je suis, tu es, nous sommes la France, Infiltré pour un meilleur, dois-je poursuivre vers une trilogie ? J’ai commencé à poser les bases, je sais plus ou moins vers où me diriger, mais je ne sais pas si je vais y aller, la question est : Que dire de plus ? Je ne veux pas écrire pour écrire, je dois donner un sens à mon projet, j’y réfléchis.
Lorsque j’ai commencé à écrire mon roman Je suis, tu es, nous sommes la France, j’étais déjà dans l’optique d’aller vers le cinéma, l’histoire s’y prête.
J’ai eu de bons échos des extraits audio de mon roman Infiltré pour un meilleur, l’auditeur plongeait, il imaginait les personnages, un ami réalisateur s’est projeté, il voyait carrément les scènes, il m’a fait un très bon retour. Je vais me pencher un peu plus sur cette idée. Et puis cela m’a conforté dans mon idée d’enregistrer une version audio, un podcast, une série du roman Je suis, tu es, nous sommes la France.
Un projet qui est en cours de réalisation, j’ai actualisé quelques textes restés dans un tiroir, puis dans un dossier sur mon ordinateur. Je travaille sur un projet musical.
J’aimerais développer des projets culturels en lien avec l’Algérie, créer des échanges. J’en discutais avec feu le chanteur Brahim Izri, nous avions quelques idées de projets artistiques. Notre ami feu Idir me disait que j’étais une passerelle entre ces deux rives.
Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?
Farid Goudjil : Et bien merci à toi Brahim et à Diasporadz pour cet entretien, ce fut un vrai plaisir, je salue les lectrices et lecteurs de ce média.
Entretien réalisé par Brahim Saci
diasporadz.com
Le 23 avril 2025
…………………………………………
Jean-Claude Gengembre, une figure majeure du monde de la percussion

Jean-Claude Gengembre incarne une vision dynamique et moderne de la percussion. Photo Romain Robine
Jean-Claude Gengembre est une figure majeure du monde de la percussion, dont la carrière exemplaire embrasse performance, composition, pédagogie et exploration musicale.
Originaire de Lille, Jean-Claude Gengembre découvre la musique dès son jeune âge au Conservatoire de sa ville natale où il se distingue rapidement, obtenant plusieurs Premiers Prix en percussion, analyse, écriture et formation musicale.
Ces premières années d’apprentissage posent les bases d’une carrière exceptionnelle. Son talent et son dévouement le mènent ensuite au prestigieux Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), où il remporte des distinctions dans la percussion et l’harmonie.
Ces formations solides lui permettent d’acquérir une technicité irréprochable ainsi qu’une compréhension profonde de la musique, qu’il saura mettre au service de sa carrière dans des contextes variés.
Jean-Claude Gengembre s’impose rapidement comme l’un des percussionnistes les plus talentueux de sa génération. Sa virtuosité et son sens musical exceptionnel lui ouvrent les portes des plus grands orchestres.
Il débute comme timbalier solo au sein de l’Orchestre national de Lille, où il exerce pendant dix ans (1996-2006), marquant de son empreinte les interprétations de l’orchestre.
Il poursuit sa carrière avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, en tant que timbalier solo, de 2007 à 2012, avant de reprendre cette fonction en 2013, après une année passée à Berlin.
Des talents de compositeur
Il occupe également la position de timbalier solo au sein du prestigieux Rundfunk sinfonieorchester Berlin entre 2012 et 2013.
En parallèle, il est régulièrement invité par d’autres formations d’envergure, telles que l’Orchestre de Paris, l’Orchestre national d’Île-de-France ou encore le Seoul Philharmonic Orchestra. Ces collaborations témoignent de son rayonnement et de la reconnaissance de son talent sur la scène internationale.
Outre son rôle de musicien interprète, Jean-Claude Gengembre se distingue par ses talents de compositeur. Avec plus de vingt œuvres à son actif, il explore la richesse des instruments à percussion, en créant des pièces pour instruments solistes, ensembles de percussions ou formations orchestrales. Ses compositions, à la fois modernes et accessibles, sont régulièrement jouées dans des conservatoires, festivals et masterclasses.
Ses œuvres sont publiées par des éditeurs de renom comme Alfonce Production et les Éditions Billaudot, renforçant ainsi leur visibilité dans le monde de la musique classique contemporaine.
Jean-Claude Gengembre est aussi un pédagogue accompli, dédié à la transmission de son savoir et de sa passion pour la musique. Professeur au CNSMDP et au Pôle Supérieur de Lille, il joue un rôle clé dans la formation des percussionnistes de demain. Il anime également des masterclasses en France et à l’international, notamment au Luxembourg, en Espagne, en Suisse et en Corée du Sud.
Son enseignement va bien au-delà de la technique : il encourage ses étudiants à repousser leurs limites artistiques et à explorer les multiples facettes de la percussion, notamment dans un contexte musical contemporain.
Une vision dynamique et moderne de la percussion
Jean-Claude Gengembre ne se limite pas aux grandes scènes orchestrales. Il est un fervent adepte de la musique de chambre, une discipline qu’il considère comme essentielle pour la richesse et l’intimité qu’elle offre. Il a collaboré avec des artistes de renom, tels que Martha Argerich, Nelson Goerner et Claire Désert, dans des projets qui explorent la percussion comme un instrument expressif et mélodique.
Ses prestations en musique de chambre mettent en valeur l’étendue de sa sensibilité musicale et sa capacité à dialoguer avec des instruments aussi variés que le piano, le violon ou le violoncelle.
Toujours en quête d’innovation, Jean-Claude Gengembre a récemment lancé un projet audacieux intitulé Bizet VS Gengembre. Ce programme revisite les œuvres célèbres de Georges Bizet, notamment Carmen et Les Pêcheurs de Perles, à travers une approche mêlant recomposition et improvisation. Ce projet démontre sa volonté de redéfinir les frontières entre classique et contemporain, tout en rendant hommage au génie de Bizet.
Jean-Claude Gengembre incarne une vision dynamique et moderne de la percussion, repoussant constamment les limites de l’instrument. Sa carrière, qui allie performance, composition, pédagogie et exploration artistique, témoigne d’un engagement total envers l’art musical. Sa polyvalence et son esprit novateur en font une figure incontournable de la scène musicale contemporaine.
Brahim Saci
diasporadz.com
Le 18 avril 2025
………………………………………………………………………………………………………..
Jean-Claude Gengembre : « Quand je ne joue pas je compose »

Jean-Claude Gengembre est timbalier solo, compositeur et arrangeur. Photo Romain Robine
Dans cet entretien passionnant, Jean-Claude Gengembre, timbalier solo, compositeur et arrangeur, nous invite à plonger au cœur de son univers artistique.
Jean-Claude Gengembre nous parle avec passion de ses créations et de ses projets qui illustrent son engagement à rendre la musique accessible et à créer des expériences immersives pour tous.
Il évoque les rencontres qui ont jalonné son parcours artistique et souligne l’importance des synergies créatives, en mettant en avant des projets avec des musiciens, des chefs d’orchestre et des comédiens.
L’artiste exprime avec conviction sa volonté de transmettre sa passion pour la musique classique, notamment auprès des jeunes générations. Il insiste sur la nécessité d’innover pour toucher un public plus large et renouveler l’intérêt pour cette forme d’art intemporelle.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Diasporadz : Vous avez commencé votre formation musicale très jeune au Conservatoire de Lille et au CNSMDP. Quels souvenirs ou enseignements marquants gardez-vous de ces années formatrices ?
Jean-Claude Gengembre : J’ai eu beaucoup de chance d’intégrer le Conservatoire de Lille, puis le CNSMDP, issu d’une famille très modeste, nous n’avions pas d’argent, j’étais élève boursier, j’en suis vraiment reconnaissant.
Mon père m’a inscrit en premier lieu dans l’école de musique d’une petite ville que nous habitions, Bauvin, mon premier professeur, à qui je dois beaucoup, Guy Defer m’a présenté au bout d’un an d’études à un grand musicien André de Tollenaere, professeur au Conservatoire de Lille, pianiste, chef d’orchestre, ce maître de musique m’a beaucoup appris, soutenu, sans lui je ne serais pas musicien professionnel.
Je pourrais également citer Christian Bellegaerde, mon professeur d’écriture pendant 6 ans qui m’a motivé à écrire ma première pièce, Jacques Delécluse et Bernard De Crépy mes professeurs de percussion et harmonie au CNSMDP, ils ont été également sources d’inspiration, et se sont révélés d’un soutien précieux tout au long de mes études à Paris.
Jacques Delécluse, pianiste, percussionniste, compositeur, confectionnait lui-même ses baguettes de percussion, je n’avais pas d’argent pour en acheter, et un jour, il m’a offert un jeu de 4 baguettes de Marimba, elles m’ont accompagné une grande partie de ma carrière, je les ai encore chez moi, ce geste m’a énormément touché.
Diaporadz : En tant que percussionniste et compositeur, comment parvenez-vous à concilier la performance musicale et la création artistique dans votre carrière ?
Jean-Claude Gengembre : Quand je ne joue pas je compose et vice versa. Il y a des périodes très chargées (rires). Ce serait difficile pour moi de choisir entre l’un ou l’autre, ils sont complémentaires, et sont tous deux mes moyens d’expression musicale. Ecrire de la musique enrichit mon jeu de percussionniste, c’est une aventure intérieure, une nécessité. Il y a eu de grandes périodes pendant lesquelles je n’ai pas composé faute de temps, je ressentais un manque. J’essaye aujourd’hui d’équilibrer mes activités de compositeur et interprète en fonction des différentes commandes de partitions. Il m’arrive de refuser des engagements de concerts pour avoir plus de temps à consacrer à la composition.
Diaporadz : Votre projet innovant Bizet VS Gengembre propose une relecture des œuvres classiques de Bizet. Qu’est-ce qui vous a inspiré pour mêler recomposition et improvisation ?
Jean-Claude Gengembre : La musique de Georges Bizet m’a beaucoup inspirée, mais il ne s’agissait pas d’écrire des arrangements, plutôt de proposer une relecture, de partir de l’émotion suscitée par la musique du compositeur de Carmen pour explorer de nouveaux horizons. Pour certaines pièces, je n’ai utilisé que des bribes de thèmes, parfois c’était juste un clin d’œil, une atmosphère, des couleurs qui font penser à… Travailler un matériau, le développer, créer une forme font partie du travail d’un compositeur, j’ai utilisé les principes d’imitation en musique, telles les imitations en miroir, certaines pièces sont des compositions totalement originales où j’ai juste conservé le plan structurel d’œuvres connues du maître.
J’ai cherché à créer un lien entre toutes les pièces, et, quoi de mieux qu’une histoire dont les péripéties du personnage principal seraient ponctuées, illustrées par de la musique ?
Ainsi est né le personnage de Serge Zibet ! Zibet est l’anagramme de Bizet, Serge est le prénom de mon père et Georges son 2e prénom, je suis né exactement 100 ans après la mort de Bizet, et, « Carmen » était lʼOpéra préféré de ma grand-mère maternelle.
Avec le plus grand respect pour les œuvres que j’ai citées dans mon travail, je me suis beaucoup amusé avec ces jeux de miroir, j’aime beaucoup l’humour en musique, j’ai parfois grossi le « trait » de certains thèmes pour en dégager un caractère « comique », et, j’ai redécouvert l’univers musical et poétique d’un compositeur génial qui a disparu trop tôt et qui aurait sans doute pu écrire encore tant de chefs d’œuvres.
Diaporadz : La percussion est souvent perçue comme un instrument d’accompagnement. Comment travaillez-vous pour lui donner une place centrale dans vos œuvres et dans la musique classique contemporaine ?
Jean-Claude Gengembre : Depuis les années 1970, la percussion et le répertoire pour percussion solo n’ont cessé d’évoluer, la place de la percussion dans les œuvres contemporaines est assez importante. J’ai beaucoup écrit pour ensemble de percussions et percussion solo, j’essaye depuis quelques années de me tourner davantage vers les instruments à vent et à cordes, ou vers l’orchestre symphonique. J’ai composé cette année mon premier conte musical « La grenouille à grande bouche » celui-ci est d’ailleurs disponible en podcast sur le site de France Musique.
Diaporadz : Vous avez enseigné et donné des master classe à travers le monde. Quel aspect de la pédagogie vous passionne le plus et comment transmettez-vous votre amour de la percussion à vos élèves ?
Jean-Claude Gengembre : C’est le partage qui m’intéresse le plus, les élèves m’apprennent souvent plus que je ne leur apporte moi-même. Passer un bon moment ensemble, faire de la musique, transmettre l’exigence, la valeur du travail dans la bienveillance et le respect de chacun, ce sont des valeurs que j’affectionne particulièrement, découvrir de nouvelles cultures, une autre manière d’appréhender la percussion et la musique en général, même s’il a ses contraintes et réclame beaucoup de sacrifices, le métier de musicien est magnifique, il permet de s’enrichir tout au long de sa carrière.
Diaporadz : Quelles connexions et passerelles existe-t-il entre la percussion classique et celle des musiques du monde ?
Jean-Claude Gengembre : Aujourd’hui tout est accessible en un clic, mais le véritable apprentissage, l’échange, les connexions se font selon moi dans la vraie vie, il faut sortir, aller « à la rencontre de… », aller au spectacle, au concert, faire connaissance, tous les musiciens s’inspirent les uns des autres, les discussions « de visu » aident beaucoup.
Énormément de compositeurs ont fait le lien entre les musiques du monde, traditionnelles, et la musique dite « classique », j’essaye pour ma part autant que possible d’écouter la musique traditionnelle des pays que je visite et/où je fais des concerts, master classe, la percussion et le chant sont présents dans toutes les civilisations depuis des millénaires, les passerelles se créent…
Je me souviens d’un merveilleux échange avec un joueur de Duduk (instrument traditionnel arménien) nous étions réunis par un compositeur, Dominique Vasseur, qui avait écrit une pièce pour Duduk et Marimba, c’était un merveilleux moment musical et humain.
Diaporadz : Un dernier mot peut-être ?
Jean-Claude Gengembre : Je vous remercie Brahim pour cette interview, je ne connaissais pas Diasporadz, j’ai pris beaucoup de plaisir à lire notamment votre interview d’Aziz Cheboub, j’aime beaucoup la littérature, elle est une grande source d’inspiration pour mes compositions. Je vais d’ailleurs me procurer « Utopie et Dystopie » son étude sur 2 textes d’auteurs que j’aime beaucoup : Michel Houellebecq et Boualem Sansal. Cela aiguise ma curiosité.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Le 17 avril 2025
Diasporadz.com
……………………………………………………………………………..

Photo Anton Reyes
Carole Zalberg : « J’écris ce qui s’impose »
Carole Zalberg est une figure remarquable de la littérature contemporaine française. Ses écrits abordent souvent des thèmes intimes et universels, tels que les liens familiaux, l’exil, l’identité et les injustices sociales. Avec une plume poétique et introspective, elle parvient à capturer les émotions profondes et les dilemmes humains dans un style à la fois sobre et poignant.
Son roman À défaut d’Amérique explore le destin croisé de plusieurs générations et leurs quêtes identitaires, entre l’Europe et les États-Unis, mêlant histoire personnelle et collective.
Dans Feu pour feu, elle plonge le lecteur dans l’univers bouleversant d’un père en deuil, mêlant des réflexions sur la violence et le pouvoir de la parole.
En dehors de ses œuvres, Carole Zalberg est activement engagée dans le monde littéraire. Elle anime des ateliers d’écriture, encouragent des voix émergentes à s’exprimer à travers l’écriture. Elle participe également à des jurys littéraires et des débats, renforçant le dialogue autour de l’écriture contemporaine.
Carole Zalberg n’est pas seulement une romancière, mais également une traductrice, et elle a travaillé sur des projets artistiques variés. Ses œuvres traduites atteignent un public international, tandis que certaines de ses histoires prennent vie sur scène, comme Feu pour feu au Théâtre de Belleville.
Elle représente l’alliance entre l’art littéraire et l’engagement personnel et social, témoignant de son désir de connecter les gens, les générations et les cultures.
Carole Zalberg a publié plusieurs œuvres remarquables, souvent avec des éditeurs prestigieux. Léa et les Voix (2002) – Nicolas Philippe/L’embarcadère, Les Mémoires d’un arbre (2002) – Le Cherche Midi, Chez eux (2004) – Phébus, Mort et Vie de Lili Riviera (2005) – Phébus, La mère horizontale (2008) – Albin Michel, Le jour où Lania est partie (2008) – Nathan Poche, À défaut d’Amérique (2012) – Actes Sud, Feu pour feu (2014) – Actes Sud, À la trace : journal de Tel Aviv (2016) – Éditions Intervalles, Je dansais (2017) – Grasset, Où vivre (2018) – Grasset, Tes ombres sur les talons (2021) – Grasset, Song Book (2022) – L’Arbre à Paroles.
Ces œuvres explorent des thèmes variés, allant de l’exil à l’identité, en passant par les relations humaines et les dilemmes sociaux.
L’apport littéraire de Carole Zalberg réside dans sa capacité à traiter des thématiques profondément humaines avec une grande sensibilité et une plume poétique. Carole Zalberg aborde souvent dans ses œuvres les notions d’exil, de déracinement et de quête identitaire. Par exemple, dans À défaut d’Amérique, elle met en lumière les trajectoires entrelacées de générations marquées par l’émigration et la recherche de sens dans des terres lointaines.
Son écriture possède une qualité quasi-poétique, avec une attention particulière à la musique des mots et à la profondeur des émotions. Cela renforce l’impact de ses récits et offre aux lecteurs une expérience immersive.
Son apport littéraire réside dans sa capacité à capturer la complexité de l’expérience humaine tout en ouvrant des fenêtres sur des univers à la fois intimes et universels.
Carole Zalberg a une place singulière dans la littérature française contemporaine grâce à sa capacité à tisser des récits mêlant l’intime et l’universel, tout en explorant les complexités des émotions humaines et des dilemmes sociaux.
Son œuvre littéraire est donc multiple, elle offre à la fois une voix unique dans la fiction contemporaine, tout en s’investissant pour faire vivre la littérature de manière collective et accessible. Une auteure comme Carole Zalberg nous rappelle que la littérature, au-delà des histoires qu’elle raconte, est un moyen de connecter les êtres humains à travers des expériences communes.
Le Matin d’Algérie : Vous revenez souvent aux thèmes de l’exil et de l’identité dans votre écriture. Quelles motivations profondes vous poussent à explorer ces questions de façon récurrente ?
Carole Zalberg : Je suis fille d’exilée du côté de ma mère, petite-fille d’exilé du côté de mon père. Ma mère est venue de Pologne à 6 ans, en 1938, pour fuir le nazisme. Les parents de mon père, également Polonais d’origine, sont arrivés dans les années 1920 pour échapper aux pogroms.
Il s’agit d’un exil particulier puisqu’il est sans retour possible. Plus rien ni personne n’existe de leur famille, de ce qui avait été bâti, dans le pays qu’ils ont quitté. Pour ma génération, issue de ce déracinement, héritière de la précarité des existences, la possibilité de la perte est comme métabolisée. Lorsqu’on écrit, même de la fiction pure, on va puiser profond en soi, tout passe par l’intériorité. Rien d’étonnant, alors, à ce que les thèmes de l’exil et de l’identité complexe s’invitent sous des formes plus ou moins directes.
Le Matin d’Algérie : Dans vos récits, les relations humaines occupent une place centrale. Quelle est votre approche pour retranscrire avec justesse la richesse des émotions tout en préservant une narration harmonieuse et fluide ?
Carole Zalberg : Merci d’évoquer la justesse. Elle est pour moi essentielle. Mon travail, têtu, acharné, consiste à dégager, dans la matière de la langue, la forme précise qui me semble porter le sens voulu. Qu’il s’agisse de romans, de poésie, de chanson, même, je confie à la musique des mots, au rythme, la responsabilité du fond. C’est une approche très intuitive que j’aurais bien du mal à décomposer en étapes, en méthode.
Le Matin d’Algérie : Dans des œuvres comme Feu pour feu, vous explorez des thèmes profonds tels que le deuil et la violence. Comment parvenez-vous à conjuguer l’intensité de ces sujets avec la sensibilité de votre écriture ?
Carole Zalberg : Il me semble que plus les sujets sont durs et intenses, plus l’écriture doit être mesurée, faire ressentir plutôt que tenter d’imposer un sentiment. Chaque description, chaque nuance doit porter un élément du récit. Ce n’est pas une question de longueur du texte mais d’économie de la phrase. Feu pour feu est très bref et donc naturellement plus dense mais, dans l’idéal, cette économie vaut pour un roman plus long comme, par exemple, À défaut d’Amérique. Je rêve qu’on puisse ouvrir mes livres à n’importe quelle page et y trouver un monde qui se tient, un ensemble cohérent d’éléments « chargés », comme lorsqu’on prélève une carotte dans un sol pour l’étudier.
Le Matin d’Algérie : Votre style est souvent qualifié de poétique et introspectif. Quelles influences littéraires ou artistiques ont façonné votre écriture ?
Carole Zalberg : J’ai du mal à répondre à cette question parce que j’ai lu, enfant et adolescente, à peu près tout ce qui me tombait sous la main. Je me suis enflammée pour la littérature contemporaine américaine, mais aussi pour Tolstoï, Duras, Cortázar, Gary, Albert Cohen et tant d’autres. Ce qui est commun à mes grandes émotions de lectrice, c’est la singularité de l’écriture. Un livre peut raconter la plus palpitante des histoires, s’il est « sans écriture », sans musique, sans recherche de forme, il me tombera des mains au bout de quelques page.
Le Matin d’Algérie : Entre Léa et les voix et Song book, votre parcours littéraire témoigne d’une évolution marquante. Comment percevez-vous votre croissance en tant qu’écrivain au fil de vos œuvres, tant sur le plan stylistique que thématique ? Y a-t-il des moments ou des œuvres qui, selon vous, ont particulièrement façonné votre trajectoire artistique ?
Carole Zalberg : Je ne perçois pas ma trajectoire comme une croissance mais comme un chemin plein de détours, d’explorations, d’expériences à la marge. Je ne m’interdis aucune aventure. J’écris ce qui s’impose, ce qui, à tel ou tel moment, se révèle à moi comme une nécessité. Je suis très poreuse au monde. Je recueille, consciemment ou non, ce qui l’agite et cela se recompose lentement, parfois durant des années. C’est ainsi que naissent mes livres.
Le Matin d’Algérie : Parmi vos livres, lequel vous tient le plus à cœur et pourquoi ?
Carole Zalberg : Le livre à venir, qui a besoin que je l’accompagne.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Carole Zalberg : J’ai terminé récemment un roman mêlant histoire familiale et réinvention. J’ai découvert récemment qu’une cousine de mon grand-père paternel s’était réfugiée en Argentine au moment de l’Occupation. Cette nouvelle branche s’y déploie depuis. J’ai été bouleversée par cette révélation car j’ai toujours été fascinée par ce pays sans savoir pourquoi. Je cherche la bonne maison d’édition pour ce texte qui m’est très cher.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Carole Zalberg : Un immense merci pour l’intérêt que vous portez à mon travail !
Entretien réalisé par Brahim Saci
Mardi 15 avril 2025
lematindalgerie.com
………………………………………………………………

Brahim Saci debout devant la maison de Slimane Azem
La maison de Slimane Azem échappe à la diaspora kabyle
Le nouveau propriétaire de la maison de l’illustre fabuliste et chanteur Slimane Azem ne veut pas être dérangé.
La vente de la maison de Slimane Azem marque la fin d’une époque symbolique pour la diaspora kabyle et pour les admirateurs de cet artiste emblématique. Il ne s’agit pas d’une simple transaction immobilière, mais plutôt de la clôture d’une période marquée par un artiste aux multiples facettes, dont l’impact dépasse largement la seule chanson kabyle.
Dominant la magnifique ville de Moissac, cette propriété était bien plus qu’une simple résidence, elle incarnait un havre pour l’esprit créatif de Slimane Azem, un lien vibrant avec sa terre kabyle qu’il n’a jamais pu revoir. Contraint à l’exil en 1967, lorsque ses chansons furent bannies des ondes radiophoniques, il devint persona non grata pour la presse algérienne. Pourtant, certains affirment aujourd’hui que cette interdiction n’avait rien d’officiel, une thèse qui ne manque pas de susciter le doute.
Slimane Azem était un exilé et un artiste profondément attaché à sa culture. Pendant une vingtaine d’années, il a partagé cette maison avec son épouse Lucienne, surnommée tendrement Malika, qui lui évoquait les montagnes kabyles et servait d’inspiration à ses chansons les plus mémorables. Ce lieu était également un carrefour d’amitié et de création, où il collaborait, notamment avec Cheikh Noredine, en composant des sketches et des chansons. Cependant, ce sanctuaire artistique a aussi vu les derniers instants de Slimane Azem, qui s’est éteint prématurément le 28 janvier 1983, à seulement 64 ans, emporté par une crise cardiaque après une longue maladie.
La maison de Slimane Azem à Moissac ne se limitait pas à un simple lieu de vie. Elle était un espace où se tissaient les liens entre son identité kabyle et son exil en France. Slimane Azem a subi l’exil forcé, un exil forcé qui le priva de sa terre natale, un thème récurrent dans son répertoire musical.
À travers ses chansons, il a incarné cette douleur de l’exil, cette nostalgie de la Kabylie, tout en continuant de porter la voix de son peuple à travers l’Europe. La maison de Moissac devient ainsi un symbole de cette quête perpétuelle de racines, un refuge où la mémoire de sa terre était continuellement nourrie par son œuvre musicale.
La maison de Moissac représente un véritable sanctuaire où s’entrelacent la mémoire de l’artiste et celle de sa compagne. Elle fut sans doute à la fois une complice et une muse, apportant une lumière douce et intime à la douleur de l’exil.
Après son décès, sa veuve a vendu la maison en viager, et plusieurs années plus tard, elle est passée entre les mains d’une propriétaire bienveillante qui a respecté son histoire. Cette femme généreuse permettait aux admirateurs de Slimane d’avoir libre accès à la maison, leur offrant ainsi l’opportunité d’honorer sa mémoire.
Cette vente ne se résume donc pas à une simple transaction immobilière, elle marque la fin d’une époque. Slimane Azem, véritable maître de la chanson kabyle, a laissé un héritage artistique immense, dont une partie reste encore inédite.
La publication de ces œuvres devient d’autant plus urgente que son dernier producteur, Mohand Anemiche de Numidie Music, est désormais âgé.
Afin de préserver cet héritage culturel, il est crucial que les générations actuelles et futures se mobilisent, notamment à travers des initiatives financières, pour faire revivre les dernières chansons de Slimane Azem.
Il convient aussi de rappeler l’effort de Slimane Azem pour promouvoir son cousin, Mouloud Azem, en enregistrant avec lui la chanson Al Mouloud Akhouya en 1980. Malheureusement, cette chanson n’a été rendue publique qu’en 2017, freinant ainsi les perspectives musicales de Mouloud. Ce dernier a dû faire face à de nombreux obstacles, notamment le refus de la radio algérienne d’enregistrer sous son nom de famille, début des années 70, il me confia que c’est Chérif Kheddam qui lui a suggéré ce changement de nom, ce qui l’a profondément blessé.
Mouloud Azem s’est aventuré dans la chanson kabyle en sortant deux cassettes, l’une en 1984 et l’autre en 1988. Cependant, il n’a pas poursuivi cette voie, restant dans l’attente de la publication du duo avec son oncle Slimane, qui aurait pu lui insuffler un nouvel élan pour poursuivre sa créativité musicale.
Slimane Azem reste une figure incontournable de la culture kabyle. Son art, marqué par l’émotion, la poésie et la critique sociale, continue d’influencer de nombreux artistes qui s’inspirent de son école. Son œuvre constitue un patrimoine unique qu’il est impératif de préserver pour les générations futures. Bien que la maison ait été vendue, elle continue de symboliser une vie et une carrière exceptionnelles, marquées par la passion et le talent.
La vente de la maison n’est donc pas qu’un acte financier, elle représente la fin d’un chapitre de l’histoire d’un artiste majeur de la musique kabyle. Cependant, son héritage demeure, et il incombe à ceux qui admirent son œuvre de continuer à nourrir sa mémoire et à préserver ses contributions culturelles pour les générations futures.
La maison de Moissac, bien que vendue, demeure un symbole vivant de l’artiste et de son œuvre. Chaque recoin de ce lieu imprégné de l’histoire de Slimane Azem, de ses créations et de ses collaborations, témoigne d’un parcours unique. Si l’immobilier change, l’esprit de Slimane Azem continue de guider ceux qui, comme ses admirateurs de la première heure, cherchent à comprendre et à préserver cette œuvre magistrale.
La vente de la maison de Slimane Azem n’est pas simplement une transaction immobilière, mais la fin d’un chapitre dans l’histoire d’un artiste majeur de la musique kabyle. Son héritage, cependant, perdure, et il appartient à ceux qui apprécient son œuvre de continuer à la transmettre et à la préserver pour les générations à venir.
Bruno Azem et sa famille déploient une énergie remarquable et une passion indéfectible au sein de l’association, Les Amis de Slimane Azem, où ils s’engagent à préserver et à faire rayonner l’héritage du légendaire Slimane Azem.
Par des initiatives culturelles, des rencontres et des projets de mémoire. Bruno Azem veille à ce que l’œuvre et l’histoire de cet artiste emblématique continuent d’inspirer les générations actuelles et futures.
Brahim Saci
Lundi 14 avril 2025
lematindalgerie.com
………………………………………………………………………..
/image%2F1720502%2F20250417%2Fob_088665_aziz-cheboub.jpg)
Aziz Cheboub est écrivain et chercheur spécialisé en littérature contemporaine et titulaire d’un doctorat de l’Université de Strasbourg.
Aziz Cheboub : « La littérature a le pouvoir de raconter autrement »
Aziz Cheboub, écrivain et chercheur spécialisé en littérature contemporaine et titulaire d’un doctorat de l’Université de Strasbourg, explore en profondeur la littérature contemporaine. Il ne la considère pas seulement comme une forme artistique narrative, mais également comme un reflet et un levier de transformation sociale et politique.
Son approche met en évidence le potentiel de la littérature à dépasser les frontières de l’art pour devenir un outil puissant de réflexion critique et de changement sociétal. Par cette analyse, il invite à une réflexion approfondie sur le rôle essentiel de la littérature dans l’éveil des consciences et l’alimentation des débats contemporains.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Diasporadz : Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels fait face la littérature contemporaine lorsqu’elle aborde des sujets aussi complexes que l’idéologie et la politique ?
Aziz Cheboub : Le principal défi auquel la littérature contemporaine est confrontée lorsqu’elle explore des sujets aussi délicats que l’idéologie et la politique réside dans l’évitement de la simplification outrancière. Ces thématiques sont des terrains minés, saturés de discours préfabriqués et d’intérêts claniques. La véritable force de la littérature réside dans sa capacité à résister au manichéisme, à plonger dans les nuances et à inviter le lecteur à un effort de réflexion.
Prenons l’exemple de Han Kang, lauréate du prix Nobel de littérature, qui, dans son roman Celui qui revient, retrace le parcours de Kim, un personnage luttant contre la censure imposée par le régime sud-coréen des années 1980. Ce récit illustre non seulement les défis de l’époque, mais aussi les évolutions positives qui ont conduit, d’une manière ou d’une autre, à des événements récents marqués par la destitution du président.
En France, la complexité de ces enjeux se reflète dans les œuvres de nombreux auteurs. Leïla Slimani, par exemple, évoque le recul de la liberté d’expression en Algérie, tout en restant silencieuse sur le Maroc, où des prisonniers politiques sont toujours détenus. De même, Yasmina Khadra, dont les positions politiques semblent parfois éloignées de la réalité actuelle, aborde des thèmes tels que l’islamisme ou la guerre d’Algérie, témoignant de la richesse et de la profondeur des zones grises que la littérature peut explorer.
D’ailleurs, la littérature algérienne oscille entre engagement et précaution, entre témoignage audacieux et stratégies d’évitement face à la censure. L’interdiction en Algérie de la biographie de Malcolm X illustre cette réalité, révélant la surveillance stricte exercée sur le discours littéraire. Un constat amer que partage la romancière Kaouther Adimi, qui s’interroge avec une pointe de désespoir : faudra-t-il bientôt écrire sur les feuilles des arbres ?
Diasporadz : Comment la littérature peut-elle influencer ou remettre en question les discours politiques dominants dans la société ?
Aziz Cheboub : La littérature a le pouvoir de raconter autrement. Contrairement à un essai qui pourrait donner des directives, elle offre des visions du monde. Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud est une réponse à L’Étranger d’Albert Camus, visant à rendre visible l’Arabe et à rendre son histoire aussi, voire plus importante que celle de Meursault.
En construisant des fictions qui déplacent les perspectives, elle dévoile ce que les discours dominants cherchent à rendre invisible. Elle politise l’intime et donne la parole aux sans-voix. C’est une force de perturbation, non de conformité. La littérature est un rempart contre les discours dominants, préservant la mémoire et nourrissant la pensée critique. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, écrit dans le climat oppressant du maccarthysme, illustre les dangers de la censure et de la suppression du pluralisme littéraire.
Ces récits rappellent que, face à la surveillance et à l’effacement des idées, la littérature demeure une arme de résistance et un vecteur de liberté intellectuelle.
Diasporadz : En tant qu’écrivain et chercheur, comment équilibrez-vous la dimension théorique de vos travaux avec la nécessité de rendre vos analyses accessibles au grand public ?
Aziz Cheboub : C’est une tension constante : Il faut savoir d’où l’on parle, mais aussi à qui l’on parle. La théorie sert de prisme d’analyse, mais ne doit jamais devenir une finalité rigide. Cette exigence ne doit pas basculer dans l’hermétisme ; je vise une écriture qui reflète ma pensée : limpide, mais fidèle à la complexité des idées. Ce défi est constant, mais indispensable pour assurer la circulation et l’impact du discours.
Diasporadz : Quelles œuvres ou auteurs contemporains considérez-vous comme les plus pertinents pour aborder les thématiques de l’anticipation politique et des idéologies modernes ?
Aziz Cheboub : Je pense à Margaret Atwood, Don DeLillo et Michel Houellebecq, dont l’œuvre, malgré les controverses, explore avec acuité les fissures idéologiques et le malaise contemporain. Boualem Sansal demeure une figure incontournable. Côté idéologies, Emmanuel Todd m’interpelle avec son analyse sur l’émergence du Sud global et le déclin de l’Occident. Il y a aussi Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire de l’État français, dont les analyses géopolitiques et la fabrique de la guerre, ou comment vendre une guerre à une population, sont très pertinentes. John Holloway, sociologue irlandais, continue quant à lui d’inspirer les altermondialistes avec sa vision d’une révolution repensée. Enfin, il m’arrive de replonger dans les œuvres d’Amin Maalouf ou de Stefan Zweig, dont la profondeur résonne toujours aujourd’hui. Et la liste est encore longue, tant les auteurs éclairants et audacieux ne cessent de renouveler la pensée et le récit.
Diasporadz : Comment vos recherches sur la dystopie et l’utopie peuvent-elles contribuer à une meilleure compréhension des enjeux mondiaux actuels, comme les crises géopolitiques ou les dérives autoritaires ?
Aziz Cheboub : Les récits dystopiques ne sont pas des prédictions, mais des miroirs grossissants du présent. En amplifiant les dynamiques contemporaines telles que la surveillance, l’autoritarisme, les inégalités, ces récits dévoilent les mécanismes qui, poussés à l’extrême, engendrent des sociétés oppressives. La Servante écarlate de Margaret Atwood en est un parfait exemple : une crise de la fécondité devient le prétexte à l’instauration d’une théocratie totalitaire, démontrant comment les peurs collectives peuvent légitimer l’autoritarisme. À l’inverse, les utopies ne relèvent pas de la crédulité, mais d’une critique active du réel. Elles permettent d’imaginer des modèles alternatifs fondés sur la justice, la solidarité et la démocratie. Face aux crises multiples : pandémies, conflits géopolitiques etc., elles offrent des perspectives essentielles pour repenser la gouvernance.
Ainsi, explorer dystopies et utopies ne relève pas d’un simple exercice intellectuel, mais d’une nécessité politique. Elles sont des outils de réflexion critique et d’imagination politique qui nous aident à identifier les dérives potentielles et à envisager des alternatives viables pour affronter les défis de notre époque.
Diasporadz : Quelle place accordez-vous aux œuvres de Michel Houellebecq et de Boualem Sansal dans votre réflexion sur les tensions idéologiques contemporaines, et comment leur approche de la dystopie enrichit-elle votre analyse des sociétés modernes ?
Aziz Cheboub : Michel Houellebecq et Boualem Sansal occupent une place centrale dans ma réflexion sur les tensions idéologiques contemporaines. Leurs œuvres, bien que distinctes, utilisent la fiction pour sonder les fractures de nos sociétés modernes. Dans 2084 : inspirée de 1984 d’Orwell, cette dystopie met en garde contre le fanatisme et la manipulation de l’information. « La dictature religieuse est prête à tout détruire », souligne Sansal, dénonçant les dérives autoritaires sous couvert de spiritualité.
De son côté, Michel Houellebecq explore les tensions idéologiques à travers des récits où le vide existentiel et le repli identitaire dominent. Il ne cherche pas à plaire, mais à provoquer, contraignant le lecteur à affronter des réalités inconfortables. Leurs œuvres ne se contentent pas de raconter des histoires ; elles sont des outils de réflexion qui dévoilent les mécanismes du contrôle, de la surveillance et de la manipulation. À travers ces dystopies, elles nous rappellent que d’autres mondes sont pensables et que la littérature demeure un espace de liberté.
Diasporadz : Quel impact pensez-vous que l’emprisonnement de Boualem Sansal a eu sur la perception de ses œuvres et sur la liberté d’expression dans le contexte sociopolitique actuel ?
Aziz Cheboub : L’emprisonnement de Boualem Sansal en mars 2025 ne se limite pas à un événement politique : il marque un tournant symbolique dans la perception de son œuvre et dans la compréhension des enjeux liés à la liberté d’expression. Cette incarcération confère à ses écrits une résonance nouvelle, transformant ses dystopies, telles que 2084 : La fin du monde, en actes de résistance incarnés.
Ce qui relevait autrefois de l’alerte littéraire prend désormais une dimension tangible, rappelant que l’écrivain, dans certains contextes, engage son propre corps dans la lutte pour ses idées. Comme je l’ai souligné dans mon essai Littérature et idéologie, la dystopie n’est pas qu’un simple exercice de style : elle est un prisme d’analyse des tensions idéologiques et des mécanismes de domination. Dans un article consacré à son arrestation, j’ai également mis en lumière les limites du gouvernement, qui cherchait à conjuguer technocratie et populisme sans réellement prendre en compte les dynamiques politiques en place.
Ce cas illustre à quel point la liberté d’expression reste fragile en Algérie, surtout lorsque la parole littéraire dérange les cercles du pouvoir. L’écrivain, loin d’être un simple observateur, devient une cible, et sa lutte offre un éclairage poignant sur les dérives autoritaires. Son emprisonnement souligne l’urgence de défendre ce droit fondamental, menacé par des politiques qui préfèrent le silence au débat. Bien sûr, on peut être en désaccord avec certaines positions de Boualem Sansal, mais la contestation ne se fait pas par la coercition : elle s’inscrit dans la disputation et la confrontation des idées. Sansal incarne cette tension entre engagement et opposition, rappelant que la littérature, lorsqu’elle interroge les dogmes et bouscule les certitudes, est l’un des derniers remparts contre l’uniformisation intellectuelle.
Diasporadz : Pensez-vous que la littérature puisse réellement offrir des solutions aux problèmes sociaux et politiques qu’elle explore, ou se contente-t-elle de dresser des constats ?
Aziz Cheboub : La littérature ne prétend pas résoudre immédiatement les crises sociales et politiques, mais elle joue un rôle fondamental en fissurant nos certitudes et en déplaçant notre regard. Elle apporte des réponses révisables et pose des questions essentielles. Elle agit comme un catalyseur de réflexion et offre un espace pour interroger nos sociétés. En ce sens, elle façonne notre rapport au pouvoir, à l’autre et à la vérité… « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà », écrivait Montaigne.
Par ailleurs, la littérature engagée, elle, ne se contente pas de refléter les luttes sociales et politiques : elle les amplifie, les met en perspective et leur donne une voix durable. Son impact dépasse le champ esthétique : elle s’inscrit dans une dynamique politique forte. Ainsi, elle est le lieu où l’imaginaire rencontre le réel, où l’idée devient puissance, où chaque mot peut ébranler un système et ouvrir la voie à d’autres possibles.
Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?
Aziz Cheboub : Je fais mienne cette citation de Montesquieu, tirée des Lettres persanes, où il dresse un portrait critique des mœurs de la société française du XVIIIᵉ siècle : « Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé. » Elle illustre à merveille le pouvoir du livre, qui dépasse sa simple fonction informative pour devenir une source inépuisable d’inspiration et un levier de transformation profonde. La lecture n’est pas seulement un refuge, mais une forme de résistance contre l’uniformisation des pensées et des pratiques, un espace où se forge la liberté intellectuelle.
Brahim Saci
Le 15 avril 2025
diasporadz.com
…………………………………………………………………………………………
/image%2F1720502%2F20250416%2Fob_8ee032_aziz-cheboub.jpg)
Aziz Cheboub est enseignant et chercheur en lettres modernes.
Rencontre avec Aziz Cheboub
Aziz Cheboub est un écrivain et chercheur spécialisé en littérature contemporaine, titulaire d’un doctorat de l’Université de Strasbourg. Il est particulièrement reconnu pour ses travaux sur les thématiques de la dystopie et de l’utopie dans la littérature moderne.
Parmi les publications de Aziz Cheboub, l’essai Littérature et idéologie, paru en 2024 aux éditions Persée, constitue une œuvre marquante. Dans cet ouvrage, il explore les relations entre la fiction et les constructions idéologiques, en analysant des romans emblématiques tels que 2084 de Boualem Sansal et Soumission de Michel Houellebecq. Son approche met en lumière les tensions sociopolitiques contemporaines à travers le prisme de la littérature.
Cheboub contribue également à une meilleure compréhension des interactions entre la littérature et les dynamiques sociales, en décryptant les idéologies qui façonnent notre réalité. Son travail est salué pour sa capacité à interroger les enjeux politiques et sociaux avec profondeur et nuance. Aziz Cheboub est étroitement lié aux mouvements littéraires contemporains qui explorent les thématiques de la dystopie, de l’utopie et de l’anticipation politique. Son travail s’inspire d’auteurs comme Boualem Sansal et Michel Houellebecq, dont les œuvres interrogent les tensions idéologiques et sociopolitiques modernes.
Il s’inscrit également dans une tradition littéraire qui utilise la fiction comme un miroir pour analyser les réalités sociales et politiques. Son approche comparative et critique des récits d’anticipation met en évidence les interactions entre la littérature et les idéologies contemporaines. Aziz Cheboub enrichit le débat autour des représentations littéraires des idéologies, notamment celles liées à l’islamisme et à l’extrême droite, en examinant leurs dynamiques et leurs effets sur les sociétés modernes.Les travaux d’Aziz Cheboub analysent les tensions entre ces deux concepts dans la littérature contemporaine, en mettant en lumière les idéologies qui façonnent notre monde. Aziz Cheboub étudie comment la fiction reflète et interagit avec les constructions idéologiques modernes, notamment celles liées à l’islamisme et à l’extrême droite. Ses recherches révèlent les dynamiques sociales et politiques à travers la littérature, en s’intéressant à des romans emblématiques comme Soumission de Michel Houellebecq et 2084 de Boualem Sansal. Il aborde également les questions de liberté d’expression et de répression, en particulier dans des contextes comme l’Algérie.
Aziz Cheboub explore le thème de la dystopie en tant que miroir des tensions idéologiques et sociopolitiques contemporaines. Dans son ouvrage Littérature et idéologie, il examine comment les récits dystopiques illustrent les mécanismes de contrôle, de répression et de propagande dans les sociétés modernes. Il analyse des œuvres comme 2084 de Boualem Sansal et Soumission de Michel Houellebecq pour mettre en lumière les dynamiques entre idéologie et fiction. Ces récits dystopiques permettent d’examiner les enjeux politiques et sociaux, tout en interrogeant les limites de la liberté individuelle face à des systèmes oppressifs.
Aziz Cheboub utilise la dystopie pour révéler les fractures et contradictions des sociétés contemporaines, offrant ainsi une perspective critique sur les idéologies dominantes, il apporte une contribution majeure à la littérature contemporaine en explorant les interactions entre fiction et idéologie. Son travail met en lumière les tensions sociopolitiques et les fractures idéologiques à travers des récits dystopiques et utopiques, il examine comment les récits littéraires reflètent et déconstruisent des idéologies contemporaines.
Aziz Cheboub propose une lecture comparative des œuvres d’anticipation politique, révélant les dynamiques de pouvoir et les mécanismes de contrôle dans les sociétés modernes, il encourage les lecteurs à développer une pensée critique face aux idéologies dominantes et à se réapproprier leur vision du monde.
En tant que chercheur, il enrichit le débat académique sur la littérature et son rôle dans la compréhension des enjeux sociopolitiques actuels, il ne se contente pas d’analyser la littérature ; il la positionne comme un outil puissant pour interroger et transformer les réalités sociales.
Brahim Saci
Le 14 avril 2025
diasporadz.com
………………………………………………………………………………………………………….
.png)
Photo DR
Le comte Bertrand de Rougé : une personnalité attachée à l’histoire et à ses racines bretonnes
Le comte Bertrand de Rougé était une figure incontournable, une personnalité marquante qui incarnait avec passion l’héritage et les traditions de la Bretagne. Né dans une famille ancrée dans l’histoire de cette région, il nourrissait une relation quasi fusionnelle avec ses racines bretonnes, qu’il considérait comme un patrimoine précieux et vivant.
Son amour pour cette terre se manifestait non seulement dans ses actions, mais aussi dans ses discours, où il évoquait régulièrement les grandes pages de l’histoire bretonne. Il était un défenseur acharné de la culture locale, une voix forte pour la préservation des coutumes et des valeurs bretonnes, tout en étant un acteur clé dans les cercles sociaux et politiques de la région. Son engagement envers la Bretagne allait bien au-delà de la simple appartenance à une lignée historique, c’est une véritable mission de transmission et de célébration des traditions qui faisaient la singularité de cette terre.
Il est décédé le 20 février 2025 à l’âge de 92 ans. Chevalier de la Légion d’honneur, de l’Ordre national du Mérite et du Mérite agricole, il a également été honoré de plusieurs distinctions en reconnaissance de ses contributions dans divers domaines. Une grande partie de sa vie a été consacrée à la préservation du château de Tonquédec, une forteresse historique située en Bretagne. Entre les années 1970 et 2000, il a supervisé d’importants travaux de rénovation pour restaurer le château et l’ouvrir au public.
Le comte Bertrand de Rougé a passé son enfance au château de Baronville, situé dans le département d’Eure-et-Loir, en France. Ce château, construit au XIXe siècle sous Napoléon III, est un exemple remarquable d’architecture de style Louis XIII. Il se trouve au cœur d’un vaste domaine agricole et forestier, et a été inscrit au patrimoine historique en 1985.
Bertrand de Rougé a joué un rôle essentiel dans la préservation de ce château familial. Avec son épouse, il a entrepris d’importantes restaurations afin de sauvegarder ce patrimoine historique et familial. Ces efforts ont permis de maintenir l’édifice en bon état et de préserver son éclat pour les générations futures. Aujourd’hui, le château appartient au comte Aymeric de Rougé, qui poursuit les travaux de restauration et d’embellissement de ce domaine avec passion.
Le château de Baronville représente non seulement le lieu de naissance de Bertrand de Rougé, mais aussi un symbole de son engagement envers la préservation du patrimoine familial. Sa passion pour l’histoire et son implication dans la sauvegarde du patrimoine ont laissé une empreinte indélébile. Sa famille, notamment ses enfants et petits-enfants, continue de perpétuer son héritage. Il a également été impliqué dans des activités communautaires, en tant que maire-adjoint de Béville-le-Comte et vice-président de la Fondation d’Aligre. Une vie riche et pleinement dédiée à la préservation de l’histoire et du patrimoine.
Le comte Bertrand de Rougé a marqué l’histoire non seulement par son engagement envers le patrimoine breton, mais également par son rôle déterminant dans la restauration et la préservation du château de Tonquédec, une forteresse médiévale emblématique située dans les Côtes-d’Armor. Construit au XIIe siècle, le château a traversé de nombreux siècles de conflits et de transformations. Sous la direction de Bertrand de Rougé, entre les années 1970 et 2000, il a connu une transformation majeure. Il a supervisé des travaux de restauration visant à préserver des éléments architecturaux fondamentaux, tels que les chemins de ronde, les ponts-levis et les donjons. Ces efforts ont permis de protéger le château des intempéries et de le rendre accessible au public, transformant ainsi ce monument en un lieu de mémoire et de découverte pour des générations de visiteurs.
Bertrand de Rougé était également profondément attaché à ses racines familiales. Ses ancêtres avaient acquis le château en 1880, et il a poursuivi cette tradition en transmettant son amour pour l’histoire et le patrimoine à ses descendants.
Sa fille, Victoire de Rougé, a pris la relève en 2022, perpétuant ainsi l’héritage familial. En plus de son engagement sur le château, il a joué un rôle actif dans sa communauté, notamment en tant que vice-président de la Fondation d’Aligre et maire-adjoint de Béville-le-Comte. Son engagement discret mais déterminé a laissé une marque durable, non seulement sur le patrimoine architectural, mais également dans les cœurs de ceux qui ont eu la chance de le connaître. Une vie dédiée à la préservation de l’histoire et à la transmission de valeurs culturelles.
Les efforts du comte Bertrand de Rougé ont eu un impact majeur sur la perception du patrimoine breton, en particulier à travers la restauration du château de Tonquédec. En redonnant vie à cette forteresse médiévale, il a non seulement préservé un monument historique, mais il a également renforcé l’identité culturelle bretonne. Son travail a permis de transformer le château en un lieu de mémoire et d’éducation, attirant des visiteurs de toute la France et au-delà. Grâce à ses initiatives, le château est devenu un symbole de la résilience et de l’importance de préserver le patrimoine local. Les générations d’écoliers qui ont visité le site, ainsi que les familles qui ont participé aux événements organisés au château, ont pu développer un lien profond avec l’histoire bretonne.
Son engagement a inspiré d’autres propriétaires de monuments historiques à investir dans la restauration et la valorisation de leur patrimoine, contribuant ainsi à une prise de conscience accrue de l’importance de préserver ces trésors culturels pour les générations futures.
Brahim Saci
Samedi 12 avril 2025
lematindalgerie.com
……………………………………………………………………………………..
« Crime d’Etat » de Farid Alilat : un beau livre mais une préface sujette à polémique

Farid Alilat est une figure clé du journalisme algérien. Sa carrière a pris son envol au quotidien Liberté, l’un des piliers de la presse indépendante en Algérie. En tant que directeur de ce journal, il a incarné le combat pour une information de qualité et impartiale. Son expérience comme rédacteur en chef de Liberté lui a permis de poser les fondations de son expertise journalistique, en couvrant des sujets d’actualité sensibles et d’importance cruciale.
Avec son projet Dernières Nouvelles d’Algérie (DNA), Farid Alilat a tenté de révolutionner l’accès à l’information en ligne. Malgré son succès initial, ce média innovant n’a pas pu survivre au manque de ressources financières, démontrant les défis persistants auxquels la presse numérique est confrontée.
Depuis 2004, Farid Alilat collabore avec le magazine Jeune Afrique, un média influent qui couvre les actualités politiques, économiques et culturelles du continent africain. Grâce à son expertise, il apporte un éclairage précis et perspicace sur les dynamiques complexes de l’Algérie et de l’Afrique du Nord. Ses articles sont connus pour leur profondeur d’analyse.
Farid Alilat est aussi un écrivain accompli, dont les livres sont une symbiose entre enquête rigoureuse et art de la narration, ses ouvrages marquants sont : « Bouteflika, l’histoire secrète » (2020), paru chez les Éditions du Rocher, une enquête magistrale sur les coulisses du régime de Bouteflika. Il dévoile les stratégies politiques, les alliances et les jeux de pouvoir qui ont marqué ses vingt ans de règne. Le livre se distingue par son accessibilité et sa capacité à dévoiler des facettes souvent méconnues de l’histoire contemporaine algérienne.
« Idir, Un Kabyle du monde » (2022), paru chez le même éditeur : une biographie qui explore la vie et la carrière d’Idir, artiste emblématique dont l’influence musicale transcende les frontières. En racontant l’histoire d’Idir, Farid Alilat nous offre une immersion dans la culture kabyle et l’impact mondial de la chanson A Vava Inouva, reprise dans plusieurs langues.
« Un crime d’État » (2025), paru chez les éditions Plon : son enquête sur l’assassinat de Krim Belkacem plonge dans les méandres de l’histoire politique algérienne, en levant le voile sur un mystère qui hante encore l’Algérie. Grâce à des recherches minutieuses et des archives inédites, Farid offre une perspective unique sur cet événement tragique.
Le style d’écriture de Farid Alilat est à la fois sobre et captivant, accessible tout en étant riche en détails. Ses ouvrages ne se contentent pas de raconter des faits ; ils invitent le lecteur à comprendre les enjeux sociopolitiques en profondeur. Il est parvenu à établir une véritable connexion avec ses lecteurs, mêlant passion pour la vérité et finesse narrative.
Farid Alilat reste une figure respectée et incontournable, tant pour son engagement envers une presse libre que pour sa capacité à ouvrir des fenêtres sur les réalités complexes de l’Algérie.
Le livre Un crime d’État, avec une préface de Kamel Daoud, est donc une enquête captivante qui dévoile les mystères entourant l’assassinat de Krim Belkacem, figure historique du FLN et signataire des accords d’Évian. Cet événement tragique s’est déroulé le 20 octobre 1970, dans une chambre de l’Intercontinental de Francfort, où Krim Belkacem a été retrouvé mort, assassiné deux jours auparavant.
Farid Alilat, journaliste expérimenté, retrace dans ce livre les circonstances de cet assassinat, en explorant les réseaux complexes et les intrigues politiques qui ont conduit à cet acte. Grâce à des documents exclusifs provenant des archives allemandes et des témoignages familiaux, l’auteur offre une perspective inédite sur les relations entre l’Algérie et la France à cette époque, ainsi que sur le rôle de Boumédiène dans cette affaire.
Ce livre, paru le 13 mars 2025, publié par les éditions Plon compte 280 pages. Il est décrit comme un récit haletant, mêlant histoire et thriller politique, qui éclaire un moment clé des relations franco-algériennes.
Le livre Un crime d’État de Farid Alilat est donc une enquête rigoureuse qui lève le voile sur les mécanismes complexes derrière l’assassinat de Krim Belkacem, une figure emblématique de la lutte pour l’indépendance algérienne. En s’appuyant sur des archives allemandes rares et des témoignages familiaux, Alilat dresse un portrait détaillé des tensions politiques et des rivalités internes qui ont marqué l’Algérie postindépendance.
Ce crime, survenu en 1970 à Francfort, est exploré comme un acte directement lié aux intrigues de pouvoir, impliquant des relations sensibles entre l’Algérie et la France. L’auteur analyse notamment le rôle présumé de l’État algérien et de Houari Boumédiène dans cette affaire, tout en interrogeant les notions de trahison et d’autorité au sein du FLN.
Plus qu’une simple reconstitution historique, le livre invite à réfléchir sur les sacrifices et les dérives liés aux luttes pour le pouvoir.
Salué par la critique, Un crime d’État est décrit comme un thriller politique captivant. La précision journalistique et la profondeur historique des récits, soutenues par une écriture accessible, ont été largement appréciées. Les témoignages humains apportent une dimension émotionnelle qui renforce l’impact du livre.
La préface de Kamel Daoud a suscité des débats en raison des controverses entourant l’auteur. Si certains y voient une contribution littéraire et philosophique qui enrichit le propos, d’autres craignent qu’elle détourne l’attention des thématiques essentielles de l’enquête. Le choix de Daoud est perçu comme audacieux, entre provocation et ouverture au débat.
Farid Alilat rejoignant Le Point, un magazine où Kamel Daoud est également contributeur régulier, peut aussi susciter des interrogations, notamment en ce qui concerne la perception publique de son indépendance journalistique. Étant donné les controverses qui entourent Kamel Daoud, certains pourraient établir une association entre les deux journalistes qui risque de détourner l’attention du contenu de Un crime d’État. Cela pourrait aussi être interprété comme une éventuelle influence sur l’orientation de son travail futur.
Cependant, Farid Alilat possède une longue carrière indépendante, marquée par sa rigueur journalistique et son expertise reconnue. Sa capacité à produire des enquêtes solides, comme celles dans Un crime d’État, témoigne de sa compétence à maintenir l’intégrité de son travail, quel que soit son environnement professionnel.
Et le changement de média, ne devrait pas affecter la qualité du livre, qui est une œuvre déjà complète et indépendante.
En réalité, tout dépendra de la manière dont cette collaboration sera perçue par le public et les critiques.
Le fait que Farid Alilat rejoigne Le Point, où travaille également Kamel Daoud, suscite donc des perceptions variées concernant l’impact sur Un crime d’État.
Pour certains lecteurs, cette transition pourrait être vue comme un rapprochement entre deux figures déjà liées par la préface de Kamel Daoud. Cela pourrait amplifier la controverse autour de ce dernier et affecter l’attention portée à l’enquête de Farid Alilat.
La collaboration dans un même média pourrait susciter des doutes sur la distance critique entre les deux auteurs, en particulier pour les publics qui suivent de près le débat sur les écrits et les prises de position de Kamel Daoud.
Mais en travaillant pour un média comme Le Point, Farid Alilat pourrait bénéficier d’une plate-forme internationale plus visible pour promouvoir ses idées et son travail, cela pourrait élargir la portée du livre à de nouveaux publics.
Mais bien que ce changement de média puisse susciter des questions, il faut noter que la qualité et l’impact de Un crime d’État reposent sur la rigueur journalistique de Farid Alilat. Pour beaucoup, ce livre est déjà une œuvre majeure qui transcende les dynamiques personnelles ou professionnelles.
En dépit des réactions variées à la préface, le livre de Farid Alilat reste largement salué pour sa rigueur, son style narratif et son importance historique. Il s’impose comme une œuvre clé pour comprendre les dynamiques politiques de l’Algérie contemporaine, tout en explorant des thématiques universelles telles que le pouvoir et la trahison.
Brahim Saci
Le dimanche 6 avril 2025
lematindalgerie.com
………………………………………………………………………………………
Henia Mouazer, une chanteuse passionnée

La chanteuse kabyle Henia Mouazer est une habituée du café littéraire L’Impondérable. Photo Diasporadz
Henia Mouazer est une chanteuse kabyle remarquable, reconnue pour son talent éclatant et son sourire radieux. Au-delà de sa musique, elle incarne générosité et humilité. Elle est une habituée du café littéraire parisien de l’Impondérable, où elle exprime son amour pour les livres en achetant à chaque occasion l’ouvrage de l’auteur invité.
Henia Mouazer est également une chanteuse kabyle passionnée qui n’hésite pas à partager des moments musicaux avec d’autres artistes tels qu’Amdan Kacel, Azeddine Lateb, Mack Nat Frawsen, Tayeb Bessai, ainsi qu’avec Akli Drouaz et Moh Smail. Ensemble, ils créent une atmosphère familiale et chaleureuse.
Originaire de Tizi Rached, dans la région de Tizi-Ouzou en Kabylie, Henia Mouazer est imprégnée de la richesse culturelle de cette région bordée par Fréha et Assif n’Sibaou au nord, par Larbaâ n’ath Irathen et Irdjen au sud, Tizi-Ouzou à l’ouest et Mekla et Ath Oumalou à l’est. Sa musique, empreinte de vérité artistique, reflète la bonté et la beauté de son âme, comme un miroir authentique.
Sa passion pour la musique et le chant a été mise de côté durant de nombreuses années en raison des aléas de la vie.
Henia Mouazer a grandi dans un village où elle s’adonnait à des activités telles que le tissage, le tricot, les travaux agricoles et l’aide familiale. À seulement 18 ans, elle fut mariée à un immigré choisi pour elle, et elle s’est installée en France dans les années 1980 via un regroupement familial.
Les défis de l’adaptation à une nouvelle vie ne l’ont pas abattue. Henia Mouazer a suivi des formations variées, allant du bricolage à la cuisine, ce qui lui a permis de s’instruire et de s’intégrer. Elle a traversé des épreuves, notamment un divorce en 2002-2003, après lequel elle a concentré toutes ses forces sur l’éducation de ses trois enfants, reportant une fois de plus ses aspirations artistiques.
Avec détermination et persévérance, Henia Mouazer a su surmonter les obstacles. Elle a créé son propre restaurant ainsi qu’un salon de thé, devenant une femme indépendante. En hommage à une amie d’enfance sourde et muette, elle a appris la langue des signes, qu’elle utilise aujourd’hui dans des vidéos YouTube pour sensibiliser à l’importance de la communication avec les personnes atteintes de surdité.
Enfin, une fois retraitée, Henia Mouazer a pu se dévouer pleinement à sa passion. En 2022, elle enregistre un premier album qui rencontre du succès. Elle vient récemment d’en produire un second qui est prometteur et déjà apprécié par ses fans. Henia Mouazer s’est fait remarquer avec Zedek Mouloud au Zénith, ainsi qu’à travers ses interventions sur Radio Antinéa de Berbère Télévision, Radio Pastel de Lille et Radio Boumerdès.
L’avenir de Henia Mouazer s’annonce brillant et riche en créativité. Cette femme extraordinaire nous inspire par sa résilience et son amour inextinguible pour l’art et le partage, la chanson kabyle est devenue son second souffle.
Brahim Saci
Le 06 avril 2025
diasporadz.com
………………………………………………………..

Photo DR
Abdel Raouf Dafri : « Il n’y a que la passion qui m’anime »
Abdel Raouf Dafri a un parcours qui fascine, atypique, hors des sentiers battus, de l’ombre à la lumière, quand le talent est là, rien ne peut l’arrêter, il est comme cette lumière du soleil d’Afrique qui illumine tant d’espoirs, dont l’éclat est recherché par tous les peintres et les créateurs de génie.
Ce fils d’immigré algérien a su s’imposer par son talent et son génie. Il est l’un des meilleurs scénaristes actuels, il s’est distingué sur la scène artistique par son originalité et sa vision juste, écartant les clichés et autres stéréotypes en jetant les œillères qui maintiennent les illusions et les indifférences, pour arracher à la nuit la clarté, pour faire jaillir la réalité avec sa profusion de couleurs pour rendre au monde sa dimension, sa beauté, sa richesse, dans la diversité et les différences.
Ce scénariste et réalisateur français d’origine algérienne, de cinéma et de télévision, a passé son enfance à Wattignies, une banlieue de Lille. Cet autodidacte s’est construit à la sueur de la passion, sans jamais baisser les bras, pour atteindre son rêve, il demeure un exemple pour les jeunes générations de tous les horizons.
Abdel Raouf Dafri a montré que par le travail et la volonté on peut y arriver, passant de la petite porte à la grande porte, faisant fi des préjugés, non sans efforts mais avec la sueur, la force de l’esprit et la générosité du cœur.
Il partage en 2010, le César du meilleur scénario original avec Jacques Audiard, Thomas Bidegain et Nicolas Peufaillit, pour Un prophète.
Abdel Raouf Dafri est nommé en 2012 au grade de chevalier des Arts et des Lettres, par le ministre de la culture, Frédéric Mitterrand. Il remporte un, International Emmy Award dans la catégorie Drama Series, série dramatique, pour le scénario de Braquo2.
Pour la télévision, il a créé La Commune, il est le scénariste de Braquo, saison 2, 3 et 4, et Alger confidentiel.
Il a écrit quatre scénarios de films pour le cinéma, Gibraltar de Julien Leclercq, Mesrine, L’Instinct De Mort et Mesrine, L’Ennemi Public No 1, de Jean-François Richet et Un Prophète de Jacques Audiard. Il a également écrit et réalisé un film dramatique, Qu’un sang impur, sur la guerre d’Algérie.
Le succès du film Un prophète, ce chef d’œuvre absolu, a révélé l’excellent acteur Tahar Rahim d’origine algérienne, qui reçoit en 2010, le César du meilleur acteur pour le film Un prophète, Tahar Rahim dont la carrière a pris une dimension internationale qui s’est récemment distingué dans Monsieur Aznavour, un film réalisé par Mehdi Idir d’origine algérienne et Grand Corps Malade.
C’est ainsi que le talent révèle d’autres talents. Abdel Raouf Dafri ne cesse de se renouveler apportant à chaque fois un nouveau souffle, par une création artistique ancrée dans le moment, et dans le réel, révélant tel un tableau des couleurs cachées qui attendaient d’être révélées pour redonner ces lettres de noblesse au septième art.
Le Matin d’Algérie : Homme de radio, journaliste, cinéaste, qui est Abdel Raouf Dafri ?
Abdel Raouf Dafri : Je suis avant tout le fils aîné de Beya Lazli, née en Algérie, dans les années trente, et qui a grandi au 250 cité Didouche Mourad à Annaba. C’est dans la maison de ses parents et ses sœurs que je me rendais chaque année (entre 6 et 14 ans) durant les vacances d’été pendant deux mois.
Ma mère est celle, grâce à qui je suis là où je suis aujourd’hui. Bien sûr, je ne suis pas aussi vertueux et honorable qu’elle parce que la vie vous oblige à ne pas être totalement naïf et trop gentil. Pour mordre dans le gâteau de ses ambitions et surtout pour survivre dans des quartiers compliqués, il faut parfois montrer les dents…
Je dirais, sans faire d’auto-analyse, que j’ai beaucoup de défauts, quelques qualités et pas mal de principes. Je suis loyal, franc et attaché à des valeurs humanistes sans être dupe des monstres, qui ont pourtant une face humaine, et qu’il m’est arrivé de rencontrer. Je suis aussi empreint d’un grand respect pour celles et ceux qui prennent soin de leur mère, leur compagne et leurs enfants.
Si on n’a pas cette ligne de conduite à l’égard des siens, à mes yeux on est forcément un porc ou une truie.
Sans être croyant, il y a une très belle phrase dans le Coran au sujet des mères qui dit : « Le paradis est aux pieds des mères. » Sans vouloir paraphraser au risque de blasphémer, j’ajouterai que : « Le cœur des mères est LE paradis ».
Le Matin d’Algérie : Vous dépoussiérez, vous donnez un nouveau souffle au cinéma français, qu’en pensez-vous ?
Abdel Raouf Dafri : Je ne sais pas si je « dépoussière » ou si je donne « un souffle nouveau » au cinéma français, mais il est clair que les histoires que je choisis d’écrire n’ont pas grand-chose à voir avec le landernau classique des films français.
J’ai surtout un regard très différent sur le monde et les humains qui le peuplent. Cela doit venir de mon parcours social (apprenti ouvrier à l’âge de 16 ans dans une usine, zéro diplôme et petits boulots qui ne mènent nulle part) ainsi que de mon auto-éducation culturelle, par les livres, la télévision et le cinéma.
Quand vous avez tété le biberon de la rue et celui d’une vie dans la cave sociétale de la France d’en bas, vous avez forcément une vision moins angélique du monde et plutôt acérée de ce qu’on appelle l’adversité. Et comme le disait un vieil ami (paix à son âme) : « Dans courage, il y a le mot rage ! »
Quant au cinéma français, même s’il engrange des succès en salles, il ne faut pas s’y tromper. Hormis quelques rares vrais films de cinéma, tout le reste est un ramassis de choses fabriquées et conceptualisées qui ne trouvent leur source dans aucun désir de création voire d’innovation.
C’est triste, mais c’est ainsi ! Heureusement, le temps qui passe efface ses indignités filmées, comme la pluie nettoie les trottoirs. Seul le temps est juge suprême de la grandeur d’une œuvre, qu’elle soit littéraire, cinématographique, musicale ou autre…
Le Matin d’Algérie : Le cinéma français n’est pas représentatif du peuple avec ses couleurs, contrairement au cinéma américain, que se passe-t-il au pays des lumières ?
Abdel Raouf Dafri : Détrompez-vous ! Le cinéma français d’aujourd’hui est très représentatif des citoyens (noirs, arabes, juifs, etc…) de France. Il est clair que je suis arrivé dans ce métier à une époque où l’on ne voyait pas sur les écrans beaucoup de personnages basanés et Français, assez consistants pour prendre leur destin en mains. Et ce, sans avoir besoin d’un Patrick, René, Julien ou Alexandre (sourire) pour leur indiquer la route à suivre.
Ce genre de narratif aux relents paternalistes et néo-colonialistes n’existe plus actuellement. Et c’est une bonne chose, même si on ne peut pas se contenter de ça…
Ce que j’aime et ambitionne à travers le medium cinéma, c’est de raconter mon pays, la France, à travers les pans les plus sombres de son Histoire (la conquête coloniale, la guerre d’Algérie, la Françafrique, l’assassinat de Robert Boulin, etc…) que l’on met sous silence avec des conséquences tragiques pour l’unité entre citoyens, tous Français mais dont la plupart ont des parents venus d’horizons Africains et Nord Africains.
Pour moi, la France a une Histoire grandiose mais aussi très sombre. Et ne raconter que la partie lumineuse en éludant les crimes, est une erreur qui génère de l’incompréhension et peut donner à certains, je pense aux enfants d’immigrés, l’impression qu’on les méprise. Sentiment qui génère une colère sourde et gare au jour maudit où elle explosera.
La France n’a pas d’autre choix que de reconnaître cette part violente de son Histoire !! Et sans pour autant avoir besoin de s’en excuser, simplement d’en parler afin de pouvoir avancer, tous ensemble.
Au sortir de la seconde guerre mondiale, l’Allemagne a fait son mea-maxima-culpa en travaillant sur le nazisme et Hitler, en éduquant ses citoyens jusque dans les écoles et les manuels scolaires pour que les jeunes générations ne reproduisent pas les erreurs et horreurs du passé…
La France, pays que je chéris, devrait faire le même travail éducatif sur son passé colonial. C’est un vœu pieux que je lance, avec la conscience qu’il ne s’exaucera qu’avec une franche volonté politique.
Le Matin d’Algérie : Des réussites issus de l’immigration sont rares, souvent étouffées, vous avez su dépasser les obstacles, d’où tenez-vous cette incroyable énergie ?
Abdel Raouf Dafri : Le monde du cinéma français est certes un milieu assez fermé, mais c’est le seul espace de travail en France (et des jobs dans d’autres secteurs d’activité, j’en ai eu un paquet) ou le racisme n’existe PAS DU TOUT !! Les professionnels (acteurs, actrices, scénaristes, réalisateurs, techniciens, producteurs, etc…) sont des gens profondément bienveillants et curieux des autres.
Certaines et certains peuvent être très cons, mais racistes ? Jamais de la vie ! Le racisme dans les métiers artistiques est une hérésie. Si le cinéma français était raciste, je n’aurais jamais pu écrire « La Commune » (ma première série sur Canal Plus) ou « Un Prophète » de Jacques Audiard.
D’ailleurs, j’ai récemment terminé avec Nicolas Peufaillit, mon frère de cœur et de labeur, la saison 1 de la série « Un Prophète » dont le premier rôle est tenu par un inconnu doué d’un immense talent, Mamadou Sidibé. Et je précise que Mamadou n’avait jamais joué quelque rôle que ce soit quand il a passé le casting et qu’il a décroché le rôle de Malik El Djebenna. On peut dire que Mamadou a décroché, dans tous les sens, son tout premier rôle en tant que jeune acteur.
Quant à mon « incroyable énergie », je la puise à la source du syndrome de survie sociale et d’orgueil personnel. Dans le film « Rocky », Sylvester Stallone a la chance de pouvoir se retrouver sur le ring face à Apollo Creed, le champion du monde des poids lourds.
Rocky est bien conscient de n’être qu’un boxeur de seconde zone, un gaucher, une « fausse patte », l’éternel exclu du « rêve américain ». De plus, il voit que tout le monde se moque de lui. Dans ce match d’exhibition, il n’est que le bouffon dont tout le monde va se gausser.
À un moment, il a un échange avec Adrian, ce grand amour qu’il rencontre enfin, et il lui dit : « Je sais bien que tout le monde me voit perdant. Même moi, je sais que j’ai aucune chance de gagner face au champion. Mais si à la fin des 45 minutes réglementaires du combat, je suis encore debout, ça prouvera que je vaux mieux que le tocard que tout le monde croit que je suis. »
Croyez-moi, entendre ça m’a bouleversé et motivé, à l’époque où je n’étais « rien qu’un p’tit gars de quartier sans horizon particulièrement brillant. » Et l’autre grande leçon du film est que si vous avez la chance de concrétiser un rêve, même si vous venez du plus bas échelon de la société, accomplissez ce rêve sans désir malsain de revanche ou d’écraser en retour celles et ceux qui vont ont méprisé quand vous n’étiez « rien ». Si vous devez prouver quelque chose en vous accomplissant, c’est à vous et rien qu’à vous.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un exemple pour les jeunes générations issus de l’immigration, vous avez tracé un sillon, qu’en est-il des barrières et autres murs qui se dressent encore çà et là ?
Abdel Raouf Dafri : Je ne sais pas si je suis un exemple pour les jeunes issus de l’immigration et si c’est le cas j’en suis ravi et honoré. Toutefois, je m’efforce d’être chaque jour exemplaire et digne. Je signale quand même qu’il y a beaucoup de jeunes Françaises et Français issus de l’immigration qui sont encore plus exemplaires que moi.
Et nous avons même une jeune Algérienne, Melissa Saichi, arrivée en France à l’âge de 16 ans et qui a été distinguée pour ses recherches sur la détection précoce des formes les plus agressives du cancer du sein. Voilà quelqu’un qui mérite la plus grande des admirations…
Bien sûr qu’il existe encore des barrières en France, notamment dans mon secteur d’activités, particulièrement sur le choix de certains sujets que les diffuseurs refusent d’aborder parce qu’ils pensent que ça va générer de la polémique et nuire au succès commercial du film ou de la série. La guerre d’Algérie et les crimes commis par le colonisateur français depuis 1830 sont des sujets encore tabous !!
Le Matin d’Algérie : Qu’un Sang impur, est votre film le plus personnel, sur la guerre d’Algérie, c’est un film courageux, un retour vers vos racines, comprendre et mieux voir, même en bousculant l’histoire, est-ce important pour vous ?
Abdel Raouf Dafri : Oui ! « Qu’un sang impur » est mon premier film et il m’est très personnel car je tenais à aborder (aussitôt que j’en aurais l’opportunité) le conflit de la guerre d’Algérie. J’ai choisi l’année 1960 qui est la période de cette guerre au cours de laquelle la barbarie dans les affrontements a atteint un point de non-retour dans les deux camps.
Avec ce film, je voulais toucher autant aux contradictions des Algériens qui se battaient pour la Libération de leur peuple du joug colonial qu’à celles des Français qui prétendaient combattre la barbarie alors qu’ils n’avaient rien à faire dans ce pays. « Algérie française » qu’ils clamaient pour justifier une occupation violente à l’égard des populations.
Je voulais montrer que dans chaque camp, la noblesse de la cause et la plus débridée des violences cohabitaient dans le cœur des combattants de chaque camp.
Je voulais bousculer l’Histoire afin de donner à mieux voir et je l’espère pour chacun, mieux comprendre.
Même si le film a été empêché par les exploitants de salles qui l’ont refusé au motif que mon film allait attirer dans leurs salles « une clientèle dont on n’a pas besoin. »
Je salue toutefois les 42 exploitants qui ont accueilli mon film et je préviens tous les autres que je n’en ai pas fini avec ce sujet qui reste encore aujourd’hui, tabou et inquiétant.
Le Matin d’Algérie : L’Algérie ce grand pays, la porte de l’Afrique, le plus grand pays d’Afrique, peine à se démocratiser, le septième art peine à se développer, pourtant il aiderait à l’émancipation de la société, qu’en pensez-vous ?
Abdel Raouf Dafri : L’Algérie est un grand pays et pas seulement par sa superficie, mais aussi par la beauté et la majesté de ses paysages. Quand on les voit, on comprend pourquoi le colonisateur français ne voulait plus repartir (rire).
Je suis le premier attristé de voir que ce grand pays ne bénéficie toujours pas d’une pluralité de partis lors des élections à la plus haute fonction, celle de la présidence.
Je me souviens que j’étais en Algérie lors des élections qui ont permis à Chadli Bendjedid de devenir Président. Je me souviens aussi que les Algériens avaient en mains deux billets pour voter. Un sur lequel il était noté « Oui pour Chadli » et l’autre : « Non pour Chadli » (rire).
À l’époque, il a été affirmé que Chadli Bendjedid avait gagné avec plus de 80% des voix. Et pour sa réélection, le résultat fut un plébiscite avec plus de 93% de « OUI ».
Avec le recul, la magouille est tellement grossière qu’on ne peut qu’en rire et en pleurer. Pourtant, malgré ce déni de démocratie, les Algériens aiment leur pays à la folie. Bien plus que les Français qui vivent pourtant dans une démocratie où la parole critique est libre, ainsi que le droit de manifester et même, de gifler le président Macron et de ne prendre que du sursis sans incarcération.
Quant au cinéma Algérien, je ne sais pas quelle est sa situation, mais ce serait dommage qu’il disparaisse ou s’éteigne à petit feu. L’Algérie est un pays suffisamment riche pour investir dans le medium audiovisuel qui lui permettrait de raconter son Histoire. Je rappelle quand même que le film de Gillo Pontecorvo, « La bataille d’Alger » est un film Algero-Italien qui est considéré à juste titre comme un chef d’œuvre et sûrement le meilleur film consacré à un épisode très violent de la guerre d’Indépendance.
Je caresse d’ailleurs le rêve de faire un jour un film sur l’Émir Abdelkader afin de montrer la grandeur et l’humanité du plus glorieux et charismatique des Algériens face à la barbarie coloniale. De plus, j’aimerais que ce soit une production Algero-Française. Vous imaginez le message symbolique que ça pourrait envoyer des deux côtés de la Méditerranée ?
Le Matin d’Algérie : C’est la passion qui vous anime, comment est-elle née en vous ?
Abdel Raouf Dafri : Il n’y a que la passion qui m’anime, et pas seulement pour mon métier. Quand je donne ma confiance et ma loyauté, c’est en totale sincérité. Je peux être naïf, mais jamais totalement aveugle.
Je sais que la main qui la veille, vous flatte gentiment l’épaule peut aussi être celle qui vous poignardera dans le dos le lendemain.
Cet esprit de feu et de passion me vient de ma mère qui s’est battue sans relâche, tous les jours de sa vie, pour que ses sept enfants ne manquent jamais de rien.
À 91 ans, elle est toujours de ce monde et je m’en réjouis chaque jour tout en me demandant comment j’encaisserai son départ définitif le jour où il se produira. Et le plus tard sera le mieux…
Le Matin d’Algérie : Quelles sont les personnalités du septième art qui vous influencent ?
Abdel Raouf Dafri : Deux personnes dans le milieu du cinéma français m’ont permis de gagner ma vie et surtout de progresser dans mon écriture. Deux producteurs : Marco Cherqui (producteur du film et de la série « Un Prophète ») et Claude Chelli (producteur de la série « Braquo » et avec qui j’ai récemment signé pour un autre projet). Avec Marco, j’ai gagné un César !
Avec Claude, nous avons gagné un International Emmy Award pour « Braquo saison 2 ». Et pour couronner le tout, nous sommes devenus amis… De vrais amis !
Quant aux GRANDS artistes dont le travail a une réelle influence sur moi, ils sont principalement américains (Clint Eastwood, Stanley Kubrick, Sam Peckinpah, John Ford, Norman Jewison, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola…), Italiens (Sergio Leone, Dino Risi, Nino Manfredi, Federico Fellini…) et Anglais (John Boorman, David Lean, Michael Powell…) Dans tous les cas cités entre parenthèses, la liste est loin d’être exhaustive.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Abdel Raouf Dafri : Bien sûr ! La série « Un Prophète » est en cours de post-production et sera diffusée sur Canal Plus, au plus tôt dans le dernier trimestre de 2025, au plus tard début 2026.
Je développe avec Claude Chelli, l’adaptation de « La porte du vent », un livre écrit par un grand policier français, Jean-Marc Souvira, et qui raconte l’affrontement à Paris, de nos jours, entre les mafias juives et chinoise.
Et je me lance aussi dans l’écriture d’un roman pour une maison d’édition française que j’aime beaucoup. Ce sera un polar aussi violent qu’émouvant et surtout l’occasion de découvrir si je suis aussi bon écrivain que scénariste…
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Abdel Raouf Dafri : Pour votre dernière question, le mot le plus approprié me semble être : « Merci »
Entretien réalisé par Brahim Saci
Mardi 18 mars 2025
lematindalgerie.com
…………………………………………………………………………………………………………

L’artiste peintre Magda Hoibian lors d’un entretien exclusif à Diasporadz. Photo DR
Magda Hoibian : « La couleur est mon premier matériau de création »
L’artiste peintre et poétesse Magda Hoibian revient dans cet entretien à Diasporadz sur son parcours atypique et son art qu’elle qualifie de « singulier ».
Magda Hoibian est une artiste peintre et poétesse qui jaillit comme une lumière éclatante, salutaire et salvatrice dans cette époque troublée, écorchée aux cieux sombres. Entretien.
Diasporadz : Vous êtes artiste peintre et poétesse, qui est Magda Hoibian ?
Magda Hoibian : Une femme avant tout, mais éprise d’indépendance, très créative dans plusieurs domaines de la vie, j’ai cheminé longtemps avant de m’autoriser à me voir, à m’envisager en tant qu’artiste.
J’ai beaucoup créé, de petites choses, comme beaucoup de femmes, tout au long de ma vie, en privilégiant le développement de la créativité chez les autres, c’était vraiment une conséquence de mon éducation à la fois familiale comme celle plus vaste de la société patriarcale.
Donc, je suis une personne qui ne veut pas renier mon genre, parce que je me suis beaucoup battue pour avoir le droit de m’exprimer en tant que fille, femme, mais aussi une personne en constante évolution dans ma vie. Ce n’était pas gagné pour moi l’expression artistique professionnelle, je me souviens au lycée de banlieue où j’étais où je regardais les élèves d’option arts plastiques, avec envie, en me disant que ça me plairait, mais que je n’étais pas douée comme eux.
C’est dingue ces formatages ! Aucun professeur ne m’a jamais aidée à trouver qui j’étais profondément. Je suis donc une humaine en mouvement, la poésie, je dois cela à mon père qui avait beaucoup de recueils de la collection Pierre Seghers, que j’aimais beaucoup lire, et à une sensibilité particulière. En effet, je vois la poésie partout, dans la peinture, dans le mouvement de la vie, je suis heureuse d’avoir sans le vouloir été anormale selon la formule de ma mère.
Diasporadz : C’est l’art qui vous anime. D’où vous vient cette passion ?
Magda Hoibian : Je ne sais pas. Je n’ai pas grandi dans une famille passionnée d’art. Mais mon père qui était un grand lecteur, virus qu’il m’a transmis, avait quelques livres d’art, il aimait la photographie et la peinture, sans avoir ni le temps, ni les codes pour fréquenter les musées ou les galeries.
J’ai eu adolescente la liberté d’aller où je voulais, j’allais donc souvent au Centre Pompidou, où j’ai eu des coups de foudre pour la peinture, même si, elle me semblait hors d’atteinte car à l’époque on ne mettait en avant que des artistes hommes.
J’ai alors commencé par la musique, la guitare et le chant, puis j’ai fait du théâtre, c’était plus abordable, avant de me mettre à créer, à faire des collages, des dessins, des « petites choses ». Je me suis mise ensuite à peindre pour moi, à une époque de vie assez marginale, où ma fille n’allait pas à l’école, où le temps était libre, étirable, c’était fantastique, très créatif, très loin de la pensée scolaire, c’est là que j’ai développé plus profondément cette passion. On allait voir beaucoup d’expositions, des spectacles, et je créais en toute liberté, ce qui a été déterminant et formateur.
Diasporadz : Vous vous situez à la croisée des chemins entre l’art contemporain et l’art singulier, pouvez-vous nous expliquer ?
Magda Hoibian : Tout à fait, mon parcours n’est pas du tout académique, pas d’école d’art, j’ai eu une décennie assez marginale, mais merveilleuse, où j’étais vraiment libre.
J’avais monté un atelier de peinture et je me suis tournée vers une pratique artistique personnelle, je me suis mise à peindre.
Je ne pensais pas que l’art contemporain était quasi réservé à ceux qui sortaient des écoles (ESAD, ex-Beaux-Arts), je pensais malgré tout entrer dans la case de la peinture contemporaine, surtout avec mon évolution picturale et ma passion pour la peinture contemporaine.
Mais finalement, je ne rentrais pas dans la case, le terme d’art singulier, me va mieux et il y a beaucoup de rencontres entre l’art singulier et l’art contemporain.
Je suis singulière de par mon parcours atypique et contemporaine peut-être aussi de par certaines peintures, mais à dire vrai je ne crois pas que cela soit finalement si important.
Diasporadz : Vous avez le génie des couleurs, votre peinture interpellent et éveille les sens, comment faites-vous ?
Magda Hoibian : Merci beaucoup, je suis très touchée. Mais je me contente seulement de faire ce que j’aime et je travaille beaucoup intuitivement, avec mon inconscient, la peinture ne fait qu’un avec moi.
J’ai toujours aimé les couleurs et je déplore le manque du sens des couleurs en France. L’hiver est gris et triste et presque tout le monde revêt un anorak noir, les maisons sont crépies de couleurs ternes, les intérieurs peints en beige et gris.
J’aime la vivacité des couleurs, vous la voyez dans ma peinture, je mets des couleurs partout, mes vêtements, les lieux où je vis, j’ai aussi eu les cheveux roses, orange avec le henné ma couleur favorite.
La couleur est mon premier matériau de création. Si ma peinture éveille les sens, alors je ne travaille pas pour rien. Nous vivons dans un monde trop raide, les humains de ce pays ne se touchent pas et c’est pire depuis la pandémie.
Moi, je caresse les plantes, je souris au vent, je me couche sur la terre, je chante avec le feu, c’est le chant des éléments. Si ma peinture participe à l’harmonie des êtres avec tout ce qui nous entoure, j’en suis heureuse.
Diasporadz : Quels sont les peintres qui vous influencent ?
Magda Hoibian : Beaucoup évidemment, je peux citer Sonia Delaunay, Chagall, Matisse, mais je découvre chaque jour de nouveaux artistes du monde entier.
J’utilise beaucoup l’excellent site AWARE qui met en avant les artistes femmes, mais aussi Instagram, je partage volontiers dans mes stories mes coups de cœur. J’aime les artistes d’Amérique latine, très reliés à la terre, aux éléments du vivant, avec une spiritualité ouverte, mais aussi les artistes du Maghreb, très colorés, très riches de par leur histoire, et plein d’autres avec qui je me sens des affinités diverses et variées.
Diasporadz : Le chercheur Arno Sternqui a créé le concept scientifique de Sémiologie de l’Expression, les aspects pratiques du Jeu de Peindre et du Closlieu, nous a quittés le 30 juin 2024 à l’âge de 100 ans, parlez-nous de votre travail avec lui ?
Magda Hoibian : Je n’ai pas travaillé avec lui, j’ai suivi une formation avec lui. Je connaissais son travail depuis longtemps ayant travaillé avec des enfants, dans ma jeunesse, j’avais lu un de ses livres, et j’aimais son approche de la peinture spontanée pour les enfants.
J’ai toujours proposé de la peinture libre aux enfants avec qui j’avais l’occasion de travailler. Ensuite, en 2010 je crois, j’ai donc payé pour un stage avec lui. Et dans la foulée j’ai ouvert mon association du jeu de peindre Les Ateliers L’envol. Actuellement, c’est fermé, mais je souhaite vivement rouvrir, lorsque je serais installée à Châtellerault dans les mois à venir.
Arno Stern a toujours clamé que les enfants traçaient sans faire de l’art, que l’art appartenaient aux seuls artistes, mais je crois que c’est plus subtil que cela, et je connais plusieurs artistes qui, enfants, fréquentaient son atelier.
Diasporadz : Peut-on dire que l’art singulier est en perpétuel évolution ?
Magda Hoibian : Je ne sais pas, mais je l’espère vivement. Mais tout est en perpétuelle évolution, nous-mêmes avec tout ce qui nous entoure.
Espérons que notre incroyable planète puisse encore avoir des océans merveilleux pleins de vie, des terres grouillantes de vers et d’insectes, de plantes fantastiques, d’arbres extraordinaires, d’oiseaux si variés, que j’aime tant, et parmi tout ce vivant, des artistes singuliers, des architectes respectueux, des poètes chantants, des femmes puissantes et respectées, des bébés heureux, des mammifères tranquilles, des voies vertes, des chevaux, des évolutions singulièrement attirantes et tirant vers le vivant durable.
Diasporadz : Vous êtes aussi poétesse, un mot sur votre poésie ?
Magda Hoibian : Je suis poétesse, c’est vrai, je n’avais pas prévu cela, je ne sais plus comment cela a commencé… Je me suis empêchée d’écrire quelques années, car c’était le domaine de ma fille Zoé, qui écrivait de la poésie et des romans. Elle a arrêté pour le moment et ça a rejailli chez moi. J’en fait des lectures, mais j’ai le projet de proposer mon tapuscrit. Je crois que mon écriture est intuitive et chantante, relativement, j’aime la relation à l’écriture, elle est différente et complémentaire à la peinture. Cela me fait aller plus loin. Ma poésie est proche du quotidien, douce et vive à la fois, souvent elle me dépasse, elle va plus loin que moi.
Diasporadz : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Magda Hoibian : Actuellement, je suis avec mon compagnon dans une belle maison atelier, en campagne du sud de l’Indre et Loire. Nous l’avons rénovée, peinte en partie, et nous allons la mettre en vente pour rejoindre la ville où il travaille, Châtellerault. Là-bas, je veux remonter mes Ateliers du Jeu de Peindre, mais aussi essayer de monter une galerie associative.
Je crois à l’idée que les artistes peuvent devenir des commissaires d’exposition, j’aime mettre en avant d’autres artistes et créer des événements. Tout cela prendra un peu de temps, mais je pense que c’est possible.
Je suis aussi en train de préparer des œuvres en broderie, une série de constellations imaginaires, et des enregistrements de poèmes que je souhaite coupler avec des peintures.
Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?
Magda Hoibian : Gracias a la vida, comme l’a écrit et chanté Violeta Parra, protégeons cette belle vie mouvante, et merci de tout cœur cher Brahim.
Entretien réalisé par BRAHIM SACI
6 mars 2025
diasporadz.com
………………………………………………………………………………………….

Magda Hoibian : une artiste peintre et poétesse singulière
Magda Hoibian est une artiste peintre et poétesse singulière, aux origines Slave et Suisse. Elle a grandi à Fontenay-sous-Bois, puis a vécu sa « période nomade » avant de s’installer en Touraine, à Betz-le-château.
L’artiste peintre et poétesse Magda Hoibian expose régulièrement ses œuvres artistiques et propose son travail en ligne et dans des lieux publics ou privés.
Magda Hoibian a développé au fil des années un style et une approche artistique quasi propre à elle, sa démarche et sa vision à l’élan poétique élevé la placent au rang des peintres et poètes qui se démarquent et sortent des sentiers battus par leur expression libre. C’est ainsi qu’elle parvient à saisir l’insaisissable dans l’essentiel, de la terre au ciel sans jamais perdre l’inspiration qui jaillit telle une source salvatrice ou une oasis salutaire des brûlants déserts.
Nous pouvons dire que Magda Hoibian se situe, comme elle le souligne elle-même, à la croisée des chemins entre l’art contemporain et l’art singulier, mais son exploration artistique va au-delà car elle a su développer son style particulier, écartant les influences pour se frayer sa propre voie, et l’on est frappé par la profusion des couleurs qui atteignent le cœur et l’esprit de l’averti et du non averti.
Sa formation non académique l’a libérée des lignes tracées des modes et des courants artistiques en vogue, ce qui lui a ouvert les ailes sans entraves ni contraintes liées aux illusions du monde créé, affinant sans cesse son approche intrinsèque et fondatrice d’un imaginaire renouvelé et sans limites.
Si Magda Hoibian visite les concepts c’est pour s’en éloigner afin de ne pas restreindre sa vision large qui va au-delà des horizons et des abstractions qui pourraient limiter la portée de son élan artistique quasi spirituel, dans les limites du ciel ouvert vers des univers insoupçonnés d’où prennent forme des créations dans la passion, la grâce et l’émotion dans le souffle des âmes.
Cet art singulier traversant les courants ayant comme ancrage le large nous amène plus loin que les rives existantes d’une histoire de l’art figée. Ces nouvelles expressions hors normes, faisant fi des conventions, jaillissent de la spontanéité contrastant avec l’intellectualisation académique, mais sans fracture et rivalité, le tout dans une nouveauté émancipée, renouvelée.
Le désir de liberté dans l’expression artistique l’a quelque peu mise en marge tout en la propulsant au large de cet océan de l’art où l’on ne se noie que pour renaitre, enrichissant ainsi la palette des couleurs et des émotions, dans une recherche incessante de volupté, dans une peinture qui s’interroge afin d’aller toujours plus loin dans la prospection, d’un univers libéré et sans dualité.
Magda Hoibian expose et ouvre les portes de son atelier de façon régulière. Magda Hoibian nous monte que la peinture ne doit pas être cantonnée, enfermée mais au contraire, libérée, partagée.
BRAHIM SACI
https://magda.hoibian.com/
diasporadz.com

………………………………………………………………………………………….

Farid Mammeri : « J’ai eu la chance de naître dans une famille où l’on baigne très tôt dans l’art et la culture »
Farid Mammeri est un immense artiste, il y a chez lui des talents à foison, il porte toute cette dimension artistique dans son regard profond où s’expriment des couleurs et des émotions, pour l’œil avisé, il n’a pas besoin de peindre, il est le tableau.
Farid Mammeri est un artiste éclectique, il est peintre, poète, écrivain, journaliste, homme de radio et il excelle avec force et humilité dans toutes les expressions artistes qu’il embrasse.
Il a été animateur, producteur d’émissions à Radio Chaine 3 pendant de longues années, où s’exprimait déjà généreusement sa vision artistique. Beaucoup ont en mémoire ses émissions de haute volée, où le cœur côtoyait l’esprit.
Farid Mammeri est natif du beau village Taourirt Mimoun, At Yenni, wilaya de Tizi-Ouzou, village natal de Mouloud Mammeri, à proximité des villages d’Ath Laṛbâa, de Tigzirt, de Tassaft Ouguemoun et Yatafene.
Toute la création de Farid Mammeri est un souffle, une respiration. Le génie créateur de Farid Mammeri magnifie l’expression artistique en l’élevant vers les plus hautes cimes, vers l’élan poétique des sublimes rimes.
Ses tableaux sont un jaillissement de lumière, tel un geyser, c’est le soleil d’Afrique avec sa lumière éclatante, celle qui a émerveillé et a fait créer beaucoup de grands peintres.
Farid Mammeri a dans ses œuvres cette sublime lumière recherchée par tous les peintres.
Ce qui frappe le plus, c’est cette lumière et ces couleurs qui donnent à ces œuvres une dimension poétique insoupçonnée, dans une transfiguration du réel, mettant tous les sens en éveil pour en saisir la moindre émotion, et ne rien perdre de l’intensité qui nous enveloppe.
Les tableaux de Farid Mammeri accaparent le regard pour ne plus le lâcher. Dans cette profusion de couleurs jaillissent des émotions qui relient le cœur à l’esprit.
Il y a dans l’élan créateur de Farid Mammeri cette volonté de transmission, pour insuffler des espoirs. Il y a dans ses tableaux cette élévation quasi spirituelle qui réchauffe le cœur et donne des ailes, dans une vision sans cesse renouvelée d’un avenir meilleur où l’art fait naître des bonheurs.
La peinture de Farid Mammeri témoigne de la richesse de la culture berbère, dans sa diversité, elle continue de susciter l’admiration, la fascination et l’intérêt, elle continuera d’influencer les générations, car justement, elles s’ouvrent et ne referment pas l’horizon.
Le Matin d’Algérie : De l’université, à la poésie, à la peinture, au journalisme, à la radio, qui est Farid Mammeri ?
Farid Mammeri : Question difficile me semble-t-il, puisqu’il s’agit d’englober en quelques mots tout un parcours de vie, des moments privilégiés, des activités liées à une opportunité favorable ou tout simplement un désir d’expression.
Produire des émissions de radio a été un peu le fait du hasard mais on y prend très vite goût. Les émissions que j’ai eu à produire de « Chroniques des Arts » à « Esquisses » m’ont permis de rencontrer nombre d’acteurs efficients de notre culture.
C’est un véritable bonheur que de rencontrer Mahieddine Bachtarzi, Abdelkader Alloula, Kateb Yacine, Mohammed Khadda, Merzak Allouache, Slim, Wim Wenders, Julos Beaucarne, Jean-Jacques Beineix… La liste est longue sur dix-sept ans de radio.
Concernant la peinture et la poésie, j’ai eu la chance de naître dans une famille où l’on baigne très tôt dans l’art et la culture. Il y a d’ailleurs deux grandes figures, Da Mouloud (Mouloud Mammeri) par la littérature et Da Azouaou (Azouaou Mammeri) pour la peinture. Sans compter que ma propre mère était artiste à sa façon, elle m’a initié au dessin et à l’écriture très tôt.
Le Matin d’Algérie : Votre peinture est époustouflante, c’est le soleil d’Afrique, c’est un jaillissement de lumière, comment réussissez-vous cette magie ?
Farid Mammeri : Nous baignons dans une culture, on s’en imprègne dès l’enfance pour peu que l’on s’y intéresse. J’ai passé ma scolarité chez mes grands-parents à Tizi-Ouzou, mon grand-père avait récupéré des toiles de Da Azouaou, de son atelier à Sidi-Moussa et elles étaient accrochées un peu partout dans la maison. J’ai ouvert mes regards d’enfant sur ces merveilles.
Par la suite, au lycée El-Mokrani, j’ai eu la chance d’avoir comme professeur de dessin Oscar Spielmann, peintre tchèque reconnu.
Il nous a initié à l’art pictural comme l’aurait fait un professeur des Beaux-Arts, pendant deux années, 6è, 5è, une fois il m’a convoqué pour me dire que j’étais l’élève le plus doué de ses 6è. Concernant la lumière, c’est l’une des belles caractéristiques de notre Algérie, que ce soit au nord ou dans le sud.
Je me souviens notamment de ces splendides couchers de soleil dans le Hoggar, ou des magnifiques journées à Ath Yenni à contempler le Djurdjura.
Le Matin d’Algérie : On sent dans vos œuvres cette volonté de transmission, qu’en pensez-vous ?
Farid Mammeri : Nous portons tous en nous cette part d’humanité dans ses héritages culturels. Chacun les revisite à sa façon, en cela on se distingue des artisans qui eux recréent de mémoire » l’héritage ancestral.
Mon village natal est connu pour être celui des « forgerons », tout aussi bien du métal que du verbe. L’art se nourrit de l’art, dit-on. On ne crée pas ex-nihilo mais en fonction de toutes nos rencontres, y compris les plus éphémères ou fugaces. Autant de trésors voués à l’oubli que la mémoire retrouve et se réapproprie, d’une façon différente, certes, mais fidèle dans l’esprit, à l’héritage des ancêtres
Le Matin d’Algérie : « …quel que soit le point de la course où le terme m’atteindra, je partirai avec la certitude chevillée que, quels que soient les obstacles que l’histoire lui apportera, c’est dans le sens de sa libération que mon peuple (et à travers lui tous les autres) ira. L’ignorance, les préjugés, l’inculture peuvent un instant entraver ce libre mouvement, mais il est sûr que le jour inévitablement viendra où l’on distinguera la vérité de ses faux semblants. Tout le reste est littérature. », que pensez-vous de cette déclaration de Mouloud Mammeri à Tahar Djaout ?
Farid Mammeri : C’est un passage dans l’entretien, peut-être prémonitoire, qui sait ? Mais qui est dans la suite logique de l’entretien entre Djaout et Da Lmouloud. Le projet de Laphomic s’est malheureusement arrêté à cet entretien. Ahmed Bounab, le directeur de cette édition, avait pour projet de faire plusieurs numéros dans le même style, un journaliste qui interroge un auteur, il s’est avéré qu’il n’y a pas eu de suite pour diverses raisons.
Pour en revenir à la citation, elle résume assez bien la pensée de Mouloud Mammeri concernant la culture au sens noble, qu’il s’attachait à préserver, défendre et propager par une transmission écrite. Il refusait celle des ghettos qui sécurisent peut-être mais stérilisent sûrement.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un artiste fascinant, vous excellez dans beaucoup d’expressions artistiques, vous passez d’un art autre, comment faites-vous ?
Farid Mammeri : Vous êtes cher ami conscient que je peux vous retourner le compliment puisque vous vous-même, vous êtes aussi bien poète que musicien chanteur.
Pour nous l’essentiel est l’expression, quelle que soit la forme qu’elle puisse prendre. On choisit celle qui nous traduit le mieux à un moment donné. Cela peut même parfois être le silence méditatif ou contemplatif.
Lorsque j’étais étudiant, nous avions créé un groupe autour de la poésie illustrée, ceci pour contourner la non publication de la poésie par les maisons d’édition et par là même la censure éventuelle qui pouvait s’opérer. Nous faisions nos expositions dans les campus universitaires et à la fac centrale d’Alger.
Ces expositions permettaient aussi des débats avec nos condisciples et nos amis étudiants.
Le Matin d’Algérie : Quel regard portez-vous sur la création artistique, la peinture en particulier, en Algérie ?
Farid Mammeri : Du temps où j’ai vécu à Alger, j’ai pu me rendre compte de l’extrême richesse de la création artistique avec un très large éventail comprenant aussi bien l’art naïf, l’art abstrait ou l’art figuratif.
Je peux citer tous les noms mais je peux renvoyer à l’excellent ouvrage de mon ami Ali El Hadj Tahar ou au dictionnaire du regretté Mansour Abrous.
De mon temps, j’ai pu encourager en les exposant au cercle Frantz Fanon, à Riadh El Feth, les talents naissants qui ont confirmé par la suite l’excellence de leurs promesses.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes aussi journaliste, homme de radio, pouvez-vous nous en dire un mot ?
Farid Mammeri : Cela fait bien longtemps que je ne produis plus d’émissions culturelles à la radio. Peut-être parce que le seul moment où cela m’a intéressé c’était lorsque j’étais à Alger, à la chaîne 3 et que cela concernait mon vrai public, les miens dans mon pays.
Il y avait une vraie dynamique en ce temps là avec comme directeur, j’en profite pour le saluer, Rachid Boumediène, et à la production le regretté Lotfi Madani. Nous étions une vraie équipe et dans les années 80 nous étions la première radio en termes d’audience.
Le Matin d’Algérie : Quel sont les peintres qui vous influencent ?
Farid Mammeri : Des premiers peintres ou graveurs du Tassili qui nous ont légué de magnifiques fresques, à tous les peintres depuis Giotto, Van Gogh, Picasso, Issiakhem, Baya, Bourdine, Hakkar, Ziani, l’éventail est grand de tous ces artistes qui nous émerveillent.
Chacun y apporte sa touche, son génie, sa créativité. Les émotions qu’ils nous procurent sont certes différentes mais il n’en demeure pas moins qu’elles sont efficientes.
Je peux être tout autant sensible à un dessin d’enfant pour peu qu’il y ait un supplément d’âme dans son expression.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur Mouloud Mammeri ?
Farid Mammeri : Nous venons de rendre hommage le 26 février dernier à l’ACB à Da Lmouloud, que dire ?
L’émotion est toujours aussi forte à l’évocation de sa disparition brutale. Il avait encore tellement de choses à dire, de terrains à défricher, de talents à permettre d’éclore.
Pour ma part, j’aurais aimé continuer le dialogue que nous avions toujours lors de nos rencontres familiales, que ce soit à Alger ou à Taourirt-Mimoun, avec sa fameuse colline.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Farid Mammeri : J’ai en projet une prochaine exposition de peintures à l’ACB entre avril et mai, ce sera l’occasion de revenir sur la thématique des printemps des libertés puisque mon exposition s’inscrit dans ce cadre.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Farid Mammeri : Merci à toi, Brahim, pour tout le travail que tu entreprends, tant par ta créativité en tant qu’auteur et musicien que passeur, média permettant l’expression des autres.
Entretien réalisé par Brahim Saci
mercredi 5 mars 2025
lematindalgerie.com
………………………………………………………………………………………….

Boudjema Aït Aoudia : « Taqbaylit d tamedyazt »
Boudjema Aït Aoudia est un poète hors du commun, hors des sentiers battus, c’est un poète du terroir, il magnifie et cisèle la langue kabyle avec une dextérité rare, une langue qu’il versifie et orne tel un orfèvre, les poèmes de Boudjema Ait Aoudia sont le diamant et l’écrin, sa poésie semblent bénéficier de la protection et de la bénédiction des ancêtres, dans un souci de transmission et de préservation des valeurs ancestrales berbères kabyles, plusieurs fois millénaires.
Boudjema Ait Aoudia vient de publier un magnifique recueil de poésie en langue kabyle « Tamuɣli-w » chez les éditions Tanekra, créées par le poète écrivain Amar Gacem, auquel Boudjema Ait Aoudia a rendu un vibrant hommage, au café littéraire parisien de l’impondérable, invité par Youcef Zirem.
Nous avons pu voir la grandeur et la profondeur du poète lors de ses lectures et de ses échanges avec le public où l’émotion était à son paroxysme, captant admirablement l’attention des gens présents, ajoutant à l’atmosphère conviviale une brise de fraternité.
Boudjema Ait Aoudia a également rendu hommage à Nour Ould Amara qui nous a quittés prématurément il y a quelques années à la suite d’une longue maladie, Boudjema Ait Aoudia nous a raconté combien Nour reste toujours présent dans son cœur et sa mémoire, il n’oublie pas son amitié et ses encouragements.
Ce magnifique recueil de poésie « Tamuɣli-w » est préfacé par le talentueux Djamel Arezki, qui a su libérer sa plume pour aller vers l’essentiel, tout en creusant pour en saisir la profondeur et la portée de l’élan poétique de Boudjemaa Ait Aoudia.
Boudjemaa Ait Aoudia est le poète vrai, la poésie est chez lui une manière d’être, c’est un humaniste généreux, il dédie d’ailleurs son recueil à son village Ait Antar, ce beau village de la commune d’Ait Yahia à proximité des villages Ait Djebbara et Tagoulmimt.
Il dédie également ce recueil à sa famille et ses amis, Dda Salem Ould Slimane, le père du célèbre artiste Mennad, Mhenna Boudinar, Nour Ould Amara, Moumouh Icheboudene, Hanafi Ait Mimoune, Amar Ould Mohand, Abdelghani Ouali, Idir Madadi, Ali Belarif, Adjoudj Ahmed, Ahmed Boualili, Bachir Bouadaoud, Bahi Hamadi, Trifi Naziha, Naima Bibi, Amokrane Ait Ouyahia, Fasia Hafsi, on peut aisément mesurer la générosité du poète par l’énumération de tous ces noms, chose, tout de même assez rare.
Cet élan du cœur inonde évidemment sa poésie, et l’œil averti ou pas se retrouve happé par la beauté poétique qui s’élève atteignant les cimes magnifiant chaque rime.
Boudjemaa Ait Aoudia anime une émission hebdomadaire sur la poésie « Agraw n imedyazen » dans ce nouveau média qui vient de naître comme une bouffée d’oxygène dans le paysage médiatique, Voix-Med Radio-TV.
Quand on lit Boudjema Aït Aoudia, on se dit que la poésie en langue kabyle a encore de beaux jours devant elle.
Le Matin d’Algérie: De la Kabylie à Paris, qui est Boudjema Aït Aoudia ?
Boudjema Ait Aoudia : Tout d’abord merci pour l’intérêt que vous portez à ma modeste réalisation poétique et littéraire, si je puis dire ainsi.
De la Kabylie à Paris, c’est toujours le même Boudjema Ait Aoudia, certes, aguerri, malgré le poids de l’exil, mais je suis resté toujours moi-même, simple, modeste et surtout humain.
J’ai toujours milité en faveur des causes justes en l’occurrence la revendication de notre identité, la langue et la culture amazighes.
J’ai découvert la poésie très jeune et j’ai commencé à déclamer les premiers vers au collège, je n’avais pas encore 14 ans. Mais c’était plus de la poésie révolutionnaire souvent d’auteurs inconnus.
J’ai grandi dans cet univers poétique merveilleux qui m’a permis de résister aux difficultés de la vie, de positiver et de croire en un avenir meilleur, ce qui m’a aidé à surmonter les difficultés de la vie.
Le Matin d’Algérie : Comment un poète de votre envergure a-t-il mis si longtemps pour publier ?
Boudjema Aït Aoudia : Merci pour ce compliment d’envergure ! Croyez-moi, ce n’est pas de la fausse modestie mais je ne me vois pas, comme on aime bien me nommer, un « grand poète ». J’aime la poésie et j’essaie de l’élever et de l’amener aux cimes qu’elle mérite.
À propos de la publication tardive, je pense qu’on n’est pas toujours les maîtres de ce qui doit être réalisé. Au moment où vous vous dites, je suis prêt, un empêchement inattendu survient comme tombé du ciel.
Et au moment où vous perdez espoir en baissant les bras, une porte s’ouvre quelque part comme par magie, et vous redonne un nouveau souffle et vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. N’est-ce pas le destin peut-être ?
Et le poète est l’une des clés du mystère. J’avais dès mon jeune âge cette envie de publier un jour mes poèmes, mais les conditions ne le permettaient pas. Les obstacles étaient nombreux, manque de moyens financiers, de moyens techniques et humains et surtout manque de liberté.
À l’époque, ceux qui maîtrisaient l’écriture en tamazight étaient peu nombreux. L’accès à l’ordinateur n’était pas à la portée de tous comme aujourd’hui. L’imprimerie qui accepte d’imprimer un livre en tamazight est rare pour ne pas dire introuvable. À tout cela s’ajoute la volonté politique visant par toutes ses entraves à ralentir au maximum la promotion et l’émancipation de l’écriture et de la lecture en tamazight.
Vous comprenez très bien à quel point il était difficile d’éditer un livre en Berbère surtout pour un jeune chômeur. Mais l’envie d’écrire à toujours été là, la poésie fait partie de moi, elle est ma respiration.
C’est en 2001, à mon arrivée en France, que mon meilleur ami Nour Ould Amara, enseignant de tamazight et producteur animateur d’émissions à Berbère télévision, a réveillé en moi ce rêve de publier. Il m’a offert un ordinateur et m’invita régulièrement à Berbère télévision lorsqu’elle était rue du Cherche-Midi dans le XIe arrondissement de Paris, Nour était un grand homme de culture, il a laissé des émissions mémorables.
Nour Ould Amara tomba malheureusement malade, mais il a continué à m’encourager et à m’aider malgré sa maladie. De grands hommes comme Nour Ould Amara sont rares aujourd’hui.
La maladie a malheureusement pris le dessus après 7ans de lutte et de résistance, que sa belle âme repose en paix, et là encore c’est une porte qui se ferme, qui met fin à mon rêve.
Mais son départ tragique a amplifié mon inspiration. Il est omniprésent dans mes pensées, il continue toujours à m’encourager et moi je continue à écrire.
C’est en 2022 que je croise un nouvel ami, lui aussi enseignant de tamazight et qui, après lui avoir raconté un peu mon parcours, a voulu prendre la relève et se charger de la saisie et de la correction de mon futur livre. Il s’agit de mon ami Mohammed Gaya. En l’espace de 3 mois environ et avec la contribution précieuse de mon ami Djamel Arezki qui a corrigé et par la suite préfacé mon livre et les encouragements de mes mis, Bachir Boudaoud, Nadia Ladj, Naziha Trifi, Ali Belarif, Amar Gacem, Amokrane Ould Younes et tant d’autres, mon petit bijou, mon recueil « Tamuɣli-w » a vu le jour, cela restera l’un des meilleurs jours de ma vie.
N’est-ce pas encore un imprévu qui m’ouvre cette porte que je croyais fermée à jamais ?Vous connaissez maintenant les raisons de ma publication tardive.
Le Matin d’Algérie : Le génie poétique vous habite, racontez-nous ?
Boudjema Aït Aoudia : Encore merci pour le compliment.
Je ne sais pas vraiment si un génie poétique m’habite, mais c’est mon refuge. C’est un peu mon Amghar azemri, chez qui je trouve des réponses à mes interrogations, de la patience, du courage, de l’amour, de la sagesse et de la compassion.
Vous savez, on a grandi moi et mes sœurs dans la pauvreté. Mon père (at irhem rebbi) était très malade, de l’hôpital à la maison de repos et puis à l’hôpital. C’est ma mère qui s’est chargée de notre éducation (que Dieu lui prête longue vie), elle a eu une vie pénible sans jamais se plaindre.
Ma mère, cette femme admirable, était toujours aux champs par tous les temps, à cultiver, oignons, pommes de terre, navets, tomates, citrouilles, ramasser les olives, faucher et ramasser le foin, je la voyais parfois les yeux brillants contenant des larmes qui ne sortaient pas.
Je reste marqué par les hivers des années 70 où nous devions manger vite le soir pour aller dormir chez une vieille voisine (paix à sa belle âme) de peur que notre maison complètement dégradée nous tombe dessus.
Toutes ces péripéties et souffrances ont contribué à forger mon expression artistique. J’essaie d’apporter dans mes poèmes, de l’amour, du courage, de la patience et du soutien à tous ceux qui en ont besoin, les orphelins, les malades, les prisonniers, les opprimés, les pauvres, d’où jaillit ma source d’inspiration, car je hais l’injustice.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les poètes kabyles qui vous influencent ?
Boudjema Aït Aoudia : J’ai eu la chance de grandir dans un milieu féminin entouré de femmes courageuses et responsables dont faisaient partie mon arrière-grand-mère paternelle, mes deux grands-mères, ma tante et ma mère. C’est chez elles, sans doute, que j’ai entendu les premières berceuses avec des rimes captivantes. Ces femmes étaient marquées par les tragédies de la guerre de libération nationale à laquelle elles ont pris part, elles ne cessent de réciter des poèmes révolutionnaires dont certains sont de leur propre composition et d’autres d’auteurs inconnus et voir même de certains moudjahidine (maquisards).
Quelque temps plus tard, nous eûmes la chance d’avoir notre première radio (transistor), achetée par ma mère grâce aux petites économies réalisées dans la vente d’œufs, de lapins, foin, et quelques légumes de saison.
C’est à travers cette radio que j’ai découvert le chanteur Taleb Rabah (paix à son âme) avec son chef-d’œuvre Ttrunt wallen jarhent d idammen, (les yeux pleurent et saignent), une chanson qui raconte la douleur, l’injustice mais aussi le courage qui régnaient pendant la guerre d’Algérie de 1954 à 1962.
J’ai continué à écouter régulièrement, Taleb Rabah, ce génie poétique qui m’a sans doute influencé pour continuer à persévérer dans la poésie.
Bien entendu, je ne peux nier l’apport incontestable de nos grands poètes, Mohamed Belhanafi, Ben Mohamed, Si Muh U Mhend, l’incontournable Slimane Azem, le vagabond Si Muhend Ouyidir, l’oublié Si Muhand Said Amlikech dont on ne parle pas ou très peu, le précurseur Youcef Uqasi, Si Yusef Ulefqi.
Hadjira Oubachir est aussi une poétesse incontournable dans la poésie féminine kabyle, elle nous transmet par sa poésie les valeurs kabyles.
Le Matin d’Algérie : La langue kabyle semble ne faire qu’un avec la poésie, chaque mot prononcé a une dimension poétique, qu’en pensez-vous ?
Boudjema Aït Aoudia: Oui, vous avez entièrement raison. La langue kabyle déborde de sens, de métaphores et souvent de mots composés où chaque mot prend des fois la place d’une phrase, comme le souligne le proverbe suivant, anheddar cwit, anfahhem atass, (parler peu et comprendre beaucoup).
Le kabyle est une langue riche, quand on la maîtrise on se régale, dans l’écoute et le discours, que ce soit dans Tajamaat ou dans le règlement de différends. Les mots dépassent parfois le sens.
Dans les fêtes kabyles on entend toujours des poèmes chantés par les femmes (Izlan).
Taqbaylit d tamedyazt, la langue kabyle est poésie.
Le Matin d’Algérie : À l’heure des réseaux sociaux, la poésie kabyle est-elle encore vivante ?
Boudjema Aït Aoudia : C’est une question un peu complexe qui nécessite un débat sérieux et approfondi mais je pense que les réseaux sociaux sont un plus non négligeable pour la promotion et la vulgarisation de cette poésie ancestrale.
Si, Si Muh U Mhand avait eu internet et les réseaux sociaux, on aurait pu sauvegarder beaucoup plus de ses poèmes.
Certes, il y a beaucoup de médiocrité dans les réseaux sociaux, mais c’est à nous d’inonder ces plateformes avec des produits sérieux, éducatifs et instructifs. Il faut impérativement prendre le dessus sur ceux et celles qui s’exhibent sur les réseaux sociaux pour détourner, salir et banaliser notre culture.
Mais, il n’y pas de raison de désespérer, la poésie kabyle se porte bien, il y a beaucoup de talents, poètes et poétesses qui veillent sur cet héritage inestimable.
Le Matin d’Algérie : Quel regard portez-vous sur la poésie d’aujourd’hui ?
Boudjema Aït Aoudia : J’ai un regard plutôt positif, même si l’histoire nous a montré que beaucoup de grands poètes ont été découverts et admirés que très tard, voir même après leur disparition, Youcef Uqasi, Si Mohand Said Amlikech et beaucoup d’autres.
Aujourd’hui la scène déborde de poésie et de grands poètes parmi lesquels on peut citer, Amar Gacem, Brahim Saci, Hadjira Oubachir, Ghani At Hemmouche, Amokrane Nait Ouyahia, Wanza, Amirouche Amwanes, Mernissa Kedouni, la liste est encore longue.
Donc, pour répondre clairement à votre question, je dirai que la poésie se porte merveilleusement bien.
Le Matin d’Algérie : La poésie enrichit le cœur et élève l’esprit, peut-elle contribuer à l’émancipation des sociétés ?
Boudjema Aït Aoudia : Bien sûr que oui, la poésie aide à se sentir connecté avec soi-même et ce n’est pas rien, c’est même magique de se sentir en compagnie de soi-même. La poésie permet de combattre la solitude et tout ce qu’elle engendre comme angoisse et souffrance.
La poésie nous permet d’atteindre ce qu’il y a de plus vrai, de plus sensible en soi, en mettant du sens, en éveillant les cinq sens et parfois moi au-delà.
La poésie permet de développer l’imaginaire. Elle nous permet de dénoncer les injustices et contribue à faire adhérer des personnes à des causes justes.
Les poèmes sèment l’amour, le pardon, l’union, la tolérance, la joie, le partage, l’entraide, la poésie permet de mettre des mots sur des maux pour apaiser l’esprit, calmer la douleur, guerir les blessures et croire en un avenir meilleur.
Imaginez un monde où règnent l’amour, la justice, la joie, le pardon, la tolérance, l’entraide et où sont absents la haine, la violence, le mépris, l’injustice !
Seule la poésie peut nous rapprocher d’un tel monde paradisiaque.
Le Matin d’Algérie : Beaucoup de chanteurs kabyles ont fait carrière sur la sueur des autres, en chantant des poètes dont ils taisent les noms, ceci doit cesser, qu’en dites-vous ?
Boudjema Aït Aoudia : Absolument ! Il faut que cela cesse, comme vous le dites si bien.
Sans citer de noms, (du moins pour l’instant), beaucoup se sont fait un nom sans avoir jamais composé un vers poétique. Ils se sont enrichis avec la sueur des autres sans avoir l’honnêteté de citer les noms des auteurs de ces textes.
Je ne suis pas contre le fait de chanter les textes d’autrui, bien au contraire, le meilleur hommage qu’on peut rendre à un poète ou à un chanteur c’est de reprendre ces textes ou ses chansons.
Même lorsqu’il s’agit de textes d’auteurs inconnus, il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de le signaler. Mais se faire passer pour un auteur compositeur de ce qu’on n’a jamais composé c’est de l’ingratitude, de l’hypocrisie et de la trahison. Il faut que cela cesse.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Boudjema Aït Aoudia : je viens de rééditer en France mon recueil de poésie intitulé, Tamuɣli-w, chez les éditions Tanekra de mon ami Amar Gacem, je le laisse faire son petit bout de chemin. J’ai entamé l’écriture d’un autre livre de poésie où il y aura justement des textes magnifiques d’auteurs inconnus dont certains ont été repris sans la moindre précision, c’est peut-être une façon de crever l’abcès !
J’ai d’autres projets plutôt collectifs, notre association AFAB (l’association franco-amazighe de Bobigny), que j’ai l’honneur de présider, prépare un grand salon du livre pour l’automne prochain à Bobigny et nous sommes en discussion sur la tenue d’un éventuel salon de peinture au printemps, toujours à Bobigny.
J’anime une émission hebdomadaire sur la poésie, Agraw n imedyazen, sur ce nouveau média qui vient de naître, Voix Med Radio-tv. La poésie a encore de beaux jours devant elle.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Boudjema Aït Aoudia : j’ai passé un excellent moment lors de cette interview, je vous remercie beaucoup du temps que vous m’avez accordé. Mon dernier mot est peut-être le souhait de voir la paix, l’amour et la justice dans le monde et dans notre beau pays L’Algérie.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Livre publié :
Tamuɣli-w, éditions Tanekra.
youtube.com/@voixmedRADIOTV
Lundi 17 février 2025
lematindalgerie.com
…………………………………………………………………………………………..

Akli Ourad : « De Londres à Jérusalem, Terreur Promise »
Akli Ourad nous surprend avec la publication d’un récit poignant, dans la narration et dans l’invraisemblable, un livre vraiment surprenant de vérités jaillissantes.
Paru aux éditions Casbah en Algérie, ce livre intitulé « De Londres à Jérusalem, Terreur Promise » – un titre bien choisi qui en dit long – est bouleversant, et Akli Ourad a l’art de raconter dans un style fluide, sans artifices, sans figures de styles lourdes et ennuyantes, il a l’art de nous mener sans détours vers l’essentiel.
Le lecteur est accaparé par le poignant récit, d’une semaine passée en juin 1999 dans les territoires de la Palestine occupée, Akli Ourad met en exergue un système d’apartheid érigé en institution qui rend pénible la moindre bouffée d’oxygène.
Depuis 1948 que cet état défie toute justice, greffé par la violence par les puissances occidentales sur la Palestine historique, une violence qui ne fait qu’empirer depuis, en effet, après une plainte de l’Afrique du Sud, Pretoria accuse Israël de violer la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans sa guerre menée à Gaza, la Cour Internationale de Justice (CIJ) avait statué en mettant en cause Israël et a considéré qu’il existait un risque plausible de génocide à Gaza ; elle ordonnait que des mesures conservatoires soient prises pour préserver les droits de la population palestinienne, le 19 juillet 2024, la CIJ estime que l’occupation du territoire palestinien par Israël (par ex., Gaza, Cisjordanie, Jérusalem-Est) depuis 1967 est illégale et doit cesser dans les plus brefs délais.
Quatorze pays ont annoncé leur intention de se joindre à la plainte de l’Afrique du Sud, qui accuse Israël de « génocide » dans la bande de Gaza, devant la Cour internationale de Justice (CIJ).
La situation de la Palestine occupée, tragique, dramatique, est toujours préoccupante, le droit international ainsi que le droit tout court semblent bafoués.
Akli Ourad est ingénieur en génie civil à Birmingham dans un bureau d’études britannique, en juin 1999 il est missionné en Palestine, dans un contexte né des Accords d’Oslo de 1995, de l’émergence d’un État palestinien.
En parcourant ce livre, De Londres à Jérusalem, Terreur Promise, page après page, on a l’impression d’errer dans un désert de non- droit, Akli Ourad nous fait découvrir la machine impitoyable et injuste du système sioniste, dans un silence médiatique des puissances occidentales insupportable.
Invité au café littéraire de l‘Impondérable par l’écrivain Youcef Zirem, Akli Ourad a plongé le public dans une émotion telle qu’on pouvait entendre une mouche voler, c’est dire la gravité du sujet abordé. L’échange engagé était de haute volée, le cœur côtoyant l’esprit.
Le Matin d’Algérie : De l’Algérie à l’Angleterre, de l’ingénieur en génie civil à l’écrivain, qui est Akli Ourad ?
Akli Ourad : Je suis un enfant de l’indépendance, né en janvier 1962 à Ouadhias, dans un centre de concentration appelé faussement « centre de regroupement ». Mes parents avaient été déplacés de force de leur village dans les hauteurs des Ouadhias, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, qui avait été détruit par l’armée française en 1957, car considéré comme un village ravitailleur des maquisards, dont beaucoup de membres de ma famille faisaient partie.
L’indépendance m’a offert, comme à toute la première génération, la possibilité d’être scolarisé par l’Algérie libre, contrairement à mes parents, qui avaient été maintenus dans l’analphabétisme, tout comme 95 % de sept générations d’Algériens, par le pays censé nous apporter la « civilisation.
J’ai effectué tout mon cursus scolaire et universitaire à Alger, jusqu’à l’obtention de mon diplôme d’ingénieur en Travaux Publics. J’ai également eu la chance de vivre une semi-carrière dans le théâtre, partageant la scène avec des comédiens chevronnés tels qu’Azzeddine Medjoubi et Sonia, dans un remake de Hafila Tassir, avec la troupe professionnelle Al Qalaa, ainsi qu’avec la troupe Debza, porte-flambeau du Printemps berbère, sous la direction de Kateb Yacine.
Par la suite, j’ai fondé ma propre troupe, Dey, où des figures du cinéma algérien, comme Nadia Kaci et Mourad Chaabane, ont fait leurs premières armes. Mon départ pour l’Angleterre a coïncidé avec le début de la décennie noire, période durant laquelle mon nom, ainsi que celui de mon frère Meziane Ourad, a été inscrit sur une liste du GIA, pour suppression de la surface de la terre, en raison de nos engagements politiques et culturels anti-islamistes. Mon Master en économie de transports et ma carrière internationale m’ont conduit aux quatre coins du monde, y compris en Palestine, ce qui m’a permis d’écrire ce livre-témoin de la barbarie toujours en cours de l’entité sioniste contre le peuple palestinien.
Le Matin d’Algérie : Votre livre est courageux, il aborde un sujet plus que jamais d’actualité, un sujet demeuré presque tabou, jusqu’à maintenant, qu’en pensez-vous ?
Akli Ourad : Je suis au fait d’avoir écrit un livre exceptionnel sous forme d’un témoignage vivant du cœur du système criminel d’apartheid imposé par Israël à un peuple palestinien sans défense, à l’exception de quelques actes de bravoure d’une résistance d’abord nationaliste, puis islamiste. Je ne qualifierai pas le sujet de la cause palestinienne de tabou, surtout pas pour nous, militants engagés pour la liberté des Palestiniens depuis longtemps.
Nous avons d’ailleurs chanté cette cause chez Debza au début des années 80, dans une chanson inspirée de la pièce de théâtre « Palestine trahie » de Kateb Yacine, dans laquelle nous dénoncions la compromission des pays dits « arabes » dans le projet sioniste. Mon livre offre aux lecteurs une immersion dans les profondeurs du système sioniste, avec ses expropriations, ses confiscations de terres, ses centres de concentration, sa déshumanisation des Palestiniens, ses colonies messianiques de la pire espèce, ses barrages militaires oppressifs, son mur de la honte et ses génocides visant une domination démographique juive.
Le Matin d’Algérie : Le titre est tellement évocateur, « De Londres à Jérusalem, Terreur Promise », comment s’est fait le choix de ce titre ?
Akli Ourad : Le premier titre que j’avais choisi était « Une semaine sous apartheid ». Cependant, après avoir lu le livre, mon préfacier, l’écrivain et essayiste algérien Salah Guemriche, m’a suggéré le titre « Itinéraire de Londres à Jérusalem », inspiré par le récit « Itinéraire de Paris à Jérusalem » de François-René de Chateaubriand, publié en 1811. Cette idée m’a plu, mais j’ai proposé une légère modification en optant pour « De Londres à Jérusalem », car mon voyage ne correspondait pas réellement à un itinéraire. J’ai également ajouté l’extension « Terreur promise », car mon voyage n’était pas une exploration spirituelle, mais plutôt une plongée dans les ténèbres du colonialisme sioniste.
Le Matin d’Algérie : On peut presque dire que c’est un livre reportage, avez-vous pensé à une adaptation au cinéma ?
Akli Ourad : Vous n’êtes pas le premier à penser à l’adaptation de mon livre au cinéma. Le style dans lequel il a été écrit permet réellement au lecteur de vivre ce voyage, en traversant toutes les émotions, le suspense, les peurs et les dangers que j’ai affrontés lors de cette expérience exceptionnelle dans ce pays de non-droit. Presque tous mes lecteurs ont imaginé une projection de ces images au cinéma. Cependant, réaliser un film nécessite l’inspiration d’un réalisateur, l’engagement d’un producteur et, surtout, un soutien financier colossal pour recréer les décors de la Cisjordanie. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve.
Le livre continue son chemin et qui sait, il pourrait tomber entre les mains de quelqu’un capable de le transformer en un film qui serait sans doute un atout dans la dénonciation du projet sioniste. En attendant, je travaille sur une pièce de théâtre en algérien (Derdja) inspirée du récit de ce livre, que je proposerai à quelques théâtres régionaux en Algérie pour son adaptation sur scène. Ce serait formidable, car cela constituerait une sorte de saison 2 de « Palestine Trahi » de Yacine.
Le Matin d’Algérie : Votre récit est tellement bouleversant, le lecteur s’en sort écorché, qu’en est-il de l’auteur ?
Akli Ourad : Moi, j’ai vécu le bouleversement en direct pendant mon passage dans cette région brûlée. Si je n’avais pas eu la témérité de ma jeunesse, que je n’ai plus, je n’aurais peut-être pas osé franchir toutes les étapes dangereuses que le sionisme, avec son armée la plus immorale du monde, ses colons les plus abjects et son système racial, m’a fait subir. Plus de 25 ans après ce voyage, j’ai ressenti des frissons de peur et de révolte en écrivant ce récit, d’autant plus que je l’ai rédigé au moment où Gaza subissait une opération de décimation des âmes et des murs, entourée par la lâcheté occidentale face à ce génocide toujours en cours. Effectivement, mon voyage, tout autant que ce récit, est une expérience bouleversante qui reste ancrée dans ma mémoire et, sans doute, dans celle du lecteur pour toujours..
Le Matin d’Algérie : Malheureusement la violence n’a fait qu’empirer depuis, voyez-vous une issue favorable à ce drame ?
Akli Ourad : La situation en Palestine s’est considérablement détériorée depuis mon passage. La première escalade significative est la construction et l’expansion de colonies empiétant de plus en plus sur le territoire palestinien, entraînant des démolitions de maisons palestiniennes et des déplacements de populations. Lors de mon passage, la population de colons ne dépassait pas 300,000. Ils sont plus de 800,000 aujourd´hui. La violence entre les colons israéliens, l’armée israélienne et les Palestiniens a augmenté.
Des incidents de violence, y compris des attaques par des colons contre des Palestiniens et leurs biens, sont devenus plus fréquents. Il y a beaucoup plus de raids nocturnes, d’arrestations et de confrontations qui engendrent des pertes humaines, des pertes matérielles et des traumatismes psychologiques au sein de la population palestinienne. Ni l’ONU à l’origine de ce conflit tentaculaire, ni l’occident-complice, ni Trump et sa riviera, ni les pays arabes compromis en dehors de l’Algérie, ne pourront mettre fin à ce conflit. Ca sera l’opinion internationale et occidentale, de plus en plus blasée par les agissement d’Israël et de leur complices, qui forcera une fin à l’impunité de l’entité.
Le Matin d’Algérie : Pensez-vous que la fin du XXIe siècle verra la fin des dictatures ?
Akli Ourad : Prédire la fin des dictatures d’ici la fin du 21ème siècle est à la fois complexe et incertain. D’un côté, les mouvements démocratiques et libéraux, soutenus par l’accès à l’information et aux nouvelles technologies, pourraient engendrer des changements politiques dans de nombreux pays, comme cela se passe en France avec les Insoumis. Les pressions internationales, le développement économique et l’émergence d’une classe moyenne active pourraient également favoriser la démocratie, mais plutôt une forme de démocratie plus citoyenne, comme celle que nous trouvons en Suisse.
De l’autre côté, certaines dictatures font preuve d’une résilience remarquable en s’adaptant aux défis, en recourant à la répression et à la propagande pour maintenir leur pouvoir. De nombreux pays affichent des régimes hybrides avec une face civile et des coulisses couleur kaki, ce qui complique la transition vers une démocratie claire. Ainsi, bien que certaines dictatures soient susceptibles de s’affaiblir ou de s’effondrer, d’autres pourraient émerger ou perdurer, rendant l’avenir politique du monde incertain.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Akli Ourad : Oui, j’ai un autre projet de livre concernant la Palestine, qui se concentrera sur le système d’apartheid. Les dénonciations du nettoyage ethnique, du colonialisme, et même du génocide n’amèneront pas Israël à se conformer au droit international ou à l’établissement d’un État palestinien.
Ce qui pourrait rendre cette solution possible à l’avenir, c’est la reconnaissance par les Nations Unies du régime d’apartheid israélien, ainsi que l’imposition de sanctions économiques et d’un embargo sur les armes qui mettra ce régime à genoux, un régime hérité de l’ère coloniale du 19ème siècle. Souvenez-vous que ce sont les résolutions de l’ONU dans les années 70 qui ont contraint le régime raciste d’Afrique du Sud à céder, conduisant à l’arrivée de Mandela au pouvoir en 1994.
Un jour, Israël connaîtra le même sort, avec la prise de conscience mondiale de la nature raciste de cette entité factice. Écrire un livre dénonçant l’apartheid sioniste sera une autre pierre apportée dans la construction d’une opinion internationale forte qui fera démonter ce régime ségrégationniste.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Akli Ourad : Après une carrière florissante dans le domaine de l’ingénierie et avant ça dans le théâtre, j’aimerais poursuivre ma jeune carrière d’écrivain en contribuant à enrichir l’offre littéraire algérienne. Je veux me laisser guider par la curiosité et le désir de découvrir de nouvelles histoires inspirées de ma vie personnelle et professionnelle.
Après plus de 30 ans, à parcourir le globe dans tous les sens, je veux explorer des univers différents, rencontrer des personnages complexes et explorer les profondeurs de l’humanité. N’ayez pas peur de prendre des chemins inconnus comme je l’ai fait avec le récit sur la Palestine, je veux tenter des expériences nouvelles et m’aventurer dans des terres inconnues pour moi jusqu’ici.
L’écriture est un voyage sans fin. Chaque fois qu’un écrivain fait face à sa page blanche, il a la possibilité de créer quelque chose de nouveau, de beau et d’unique. Je veux me lancer dans l’océan de l’imagination et laisser mes mots émerveiller et inspirer les lecteurs.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Livre publié :
De Londres à Jérusalem, Terreur Promise, éditions Casbah.
lematindalgerie.com
Jeudi 6 février 2025
…………………………………………………………………………………………….

Karima Sumam : « L’acewwiq de nos grands-mères est une source d’inspiration inestimable »
Karima Sumam est une chanteuse de talent, c’est une voix douce, dont les émotions s‘écoulent comme cette eau pure jaillissant du fond des âges des sources de l’Akfadou ou du Djurdjura, qui donne un nouveau souffle à la chanson kabyle.
Elle est originaire de Bicher ce beau village de la vallée de la Soummam, de la commune de Tamokra de la Daïra d’Akbou.
Karima Sumam quitte l’Algérie en 2002 pour la France, pour continuer ses études à Paris.
Karima Sumam réussit son parcours universitaire avec brio, elle décroche une double Licence et un Master en sciences du langage à Paris, elle exerça divers métiers dans le domaine de la pédagogie.
Mais c’est sa passion des arts qui l’accapare, une passion qui ne date pas d’aujourd’hui, elle vient de l’enfance, dès l’âge de 6 ans aux côtés de son père, grand adepte d’instruments à cordes.
Sa ferveur pour la musique s’est développée au collège Mouloud Feraoun à Akbou où elle a fait partie d’un petit groupe de chorale où s’affirment ses capacités vocales.
De 2017 à 2023 elle participa à de nombreux spectacles associatifs à travers la France, à Blois, Châteauroux, Tours, Aubervilliers etc…
L’année 2020 voit l’enregistrement de son premier Album, avec un choix de thèmes judicieux, d’où jaillissent des espoirs, de l’ombre à la lumière, ses chants bouleversent et interpellent le cœur et l’esprit.
La chanson « Amedya » « L’Exemple », où l’émotion atteint son paroxysme, est un hommage à son défunt père. Un album très personnel donc, s’inspirant de son vécu, de sa vision de femme au regard lucide, porteur d’espérance, interrogeant le temps et l’époque.
L’année 2023 donnera naissance à plusieurs singles, dont « L’Aïd n tmettuth », honneur à la femme, « octobre rose », « Taqbaylit », avec un franc succès auprès du public. On la voit s’afficher cette même année aux côtés de Rabah Asma et de Kamel Rayah au Casino de Paris et au Zénith de Paris.
« Isufar» son nouvel album viendra en 2025 enrichir son répertoire musical en s’ouvrant sur le monde, sur d’autres horizons, sur l’universalité, on verra émerger d’autres styles, sans perdre la couleur berbère kabyle.
Karima Soumam arrive comme un rayon de soleil dans le paysage de la chanson kabyle. L’avenir paraît donc serein et plein d’espoir.
Le Matin d’Algérie : Du village à Paris, des études en sciences du langage à la chanson kabyle, qui est Karima Sumam ?
Karima Sumam : Je dirais que Karima Sumam est une artiste, chanteuse algérienne d’expression Kabyle qui prône la liberté d’expression de la femme, et qui veille à la promotion de la culture berbère même au-delà des frontières.
Après plusieurs expériences intéressantes dans divers domaines artistiques tels que la chorale, la peinture, l’écriture et le théâtre, la chanson l’interpelle de nouveau en 2017. Afin de répandre ses idées et de les exprimer avec éloquence, elle réemprunta le chemin de la musique et l’expression par la chanson
D’un genre moderne d’inspiration traditionnelle, sa musique et son travail artistique de façon générale se nourrit soit de son vécu personnel ou de celui des femmes de sa génération.
Son engagement pour soutenir la femme ne s’arrête pas à l’expression musicale. Elle rejoint le collectif, Des Roses berbères, pour lutter contre le cancer du sein à sa première édition depuis octobre 2022.
Elle proposa publiquement l’idée de produire un titre pour sensibiliser les femmes à parler de leur maladie et de leur combat intérieur qu’elles mènent au quotidien. Le Titre « Octobre Rose » sera diffusé l’année suivant en octobre 2023 et il sera le premier titre féminin à aborder cette thématique taboue.
L’objectif principal de son projet artistique est de soutenir cette cause mais aussi de réunir les artistes autours de cette date symbolique dans un seul but commun, transmettre un grand message d’espoir à toutes les femmes touchées de près ou de loin par cette maladie.
Afin d’étendre encore plus cette action, elle lança un appel à solidarité sur les ondes de Radio Soummam , une demande adressée au collectivités locales, aux entreprises et aux hôpitaux pour mener plusieurs actions de solidarité afin de sensibiliser les femmes de la région et des villages environnants et les encourager à se rendre aux compagnes de dépistage du cancer, les accompagner et veiller à les accueillir dans de bonnes conditions humaines et matérielles.
Son souhait pour les années à venir est que cette action de solidarité et de sensibilisation du collectif Des Roses Berbères en France, soit également menée partout en Algérie sous un même slogan, « unissons-nous pour un octobre rose ! ».
Le Matin d’Algérie : On voit ces dernières années beaucoup de chanteuses kabyles avec un parcours universitaire, c’est une nouvelle ère qui nous plonge dans l’universel, pourtant elles ne perdent pas pour autant leurs couleurs kabyles, à quoi est-ce dû à votre avis ?
Karima Sumam : Une grande majorité des jeunes chanteuses Kabyles qu’on voit émerger en France aujourd’hui ont vécu soit leur enfance ou une partie de leur vie en Kabylie puis sont arrivées en France pour terminer leurs études. Pour d’autres, je suppose qu’elles ont grandi dans une famille qui affectionne particulièrement la langue maternelle en l’occurrence la langue kabyle.
Il est important de souligner également la valeur identitaire que la langue des ancêtres représente pour chacun d’entre nous.
Le Matin d’Algérie : Comment est née cette passion pour le chant et la musique ?
Karima Sumam : Cette passion pour la musique remonte à mon enfance. Un précieux héritage de mon défunt père amoureux de la musique et de la chanson kabyle. Je me souviens de ces moments où j’étais assise à ses côtés, j’avais à peine 6 ans, lui, les doigts sur les cordes de sa guitare et moi savourant chaque note. Nos deux voix retentissaient souvent aux quatre coins de la maison familiale sur des titres de notre grand artiste Lounis Aït Menguellet.
Le Matin d’Algérie : Quelles sont les chanteuses et les chanteurs qui vous influencent ?
Karima Sumam : Parmi les premiers artistes qui m’ont fait découvrir la beauté du verbe et de la mélodie Kabyle, il y a Lounis Aït Menguellet, Matoub Lounes, Idir, Karima, Nouara, Nora, Cherifa, Cherif Kheddam, Kamel Hamadi, Slimane Azem, Cheikh El Hasnaoui, Si Mohand U Mhand, et bien d’autres…
Le Matin d’Algérie : Dans la chanson « Amedya » vous rendez hommage à votre père, pouvez-vous nous dire un mot sur cette chanson ?
Karima Sumam : Amedya » diffusé le 17 novembre 2020 est mon premier titre de l’album « Aktayen » diffusé l’année suivante.
Le titre « Amedya » est une lettre ouverte adressée à mon défunt père. Un père exemplaire, une référence de courage de sagesse et de clairvoyance. Chaque mot, chaque phrase de ce titre est un symbole et un témoignage de reconnaissance.
Le Matin d’Algérie : La femme est omniprésente dans vos chansons, est-elle toujours la gardienne des traditions ?
Karima Sumam : La femme est effectivement omniprésente dans la plupart de mes titres. À mon sens, chaque femme peut tirer sa force de sa fragilité. Jadis la femme était reine, elle devient guerrière par la force des choses. La femme kabyle, plus particulièrement, détient en elle une richesse culturelle, des valeurs transmises de mère en fille et un courage sans égal.
La femme Kabyle a un attachement très particulier à la terre mère, aux racines, aux traditions et aux rites. Cela se traduit dans toutes ses tâches et ses activités au quotidien, elle a un rôle important dans l’éducation de ses enfants certes mais elle a également un rôle important dans la transmission des savoirs à plus grande échelle et ce par différents canaux de communication, le chant, la poésie et l’artisanat. Pour ma part, l’ancienne génération, celle de mes grands-mères, m’a beaucoup apporté. Le chant, achewwiq, de mes grands-mères et leur poésie, leur savoir, leur savoir-faire et leur expérience de vie sont une source d’inspiration inestimable
Par ses idées novatrices, la femme d’aujourd’hui a imposé sa notoriété dans plusieurs domaines. Il faut reconnaître que les femmes, quels que soient leurs origines, contribuent activement au développement des sociétés, elles sont le pilier et la fondation de toutes les civilisations. (Cf titre « Laid n t mettut » Honneur à la femme, clip officiel mars 2023, YouTube)
Le Matin d’Algérie : L’ouverture de votre musique sur le monde vous va bien, vous réussissez à marier les différentes sonorités comme par magie, à mélanger les couleurs comme le ferait le peintre dans un tableau, comment faites-vous ?
Karima Sumam : Avant d’arriver à la phase d’enregistrement au studio, le thème à aborder doit être en phase avec mon besoin d’expression du moment. Cette étape est primordiale, car je ne peux travailler que sur des sujets qui m’inspirent. L’inspiration peut partir d’une image, d’un objet, d’un fait, d’un mot entendu de façon hasardeuse lors d’un échange ou d’une discussion ou tout simplement d’un moment de silence.
Quelle que soit l’origine du texte, qu’il soit mien ou venant d’un parolier, le thème doit être une source d’inspiration pour moi car sans cela je ne peux faire évoluer ou mûrir le projet, ni lui trouver une orientation musicale, imaginer et écrire un scénario…etc. Une chanson c’est un tout : un ressenti, une atmosphère, un contexte historique, social qui doit stimuler mon imaginaire.
Il m’arrive d’imaginer le scénario du clip vidéo rattaché au thème avant même de finaliser le travail sur le texte et son enregistrement au studio.
Afin de donner vie à chaque titre avec le respect du style et de l’orientation musicale qui lui sont propres, il est important d’associer l’imaginaire de l’artiste et son ressenti avec le travail de réflexion et de technicité de l’arrangeur.
Je pense qu’il faut s’armer de beaucoup de patience pour produire un travail de qualité, réunir toutes les composantes est nécessaire pour que notre projet, soit bien construit et prenne toute son épaisseur.
Pour résumer je dirais que l’authenticité, la couleur et la richesse des sonorités de chaque titre vient d’un long travail de réflexion, de recherche et d’ajustements.
Le Matin d’Algérie : Quel regard portez-vous sur la chanson féminine algérienne et la chanson kabyle en particulier ?
Karima Sumam : La chanson féminine algérienne est en constante évolution. On voit de plus en plus de femmes s’exprimer par le chant et dépasser certains tabous. La nouvelle génération est plutôt prometteuse, la chanson féminine est de plus en plus reconnue et plutôt bien respectée.
Le Matin d’Algérie : Les arts en général aident l’émancipation des sociétés, surtout la chanson, qu’en pensez-vous ?
Karima Sumam : L’Art en général est un moyen de communication. Nous le savons bien, la communication est un moyen d’échange des idées et d’ouverture sur le monde. Que ce soit par la peinture, par la danse ou par le chant, ce sont tous des moyens d’expression et d’échange, d’évolution et d’émancipation. Un texte orné de musique propose aux peuples du monde entier un langage commun et universelle.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Karima Sumam : Effectivement. J’ai un projet d’un nouvel album qui est en cours de finalisation. L’intitulé de ce nouvel album est « Isufar ».
L’idée du choix de cet intitulé a émergé au moment où j’ai commencé à constater la diversité des composantes de cet album. Donc, il était tout naturel pour moi à un moment donné de rattacher ce projet artistique à une tradition et un art culinaire ancestral, un plat riche en ingrédients préparé chaque nouvel an berbère à l’occasion de Yennayer.
« Isufar » en tant que projet artistique a plutôt un sens imagé qui se traduit par la variété de ses thématiques, la richesse de ses sonorités et son ouverture sur une musique moderne et universelle. Il sera diffusé courant 2025.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Karima Sumam : Je dirais, qu’au-delà de cette valeur identitaire que recèle la chanson kabyle, cela reste un précieux héritage culturel pour notre pays et pour les générations futures, c’est un héritage qu’on a certainement tous le devoir de préserver.
Notre volonté de transmission doit être décuplée, d’une part pour assurer sa survie et d’autre part, pour nous en tant qu’artistes, d’affirmer son existence et d’aspirer à son expansion dans le monde.
Entretien réalisé par Brahim Saci
lematindalgerie.com
Mercredi 5 février 2025
…………………………………………………………………
Fahim Messaoudène : « Que mes productions servent à ce que notre langue évolue »

Rencontre avec l’artiste Fahim Messaoudène. Photo Diasporadz
L’artiste Fahim Messaoudène nous parle dans cet entretien accordé à Diasporadz de son parcours, de ses productions artistiques et de son rêve de voir sa langue maternelle, tamaziɣt, évoluer et prospérer dans le temps.
Fahim Messaoudène nous surprend toujours par la beauté et la pureté de ses productions, c’est un artiste écrivain prolifique, son imagination déborde, il chante et écrit en langue kabyle, pour petits et grands, magnifiant les genres sans jamais se lasser.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Diasporadz : Vous êtes vraiment un créateur éclectique. Qui est Fahim Messaoudène ?
Fahim Messaoudène : Merci, je fais ce que je peux. Je suis romancier, fabuliste, poète, auteur-compositeur et interprète. Certes, je touche un peu à tout dans le monde artistique et littéraire, je suis né avec cette fibre artistique avec le mouvement associatif qui a semé en moi cette graine de créativité.
Diasporadz : Vous êtes un artiste habité par la passion des arts, d’où vient cette passion ?
Fahim Messaoudène : C’est une force intérieure qui me sollicite toujours de créer. Tout commence lorsque j’étais enfant, à travers les chansons de Slimane AZEM, les casettes de Muḥya, les revues écrites en Tamazight…
Enfant, j’étais adhérent dans l’association de notre village. D’ailleurs, via cet entretien, Je rends hommage à tous les membres de l’association de l’époque de 1989. Des jeunes étudiants, beaucoup sont des militants de la culture… ils ont transmis ce militantisme et ils ont semé, en moi, cette graine qui a germé avec le temps.
Diasporadz : Vous embrassez plusieurs champs culturels et artistiques, vous passez d’un genre à l’autre avec une aisance déconcertante, comment faites-vous ?
Fahim Messaoudène : Tout dépend de la période de l’inspiration et les mouvements émotionnels que je traverse. Je ressens cela comme une sorte de repos, et un moment de trêve entre le cœur et l’esprit.
Tout cela me donne la force de créer et de puiser des idées créatives tout en passant d’un champ à un autre sans jamais me lasser.
Diasporadz : Vous publiez beaucoup en langue kabyle, pourquoi faut-il publier en kabyle ?
Fahim Messaoudène : En kabyle, parce que tout simplement c’est ma langue maternelle et c’est celle que je maîtrise le mieux, dont je saisis le mieux l’imaginaire, et c’est aussi parce que la langue kabyle manque d’écrits.
Diasporadz : De la chanson pour enfant au livre pour enfant, comment est née l’idée d’écrire pour les enfants ?
Fahim Messaoudène : J’ai toujours souhaité écrire pour les enfants. Je me rappelle, je me souviens de mon enfance, nous n’avions pas de textes ni de chansons pour enfant.
Dans l’association au village, nous chantions des chansons à texte qui dépassaient notre niveau. Cette idée m’est restée dans la tête à ce jour. Depuis, j’ai pensé écrire à cette catégorie, j’ai essayé de combler ce manque. Et surtout aujourd’hui, la langue Tamazight est enseignée à l’école, du coup, les enfants trouveront des livres, des chansons destinées à eux.
Diasporadz : Quels sont vos influences dans la littérature et la chanson ?
Fahim Messaoudène : Dans la littérature, j’aime beaucoup lire les romans noirs, fantastiques et imaginaires, concernant la chanson j’écoute beaucoup plus le chaâbi, mais surtout la chanson à texte.
Diasporadz : Pourquoi chantez-vous sous un pseudonyme ?
Fahim Messaoudène : En Fait, je voulais juste séparer l’écrivain Fahim Messaoudène et le chanteur Iziran.
Diasporadz : Y a-t-il un genre littéraire qui vous tient le plus à cœur ?
Fahim Messaoudène : Je dirais que c’est surtout le genre fantastique qui m’accapare.
Diasporadz : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Fahim Messaoudène : Oui, un livre pour enfant qui sera édité ce mois-ci, intitulé « Ad ƔreƔ (je vais lire), un recueil de poèmes, un recueil de nouvelles et textes et un roman fantastique déjà fini que j’envisage d’éditer vers la fin de l’année.
En parallèle, je suis sur un projet de dix comptines que je mettrai sur ma chaine youtube (Iziranofficiel) vers la fin du mois de février.
Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?
Fahim Messaoudène : Je souhaite que mes productions servent à ce que notre langue évolue et prospère dans le temps.
Tout mon parcours artistique et toutes mes productions se trouvent dans mon site-blog suivant : https://messaoudenefahim.wixsite.com/iziran, pour celles et ceux qui souhaitent le visiter.
Merci à vous et au journal Diasporadz pour cet entretien.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Le 2 février 2025
diasporadz.com
Iziran officiel (Iziran)
www.youtube.com/@mohouvouj
………………………………………………………………………………………
Fahim Messaoudène, romancier, fabuliste, poète, auteur-compositeur chanteur

Fahim Messaoudène est un artiste, auteur-compositeur chanteur, poète, fabuliste, écrivain, romancier, aux talents multiples, et il excelle dans chacune de ces expressions artistiques.
L’artiste Fahim Messaoudène est auteur-compositeur et interprète sous le pseudonyme « Iziran », il est également membre fondateur de plusieurs associations notamment dans son village natal, c’est dire que la culture foisonne et bouillonne chez cet artiste au grand cœur dont la création artistique poétique et musicale apporte beaucoup de bonheur.
Natif du village Iguersafen, un grand village situé sur le versant ouest de l’Akfadou, dans la commune d’Idjeur, à une soixantaine de kilomètres du chef-lieu de la Wilaya de Tizi-Ouzou.
En 2004, Fahim Messaoudène obtient un DEUA (Diplôme d’études universitaires appliquées) en électronique. Dix ans après, il réussit le concours de formateur en électricité bâtiment au centre de formation professionnel et de l’apprentissage de Boukhalfa (Tizi-ouzou).
Deux ans après, en 2016, il quitte son poste, pour immigrer en France, comme beaucoup de jeunes kabyles, et il s’installe définitivement à Marseille où il rejoint le mouvement associatif.
Fahim Messaoudène a écrit des chansons pour plusieurs chanteurs kabyles dont Kedym, Yufitren, Nassim Bechouche et d’autres jeunes chanteurs en cours de production.
La poésie a toujours été pour Fahim Messaoudène un art de vivre, la poésie fait partie de son vécu et il ne cesse d’œuvrer à la faire rayonner.
L’élan poétique est partout dans ses expressions artistiques, il suffit de l’écouter ou de le lire, l’on sent très bien la force et la beauté du verbe magnifiant le chant ou le poème kabyle.
Chez Fahim Messaoudène la rime se conjugue avec la cime, tout est fait pour élever l’esprit transcendant le cœur.
La production poétique et littéraire de Fahim Messaoudène est riche et variée. Il a publié un recueil de poésie intitulé Tiyersi, édité en 2013 par les Editions Richa Elsam, un recueil de nouvelles et fables intitulées Timsirin n ddunit, édité en 2014 par les Editions Sefraber, un roman intitulé Anza, édité en 2016 par les Editions Richa Elsam, qui a remporté le 1er prix national, Grand Prix Littéraire Mohammed Dib en 2018 à Tlemcen, un recueil de poésie traditionnelle féminine du village Iguersafen intitulé Izlan n tlawin, édité en 2017 par les Editions Richa Elsam, un recueil de textes et nouvelles pour les enfants intitulé Iziran n temẓi, édité en 2019 par les Editions Cheikh Mohand Oulhocine, un roman pour enfant intitulé Izir deg irebbi n teẓgi édité en 2020 par les Editions Achab qui a remporté le prix Taous Amrouche au concours de la littérature jeunesse, 2e édition (2020-2021), organisé par la fondation Tiregwa au Canada.
Le fleuve de la création ne cesse de s’écouler chez Fahim Messaoudène, il publie de nouveau un recueil de dialogue, poèmes et jeux pour enfants intitulé Taɣuri swuraren, édité en 2023 par les Editions Cheikh Mohand Oulhocine, qui a remporté le prix Taous Amrouche au concours de la littérature jeunesse en 2024, organisé par la fondation Tiregwa au Canada, un roman intitulé Izenyefferwakal, édité en 2023 par les Editions Cheikh Mohand Oulhocine qui a remporté la 2e place, Prix littéraire Mohand Akli Hadadou en 2024 à Chemini.
En 2021, il commence son immersion dans la chanson, sous le pseudonyme Iziran, composant alors des chansons pour enfants, Tizlatin i yigerdan en 2021, Arrazen en 2022, Afrux-iw en 2024, Nekk d warraw-iw en 2024, Amcic-iw.
Puis d’autres chansons, Tizlatin-nniden en 2023, Tamedyezt, Asekkak, Ddunit, Tamedyezt, Azaylal, en 2024, Tizlit, Inign tmara, Fkan-amisem, Yalwa i yettnadi, Tifidi, Nwala, Yir tadukli, Lmut-im.
Fahim Messaoudène est ce digne fils de la Kabylie, amoureux de sa terre et de la langue kabyle avec tout ce qu’elle véhicule de valeurs, de philosophie, de poésie, qui ne cesse de travailler, de créer afin d’éclairer par l’asefru, le poème, rayonnant tel un phare salvateur pour des navigateurs en perdition.
Il chante pour les enfants, pour la nature, il écrit avec le cœur avec cette force pure jaillissant de la source du Djurdjura et de l’Akfadou au pied duquel est situé son village natal.
Brahim SACI
Le 2 février 2025
diasporadz.com
IZIRAN Officiel (IZIRAN)
www.youtube.com/@mohouvouj
……………………………………………………………………………

Toufik Hedna : « Mon parcours est une quête de beauté et de sens »
Toufik Hedna est né à Sétif, c’est un enfant de l’indépendance, bercé dès l’enfance par les contes de sa famille et les récits bouleversants du 8 mai 1945 et de la guerre d’Algérie. Ces histoires qui lui ont appris le passé, l’engagement et le prix de la liberté.
Dans sa famille, cet héritage remonte jusqu’à un aïeul, Saad Tebbani, fondateur de la zaouïa Saâdia à Benghazi, qui a combattu l’invasion française, tombé en martyr à Sfax.
La mémoire de Saad Tebbani reste vivante et l’inspire chaque jour. Dans son enfance, il y avait aussi Djeda Hada, dont les contes captivaient son imagination, et son grand-père, Si Mohamed, il le revoit encore, assis pendant des journées entières, à écrire au calame sur des manuscrits, fabriquant lui-même ses crayons et son encre. Cette dévotion pour l’écriture et le respect de chaque mot l’ont profondément marqué.
Toufik Hedna était l’invité de l’écrivain Youcef Zirem au café littéraire parisien de l’Impondérable, pour présenter son roman « Les Amants disparus du Pont de Bomarchi ». L’échange avec Youcef Zirem était riche et éclairé devant un public attentif. Ce roman commence par une histoire d’amour, mais des pans d’histoire sont cités, même s’il a fallu faire des choix, on ne peut jamais tout dire.
« Les amants disparus du pont de Beaumarchi », est son premier roman, Toufik Hedna réussit à captiver le lecteur, à le retenir, page après page, la narration fascine par sa fluidité, son style épuré, à la fois simple et sobre, écartant le superflu, s’en défaire même pour aller avec justesse vers l’essentiel où battent mieux les ailes, pour tenir le lecteur en haleine page après page à travers les éclaircies et les nuages.
L’auteur raconte et nous envahit d’émotions au point de ne plus vouloir sortir, on a envie que l’histoire continue. Toufik Hedna a le génie de réussir à relier ces pans d’histoire d’époque différentes sans dérouter le lecteur, mais au contraire, on a l’impression d’être là-bas, chacun s’imagine alors traversant ce pont.
C’est un roman qui ne souffre d’aucun temps mort, tout en laissant le souffle libre et apaisé, il ne dérange pas, il n’épuise pas mais il interroge. C’est une écriture aérée et claire qui respire, qui confère un aspect contemplatif tout en bousculant notre vision du monde, tout en l’élargissant, malgré la complexité des situations et des péripéties.
Un lien étroit s’installe entre l’auteur et le lecteur réussissant à répondre aux attentes d’une pensée étanchant la soif.
Le Matin d’Algérie : De l’architecture au roman, qui est Toufik Hedna ?
Toufik Hedna : Toufik Hedna est avant tout un passionné de l’art et de la création sous toutes ses formes. Architecte et urbaniste de formation, je me suis toujours senti attiré par l’écriture, qui constitue pour moi un moyen puissant d’explorer les dimensions intimes et sociales de l’existence humaine. Mon parcours est une quête de beauté et de sens, que ce soit à travers la conception d’espaces architecturaux ou la narration littéraire.
Le Matin d’Algérie : Vous venez de publier votre premier roman, « Les amants disparus du pont de Bomarchi » chez les éditions Hedna, une œuvre explorant la mémoire, la résistance. Parlez-nous de la genèse de ce roman ?
Toufik Hedna : Ce roman est né d’une double urgence. La première était personnelle : celle d’écrire enfin un premier roman après des années de tentations avortées. À chaque fois, je débutais un récit sans parvenir à le mener à son terme. Mais cette expérience a été précieuse, car elle m’a permis de réunir des fragments épars, des bribes d’histoires laissées de côté, pour les inscrire dans une trame cohérente. La deuxième urgence était collective : celle de réhabiliter une mémoire oubliée, celle des petites histoires transmises oralement, souvent effacées par la Grande Histoire, celle qui s’impose par l’écrit et le récit dominant.
En Algérie, chaque ville, chaque village, chaque rue regorge de récits méconnus, des histoires de vies simples qui méritent d’être entendues. « Les amants disparus du pont de Bomarchi » est donc une plongée dans cette Algérie profonde, marquée par le poids de l’oppression coloniale et les questionnements identitaires de la jeune génération. À travers ce roman, j’ai voulu explorer des thèmes universels tels que l’amour, la résistance, et la quête de liberté. Il s’agit aussi d’un hommage à tous ceux qui, malgré les épreuves, ont lutté pour leurs idéaux.
Le Matin d’Algérie : Vous écrivez sous un pseudonyme, Belson. Pourquoi ce choix ?
Toufik Hedna : Belson est un clin d’œil à mes origines et à mes influences littéraires. Ce pseudonyme me permet également de prendre une distance créative par rapport à ma vie quotidienne et d’explorer des territoires imaginaires avec une plus grande liberté. Il incarne aussi un hommage discret à des figures qui m’ont profondément inspiré.
Le choix de ce nom n’est pas anodin : il s’inspire du prénom de mon défunt père, Belgacem, que l’on avait l’habitude d’appeler « Bel ». Une partie de sa vie se retrouve en filigrane dans le récit, comme une sorte de biographie embellie et amplifiée, où j’ai voulu incarner l’idéal du patriarche algérien.
« Belson » signifie littéralement « le fils de Bel », tout en ajoutant une touche de mystère pour intriguer le lecteur.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur les éditions Hedna ?
Toufik Hedna : Les éditions Hedna sont une aventure à la fois familiale et littéraire, qui s’attache à offrir une voix à des auteurs partageant une vision authentique et engagée de la littérature. C’est une maison d’édition à taille humaine, profondément ancrée dans des valeurs de qualité, de transmission, et surtout de créativité littéraire.
Nous publions généralement une dizaine d’ouvrages par an, mais ces deux dernières années, en raison de mon immersion dans l’écriture, nous n’en avons publié que deux. Cette pause reflète aussi notre philosophie : privilégier la qualité à la quantité.
Ce qui nous distingue, c’est notre approche humaine. Nous avons toujours favorisé une relation de proximité avec nos auteurs, plutôt que de considérer l’édition comme une simple transaction commerciale. Pour nous, chaque auteur ou autrice est avant tout une personne, et chaque livre bien plus qu’un simple numéro d’ISBN. C’est un projet vivant, une part de leur âme que nous avons la responsabilité d’honorer.
Le Matin d’Algérie : « Les amants disparus du pont de Bomarchi » est un titre percutant, évocateur, qui en dit long, comment vous est venu ce titre ?
Toufik Hedna : Le titre s’est imposé naturellement au fil de l’écriture. Le pont de Bomarchi est un lieu qui a marqué ma jeunesse : c’était un passage quotidien jusqu’à l’âge adulte. Je m’y arrêtais souvent pour contempler la gare, un lieu mythique pour moi, avec ses trains, ses voyageurs, et cette effervescence qui me fascinait. Mon père était cheminot, ce qui renforçait mon attachement à cet endroit. Même aujourd’hui, il m’arrive de m’attarder sur ce pont, d’évoquer des souvenirs, de penser à mon père et à mes escapades dans les trains, qui étaient gratuits pour moi, vers des lieux lointains.
Le pont de Bomarchi, c’est aussi un lieu de rencontres amoureuses, où des couples venaient se retrouver, parfois en secret. C’est un espace chargé d’émotions, où j’ai vu des hommes que l’on disait forts pleurer leurs chagrins, où noyer leurs peines dans une bouteille. Ce pont a toujours conservé une part de mystère, presque comme s’il murmurait les histoires qu’il avait vues défiler.
Ce lieu symbolise le passage, la mémoire, les rencontres, mais aussi les ruptures et les épreuves. Les « amants disparus » incarnent cette idée d’un amour intemporel et tragique, pris dans les tourments de l’Histoire, entre l’intime et le collectif. Ce titre est, pour moi, une célébration des souvenirs personnels et universels, une évocation poétique de ce lieu chargé de sens.
Le Matin d’Algérie : L’Algérie peine à démocratiser la littérature peut aider à l’émancipation d’une société, quel est votre avis ?
Toufik Hedna : Absolument. La littérature a le pouvoir d’ouvrir des perspectives, de poser des questions fondamentales et d’éveiller les consciences. En Algérie, elle peut jouer un rôle crucial pour briser les tabous, raviver la mémoire collective et promouvoir un dialogue démocratique. Un livre peut être une étincelle capable de changer les mentalités.
Le Matin d’Algérie : Vous animez des émissions de radio comme Poésie sur le vent sur Radio Laser et Evasion des mots sur C Lab 88, d’où est venue cette passion pour la radio ?
Toufik Hedna : La radio est un moyen unique de créer du lien avec les auditeurs. C’est une forme d’art orale qui m’a toujours fasciné, car elle permet de partager des émotions, des idées et des histoires avec une proximité intime. Ces émissions sont pour moi une manière d’explorer et de transmettre ma passion pour la poésie et la littérature.
Le Matin d’Algérie : Milan Kundera a dit « La bêtise des gens consiste à avoir une réponse à tout. La sagesse d’un roman consiste à avoir une question à tout », qu’en pensez-vous ?
Toufik Hedna : Je partage pleinement cette vision. Un roman doit inviter le lecteur à réfléchir, à douter, à remettre en question ses certitudes. La force de la littérature réside dans sa capacité à ouvrir des horizons et à poser des questions universelles qui résonnent au-delà des époques et des cultures.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les auteurs qui vous influencent ?
Toufik Hedna : Je suis profondément façonné par des auteurs comme Kateb Yacine, Faulkner et Artaud. Pourtant, je lis tout ce qui croise mon chemin, parfois même des livres récupérés dans une poubelle, que j’essuie à peine avant de m’y plonger avec avidité. Ces trois figures, chacune à sa manière, m’inspirent par leur audace, leur sensibilité et leur regard unique sur le monde.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Toufik Hedna : Oui, je travaille sur un roman inspiré de l’histoire de Sétif, un projet entamé il y a plus de trois ans. Initialement conçu comme un essai, il s’est transformé en roman, une surprise pour les Sétifiens et les amoureux de l’Algérie.
L’écriture d’un roman est une expérience intense, presque une traversée sur un fil entre le réel et la folie. Vous habitez vos personnages, et parfois ils vous habitent à leur tour. Il m’est arrivé de marcher des kilomètres pour entrer dans la peau d’un personnage, ou de ne plus pouvoir m’en défaire, comme si j’étais « Meskoune » possédé. Pour m’en libérer, je me suis plongé aussitôt dans un autre roman avec de nouveaux personnages – un conseil que je donne à tous les écrivains.
Je suis presque à la fin de ce projet : l’ébauche est faite et la trame tracée. Maintenant, il reste la restructuration, un exercice que j’adore car il me permet de briser la monotonie du récit. C’est une étape qui prend souvent du temps, tout comme les corrections et la relecture, un travail fastidieux mais indispensable. Après cela, viendra la publication. Voilà, je n’en dirai pas plus, ce sera une surprise !
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Toufik Hedna : Un grand merci à ceux qui lisent et partagent leurs émotions à travers la littérature. Les livres sont des ponts entre les âmes, capables de nourrir l’espoir d’un monde meilleur.
Je suis ravi d’annoncer que je présenterai ce livre à l’Espace Ouest France, invité par la Librairie Le Failler, le 20 Janvier 2025 à 19h. La soirée, animée par Arnaud Wassmer, sera l’occasion de présenter mon roman « Les Amants disparus du pont de Bomarchi ». Une belle rencontre, entre littérature et passion.
Vous pouvez réserver dès maintenant ici : https://my.weezevent.com/belson.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Livre publié : Les Amants disparus du pont de Bomarchi, BELSON, Roman, Éditions Hedna, 380 pages, 24 €.
dimanche 12 janvier 2025
lematindalgerie.com
……………………………………………………………………..
Maggy de Coster : « Je fais les choses avec amour et passion »

De Haïti à Paris, Maggy de Coster a fait de la littérature sa respiration, de la plume sa fidèle compagne et une amie salvatrice, la muse n’étant jamais loin.
Nous pouvons dire que Maggy de Coster écrit comme elle respire, la littérature apparait alors comme une question de survie amenant la vie.
Maggy de Coster cite cette phrase qui résonne dans le temps et au-delà… « À vaincre sans péril on triomphe sans gloire » comme dit Corneille dans Le Cid.
Diasporadz : De Haïti à Paris, vous avez beaucoup écrit, qui est Maggy de Coster ?
Maggy de Coster : Mon parcours poétique a commencé à Jérémie, ma ville natale, baptisée Cité des Poètes, alors que j’étais en 3e quand je suis devenue la co-directrice de la revue poétique intitulée « La Jeune Muse ». Je me passionnais pour l’écriture dès ma plus tendre jeunesse où je couchais sur du papier mes premiers vers.
Je lisais les fables de La Fontaine qui m’ont inspiré mon premier poème puis Apollinaire, Rimbaud, Leconte de Lisle, Paul Claudel, André Lévesque (une poète canadienne) et bien d’autres
Peu après, dans la capitale, j’ai été repérée par le poète et professeur de Lettres Christophe Charles qui publiait mes poèmes dans « La revue des écoliers » qu’il dirigeait avant de m’accorder une pleine page dans sa rubrique au quotidien Le Nouveau monde, intitulée « Poètes pour demain ».
Sur ces entrefaites, je venais à faire partie des jeunes poètes de sa génération qui ont publié pendant leur adolescence. Cette précocité s’explique par le fait que nous étions tous préoccupés par la dégradation de la situation sociopolitique du pays et par le besoin de dire notre refus des conditions matérielles d’existence dans lesquelles évoluait le peuple haïtien.
Bien que passionnée par le monde littéraire, je voulais être médecin : être un penseur pansant les plaies physiques, j’ai préparé le concours et n’ai pas réussi mais je ne regrette rien.
Diasporadz : Vous êtes habitée par la passion des arts, racontez-nous ?
Maggy de Coster : Je suis à la fois curieuse et insatiable de nature donc je pense qu’on n’a jamais fini d’apprendre. Les savoirs sont tellement étendus qu’une vie ne suffira guère pour tout absorber et digérer afin d’en garder la substantifique moelle pour parler à la Rabelais.
J’ai appris au cours de journalisme que pour être efficace on doit s’intéresser à tout, en d’autres termes avoir une bonne dose de culture générale. Je n’avais pas attendu que je sois à l’Université pour commencer à me meubler l’esprit. Je me rappelle avoir commencer à lire Madame Bovary qui faisait partie des livres de la bibliothèque familiale alors que j’étais en classe de 6e seulement.
Diasporadz : Vous voguez sans avoir peur des vagues, vous battez des ailes sans avoir peur des orages, vous paraissez si libre, à quoi est due cette magie ?
Maggy de Coster : « À vaincre sans péril on triomphe sans gloire », comme dit Corneille dans Le Cid. Je suis jusqu’au-boutiste.
Je me suis toujours dit que : si j’arrive à réussir dans tel ou tel domaine, ce n’est pas parce que j’ai de la chance mais tout simplement parce que je suis très patiente, très obstinée et très dure envers moi-même et du coup, je ne supporte pas l’échec ; je suis toujours prête à recommencer tout en repartant sur de nouvelles bases.
J’ai envie de dire aussi parce que je me suis toujours pensée d’abord en tant qu’être humain avec mes forces et mes faiblesses, de l’intelligence et une capacité d’adaptation universelle au lieu de me considérer comme une femme noire à verser dans le communautarisme et le repli sur soi.
En outre, je fais les choses avec amour et passion et non par avidité de gains matériels. Vous savez, je ne suis pas difficile, l’important pour moi c’est de faire ce que j’aime et d’être bien avec moi-même et avec les autres. Je cultive chez moi l’amour et la générosité.
Diasporadz : Quels sont les auteurs qui vous influencent ?
Maggy de Coster : Comme je l’ai mentionné plus haut, j’ai été influencée par des auteurs français puis par des auteurs haïtiens.
Je suis inclassable me disait le poète haïtien Dominique Batraville mais moi je me considère comme universelle.
Mes sources d’inspiration : le monde, tout ce qui m’entoure. Faisant mienne cette pensée de Raoul Follereau : « On n’a pas le droit d’être heureux tout seul », mon postulat de base était d’écrire pour changer, « changer la vie » comme dit Rimbaud.
Diasporadz : En littérature, vous passez aisément d’un genre à l’autre, comment faites-vous ?
Maggy de Coster : Je suis du genre éclectique et je suis comme une abeille qui butine de fleur en fleur afin de produire le meilleur miel. Je ne me mets pas de barrière, je peux exceller plus dans un genre que dans un autre. Avant de me lancer dans le roman j’ai commencé par l’écriture des nouvelles parce que c’est plus ramassé et plus percutant.
Je tiens cette veine de Maupassant dont la nouvelle la plus courte est « Misti le chat » car les enfants aiment toujours entendre les histoires des animaux. J’ai toujours eu la passion de la lecture car cela me permettait de changer d’univers, de faire des voyages immobiles.
J’aime toujours me lancer des défis. Tant que je ne les relève pas je ne vais pas cesser de poursuivre ma quête avec obstination car je n’aime pas les échecs.
En effet, après ma première publication qui avait été bien reçue à l’adolescence, je ne m’étais pas du tout prise au sérieux même si j’étais passionnée par l’écriture qui se révélait un besoin, voire une nécessité.
C’est grâce aux encouragements de mes lecteurs qui voyaient en moi – comme dans beaucoup d’autres jeunes de ma génération – un espoir pour demain et qui me disaient à chaque fois à « quand le prochain recueil » que j’avais fini par comprendre qu’il y avait une attente à honorer et que j’étais une vraie autrice en devenir et qu’il fallait combler les attentes en écrivant pour être publiée
L’écriture en tous genres a toujours été pour moi une planche de salut.
Diasporadz : Vous paraissez infatigable, parlez-nous de vos dernières publications ?
Maggy de Coster : Je vais toujours jusqu’au bout de ce que je commence. Il s’agit de la publication d’un auteur latino que j’ai traduit de l’espagnol en français et que j’ai présenté le 12 octobre dernier à la Maison de l’Amérique latine. Selon la Société des Gens de Lettres dont je fais partie, le traducteur littéraire est un auteur potentiel. Il donne vie aux écrits dans sa langue de naissance et les fait connaître sous d’autres cieux. Donc il s’agit d’une nouvelle naissance.
En ce qui me concerne, j’ai un recueil de contes pour enfants paru aux Éditions Unicité, 2023
Mon recueil de poèmes « Les versets simplifiés du soleil levant » publié aux Éditions du Cygne, 2017, est traduit en anglais par Danielle Legros Georges et publié aux USA aux Editions Blue Flare, 2024.
Diasporadz : Que pensez-vous de cette citation « Quand nos aïeux brisèrent leurs entraves, ce n’était pas pour se croiser les bras » de l’écrivain poète haïtien Charles Alexis Oswald Durand ?
Maggy de Coster : Comme dit Ferrat « le poète a toujours raison » donc Oswald Durand avait sans doute vu loin car les poètes sont en quelque sorte extralucides et intuitifs. On est des passeurs de mémoire.
Diasporadz : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
J’ai un ouvrage de collaboration qui sortira bientôt aux Éditions La route de la soie. Il s’agit de poèmes inspirés des toiles de Sarah Mostrel.
J’ai aussi le projet d’un livre poésie-peinture avec un autre peintre.
Je suis en train de traduire des poèmes de l’espagnol en français de l’anthologie Resistir réalisée par la poète franco-équatorienne pour un récital dans le cadre du Printemps des Poètes 2025.
Je me suis mise aussi à la peinture sans me considérer comme peintre mais les peintres confirmés ont trouvé mes créations valables et « exposables ».
Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?
Maggy de Coster : Je souhaite continuer d’avoir la même énergie et la même veine littéraire pour continuer à produire.
Entretien réalisé par Brahim Saci
8 janvier 2025
diasporadz.com
……………………………………….
Maggy de Coster : la littérature comme planche de salut

Maggy de Coster a plusieurs cordes à son arc, la littérature semble l’habiter, elle excelle dans l’écriture et la muse lui est une amie salutaire.
De la littérature à la poésie, Maggy de Coster vogue défiant la houle, battant ses ailes dans le vaste ciel du savoir éclairé par le soleil. De Haïti à Paris elle a tant écrit et continue de créer, de militer, de s’engager pour un avenir meilleur de cœur à cœur.
Le roman, la poésie, les arts, sont le langage universel qui relie les hommes et les femmes du monde entier. Maggy de Coster ne s’essouffle pas car elle est habitée par la Muse.
Voici quelques-unes de ses publications parmi les plus récentes :
- Histoires à écouter assis ou allongé, Paris, Editions Unicité,
- À fleur de mots, Editions du Cygne,
- Déclinaison du verbe, Paris, Editions Unicité,
- Antes que despunte el Alba/ Avant l’aube/ Prima che spunti l’alba, Edizioni Universitarie Romane, Roma,
- Les versets simplifiés du soleil levant, Paris, Editions du Cygne,
- Fenêtre ouverte / Ventana abierta, anthologie bilingue français-espagnol, Paris, Les Editions Idem,
- In-version poétique / In-versione poetica, [édition bilingue français-italien], Edizioni Universitarie Romane, Rome,
- Entre éclair et pénombre / Entre relámpago y penumbra, [édition bilingue espagnol-français], Paris, L’Harmattan.
Maggy de Coster a obtenu plusieurs prix et distinctions en France, en Italie et dans des pays d’Amérique latine où elle est souvent invitée en tant qu’autrice et conférencière :
- Le Prix International de Traductrice et Éditrice de Poésie, décerné par l’Académie Claudine de Tencin, Grenoble, 2019.
- Le Collège Daniel Octavio Crespo de Panama lui a décerné le certificat d’Honneur et Mérite en 2012
- Le Premier Prix de Poésie de la Academia Internazionale Il Convivio, en Sicile (en 2003)
- Le Diplôme avec mention et la Médaille de Vermeil de l’Académie Internationale de Lutèce pour son œuvre poétique (en 2004).
- La Médaille de Vermeil de L’Académie Internationale de Lutèce pour son recueil de poème La Tramontane des soupirs ou le Siège des marées, Les Éditions New Legend, 2002.
- La Médaille d’argent de l’Académie Internationale de Lutèce, Paris, février 2005 pour son roman Le chant de Soledad, Editions du Cygne, (2007).
L’écriture est aussi pour Maggy de Coster une histoire de survie, c’est sa bouffée d’oxygène, c’est sa respiration. Le lecteur averti ou pas capte la résonnance, l’énergie semée, tissée page après page, même s’il ne peut l’appréhender il peut néanmoins la ressentir.
L’élan poétique s’élève pour atteindre les cimes sans oublier la terre, les racines d’où jaillissent des sources insoupçonnées qui s’écoulent dans les veines de ceux ou celles qui ne font qu’un avec la nature et tout ce qui est créé. L’écriture apparait ainsi comme un phare qui déchire le brouillard arrachant l’éclaircie pour que brille l’espoir.
Brahim Saci
8 janvier 2025
diasporadz.com
………………………………………………………………….
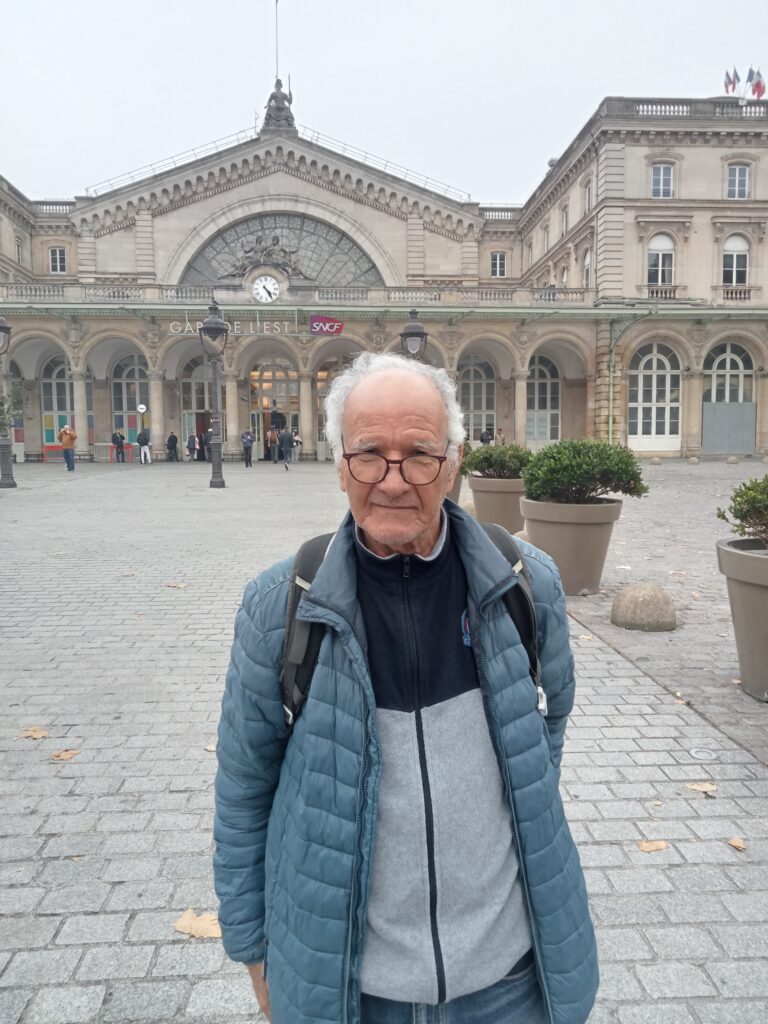
Saïd Zahraoui publie : « Tarik – Histoire oubliée d’un héros berbère »
Saïd Zahraoui, après des études en sciences économiques, entre dans le journalisme en 1971, dans le quotidien national de langue française La République basé à Oran. L’arabisation de ce journal en 1975 a mis fin à une expérience professionnelle passionnante.
Par la suite, déçu par le journalisme, il quitte la profession début des années 80 pour divers emplois jusqu’en 1986, où il entre au quotidien du soir Horizons, comme correspondant régional.
En 1991, après la relative libéralisation politique introduite par la Constitution de 1989, il est un des premiers à quitter la presse d’État à Oran pour s’engager dans la presse dite indépendante.
Après deux ou trois tentatives malheureuses, il fonde, en 1993, Détective, hebdomadaire d’enquêtes et de faits de société, et non de simples faits divers comme certains ont eu tendance à le réduire. Très précisément la publication avait pour ligne éditoriale d’autopsier les tabous quels qu’ils soient, en tant que verrous empêchant l’émancipation sociale.
Le journal connut, dès son apparition, un franc succès. Lequel succès sera la cause même de son départ deux ans plus tard, les principaux financiers se bousculant pour prendre les commandes du journal.
En 2000, il est en France où il publie, chez Robert Laffont, « Entre l’horreur et l’espoir », un témoignage des grands tournants politiques qui ont marqué la décennie noire en Algérie (1989/1999).
Installé à Marseille, il fonde, en 2004, Marseille la Cité, un mensuel dédié à la vie culturelle et du monde associatif de la cité phocéenne. Pour des causes financières, le périodique cesse de paraître en 2008.
Saïd Zahraoui cessera toute activité publique pendant de longues années pour des raisons de santé graves. Entré en convalescence dès 2012/2013, il se consacrera entièrement au projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps déjà : percer le mystère qui entoure la vie de Tarik Ibn Ziad.
Ce dernier projet, qui ne paraissait pas évident, ne l’empêchera pas de s’inscrire à l’université d’Aix-en-Provence pour l’obtention d’une licence de philosophie en 2019.
Le 3 octobre 2024, paraît chez L’Harmattan son roman historique « Tarik – Histoire oubliée d’un héros berbère », dédié à la vie du conquérant de l’Espagne d’avant la traversée du Détroit.
Saïd Zahraoui a un parcours qu’il qualifie lui-même de « chaotique » redonne ces lettres de noblesse à ce personnage emblématique de l’histoire berbère, Tarik Ibn Ziad.
Saïd Zahraoui nous livre avec cette publication une épopée romanesque qui laisse le lecteur presque en haleine dans l’admiration en suivant ce personnage historique héroïque et infatigable. Page après page on l’accompagne, on s’identifie à lui, on voudrait que l’histoire continue. La magie narrative de Saïd Zahraoui nous retient pour ne plus nous lâcher, de sorte que, même quand la lecture se termine, on y pense encore, car Tarik continue de vivre.
Le Matin d’Algérie : Vous avez étudié, les sciences économiques, journaliste, puis une licence en philosophie, maintenant vous publiez un roman historique, qui Said Zahraoui ?
Saïd Zahraoui : Il est un peu tout ça, mais chaque fois pleinement… Je veux dire : quelqu’un en quête permanente de soi, au travers des choses qui le passionnent. J’ai arrêté mes études de sciences économiques en pleine quatrième année de licence, parce que je ne m’entendais plus avec mon directeur de mémoire. C’était une époque où moyennant un repas et une bonne bouteille, comme on dit, tu « persuadais » certains profs que tu étais un futur brillant économiste. Je n’ai pas marché dans cette combine. J’ai tout laissé en plan, et je suis parti.
J’ai quitté El Djoumhouria (ex-La République) début des années 1980 pour la même raison : le dégoût de la profession. La répression des manifs du Printemps berbère à Alger, puis à Constantine si mes souvenirs sont bons, n’ayant eu aucun écho dans le journal, j’avais presque honte de me dire journaliste. Alors que j’avais une situation bien établie de grand-reporter et une carrière toute tracée, je suis parti voir ailleurs et m’engager dans différents boulots… Je pourrais donner d’autres exemples de même type, mais ce serait trop long. C’est dire si ma vie a été assez chaotique.
Disons, pour conclure là-dessus, que c’est là, pour moi, une affaire d’idéal ou d’esthétique de vie, comme une sorte de question de vie ou de mort. J’exagère peut-être mais vraiment à peine… Bref, j’essaie toujours de faire en sorte que ce que je fais comme boulot me convienne, et que les conditions dans lesquelles je le pratique ne heurtent pas mes convictions, en termes de valeurs humaines. Il faut que je sois dans le boulot, comme dans la vie, en harmonie avec moi-même, sinon je me casse.
Le Matin d’Algérie : Vous venez de publier chez l’Harmattan un roman historique sur un personnage emblématique de l’histoire des berbères, Tarik – Histoire oublié d’un héros berbère, comment est né ce projet ?
Saïd Zahraoui : Au tout début il y eut, dès le lycée dans les années soixante, la fascination pour le personnage chez l’adolescent que j’étais. Je n’avais alors aucune ambition d’écriture. Et quand, plus tard, l’idée commença à me titiller, les impressions et les sensations de cette époque remontèrent naturellement à la surface… Une époque remplie de rêves colorés, plus ou moins en rapport avec ce qui faisait, dès le primaire, l’essentiel de nos lectures extrascolaires, à savoir les illustrés… Bleck le Roc, Miki le Ranger, Kit Carson, Pecos Bill etc… Tout fictionnels que soient ces personnages, on ne s’empêche pas de penser que ces héros, comme leurs innombrables pendants au cinéma sous les traits d’acteurs célèbres, ont façonné à la fois la culture américaine et l’image cohérente qu’on a de la société américaine malgré son extraordinaire diversité. Si cohérente d’ailleurs qu’on serait tenté de la définir par quelques mots qui font une sorte d’image d’Épinal de l’Amérique : pionnier, bravoure, aventure etc… Voilà pour la genèse.
Quant au projet d’écriture lui-même sur mon héros, Tarik ibn Ziad, je l’ai débord conçu, pendant très longtemps, comme scénario de BD… Sans trop chercher à savoir s’il avait quelque chance d’intéresser un dessinateur, je m’y suis mis assidûment, comme si je voulais rattraper ma passion des illustrés. Le contenu de l’histoire n’était pas encore tout à fait celui du roman, tel que publié aujourd’hui, mais, pour dire seulement à quel point j’y tenais, le projet final c’était, selon le plan de rédaction, pas moins de six livres, composés chacun d’environ quelques deux-cents vignettes. Un de ces six livres était bouclé et le deuxième en voie… quand vint un accident de parcours. Hospitalisation, billard, chimio, rééducation etc…
Je sortais d’une convalescence, lente et pénible, quand j’ai abordé, lors d’une édition des Rencontres d’Averroès de Marseille, l’historien Pierre Guichard, spécialiste de l’Espagne musulmane (l’Andalousie), pour lui demander s’il pouvait m’indiquer quelques titres d’ouvrages dédiés à Tarik. Souriant et très aimable, il me dit : « Ne vous fatiguez pas. Il n’y a pas plus de deux ou trois phrases écrites à son sujet dans toute la littérature historique. » J’en pris acte, n’ayant aucune raison de mettre en doute son propos. Et d’emblée, mes recherches et surtout ma réflexion sur les données historiques collationnées prirent une nouvelle direction.
Le Matin d’Algérie : Tarik semblait oublié des chroniqueurs de l’époque mais malgré le peu de références vous avez réussi à faire revivre ce personnage, comment avez-vous réussi cette magie ?
Saïd Zahraoui : Justement… Je ne suis pas historien mais l’Histoire ancienne m’a toujours passionné. Et si j’ai d’abord conçu mon projet comme BD, c’était dans l’idée de transmettre cette passion aux enfants, aux jeunes… Je suis persuadé que l’Histoire est une dimension culturelle essentielle dans la formation de l’individu et que tout doit commencer dès le jeune âge. J’en ai moi-même attrapé le virus de façon déterminante, pas à l’école, mais auprès d’un historien autodidacte qui se revendiquait en tant que tel. Bref, l’enseignement officiel, à mon avis, s’il ne prend pas en compte cette exigence, ne réussit à produire que des espèces de petits monstres, dont le déploiement plus tard peut s’avérer néfaste, nuisible, ruineux… Les exemples, à cet égard, ne manquent pas. Et personnellement, j’en ai quelques-uns dans ma besace, qui sont très-très éclairants…
J’en reviens à ce que je disais il y a un instant. C’est surtout la manière même de réfléchir à ce que je faisais qui a été influencée par les paroles de l’historien Pierre Guichard. J’ai commencé donc à questionner chaque donnée avérée ou non… J’en dit quelques mots en quatrième de couverture de l’ouvrage, mais ça mérite d’être rappelé ici.
S’il est admis que Tarik a pu lever une armée d’environ dix-milliers guerriers pour envahir l’Espagne, et si le gouverneur byzantin de Ceuta (chrétien) a mis ses navires à la disposition du guerrier berbère (musulman) pour qu’il traverse le Détroit avec ses hommes, c’est que, primo : il devait y avoir entre les deux hommes une forte et vieille complicité, et deuzio : la vie de Tarik, en tant que héros auprès de son peuple, est bien antérieure à la traversée du Détroit et la conquête de l’Espagne. Il n’y a rien de plus logique que ce double constat, et ça correspond à une autre double réalité. À savoir : on ne sait absolument rien de précis à propos de notre héros d’avant la conquête, et il n’existe aucune donnée historique datant de quelque année que ce soit de toute la première décennie du 8e siècle (700 à 711), concernant la région correspondant au Maroc actuel.
La seule réponse possible à la question de savoir pourquoi ce trou noir dans une séquence cruciale de l’histoire de la région, c’est la suivante : sachant que les seuls historiens de l’époque étaient les chroniqueurs arabes, qui n’avaient sûrement rien à envier à nos actuels intellos stipendiés, force est d’admettre qu’ils ont délibérément occulté la vie de Tarik d’avant la traversée parce qu’il devait être, pour les peuples des autres provinces, une sorte de « mauvais exemple » d’autochtone islamisé.
Pour quelle raison ?
À mon avis, longtemps avant l’envahissement de la péninsule, il a d’abord levé une armée pour imposer, face aux Arabes, une autonomie de gouvernement de la province dans le cadre du califat, et cela avec le soutien logistique du gouverneur byzantin.
Il n’y pas une autre raison qui puisse éclairer les quelques rares faits historiques attestés mais incompréhensibles, dont, par exemple, le fameux conflit entre lui et le gouverneur arabe du Maghreb Moussa ibn Nouceir. S’il y en a une, je suis preneur…
Pour finir là-dessus, sans doute dois-je rappeler que Tarik était le contemporain de la Kahina, décédée en 703… Tarik a dû en apprendre sur son épopée… Pourquoi est-ce qu’on ne lui concéderait pas, sinon l’intelligence, du moins le réflexe d’avoir pris en compte les possibles erreurs de l’héroïne aurassienne, qui expliqueraient sa fin tragique, pour qu’il organise à son tour et dans des circonstances autres sa propre résistance aux Arabes ?
On a souvent tendance à oublier que les gens de l’époque avaient aussi un cerveau… Et c’est ce qui fait que, quatorze siècles après ces événements, nous continuions de patauger dans des conjectures souvent aussi absurdes que ridicules, sans penser une seule seconde que les historiens de l’époque, comme porte-voix des vainqueurs, se seraient peut-être livrés, dans leur écriture de notre Histoire à nous, à un véritable brouillage de pistes.
En tout état de cause, ce n’est là que ma version personnelle concernant cette période historique, une idée que je laisse d’ailleurs clairement ressortir au travers de la structure narrative du récit… Voilà qui rassurerait, j’espère, certains historiens sourcilleux, qui me reprocheraient, si ça se trouve, de m’être hasardé sur un bout de leur terrain encore en friche…
Le Matin d’Algérie : C’est l’un des personnages historiques qui fascinent le plus, à quoi est-ce dû à votre avis ?
Saïd Zahraoui : Ça oui, pour fasciner, il fascine… La preuve : moi. Au tout début, il y avait déjà son célèbre et soi-disant discours prononcé devant son armée après la traversée et aussi, selon la légende, une fois qu’il avait incendié les navires, un discours où il dit « Ô guerriers, à présent vous avez devant l’ennemi et derrière vous la mer, et nulle part où fuir ! … » Etc. C’est des paroles qui marquent quand on a quinze ans…
Mais ce discours, d’une puissance et d’une perfection rhétorique extrêmes, a toutes les caractéristiques de ce que je suppose être l’arnaque des historiens arabes de l’époque à propos de Tarik et ses faits d’armes. À partir de la conquête, ils ont commencé à le glorifier, bien plus que les Berbères eux-mêmes, pour faire oublier le passé récent. Il est fort probable que ce soit là un discours imaginaire, conçu après coup par les chroniqueurs arabes.
Quant à l’incendie des navires, peut-on imaginer pire supercherie ? Pour moi, ça n’a jamais existé, et par voie de conséquence le discours non plus… De quel droit mettrait-il le feu à une flotte qui ne lui appartient pas ? C’est complètement insensé. Sans compter que ses officiers n’étaient pas tous tarés au point où il ne serait pas trouvé parmi eux au moins quelques-uns de très influents pour l’en empêcher. Et puis il y a quand même, entre d’une part la conquête elle-même dont on connaît la suite, c’est-à-dire la civilisation andalouse dont il est, en quelque sorte, le père et l’inspirateur, et d’autre part le fait qu’on ne sache rien du personnage, un paradoxe si grand, si incompréhensible et si vertigineux pour ainsi dire que ça se traduit par de la fascination…
Le Matin d’Algérie : Votre livre est fort bien mené, un style fluide qui n’alourdit pas comme les romans historiques en général, à quoi est due cette prouesse ?
Saïd Zahraoui : Merci du compliment… La fluidité du style serait peut-être le fait que je me sois identifié à mon héros, et sur une longue période : une bonne douzaine d’années quand même…
Le Matin d’Algérie : L’étude de ce personnage à la fois fascinant mais aussi avec ses zones d’ombres, laisse des traces, c’était un défit de le faire revivre même avec si peu d’informations, pari réussi ?
Saïd Zahraoui : Sur le point nodal de tout le récit, je pense que oui. Très humblement, je pense avoir levé le voile sur la cause principale de l’ostracisme et à la fois du brouillage de piste, dont Tarik a fait l’objet : il a organisé les tribus pour imposer une autonomie de gouvernement de la province de Maurétanie tingitane dans le cadre du califat omeyyade.
À partir de là on comprend beaucoup de choses : sa complicité avec l’autorité byzantine de Ceuta, son conflit avec le gouverneur arabe du Maghreb Moussa ibn Nouceir, pourquoi il a été à un moment donné gouverneur de Tanger, pourquoi il y avait des Arabes dans son armée, pourquoi l’armée de Moussa ibn Nouceir, lors d’une agression contre Ceuta, a été décimée par les Berbères, sans doute des hommes de Tarik, etc. À partir de cette cause-là, c’est-à-dire la revendication de l’autonomie de la province, c’est toute une séquence historique dans son ensemble, qui se reconstitue comme un puzzle.
Pour le reste, c’est-à-dire les événements liant entre eux ces moments cruciaux tout au long de la période concernée, c’est le résultat de mon imagination… Par exemple, l’adolescence de Tarik, son périple initiatique à travers toute la Berbérie, sa première rencontre avec le gouverneur byzantin, c’est de la fiction… J’aurais pu très bien imaginer un Tarik issu d’une riche famille, qui aurait étudié auprès de vieux précepteurs formés à Carthage avant sa destruction en 698 etc.
Mais l’idée de périple initiatique m’a paru plus romantique, proche du conte… De même, sachant que le gouverneur byzantin de Ceuta était à la fois romain et berbère, j’ai dû lui inventer une biographie pour justifier cette double appartenance… Ce qui justifie encore plus sa complicité avec Tarik face aux Arabes… Qu’on se rassure donc : au plan de la fiction, il reste encore à faire…
Le Matin d’Algérie : Y aura-t-il une suite ?
Saïd Zahraoui : Très possible, mais c’est trop tôt pour en parler…
Le Matin d’Algérie : Votre livre mérite une adaptation au cinéma, qu’en pensez-vous ?
Saïd Zahraoui : Ça fait plaisir de vous l’entendre dire. Ma fille aînée m’a dit presque la même chose. Très exactement : « Dès les premiers chapitres, j’ai comme l’impression de voir un film… »
D’abord ça signifie que vous avez apprécié. Ensuite ça prouve, dans une certaine mesure, que la structure narrative que j’ai mise en place a fonctionné. Et ce n’est pas étonnant. À l’origine, mon récit devait être un scénario de BD. Ce n’est pas loin…
Le Matin d’Algérie : Avez-vous d’autres projets en cours ou à venir ?
Saïd Zahraoui : Pas plus que des cogitations…
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Saïd Zahraoui : Un grand merci pour toi et pour toute l’équipe du Matin d’Algérie.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Livre publié :
Tarik – Histoire oublié d’un héros berbère, éditions L’Harmattan
lundi 6 janvier 2025
lematindalgerie.com
……………………………………………………………
Rencontre avec Jean Calembert autour de son roman « Où vas-tu nuage ?»
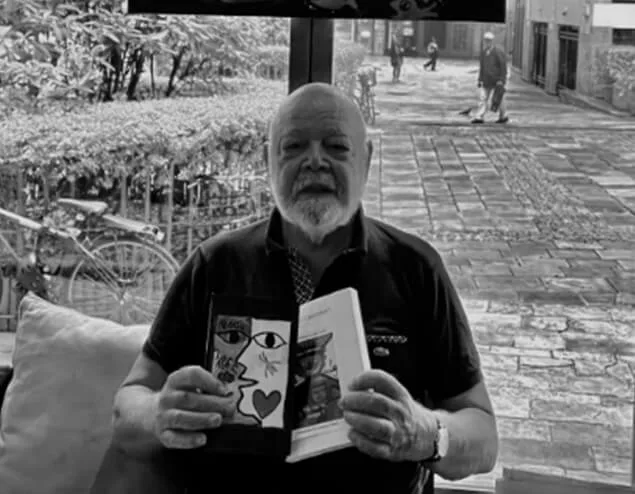
L’écrivain belge Jean Calembert nous parle de son livre « Où vas-tu nuage ?» qu’il vient de publier chez L’œil de la femme à barbe édition, un roman consacré à Jaber Al Mahjoub, dit Jaber, cet artiste peintre, saltimbanque, hors normes, presque irréel, figure emblématique de l’Art Brut, qui s’est éteint à Paris dans le 11e arrondissement, le 20 octobre 2021 à l’âge de 83 ans.
Diasporadz : Votre livre est bouleversant, surtout quand on a connu Jaber, comment est née l’idée de ce livre ?
Jean Calembert : Bizarrement et brusquement. J’étais en contact depuis quatre mois avec un curieux personnage qui était semble-t-il intéressé par mes deux premiers romans. Il m’a promis de les acheter en septembre 2023 tout en clamant qu’il ne les lirait jamais. Intrigué par le joyeux farfelu, j’ai visité son site et découvert que c’était un ancien galeriste, belge exilé à Paris, absolument fou d’un peintre nommé Jaber que je ne connaissais pas du tout et dont je suis tombé immédiatement sous le charme, de l’artiste et du personnage.
À l’époque, j’étais en panne d’inspiration avec deux manuscrits en jachère. Après un mois de dialogue avec Raymond Michel (le joyeux farfelu), quelques interviews avec des proches de Jaber et des recherches dignes de Hercule Poirot, j’ai décidé d’écrire « quelque chose », je ne savais pas quoi, en commençant par la jeunesse de Jaber, la partie la plus simple mais la moins documentée !
Je me suis mis dans la peau du petit orphelin analphabète et j’ai inventé beaucoup de choses, notamment sur son vécu avec Mimoune, un vieux boulanger de La Goulette. C’était parti. J’ai fini mon premier manuscrit à la fin de l’année 2023, en quatre mois ! Après l’architecture n’a pas changé mais j’ai « toiletté », peaufiné, nuancé le récit pendant six mois.
Diasporadz : Vous avez réussi le pari de faire revivre Jaber, comment avez-vous réussi cette magie ?
Jean Calembert : Au début, j’avais l’intention d’écrire une nouvelle, puis un roman, avec des tranches de vie basées sur les moments magiques qui structuraient la vie de Jaber : l’enfance, la partie boulanger-chanteur-boxeur-bonimenteur, son mariage et son divorce aux USA, sa résistible ascension, sa vieillesse, son décès. Très vite, j’ai eu l’idée d’intégrer dans le récit des interludes de pure fiction, les chapitres « Jaber et moi ». J’écrivais jour et nuit, deux heures le matin, deux heures en début d’après-midi, pause, une heure avant le repas du soir.
À l’époque, je rêvais beaucoup de Jaber (des rêves que j’essayais de programmer !). Mais, quand j’y pensais le lendemain, les souvenirs étaient vagues, inconsistants. J’ai décidé alors de monter mon PC dans la salle de bain. Lorsque je me réveillais la nuit entre deux rêves, je prenais quelques notes qui me servaient de matériau de base, de substrat pour un ou plusieurs épisodes.
Durant toute cette période, j’ai chanté, peint, mangé, fait du vélo, déconné, vieilli avec Jaber ! Et le personnage a pris forme. J’y ai pris un plaisir fou. J’ai inventé un Jaber Bis, sans autre contrainte que les limites de mon imagination avec une double exigence : respecter ses valeurs et ne jamais porter de jugement de valeur sur son parcours de vie.
Diasporadz : Vous avez cherché et trouvé l’ombre et la lumière entourant sa vie, qu’en pensez-vous ?
Jean Calembert : Je ne l’ai pas cherché. C’est cela, le vrai Jaber. L’ombre et la lumière ! Docteur Jekyll et Mister Hyde ! Il a deux visages. Celui qu’il montre surtout en public et qu’il affiche en semaine, différent chaque jour, celui d’un joyeux bouffon, au rire moqueur, jamais méchant. Et puis le visage qu’il a vraiment. Celui que l’on voit quand il tombe le masque, surtout en privé et le week-end. Celui d’un poète philosophe qui aime bien faire rire les autres, mais se contente d’une joie discrète teintée d’autodérision.
Il ne faut pas essayer de dissimuler ou de nier les défauts de Jaber. Il faut, au contraire, les voir comme un mal nécessaire et dérisoire par rapport à tout ce que Jaber a apporté́. Il faut apprendre à comprendre et à pardonner le côté́ sombre et secret de Jaber pour l’aimer vraiment, totalement.
Diasporadz : Je vois très bien une adaptation au cinéma, d’ailleurs la construction même du livre s’y prête, y avez-vous songé ?
Jean Calembert : Honnêtement, non ! J’en suis encore à prendre le bel objet qu’est « Où vas-tu, nuage ?» dans mes mains, d’en admirer les rabats, d’en feuilleter les pages, de sentir l’odeur du papier, d’en relire des passages. Et de revivre les merveilleux moments passés avec mon éditrice Ghislaine Verdier de L’oeil de la femme à barbe(!), dans son atelier, à la sortie du livre au Falafel Café, à la Halle Saint-Pierre.
Mais c’est vrai que votre question et certaines chroniques de mes premiers lecteurs donnent corps à cette hypothèse… Un film sur Jaber ? Pourquoi pas !
Diasporadz : Dans vos recherches, quelles sont les difficultés majeures rencontrées ?
Jean Calembert : Assez peu finalement. J’ai été frappé par l’enthousiasme des gens (collectionneurs, galeristes, amis proches, amis tunisiens, famille, etc.) à parler de lui avec amour, respect et chaleur et à me faire part d’anecdotes plus savoureuses les unes que les autres. Retrouver la femme de Jaber aux USA, et la faire parler, a été, je crois, un exploit. Faire la lumière sur sa fin de vie a été le plus difficile et le plus pénible. Le reste a coulé de source, presque naturellement.
Diasporadz : Tel un détective vous avez pu reconstituer la vie de Jaber, avez-vous atteint votre objectif ?
Jean Calembert : Reconstituer sa vie n’était pas un objectif. Comprendre le personnage, faire le tri entre des témoignages contradictoires, explorer la partie cachée de l’iceberg, le ressusciter de façon crédible, oui ! D’après une majorité de lecteurs, je crois que j’ai réussi cette mission impossible.
Diasporadz : Peut-on dire qu’il s’est noyé dans l’Art brut ?
Jean Calembert : Je ne crois pas. J’en suis même certain. La période la plus heureuse de sa vie, ce n’est pas celle de la rencontre avec Dubuffet, ni celle de sa consécration comme un des maitres de l’Art brut.
C’est la période où, avec pour seules armes son culot, son vieil oud, ses grimaces, son enthousiasme, sa naïveté́ et son bagout, il captivait sans effort des centaines et des milliers d’inconnus. Ce sont, avec le recul, les plus belles années de sa vie !
Je ne suis pas sûr que son art soit si brut que cela. Éveiller la curiosité́ des gens, faire le clown, chanter, peindre, c’est sa raison de vivre. Le temps suspend son vol quand Jaber crée, ce sont les seuls moments où il connait un bonheur intense. Un bonheur qui dure et ne s’évapore pas dans l’instant.
En un week-end, il peut réaliser dans la joie plus de 200 œuvres sur papier, presque toutes géniales. Comme il peut, avec la même jouissance, préparer plus de 100 sculptures banales et fragiles comme le pain et accoucher le week-end de deux totems flamboyants, résultats d’une sorte de free-jazz endiablé, envoutant.
Chez Jaber, le génie suit un drôle de chemin, imprévisible et délicat. Il le dit lui-même : « Pour moi, la vie d’artiste… c’est le chemin du hasard. Quand j’ai des chaussures, j’ai pas de chaussettes et quand j’ai des chaussettes, j’ai pas de chaussures. C’est pourquoi j’ai choisi de faire ce long chemin pieds nus ».
Diasporadz : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Jean Calembert : À court terme, je me consacre à la promotion de « Où vas-tu, nuage ?». J’aime rencontrer des gens qui ont connu Jaber, me montrent des œuvres qu’ils ont acheté ou que Jaber leur a données. Ils me parlent de lui avec passion, me montrent des coupures de journaux, des photos, des vidéos… Et j’aime faire connaître Jaber, l’artiste et la belle personne à des gens qui le découvrent.
Et puis, dès le printemps, j’aspire à retrouver mes proches que j’ai délaissés depuis l’aventure Jaber. D’aller dans ma Drôme Provençale, de refaire du vélo, de réécouter Léo Ferré, John Coltrane et Thelonious Monk, de relire Kerouac et Bukowski !
Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?
Jean Calembert : Une nouvelle vie commence pour Jaber et moi.
Emporte-moi, nuage ! Enlève-moi, nuage, comme il plait au vent. Cela seul importe. Le reste n’est rien !
Entretien réalisé par Brahim Saci
5 janvier 2025
diasporadz.com
………………………………………………………………………….
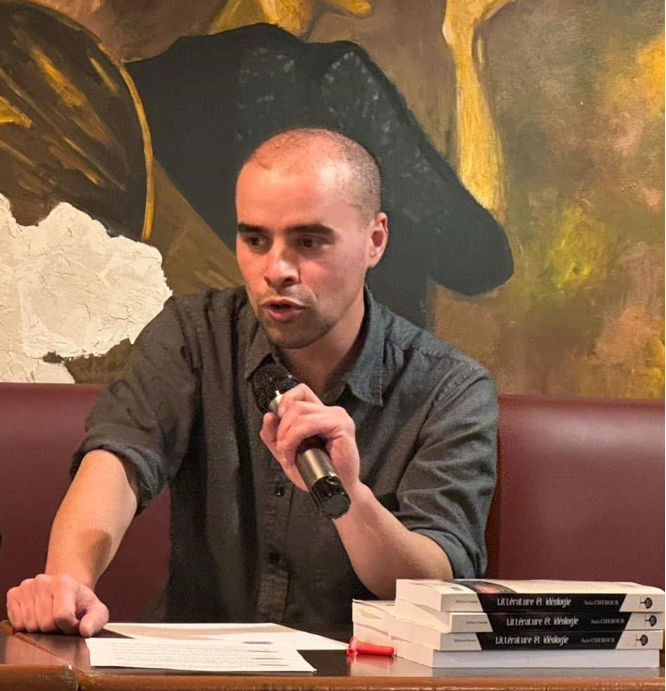
Aziz Cheboub : « La littérature a le pouvoir de transformer les individus»
Aziz Cheboub est docteur en littérature de l’Université de Strasbourg, il est un chercheur et enseignant en lettres modernes. Depuis son master, il explore les thématiques de la dystopie et de l’utopie dans la littérature contemporaine dans une analyse de la littérature et sa relation étroite avec les interactions et influences de la société.
Cette société où les lobbys semblent tirer les ficelles, celles qui nous éloignent du ciel, entre utopie, propagande et idéologie, le commun des mortels semble perdu.
Aziz Cheboub tente une approche subtile, éclairée afin de dénouer les nœuds et écarter les brumes pour mieux voir les protagonistes, les acteurs et la scène.
Aziz Cheboub publie un essai intitulé Littérature et idéologie aux éditions Persée, en approfondissant ses recherches sur les rapports entre la fiction et les constructions idéologiques de cette époque écorchée, écartelée par la dystopie.
Dans ce livre thèse courageux, il tente de démêler ce qui est de l’idéologie, de l’utopie, de la dystopie pour mieux comprendre les enjeux et les intérêts qui luttent et s’allient pour fracturer le monde déjà fragilisé et la société.
Aziz Cheboub mène cette quête et analyse à travers cinq livres, cinq romans emblématiques, La tentation de la défaite, d’Antoine Vitkine, 2084, de Boualem Sansal, Jihad, de Ligny Jean-Marc, Soumission, de Michel Houellebecq et 2028 de Thérèse Fournier, c’est une étude comparative, politique par le prisme de la littérature, mettant en exergue les tensions, articulations, soubresauts socioculturels contemporains.
Même si les concepts se bousculent à bout de souffle, page après page, on en sort néanmoins un peu plus avertis. On se réapproprie son libre arbitre et sa propre vision.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes docteur en littérature, vous êtes un passionné des livres, qui est Aziz Cheboub ?
Aziz Cheboub : Je suis avant tout un passionné des mots et des idées qu’ils portent. Mais, au fond, qui suis-je ? Un explorateur des mondes littéraires, un chercheur de vérités enfouies entre les lignes, et un fervent défenseur de la liberté de pensée.
Mon intérêt se porte particulièrement sur les œuvres littéraires qui interrogent les enjeux politiques et sociaux, transmettant, parfois avec justesse, parfois de manière discutable, des idéologies qui agissent comme un miroir de notre réalité.
Le Matin d’Algérie : Vous venez de publier un livre courageux, Littérature et idéologie, chez les éditions Persée, racontez-nous la genèse de ce livre ?
Aziz Cheboub : La genèse de mon ouvrage remonte au début de mon doctorat à l’université de Strasbourg en 2018. Les questions soulevées par mon corpus étaient d’actualité et elles le sont toujours.
Ces questions ont le mérite d’être posées, décortiquées et étudiées. J’ai constaté que des idéologies comme l’islamisme et l’extrême droite, bien qu’apparemment opposées, partagent des dynamiques et des mécanismes similaires dans leur ascension et leur impact sur les sociétés contemporaines.
On n’a jamais vu une extrême droite aussi victorieuse en Europe. En Afghanistan, malgré l’intervention des États-Unis, après leur retrait militaire en 2021, les Talibans sont réapparus et se sont accaparés le pouvoir. Nous assistons à une politique ankylosée et incapable de répondre véritablement aux préoccupations de la population en termes de justice sociale.
C’est ce constat qui m’a poussé à approfondir cette thématique et à en faire le cœur de mon livre. Le but de cet ouvrage est de comprendre comment ces idéologies se construisent, se propagent et influencent la littérature ainsi que la pensée collective.
Le Matin d’Algérie : Votre livre et un essai, mais c’est plutôt un livre thèse, qu’en pensez-vous ?
Aziz Cheboub : Certes, on pourrait dire que mon livre est un essai, mais je le considère plutôt comme un « livre-thèse ». Pourquoi ? Parce qu’il ne se contente pas d’exposer des idées, il les analyse, les dissèque à travers des récits fictifs et tente de proposer une vision globale et argumentée des rapports entre la littérature et l’idéologie.
Je n’ai pas uniquement concentré mes efforts sur l’aspect politique de ces œuvres, mais aussi sur leur littérarité et leur esthétique. Les romans de mon corpus restent des fictions, des fictions qui, cependant, abordent des enjeux contemporains et nous permettent de réfléchir sur notre réalité actuelle.
Le Matin d’Algérie : J’avoue qu’on se perd un peu dans les concepts, là où se mêlent littérature et philosophie, pouvez-vous nous éclairer ?
Aziz Cheboub : Il est vrai que les concepts abordés dans « Littérature et idéologie » peuvent paraître complexes, car ils se situent à l’intersection de la littérature, de la politique, de la philosophie et même de la théologie. Cette convergence des disciplines est essentielle à l’ouvrage, car elle permet d’explorer des questions profondes sur la nature humaine, la société et les idéologies qui nous gouvernent.
Ce vocabulaire est crucial pour comprendre non seulement ces romans, mais aussi toute œuvre dystopique (monde futuriste fictif cauchemardesque) ou utopique (monde futuriste paradisiaque), son opposée. Ces œuvres ne peuvent être réduites à de simples fictions ; elles interpellent les lecteurs sur la nécessité de comprendre le monde dans toute sa complexité et d’éviter les simplifications à outrance.
Dans mon livre, au début de chaque chapitre, je remonte à l’étymologie de chaque concept pour mieux le cerner. Ainsi, tout lecteur, même non-initié, peut y trouver des explications claires de chaque concept abordé. Cette approche permet de démystifier des idées souvent perçues comme abstraites et de les rendre accessibles à un public plus large.
Le Matin d’Algérie : On a vu ces dernières années la littérature empêtrée dans la politique, ne risque-t-elle pas de perdre son sens ?
Aziz Cheboub : Certes, il existe un risque que la littérature perde son essence si elle se transforme en simple outil de propagande ou de militantisme. Cependant, la véritable force de la littérature réside dans sa capacité à transcender les idéologies et à offrir des perspectives nuancées et critiques.
Elle incite à la réflexion, à l’empathie et à la compréhension des complexités de notre monde.
La littérature ne doit pas être perçue comme un domaine isolé de la politique, mais plutôt comme une composante essentielle de notre discours sociétal. En confrontant les lecteurs à des idées et des réalités souvent dérangeantes, elle joue un rôle crucial dans la formation de citoyens éclairés et engagés. La clé réside dans le maintien d’un équilibre entre l’engagement politique et la richesse narrative pour préserver la puissance transformative de la littérature.
Le Matin d’Algérie : Quelle est d’après-vous la limite entre l’idéologie, l’utopie, la dystopie et la littérature ?
Aziz Cheboub : La frontière entre l’idéologie, l’utopie, la dystopie et la littérature est souvent subtile. La littérature peut refléter une idéologie, critiquer une utopie ou mettre en garde contre une dystopie, comme George Orwell l’a fait dans « 1984 » pour dénoncer le stalinisme.
Cependant, cette idéologie représentait le début d’une utopie pour les bolcheviques, tandis que le règne de Staline était perçu comme une dystopie par les mencheviks. Tout dépend de notre perspective idéologique. Ainsi, la littérature nous aide à naviguer entre ces concepts et à en saisir les nuances et les implications profondes.
Un lecteur avisé est encouragé à exercer son esprit critique, à distinguer l’anecdotique du fondamental, et à se concentrer sur ce que Edgar Morin appelle « l’urgence de l’essentiel ». Cela signifie reconnaître les enjeux majeurs et comprendre la complexité du monde sans tomber dans des simplifications excessives
Le Matin d’Algérie : Votre analyse comparative des cinq romans emblématiques est pertinente, on s’approche des problématiques de la sociologie, est-ce qu’on ne s’éloigne pas de la littérature ?
Aziz Cheboub : L’analyse comparative des cinq romans vise à montrer comment la littérature peut éclairer des problématiques sociopolitiques. On pourrait craindre de s’éloigner de la littérature en abordant ces questions, mais au contraire, je pense que cela enrichit notre compréhension des œuvres et de leur impact sur la société.
Par exemple, « Soumission » utilise une prose froide et détachée pour refléter l’aliénation du protagoniste, François, dont la trajectoire spirituelle rappelle celle de l’écrivain français du XIXe siècle Joris-Karl Huysmans. Quant à « 2084 », il emploie une langue riche et imagée pour dépeindre un futur dystopique. Ces choix stylistiques ne sont pas anodins ; ils renforcent les thèmes et les messages des romans, tout en offrant une expérience de lecture immersive et stimulante.
En analysant ces œuvres sous l’angle esthétique, nous pouvons mieux comprendre comment les auteurs utilisent les techniques littéraires pour enrichir leur propos et captiver leurs lecteurs. Cela démontre que la littérature, même lorsqu’elle aborde des questions sociopolitiques, reste avant tout un art, capable de toucher et de transformer ses lecteurs par la beauté et la puissance de son écriture.
Le Matin d’Algérie : Votre passage au café littéraire de l’Impondérable de l’écrivain journaliste Youcef Zirem a été un succès, il y a encore un public pour la vraie littérature malgré ce qu’essaient de promouvoir les médias lourds répondant à des intérêts, ce que j’appellerais une pensée unique de l’évènementiel, qu’en pensez-vous ?
Aziz Cheboub : Mon passage au café littéraire de l’Impondérable, organisé par Youcef Zirem, a été une expérience incroyablement enrichissante, tant sur le plan humain qu’intellectuel. Cet espace de rencontre pour les amateurs de littérature favorise l’échange d’idées et la discussion autour des livres, stimulant ainsi la créativité et l’intérêt pour la lecture.
Cela démontre qu’il existe encore un public avide d’une littérature plurielle, malgré l’omniprésence des médias de masse et de leur promotion de la pensée unique.
De nos jours, on assiste à la prolifération des médias alternatifs car la plupart des médias mainstream ont perdu leur crédibilité. Ces médias, souvent accusés de promouvoir une pensée unique et de répondre à des intérêts financiers, disposent de moyens considérables qui leur permettent de dominer le paysage médiatique.
En revanche, les médias alternatifs émergent pour offrir des perspectives variées et souvent contre-courant. Ils donnent la parole à des voix marginalisées et couvrent des sujets négligés par les grands médias. Cependant, il est crucial de soutenir ces médias alternatifs pour éviter une homogénéité des discours et préserver la diversité des idées. En enrichissant le débat public, ces médias contribuent à une réflexion plus nuancée et à une meilleure compréhension des enjeux contemporains.
Il est également important de reconnaître que les médias mainstream, grâce à leurs vastes ressources, ont la capacité de toucher un large public et de mener des enquêtes approfondies. Il faut encourager ces médias à diversifier leurs perspectives et à offrir un contenu plus équilibré. En soutenant à la fois les médias alternatifs et en incitant les médias mainstream à évoluer, nous pouvons préserver la richesse du débat public et garantir une information de qualité, diversifiée et accessible à tous.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Aziz Cheboub : Absolument. En ce moment, je travaille sur un roman que je dois encore peaufiner. Parallèlement, je prépare des communications pour des colloques futurs, où je prévois de parler des recherches connexes aux thèmes abordés dans « Littérature et idéologie ».
Ces projets s’inscrivent dans la continuité de mes travaux et de mon engagement à promouvoir la réflexion critique à travers la littérature.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Aziz Cheboub : Dans un monde en perpétuelle mutation, il est essentiel de défendre et de promouvoir la diversité des voix et des idées. Je suis profondément convaincu que la littérature a le pouvoir de transformer les individus et les sociétés, et je continuerai à œuvrer pour qu’elle occupe la place qu’elle mérite dans nos vies.
Je tiens à vous remercier chaleureusement Brahim pour cet échange riche et ses questions pertinentes. Merci également à tous les lecteurs et aux amateurs de littérature pour leur soutien indéfectible. Continuons à lire, à réfléchir et à échanger.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Livres publiés :
Littérature et idéologie, éditions Persée
Utopie et dystopie, Edilivre
dimanche 5 janvier 2025
lematindalgerie.com
Sortie du roman « Où vas-tu nuage ? » de Jean Calembert
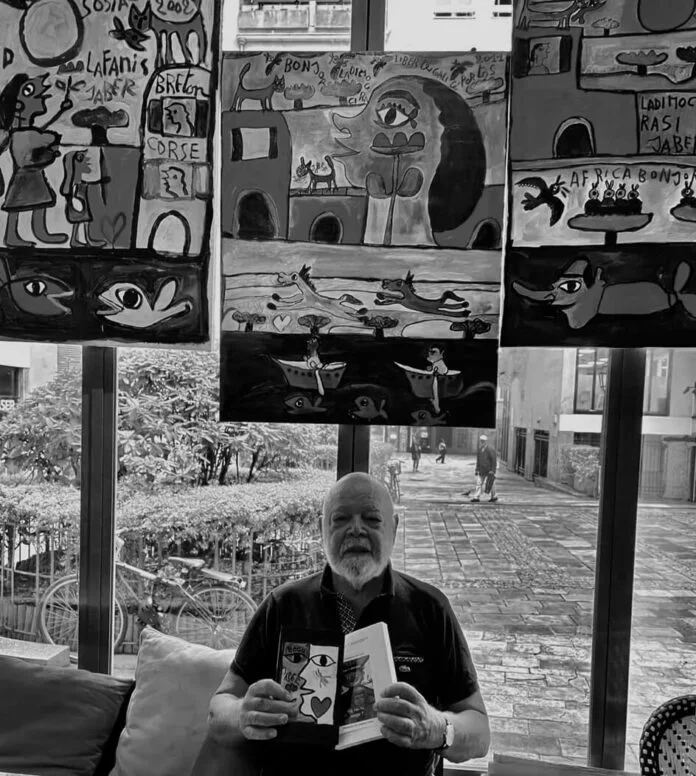
Sortie du roman « Où vas-tu nuage ? » de Jean Calembert
Jean Calembert vient de publier « Où vas-tu nuage ?», chez L’œil de la femme à barbe édition, un roman consacré à l’artiste Jaber Al Mahjoub, dit Jaber.
Jean Calembert est un écrivain belge au parcours des plus atypiques, docteur en droit, expert en marketing, il a parcouru le monde avant sa plongée et une immersion passionnée dans la littérature à l’âge de 77 ans.
Après son roman, Le Mal-Aimé, publié chez Bitbook.be, où interrogeant déjà, interpellant, voguant entre le réel et la fiction, laissant le lecteur dans l’émerveillement par la beauté littéraire, il aboutit à une simplicité quasi magique dans la narration et les descriptions, une simplicité digne des plus grands auteurs, comme louis Ferdinand Céline, Marguerite Duras, Françoise Sagan, mais aussi William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck, Paul Auster, Truman Capote, Jacques Sternberg, Marcel Moreau, Jack Kerouac et Charles Bukowski, des figures centrales de la littérature universelle.
Philip Milton Roth disait, « Le vrai écrivain n’est pas celui qui raconte des histoires, mais celui qui se raconte dans l’histoire. La sienne et celle, plus vaste, du monde dans lequel il vit. »
Jean Calembert revient avec un livre qui bouscule la pensée, la froisse, pour qu’elle revive, même s’il nous a habitués à des romans hors du commun dans une fiction transcendant la réalité avec une force littéraire et un élan poétique inouï. On peut dire que c’est un retour sur la scène littéraire poétique avec un tableau transfigurant le surréalisme.
Jean Calembert vient de publier « Où vas-tu nuage ?» chez L’œil de la femme à barbe édition, un livre incroyable consacré à Jaber Al Mahjoub, dit Jaber, cet artiste peintre, saltimbanque, hors normes, presque irréel, figure emblématique de l’Art Brut, qui s’est éteint à Paris dans le 11e arrondissement, le 20 octobre 2021 à l’âge de 83 ans.
Jean Calembert a eu comme un coup de foudre pour cet artiste décalé, hors du monde, cet artiste si éloigné des canons artistiques habituels.
J’ai connu Jaber pendant plus de trente ans, je ne peux donc que me réjouir de cette publication.
Jaber était cet artiste, bohème, écorché, incompris aux frontières de l’absurde et de l’extravagant, à l’allure fantasmagorique déchirant la vision blessant les regards, tant il paraissait hors du temps, comme sorti de l’illusion, au visage, tantôt grimaçant tantôt souriant tout aussi attachant, poussant la réflexion jusqu’à se tordre pour espérer approcher cet Art brut, libre sans attaches.
Jaber Al Mahjoub était semblable à son oud auquel il manquait souvent une corde, mais il ne jouait pas vraiment, il frappait les cordes, sortant un air brutal, d’un jeu percussif heurtant l’instrument.
Vers la fin de sa vie, quand je le croisais, nous prenions un café à Paris, rue des Pyrénées dans le 20ème arrondissement, chez Said, et nous parlions un peu, mais c’était presque un monologue, j’étais presque seul à parler, il était ailleurs, vide était son regard, mais j’aimais lui rappeler Beaubourg début des années 1980 et il souriait tout en grimaçant, il ne pouvait s’en empêcher malgré un âge avancé.
Ce livre est comme une quête tridimensionnelle tentant de saisir ce qu’il y a entre le réel et l’illusion par le prisme de l’Art brut. C’est un livre bouleversant, attachant, le style narratif fluide sans ornements inutiles nous fait aimer le personnage page après page, espérant croiser ce nuage.
Brahim Saci
4 janvier 2025
diasporadz.com
………………………………………………………………….
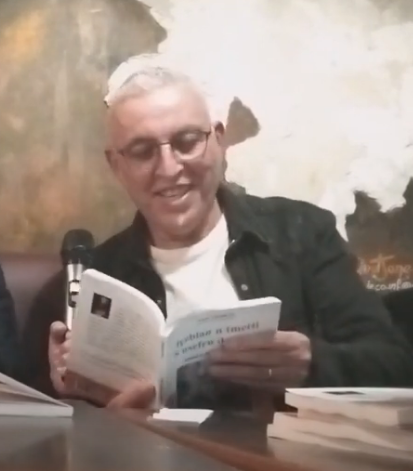
Nasser Abassi : « Mes poètes préférés sont Si Moh U Mhand et Youcef U Kaci »
Nasser Abassi est connu comme homme de radio, il a longtemps fait des entretiens avec des artistes installés en France pour Radio Soummam.
Il a été fonctionnaire dans l’éducation nationale en Algérie pendant une douzaine d’années. Il a très tôt fréquenté les mieux culturels. Puis il quitte le pays comme beaucoup pour la France sans toutefois perdre l’attachement pour le pays natal.
Il a continué à produire des émissions à la radio, à Berbère télévision, et pour radio Soummam, il a ainsi pu inviter un grand nombre d’artistes kabyles, il a toujours été attentif à la création artistique dans un soucis sans cesse renouvelé de la faire connaître et de l’apporter au public.
Nasser Abassi a toujours agi avec son cœur, dans l’amour de la culture qu’il sait fragile. Il a toujours œuvré de son mieux pour promouvoir et élever cette culture pour en tirer le meilleur. Toujours souriant et l’air jovial pour mettre à l’aise l’artiste invité.
Mais cette fois, il vient de publier avec bonheur un beau recueil, Iɣeblan n tmetti S usefru d wanzi, où la poésie côtoie le proverbe, pour raconter la vie, avec ses affres, ses tourments mais aussi ses joies, et l’amour.
La maturité de ce recueil montre que la poésie a toujours été là. Nasser Abassi cisèle le vers avec une dextérité rare magnifiant le verbe kabyle aux couleurs des saisons ouvrant l’horizon à l’espoir qui n’est jamais loin pour celui qui voit avec la rime, avec le poème, l’asefru, alors tout s’éclaire écartant les brumes et les brouillards.
Le poète s’élève tel un phare guidant, éclairant, empêchant le naufrage. Par ce recueil Nasser Abassi nous aide à mieux voir, comme dans un miroir, c’est aussi un retour vers le cœur, chaque poème apporte du bonheur.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un homme de radio, de télévision, un enseignant, mais surtout un poète, qui est Nasser Abassi ?
Nasser Abassi : Nasser est une simple personne qui essaie de faire de son mieux pour la promotion de la culture amazighe.
Le Matin d’Algérie : Vous avez œuvré pendant de longues années à promouvoir, à faire connaître notre culture, en invitant un grand nombre d’artistes dans vos émissions radios, d’où vient cet amour pour la culture ?
Nasser Abassi : Étant un amoureux de la chanson à texte et ayant côtoyé ce milieu et surtout les anciens artistes qui sont marginalisés, mon but était de promouvoir ces chanteurs et de donner à César ce qui appartient à César.
J’ai toujours aimé le travail radiophonique, et mon souhait était d’être animateur radio. Souhait exaucé en intégrant berbère télévision au début des années 2000, puis en collaborant avec Radio Soummam pendant des années.
À Radio Soummam, j’ai collaboré avec une de mes collègues, j’ai coproduit des émissions pour Tiziri, j’ai fait des interviews avec des artistes installés en France pour son émission Asmekti. Sinon à berbère télévision j’ai travaillé une douzaine d’années.
Actuellement, j’ai intégré une nouvelle radio à Paris, Voix-Med (Voix méditerranéenne), qui va voir le jour prochainement.
Le Matin d’Algérie : Vous venez de publier un recueil en kabyle, Iɣeblan n tmetti S usefru d wanzi, bouleversant, d’une grande profondeur, on peut dire que c’est réussi, on se retrouve dans cette langue kabyle limpide qui s’écoule sans difficulté contournant ou perçant les rochers, d’où la force qui s’en dégage. Cette façon que vous avez de passer du poème au proverbe est judicieuse car elle suggère un lien intemporel sans fin, comment avez-vous réussi cela ?
Nasser Abassi : Le projet était venu après l’insistance de mes amis qui m’ont beaucoup encouragé, sinon je ne me considère pas vraiment comme un poète, je fais seulement des essais poétiques. J’ai produit un CD de 8 poèmes en 2023 et un recueil de poésie et proverbes en 2024.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les poètes qui vous influencent ?
Nasser Abassi : Mes poètes préférés sont Si Mohand U Mhand, Youcef U Kaci et Ben Mohamed.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Nasser Abassi : Mon projet à venir est de traduire en français ce recueil, Iɣeblan n tmetti S usefru d wanzi, c’est d’ailleurs en chantier.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Nasser Abassi : Je te remercie pour cette belle rencontre et l’intérêt que tu donnes à l’art et aux artistes. J’en profite pour souhaiter une bonne année 2025 et un joyeux Yennayer 2975.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Livre publié :
Iɣeblan n tmetti S usefru d wanzi, éditions El Amel
samedi 4 janvier 2025
lematindalgerie.com
………………………………………………………………………………………………..

François Kerdoncuff est décédé le 12 septembre 2024 à l’âge de 70 ans
Hommage à François Kerdoncuff le 28 novembre prochain
Le Conservatoire municipal Camille Saint-Saëns et la Mairie du 8e arrondissement de Paris rendent hommage à François Kerdoncuff, le jeudi 28 novembre à 19h
On ne peut que saluer cette belle initiative de rendre hommage à François Kerdoncuff décédé le 12 septembre 2024 à l’âge de 70 ans des suites d’une longue maladie.
François Kerdoncuff a dirigé le Conservatoire Municipal Camille Saint-Saëns du 8e arrondissement de Paris où il a aussi enseigné le piano, pendant onze ans, de 2005 à 2016, succédant à Michel Capelier qui a été à la tête de ce conservatoire pendant vingt ans de 1985 à 2005.
Le concert que j’ai donné au conservatoire du 8e le 07 juin2006 reste gravé dans ma mémoire, je revois encore les deux directeurs, Michel Capelier et François Kerdoncuff au premier rang, monsieur François Lebel maire du 8e pendant 31 ans, de 1983 à 2014, décédé le 22 août 2024, était là également. Ce jour-là, la chanson kabyle a fait vibrer tout le quartier Saint-Honoré jusqu’à l’Élysée.
Michel Capelier et François Kerdoncuff, paix à leur âme, qui ont voué leur vie à la musique, ont contribué au rayonnement de ce beau conservatoire, haut lieu de l’enseignement musical pour transmettre cet art majeur aux jeunes générations.
François Kerdoncuff a continué l’œuvre de Michel Capelier, en faisant de ce conservatoire l’un des plus chaleureux et des plus beaux de Paris, l’un des meilleurs accueils, où les élèves sont heureux de venir, où il fait bon vivre, où l’harmonie règne entre l’équipe pédagogique et l’équipe administrative, où le transfert du savoir musical, de la danse et de l’art dramatique, se fait chaque jour dans les meilleures conditions.
François Kerdoncuff : une vie vouée à la musique
Pascale Cattanéo, alors secrétaire générale, et François Kerdoncuff créent en décembre 2015 le « Bœuf de Noël », une belle trouvaille de Pascale Cattanéo à laquelle s’est joint favorablement et avec bonheur le directeur François Kerdoncuff.
On peut dire qu’ils ont travaillé en binôme, dans une harmonie parfaite, dans une vision et une perspective d’équité, de respect et de partage, laissant une belle empreinte au conservatoire du 8e.
L’idée du « bœuf de Noël » est de jouer et d’improviser pour fêter la fin de l’année dans la convivialité, en musique, ouvert à toute l’équipe administrative, pour ceux qui ont une pratique artistique et à l’équipe pédagogique avec leurs élèves pour partager un moment chaleureux, les cours s’arrêtaient alors à 20h.
J’ai eu l’honneur de participer à ce « Bœuf de Noël » de 2015 à 2019 en chantant une chanson bilingue kabyle français et parfois deux chansons.
Chaque année Pascale Cattanéo et François Kerdoncuff conviaient toute l’équipe administrative aux vœux du maire pour fêter la nouvelle année dans l’amitié et la convivialité, que de souvenirs mémorables !
François Kerdoncuff, élève de Nadia Tagrine pianiste concertiste, professeur, formant de nombreux concertistes et professeurs parmi lesquels : Laurent Grynszpan compositeur et professeur agrégé, François Kerdoncuff, Annie Devize-Nalezny, Jean-Pierre Bartoli, Sylvie Lechevalier, Emmanuelle Bartoli, Gisèle Magnan, Philippe Tamborini, Maud Garbarini, Irène Kudela, Stéphane Fuks, Véronique Bonnecaze, et bien sûr sa fille Nathalie Béra-Tagrine.
L’un des meilleurs pianistes de sa génération
François Kerdoncuff, disciple de Vlado Perlemuter considéré comme l’un des interprètes les plus marquants des œuvres de Ravel, était l’un des meilleurs pianistes de sa génération, la passion et le travail l’ont élevé vers de hautes cimes, jusqu’à ne faire qu’un avec son piano, se distinguant par un jeu si particulier, c’est comme une immersion dans la lumière des sensations, c’est un jaillissement d’émotions, ses interprétations des œuvres de Jean-Sébastien Bach, ou de Johannes Brahms, dont la maîtrise et l’exécution semblent leur donner une deuxième vie, laissant le public dans l’émerveillement et l’admiration, marqua à vie les cœurs et les esprits.
Nicholas Deshoulières l’actuel directeur du Conservatoire du VIIIe arrondissement Camille Saint-Saëns, pianiste, musicologue, est un passionné, qui agit avec le cœur et l’esprit dans un souci sans cesse renouvelé de rendre la musique classique dite savante accessible au plus grand nombre pour qu’elle ne soit pas réservée qu’à une élite et permettre aux mélomanes et non avertis de découvrir cet univers musical.
Nicholas Deshoulières suit les pas de ses prédécesseurs en continuant ce bel héritage, dans le même esprit d’ouverture et de partage avec les efforts de chacun, de l’équipe administrative et de l’équipe pédagogique.
François Kerdoncuff a laissé une belle empreinte dans l’univers de la musique classique, aussi grand fut son talent, aussi grande fut son humilité, il mérite tous les hommages.
Madame Jeanne d’Hauteserre Maire du 8e s’associe avec bonheur à cet hommage, le jeudi 28 novembre à 19h, à la Mairie du 8e arrondissement de Paris.
– L’accueil du public se fera à partir de 18h30.
– Le concert débutera à 19h.
– Madame Jeanne d’Hauteserre Maire du 8e arrondissement ouvrira ce bel événement par un discours, suivi des prestations musicales des professeurs du Conservatoire et des solistes invités.
Brahim Saci
Le 20 novembre 2024
diasporadz.com
……………………………………………………………………………
Mohand Aouarhoun : « La chanson kabyle manque de créations »

Le chanteur Mohand Aouarhoun a généreusement accepté de se livrer à cœur ouvert à Diasporadz pour nous parler de son parcours dans la musique kabyle, de ses inspirations et de ses aspirations.
Mohand Aouarhoun est un chanteur, auteur compositeur talentueux qui chante depuis de longues années et qui compte plusieurs albums de qualité.
Bio express
Le chanteur Mohand Aouarhoun a étudié le solfège et la musique chaâbi à la maison de jeune d’Azazga avec le maestro Moh Tahir, et à la maison de culture de Tizi-Ouzou avec Rachid Blik, c’est dire qu’il a une formation musicale solide.
Même s’il se fait discret ces dernières années, il n’est pas rare de le rencontrer avec son beau mandole Chafaa qui a une sonorité remarquable surtout entre les mains d’un virtuose comme le chanteur Mohand Aouarhoun. Il faut dire que le mandole et l’artiste sont inséparables, chez Mohand Aouarhoun la passion se conjugue avec le savoir-faire et la maîtrise de l’instrument.
Mohand Aouarhoun enchante son public avec des compositions de qualité, des chansons aux thèmes variés qui reflètent la vie.
Diasporadz : Vous êtes un excellent musicien, un grand poète, vous excellez aussi dans le chant, qui est Mohand Aouarhoun ?
Mohand Aouarhoun : Mohand Aouarhoun est un villageois kabyle qui vit à Paris depuis 20 ans maintenant, salarié, père de famille. Je suis du village Agraradj, le village de Ahmed Saïd ou Abdoun (1844-1895), bandit d’honneur kabyle considéré comme l’un des plus célèbres bandits d’honneur avec Arezki El Bachir, qui marquèrent la région kabyle dans les années 1890, en luttant contre les injustices et le colonialisme de l’époque.
Je suis passionné par la musique, elle vibre en moi, je suis auteur compositeur interprète, chanteur kabyle, je ne me sens vivre qu’en créant, qu’en composant, la musique est pour moi un second souffle. J’ai composé et enregistré beaucoup de chansons.
Diasporadz : Racontez-nous vos débuts dans la chanson ?
Mohand Aouarhoun : Mes débuts dans la chanson remontent à très longtemps, j’ai aimé la musique depuis mon plus jeune âge. J’écoutais beaucoup la radio, et des cassettes, la passion était déjà là et elle n’a fait que grandir avec le temps.
Dès l’âge de 13 ou 14 ans j’ai fabriqué une guitare avec un bidon d’huile, une planche, des clous et des fils en plastique, tant l’envie d’apprendre et de jouer était grande, nous n’avions pas les moyens d’avoir une vraie guitare.
Avec cet instrument de fortune j’ai commencé à apprendre quelques notes tout en essayant de créer, de composer quelques airs, quelques mélodies.
Les années ont passé et je n’avais toujours pas d’instrument, faute de moyens évidemment, mais par chance, j’avais un ami qui possédait une guitare, parfois il me la prêtait, parfois on jouait ensemble.
Il s’agit de Ahcene Afalu, qui est aussi un grand artiste. Il faut dire qu’à l’époque on voyait la musique comme un tabou et mon père, paix à son âme, n’aimait pas me voir avec une guitare, car pour la société de l’époque, la musique était synonyme de bohème, vivre en marge, sans souci du lendemain, et c’était mal vu.
C’est à l’âge de 20 ans que j’ai réellement commencé à composer des chansons, car j’avais une certaine maîtrise de la guitare. Je fus invité à la radio Chaîne 2 en 1993 ou 1994, je ne m’en souviens pas très bien, par Saïd Freha, j’ai alors chanté l’une de mes compositions, qui a eu un succès immédiat.
Puis je me suis inscris à la maison de jeune d’Azazga pour des cours de solfège et des cours de musique chaâbi avec le grand musicien auteur compositeur interprète Moh Tahir.
De 1995 à 1996, j’ai suivi des cours de musique chaâbi à la maison de culture de Tizi-Ouzou avec Rachid Blik, ce qui m’a donné une formation solide.
Diasporadz : Vous chantez depuis de longues années, mais vous vous faites rare sur la scène artistique, à quoi est-ce dû à votre avis ?
Mohand Aouarhoun : J’ai beaucoup chanté au pays, j’ai aussi animé plusieurs fêtes de mariage et j’ai participé à plusieurs concerts, quand on m’invitait je ne disais jamais non.
C’est en avril 2000 que j’ai enregistré ma première cassette de 6 chansons « Ilmezyen » au studio Yugurthen d’Azazga, qui a eu un bon accueil du public, ce succès qui m’a permis d’enregistrer en 2003 un deuxième album de 6 chansons Ajajih, dans le même studio et avec la même équipe, Moh Tahir, Madjid Halit, Djamel Mensous et tous les musiciens.
Ici en France, j’ai animé quelques soirées dans des restaurants et bars, j’ai chanté dans des mariages, j’ai chanté une fois à la Salle Jacques Brel à Pantin en 2008 invité par un professeur de musique, Rosine Chabrun.
Mais, malgré les nombreuses associations kabyles, je ne suis malheureusement jamais invité.
Diasporadz : La première fois que je vous ai vu c’est dans ce bar rue de Pyrénées dans le 20e arrondissement de Paris, Chez Ammi Said, avec votre beau mandole Chafaa, vous semblez ne faire qu’un avec lui, est-ce important pour vous un instrument de cette qualité ?
Mohand Aouarhoun : Il est vrai que je viens quelques fois pour jouer chez Ammi Said, entre amis sans sonorisation, j’aime bien ce coin convivial et chaleureux. Quand on aime la musique comme moi, la qualité de l’instrument est importante et même primordiale. En ce qui concerne le mandole, la résonnance est capitale. Mon mandole Chafaa Rachid, fabriqué en 1996, a une sonorité et une résonnance extraordinaires, je l’ai prêté à beaucoup de chanteurs kabyles qui ont pu enregistrer avec en studio. C’est un instrument qui a l’un des meilleurs sons, qui donne l’envie de jouer.
Diasporadz : Quels sont les chanteurs qui vous influencent ?
Mohand Aouarhoun : J’aime beaucoup les anciens chanteurs, Cheikh El Hasnaoui, Cherif Kheddam, Slimane Azem, Allaoua Zerrouki, Matoub Lounès, Cherif Hamani, Ait Menguellet, Idir, Brahim Tayeb, Abbès Nait Rzine et beaucoup d’autres.
Les anciens chanteurs kabyles restent une source d’inspiration inépuisable.
Diasporadz : Quel regard portez-vous sur la chanson kabyle d’aujourd’hui ?
Mohand Aouarhoun : Il y a de jeunes talents qui excellent dans le chant, nous voyons beaucoup de belles voix, mais il manque la création, et ce manque se fait sentir de plus en plus. On constate malheureusement qu’il y a plus de reprises que de nouvelles chansons. C’est un triste constat.
Diasporadz : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Mohand Aouarhoun : J’ai plusieurs chansons non enregistrées abordant des thèmes riches et variés, je pense enregistrer quelques chansons, voire un clip ou deux.
Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?
Mohand Aouarhoun : Merci au journal Diasporadz qui m’a donné l’occasion de m’exprimer sur mon parcours dans la chanson kabyle et merci à vous pour ce bel entretien.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Le 11 novembre 2024
diasporadz.com
……………………………………………………………………………..
Mohand Aouarhoun, un chanteur de talent

Il y a des artistes qui brillent par leur talent, Mohand Aouarhoun en fait partie, c’est un chanteur auteur compositeur, épatant, par l’élévation artistique, du chant, de la musique qu’il maîtrise, après des années de travail, de sueurs versées, mais dont la discrétion est aussi grande que son talent.
Mohand Aouarhoun est un chanteur de talent qui compose depuis de longues années, son savoir musical est grand. Quand on l’entend interpréter des préludes, istikhbars, on comprend tout de suite, que l’artiste s’est abreuvé à la bonne source, celle de la musique chaâbi, ce genre musical populaire algérien, né à Alger au début du XXe siècle.
Le chaâbi est l’un des genres musicaux les plus populaires d’Algérie. Il dérive de la musique arabo-bérbéro-andalouse d’Alger, Sanâa d’Alger ou l’Andalou, le répertoire de musique savante, classique, arabo-berbéro-andalouse algérienne de l’école d’Alger que la tradition rattache à la ville de Cordoue en Espagne musulmane.
Mohand Aouarhoun fait partie des passionnés de la musique, son jeu musical est fluide, en même temps appuyé et puissant, il a une manière bien à lui d’exécuter les préludes en ne perdant aucune note, et ces notes s’enchaînent harmonieusement dans un jaillissement d’émotions qui envahit et remplit l’air, c’est une musique du cœur et de l’esprit.
Mohand Aouarhoun ne fait qu’un avec son mandole Chafaa, du célèbre luthier algérien luthier Chaffa, l’un des plus grands luthiers. La résonnance de ce mandole est tout à fait particulière et exceptionnelle, un bonheur pour le cœur et l’oreille, surtout entre les mains d’un musicien averti, virtuose comme Mohand Aouarhoun.
Le chanteur Mohand Aouarhoun est originaire du célèbre village Agraradj, un village de la commune Aghribs dans la wilaya de Tizi Ouzou, de la confédération des Aït Djennad, le village Agraradj se décompose en deux, l’ancien village, thadarth, et le nouveau village Agouni-Ghezifene.
Le village Agraradj est situé à 40 km au nord-est de Tizi Ouzou, à 22 km au sud-ouest d’Azeffoun et à 7 km au nord d’Azazga.
C’est le village de Ahmed Saïd ou Abdoun (1844-1895), bandit d’honneur kabyle considéré comme l’un des plus célèbres bandits d’honneur qui marquèrent la région kabyle dans les années 1890.
En 1884, Ahmed Saïd ou Abdoun fut accusé du meurtre d’un adjoint indigène appartenant à une famille rivale de la sienne, à la suite d’un procès controversé, il fut condamné et déporté pour les travaux forcés en Guyane.
Le 11 octobre 1886, Ahmed Saïd ou Abdoun parvient à s’évader du bagne, fait exceptionnel mais ce fut alors un parcours plein de péripéties à travers l’Atlantique. Il aurait notamment travaillé sur les chantiers du canal de Panama avant de revenir en Europe puis en Algérie.
De retour en Kabylie, il constitue une bande célèbre qu’il dirige avec son frère, Mohammed ben el Hadj Amar ou Abdoun avec la bande d’Arezki El Bachir, Arezki El Bachir du village Aït Bouhini dans l’actuelle commune de Yakouren de la confédération des Ait-Ghobri, ils ont sillonné la région kabyle pour rétablir la justice et défendre la veuve et l’orphelin, ils ont donné du fil à retordre aux autorités coloniales françaises. Arrêté, Ahmed Saïd ou Abdoun fut condamné à mort puis exécuté le 14 mai 1895 à Azazga avec cinq autres compagnons dont Arezki El Bachir.
Mohand Aouarhoun se souvient des balades à Tamgout cette montagne majestueuse témoin de la mémoire d’un peuple, des promenades à TaddartTaqdimt, Aguelmim U-Gbanim, Tabriqt U Akkour, AmdiqTaâzrawt, ces lieux remplis d’histoire, où l’émotion fait jaillir l’inspiration.
Des chansons comme,Ilmezyen, Asfelnzman, Tajmilt, l’hommage à MatoubLounès, Lexyal-im, ixefittarggun, Anda ken, montrent la complexité, la diversité des thèmes abordés, des rythmes et préludes exécutés, témoignant d’une maîtrise certaine, musicale, poétique et vocale.
Des chansons composées brillamment, avec sans cesse le souci, de parfaire, de bien faire, afin de tout donner, pour que resplendisse la beauté.
Les années filent et se succèdent avec leur lot d’expériences, de joies et peines, de dur labeur, mais en apportant la maturité. Mohand Aouarhoun chante l’amour, la jeunesse, mais aussi les affres de la vie, qui font jaillir de nouvelles compositions de questionnements, d’interrogations, de révolte, aspirant toujours à un avenir meilleur plein d’espoir où les musiques composées montrent toute la beauté de cet art, enveloppent le poème, le tout arrivé à maturité.
Mohand Aouarhoun continue à composer pour le plus grand bonheur des mélomanes et de ses fans.
Brahim Saci
diasporadz.com
Le 10 novembre 2024
…………………………………………………………………………

Crédit photo : Christian Vigne
Alexandra Cretté : « La poésie est une production de toute culture humaine »
Alexandra Cretté fait partie de ces auteurs qui fascinent par leur parcours et leur façon d’être. La poésie a toujours été là comme la plus fidèle amie, accompagnant chaque pas, chaque souffle. Elle a attendu la pleine maturité pour publier, sans rien bousculer, attendant le moment, son moment.
Les yeux d’Alexandra Cretté brillent de générosité avec le regard de l’humilité. Elle est le poète du partage semant l’amour pour rendre meilleurs les jours.
Elle est née et a grandi à Aubervilliers en Seine-Saint Denis, cette ville ouvrière et d’immigration, une enfance des plus modestes, elle fut la première de sa famille à décrocher le BAC (Le baccalauréat).
« Mon enfance fut solitaire, je n´ai ni sœur, ni frère, ni oncle, ni tante, ni cousin, ni cousine». Ces mots résonnent dans l’espace-temps, mais l’enfance fut heureuse dans cet HLM, très aimée par sa famille.
Après une classe préparatoire littéraire, elle obtient un Master de philosophie politique à la Sorbonne, Paris IV, sur le concept d’amitié chez Aristote, le lien entre son éthique et sa politique dans, L’éthique à Nicomaque, la question du rapport entre éthique et politique. Pour Aristote, l’éthique est avant tout une sagesse de l’homme qui se détermine dans l’action, L’éthique à Nicomaque, est un cours sur la morale, Aristote dit « Le bien certes est désirable quand il intéresse un individu pris à part, mais son caractère est plus beau et plus divin quand il s’applique à un peuple et à des États entiers. »
Déjà tant d’interrogations qui bousculent les certitudes, Alexandra Cretté souhaite atteindre ce bonheur et cette justice dont parle Aristote, une quête qui ne voit sa source que dans l’action, commence alors l’engagement social et politique.
Elle rejoint l’activisme de groupes anarcho-libertaires parisiens et ses yeux s’ouvrent d’avantage, écrivant des articles, organisant des actions, la poésie reprend la place, elle retrouve Francis Combes et sa maison d’édition, Le Temps des Cerises, elle codirige la Revue Commune avec Roger Bordier, vivant de remplacement en tant qu’enseignante dans des collèges et des lycées.
En 2006, c’est l’appel du large et des grands espaces, elle part en Guyane où elle s’implique et intègre le syndicalisme. Le poète éditeur Francis Combes publie certains de ses poèmes dans une anthologie de la poésie engagée contemporaine aux editions Le Temps des Cerises.
En Guyane, Alexandra Cretté retrouve la société multiculturelle de son enfance, les réalités des espaces à la lisière du monde occidental et l’Amazonie qui fascine et émerveille.
En 2020, elle fonde la revue littéraire, Oyapock, avec son ami, Samuel Tracol, avec qui elle travaille syndicalement sur des problématiques internationales. Ils ont réuni 20 auteurs de Guyane, Haïti, Martinique, Brésil, France, publiant en ligne, de la poésie, du théâtre, des nouvelles, des chroniques, des extraits de romans, travaillant avec la Maison du Conte de Cayenne, pour participer à des soirées de lectures et des festivals. Ils ont publié un livre collectif de poésie avec les éditions Atlantiques déchaînés, dirigées par Fabien Marius Hatchi, L’Anthologie de la Revue Oyapock.
En mai 2023, Alexandre Cretté gagne la mention spéciale du prix international de poésie Balisaille en Martinique, présidé par Lyonel Trouillot et Raphaël Confiant, pour son recueil Par, le regard de ces autres mal nés, publié par Atlantiques déchaînés et Le Merle moqueur de Francis Combes.
Alexandra Cretté fut invitée en juillet 2023 au 33éme festival international de poésie de Medellin et au festival international de Caracas, puis en mai 2024, au Festival Mai poésie, en Martinique, organisé par l’association Balisaille, qui a réuni des poètes et écrivains de Martinique, mais aussi de Guyane, Guadeloupe, Ile Maurice, Réunion, France, Côte d’Ivoire et Bénin, en tant que lauréate 2023 du prix Balisaille. Elle publie aussi régulièrement dans la Revue internationale du Mouvement Mondial de la Poésie, Planetariat.
Alexandra Cretté est invitée en janvier 2025 au Congrès international des poètes à la Havane à Cuba. Elle nous surprend et nous émerveille par la publication de son recueil « Par le regard des autres, mal nés », au titre évocateur poignant, un seul poème forme ce livre, qui n’en finit pas, comme pour tenir et retenir le lecteur en lui tenant la main au fil des pages qui se tournent entre l’ombre et la lumière, avec une magnifique préface de Raphaël confiant qui éclaire le livre et le délivre des doutes et interrogations tout en saisissant l’essentiel, de l’humain à la terre, de la terre au ciel.
Ce recueil, ce poème s’écoule entre les cultures et les langues dans une harmonie formée par le cœur et l’esprit, sortant du réel pour oublier la misère celle apparente et celle cachée.
Professeur de lettres modernes en Guyane depuis de longues années, auteur de poésie, de nouvelles, de théâtre, Alexandra Cretté pense que la poésie peut changer le monde.
Le Matin d’Algérie : De la philosophie à la littérature, qui est Alexandra Cretté ?
Alexandra Cretté : Bonjour, merci de m’avoir proposé cette interview. En fait, pour répondre à votre question, la littérature a toujours été là en premier. Il s’agit dans ma vie intellectuelle d’un chemin de la littérature à la philosophie, puis d’un retour vers la littérature. J’ai passé une grande partie de mon adolescence à lire de la littérature, les bancs du collège m’ont surtout vu lire sous la table plutôt que de participer activement à un cours de physique-chimie, par exemple. Je lisais beaucoup, j’écrivais avec un immense plaisir. J’ai des souvenirs très précis de ce plaisir presque boulimique, en tout cas excessif, de l’écriture. J’ai grandi dans une banlieue ouvrière assez pauvre, les professeurs voyaient avec une certaine bienveillance ce goût rare pour les livres. Je lisais Baudelaire, Dumas, Zola, Hugo, Balzac, Camus, Gide.
Lorsque j’ai rencontré la philosophie en classe de terminale, je suis tombée à nouveau dans une grande passion. Une passion pour cette discipline et surtout pour la façon dont elle utilisait le langage, à l’opposé de la littérature. J’étais fascinée par la possibilité d’énoncer la pensée sous une forme systémique et nue. Une sorte de pureté que propose le concept, d’efficacité par la méthode et la structure.
C’était tout un monde à découvrir, et je m’y suis plongée pendant cinq ans à la Sorbonne. C’est la philosophie politique qui s’est imposée comme mon domaine d’intérêt principal et j’ai donc travaillé sur Aristote, mais aussi sur Diderot. J’ai enseigné la philosophie un an comme professeure contractuelle, mais n’ayant pas réussi les concours, je suis revenue à la littérature et j’ai obtenu mon CAPES de lettres en candidate libre.
Cependant, pendant toutes les années de ma formation universitaire, je n’ai jamais quitté la littérature et mon chevet a toujours été couvert de romans, de théâtre et de poésie…
Le Matin d’Algérie : D’Aubervilliers à la Guyane, racontez-nous ?
Alexandra Cretté : Vous pointez avec justesse l’importance des lieux où je suis née et ai vécu. Naître à Aubervilliers n’est pas sans conséquences, du point de vue du regard social sur mon identité, comme de la construction de mon propre point de vue sur la France et le monde.
Aubervilliers est un des symboles de la misère populaire. Immortalisée dans le poème de Jacques Prévert
« Petits enfants d’Aubervilliers,
Petits enfants des prolétaires,
Vous plongez la tête la première
Dans les eaux grasses de la misère »
C’est une ville industrielle, où HLM et entrepôts s’empilent en bordure de Paris. Une ville qui a accueillis beaucoup d’immigrés, principalement des anciens espaces coloniaux. Mais aussi une ville de politique culturelle, avec des bibliothèques dans tous les quartiers, un théâtre prestigieux, des ateliers d’artistes, des intellectuels engagés et des écrivains importants. J’y ai rencontré Francis Combes et sa fille Juliette Combes- L’atour, des éditeurs engagés et des intellectuels importants dans la dynamique de l’édition indépendante en France.
Lorsque je suis arrivée en Guyane, où je vis depuis 18 ans, j’ai tout de suite su que ce serait un des lieux importants de ma vie. C’est une terre complexe, multiculturelle, plurilingue, héritière d’une histoire terrible et très contemporaine aussi. C’est un intense lieu migratoire. Un habitant sur trois est de nationalité étrangère. Les deux tiers de la population ont moins de trente-cinq ans. Nous sommes très différents de la France hexagonale. Le rapport à la langue aussi est y est pour moi fondamental car, si le français en est la langue officielle en tant que département d’outre-mer, il n’est pas la langue principalement parlée, langue qui varie très fortement selon les espaces du territoire. Cette Babel linguistique est un formidable creuset poétique pour envisager l’élasticité possible de la langue française dans la francophonie.
Je devrais même dire les langues françaises, ce qui serait bien plus juste au vu des spécificités, des modifications de tournures et de syntaxe. De plus, l’espace amazonien influence mon écriture par la confrontation constante à l’immensité naturelle de la forêt, vaste comme un continent, à l’opposé de l’espace européen, où la main de l’homme est toujours apparente. Je ne veux pas entretenir le mythe erroné d’un espace vierge et ouvert aux pionniers, mais insister sur le rapport à un espace non maîtrisable, dont la complexité dépasse très largement l’individu. Cela ouvre un ensemble de possibles et de symboles riches et féconds pour un poète.
Le Matin d’Algérie : Vous venez de publier « Par le regard des autres mal nés » chez les éditions Atlantiques déchaînés, un titre évocateur qui interpelle le cœur et l’esprit, comment s’est fait le choix de ce titre ?
Alexandra Cretté : Merci de rendre hommage à ce titre. Il s’agit d’un titre à double sens.
Le premier est le sens littéral: mon écriture est une écriture issue d’un lieu postcolonial où les peuples qui y vivent participent d’un espace d’exclus, aux marges de l’occident. Héritiers d’une colonisation violente, de la structuration raciale de l’esclavagisme et de la rationalisation de la déportation pénitentiaire, les peuples de Guyane regardent le monde à travers ce prisme lucide et contemporain. J’y vis depuis presque vingt ans, ce regard me modèle et transforme intrinsèquement mon rapport à la poésie et au monde.
Le deuxième sens est un sens caché car ce titre est aussi une citation de l’Enfer de Dante, première partie de sa trilogie intitulée la Divine comédie. Vous trouverez ce vers au chant XVIII, lorsque Dante longe la partie de l’Enfer consacrée aux ruffians et séducteurs, ces hommes qui consacrèrent leur vie à détruire les femmes. Cette violence subie à travers le lien passionnel est d’ailleurs l’un des thèmes de mon recueil.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur Raphaël Confiant qui a préfacé votre livre, comment s’est faite la rencontre ?
Alexandra Cretté : Raphaël Confiant présidait le Jury du Prix dont j’ai obtenu la Mention Spéciale, le Prix International de l’Invention Poétique 2023 en Martinique, organisé par l’Association Balisaille. Je ne l’ai jamais rencontré avant ma participation au festival suivant en mai 2024. C’est lors du festival International de Poésie de Caracas en juillet 2023 que mes éditeurs, Francis Combes et Fabien Marius-Hatchi, me proposent une préface par Raphaël Confiant. Ils se sont chargés de lui transmettre l’idée et c’est avec une joie immense que j’ai reçu son accord.
Cette rencontre entre nous est une rencontre textuelle, forte et profonde, d’auteur à auteur.
C’est une préface magnifique qui honore mon livre et mon travail en poésie.
Le Matin d’Algérie : La poésie a toujours été en vous, pourtant la publication est tardive, pouvez-vous nous expliquer ?
Alexandra Cretté : J’ai effectivement toujours écrit de la poésie, depuis presque l’enfance. Je publiais des poèmes dans le journal de mon lycée. Entre vingt et trente ans j’ai publié des textes et des poèmes à travers la Revue Commune, aux éditions du Temps des Cerises. En 2008, je publie deux longs poèmes dans L’Anthologie de la poésie engagée contemporaine, toujours aux éditions du Temps des Cerises. Cependant aucun recueil personnel. J’en ai écrit plusieurs par la suite, entre 2007 et 2020 : Last Baadaassss song, un recueil sur la jeunesse et la Guyane; Sur la face nord du dôme de Tharsis, qui est un long poème sur l’anthropocène; À l’ombre des flamboyants jaunes, un recueil sur l’enfance. Une pièce de théâtre, aussi, Médée-Oiapoque, sur l’exil et la trace du mythe. Mais je n’ai jamais vraiment été active durant une grande dizaine d’années pour passer à la publication. Le militantisme, le syndicalisme étaient mes activités intellectuelles principales et mobilisaient la majeure partie de mon énergie. C’est en 2020, lorsque je créé La Revue Littéraire Oyapock, que je me lance dans un nouveau projet et que l’écriture et la publication deviennent centrales. Mais ce sera dans un cadre collectif, dans une dynamique de groupe qui vise à faire accéder à la publication des auteurs et des autrices, et pas seulement ma seule production. Mon écriture et mon activité culturelle se nourrissent de ce contact permanent avec l’autre, avec l’idée d’une dynamique qui ne peut être solitaire.
Le Matin d’Algérie : Vous vous impliquez dans le syndicalisme, mais la poésie est aussi une forme de lutte, cela peut paraitre paradoxal mais il n’en est rien en vérité, qu’en dites-vous ?
Alexandra Cretté : Il est vrai que mon militantisme syndical a occupé longtemps une place centrale dans mes activités. J’ai été co-secrétaire de SUD éducation Guyane, un syndicat d’orientation libertaire, pendant quinze ans. J’y ai défendu une conception internationaliste et émancipatrice de l’éducation, très horizontale et égalitaire. Pendant toutes ces années, je n’ai jamais cessé d’écrire de la poésie. Mais cette poésie n’est pas un discours doctrinaire ou idéologique. J’ai passé assez de temps à rédiger des articles, des tracts ou des discours pour savoir que cet espace artistique, ce rapport au monde par les mots, n’a pas besoin d’une structure argumentative pour faire exister mes idées, ma vision du monde.
Le combat du poème dépasse celui de ma main. Aujourd’hui, je créé des projets de traduction et des groupes de recherches dans un collectif international d’auteurs, le Mouvement Mondial de la Poésie. Je travaille d’ailleurs avec la Maison de la Poésie algérienne, via son ancien co-fondateur, Achour Fenni.
En Guyane notre Revue, la Revue Littéraire Oyapock, est une maison de l’écriture et de l’amitié. Mon premier livre, notre premier livre, a été un livre collectif, une grande aventure avec JJJJ Rolph, Émile Boutelier, James-Son Derisier, Rossiny Dorvil, Sandie Colas, Widjmy StVil, Jonas Charlecin et Nitza Cavalier. Et nous vivons tous ensemble l’idée d’une littérature en acte, ouverte sur le monde et engagée dans un cri.
Le Matin d’Algérie : La poésie peut changer le monde d’après vous, pourtant c’est un genre littéraire qui peine à s’imposer partout dans le monde, qu’en pensez-vous ?
Alexandra Cretté : J’aimerais nuancer votre formulation qui présente la poésie comme un genre qui « peine à s’imposer partout dans le monde ». Il est vrai que les systèmes économiques de distribution du livre favorisent largement le romanesque ou le livre d’idées. Cependant, ces genres sont spécifiques à des espaces culturels précis, l’occident, les grandes et très grandes villes. Alors que la poésie, elle, est une production de toute culture humaine, par l’oralité ou l’écrit, elle universalise le lien au langage qui relie les hommes à la signification, à la grâce du sens.
Je dirai que la poésie ne s’impose pas. Elle créé son propre espace. S’il est vrai que dans l’histoire littéraire elle a déjà eu en France une place de genre majeur et que ce temps est révolu, ce n’est pas le cas dans d’autres pays. En ayant eu la chance de participer à deux festivals internationaux et de discuter avec des poètes du monde entier, j’ai compris que les dynamiques poétiques sont variées et que la culture de la poésie est internationale.
En Haïti, qui n’est pas poète n’est pas un grand écrivain. Même au milieu de la guerre des gangs, des drones et des armes de guerre, les livres de poésies s’écrivent, se publient. En Colombie, au festival de Medellín, les poètes sont accueillis par le public comme de véritables stars.
Je dirai donc que la poésie change le monde parce qu’elle est une façon différente d’utiliser le langage. Elle dépasse l’utilité, la narration. Je ne pense pas qu’elle soit intrinsèquement révolutionnaire. Ou porteuse d’une mission de libération. Si vous lisez Le Parti pris des choses de Francis Ponge, vous ne trouverez pas une idée ou un chant de liberté. Mais si vous lisez ce live et le comprenez esthétiquement, votre sensibilité ne peut plus accepter les moules prédéfinis de la production culturelle de masse, ou du moins, elle en verra les failles, les simplifications et les tricheries. C’est ce que font tous les grands livres de poésie. Ils nous rendent le monde.
Le Matin d’Algérie : Votre livre est formé d’un seul poème et pourtant vous réussissez à retenir le lecteur pour ne plus le lâcher, et celui-ci voudrait que le poème continue, à quoi est due cette magie ?
Alexandra Cretté : Je vous remercie de voir une certaine magie dans mon écriture, c’est un grand compliment. Ce livre a effectivement été conçu comme un chant unique, mêlant deux voix, une voix extime et une voix intime. C’est un travail sur la polyphonie, la possibilité de mêler différentes voix poétiques pour créer un miroir, ou une profondeur, selon le moment du poème.
La structure du recueil est plutôt cyclique, comme la mémoire, comme mon rapport à l’espace, puisque ma vie s’organise dans des cercles qui sont pour certains des cercles sud-américains, et d’autres, plus réguliers, des cercles qui me ramènent vers la France, où vit ma famille, où sont mes souvenir d’enfance…
Cet espace transatlantique personnel est aussi doublé d’une conscience historique des lieux, de leur symbolisme, de leur incompatibilité, également.
Les critiques mettent souvent en avant dans mon livre la poésie amoureuse et le chant de l’Amazonie, deux thèmes centraux, mais qui me permettent, par leur dimension universelle de porter d’autres thèmes : la misère, la folie, la révolte, le carcéral, la colonisation, la migration. L’intime est là pour asseoir dans la chair émotionnelle les désastres du monde et l’envie de les transformer, d’où une fin tournée vers l’enfance, vers l’amour filial et l’infinie contemplation.
Cela doit être ce mouvement perpétuel entre passé et présent, présence et absence, qui a guidé votre lecture comme un fil d’Ariane incassable.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les poètes qui vous influencent ?
Alexandra Cretté : Toute mon adolescence a été influencée par l’écriture de Rimbaud. Une saison en Enfer et Les Illuminations ont transformé mon rapport au langage. Mais à vrai dire, même si Aragon et Éluard ont largement aussi nourri mon univers poétique, ce sont surtout des poètes francophones ou étrangers qui ont traversé ou motivé les transformations de mon écriture. Anna Akhmatova avec Requiem et Paul Celan, avec Pavot et mémoire, sont deux auteurs pivots de ma jeunesse, car avec eux j’ai trouvé une poétique différente pour dire l’histoire, une densité nue de l’écriture que je ne connaissais pas.
Vivant depuis longtemps dans l’espace sud-américain amazonien, certains recueils m’habitent, comme Poème sale, du Brésilien Ferreira Gullar, une œuvre de toute beauté, long poème écrit sur le chemin de son exil fuyant la dictature. Ou encore les immenses œuvres du poète haïtien spiraliste Frankétienne, dont L’Oiseau schizophone m’apparaît comme une des possibilités ultimes de la voix du poète.
Aujourd’hui, je suis principalement influencée par les auteurs avec lesquels j’écris, ou avec qui je travaille au quotidien. Mes amis dans l’écriture et aventuriers littéraires, JJJJ Rolph, Daniel Pujol, Loran Kristian, Émile Boutelier, Luis Bernard Henry. Toute cette activité autour de la production poétique nourrit réciproquement nos écritures, nos discussions et nos perspectives.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Alexandra Cretté : De nombreux projets sont en cours dans différents domaines.
Concernant mon travail poétique personnel, je suis en train de finaliser un recueil important, Panoptica Americana, qui devrait être publié en co- édition par mes éditeurs, Atlantiques déchaînés et Le Merle moqueur, dans le courant du premier semestre 2025. C’est un projet ambitieux basé sur une complexification de mon modèle poétique polyphonique.
Il s’agit d’un ouvrage à trois voix poétiques sur le continent américain. Une voix lyrique sur les métaphysiques spirituelles du candomblé brésilien, une voix ironique sur ma vision autobiographique de l’espace, une voix didactique sur les projets impérialistes et esclavagistes qui modelèrent ou tentèrent de modeler le continent du nord au sud.
Par ailleurs, je travaille sur la traduction d’un recueil du poète népalais Keshab Sigdel, Embargo. Avec la poétesse franco-tunisienne Arwa Ben Dhia, je projette une traduction en français d’un ouvrage de la poétesse palestinienne Hanan Awwad. Enfin, j’écris avec le poète Amar Benhamouche un recueil à quatre mains en français et en kabyle, Pierres sorties du torrent.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Alexandra Cretté : Je remercie chaleureusement le Matin d’Algérie pour cette interview riche et pertinente. C’est une belle opportunité pour moi de faire découvrir mon travail littéraire dans d’autres pays, d’autres espaces. Merci.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Livre publié :
« Par le regard de ces autres, mal nés »
Editions atlantiques déchaînés – Le Merle Moqueur
lematindalgerie.com
Jeudi 7 novembre 2024
………………………………………………………………………
Rencontre avec Frédéric Lemaître et Isabelle Dalle de la revue Persona

Frédéric Lemaître et sa compagne Isabelle Dalle se dévoilent à Diasporadz pour nous parler de leur beau bébé, la revue Persona. Lui en est le red chef. Elle la directrice artistique.
Persona, c’est aussi « une aventure exceptionnelle » qui a tant subjugué notre ami le poète et journaliste Brahim Saci. Il nous en fait ici une présentation tout a fait personnelle et subjective. Avec des mots qui sortent directement du cœur. Avec passion. Il en ressort un véritable hommage au professionnalisme de Frédéric Lemaître et Isabelle Dalle qui président à la destinée de Persona.
Le magazine culturel Persona est une revue trimestrielle où rien n’est laissé au hasard par Frédéric Lemaître et Isabelle Dalle. Tout est pensé avec le souffle sans cesse renouvelé de l’art, l’écriture, le graphisme, la photographie, de long entretiens, des documents inédits, elle explore avec bonheur le monde musical, graphique, littéraire, cinématographique, et théâtral.
Le tout s’articule « Avec un intérêt particulier pour la parole échangée. Car l’esprit de Persona c’est ça : Dérouler le fil d’une pensée et explorer, dans une trajectoire libre, les à-côtés d’un artiste. Et bien sûr, avec le titre de la revue, entrouvrir une porte sur le rapport que nous pouvons avoir avec nous-mêmes au travers de l’art, mais aussi à travers l’autre… autrement que sous l’angle d’un simple objet de promotion ».
Le magazine culturel Persona tend maintenant et cela depuis plusieurs années, de plus en plus, à s’imposer sur la scène médiatique, journalistique, par la qualité et le choix perspicace des articles et des rencontres. Il est clair que cette revue sort des sentiers battus, par un verbe tranchant, battant des ailes sans artifices et vrai, chose rare dans une époque troublante et écorchée où la tendance est au conformisme, où une seule vision semble remplir l’air ambiant.
La revue pluridisciplinaire Persona s’échappe de ce carcan et se distingue en innovant par une approche subtile du cœur et de l’esprit tout en donnant la parole à ceux qu’on ne voit que rarement ou pas ailleurs, c’est une oasis dans un désert, très recherchée par les artistes car ils étanchent pour la plupart leur soif de liberté.
On retrouve cette phrase qui sonne comme un crédo, sur le site de la revue « De l’autre côté du miroir, les artistes nous dévoilent leu face cachée. » De ce fait, Persona se démarque vraiment des autres magazines existants sur le marché.
Pour sauvegarder cette liberté de ton et d’action Persona a fait le choix d’être sans publicité, afin d’offrir au lecteur le meilleur, chose rare aujourd’hui, dans un monde mercantile pris dans une spirale infernale, une course permanente et effrénée de l’inachevé pour nourrir l’illusion nous cachant l’horizon.
Quand on se plonge dans ce magazine, on ne peut s’empêcher de tout lire tant nous sommes happés par la qualité des articles, des photos, l’élan graphique magnifiant le tout et l’amour qui s’en dégage. C’est indéniablement une revue du cœur et de l’esprit, un magazine de l’amour fait avec amour.
Frédéric Lemaître et sa compagne Isabelle Dalle sont cette revue Persona. Isabelle Dalle, célèbre graphiste, s’occupe du design avec l’œil averti de l’artiste. Frédéric Lemaître s’occupe de la rédaction en chef tout en menant, tel un travail d’orfèvre, des d’entretiens et en rédigeant articles de haute volée, luttant contre vents et marrées et les aléas, efforts et sueurs versés, pour faire vivre ce beau magazine qui éclaire, dévoile, et émerveille.
L’amour et la passion unissent Frédéric Lemaître et Isabelle Dalle. Il faut bien cela et surtout cela pour perpétuer ce beau magazine Persona, dont chaque numéro est comme un diamant et son écrin, pour la qualité de l’écriture, du graphisme, des photos, et la profondeur des échanges et des entretiens, allant avec finesse faire parler les artistes, jusqu’au dévoilement, cherchant l’apparent et le caché, le dedans et le dehors jusqu’au soi véritable.
Brahim Saci
diasporadz.com
Le 25 octobre 2024
………………………………………………………………………
Frédéric Lemaître : « Le magazine Persona est une aventure exceptionnelle »

Frédéric Lemaître est rédacteur en chef du magazine Persona, une belle revue pluridisciplinaire trimestrielle très en vogue aujourd’hui, qui tend à devenir incontournable dans le monde artistique tant la qualité est au rendez-vous.
Persona est une revue de l’amour faite avec amour, cœur et esprit, c’est un espace culturel d’échanges, de dialogues, de rencontres avec le monde de l’art, avec des artistes de tous horizons.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Diasporadz : Comment est née l’idée de ce beau magazine Persona ?
Frédéric Lemaître : Par frustration d’abord, car, moi Frédéric, écrivais déjà dans plusieurs fanzines, mais sans y trouver mon compte. J’eus alors l’idée de créer ma propre revue en y mettant tout ce qui me plaît : musique, photographie, littérature, philosophie…
Isabelle Dalle ma compagne, graphiste de métier, a dit « Banco, je t’accompagne ». Alors, si je suis le fond, elle est la forme et c’est évidemment son travail que l’on voit en premier et qui séduit au premier regard. Ensuite, le lecteur peut se faire une idée du reste en allant plus en profondeur, au rythme de sa curiosité.
Diasporadz : Comment s’est fait le choix du nom Persona ?
Frédéric Lemaître : Comme souvent, c’est l’esprit libre et ouvert qui libère une pensée en adéquation avec sa propre ligne de vie. Le nom est arrivé comme une évidence. Puisque j’avais l’intention d’interroger l’être intérieur de chacun, fouiller sa persona, sa vibration interne, l’inspiration ou le souffle divin m’a alors chuchoté ce nom que j’ai accueilli instantanément avec joie et clarté. C’était comme une certitude, ça ne pouvait pas être autrement. Aller chercher la face cachée.
Diasporadz : Persona s’illustre et s’impose par sa qualité. Chaque revue est comme un tableau de grand maître, c’est à chaque fois un beau voyage poétique à travers la beauté graphique et la pertinence des entretiens qui nous promènent entre l’ombre et la lumière, comment arrivez-vous à cette prouesse ?
Frédéric Lemaître : C’est beaucoup de travail. Il faut savoir écouter l’autre et longtemps pour voir sa beauté intérieure comme extérieure. C’est aussi une passion, c’est pourquoi passer autant de temps sur le travail de chaque artiste n’est pas assommant, mais au contraire très enrichissant. Ainsi les questions à leur poser arrivent assez facilement, avec cohérence et intérêt.
C’est aussi un moment de plaisir intense de savoir que nous avons entre nos mains tant de secrets à faire découvrir et à entendre. Il y a ensuite la mise en page… mettre en lumière le travail de chacun… et pour cela l’intelligence, l’invention et la perspicacité d’Isabelle Dalle font des miracles. Tout s’imbrique avec finesse pour le plaisir des yeux.
Diasporadz : Comment se fait le choix des rencontres ?
Frédéric Lemaître : Par affinité bien sûr. Il y a aussi parfois et de plus en plus souvent l’agrément de découvrir des artistes inconnus du grand public, mais qui de leur côté ont également développé un langage personnel et pertinent qu’une oreille avisée comme celle de Persona a su entendre de son radar singulier et avide de nouveauté.
Il y a également la volupté des rencontres atypiques et bien entendu les propositions des attachées de presse qui révèlent aussi de leur côté de splendides trouvailles, parfois.
Diasporadz : Vous offrez un espace de liberté rare aujourd’hui, les nombreux artistes qui vous sollicitent en sont-ils conscients ?
Frédéric Lemaître : J’espère, mais bien souvent la jeunesse s’en fiche et est déjà passée à autre chose l’instant d’après ! Question de génération. Le constat est donc souvent amer car beaucoup de personnes considèrent la revue comme un espace de com’, ce qu’elle ne veut surtout pas être, mais au contraire, un véritable échange entre passionnés et artistes.
Diasporadz : Un mot sur la célèbre graphiste Isabelle Dalle qui vous accompagne…
Frédéric Lemaître : J’en parle déjà plus haut. Elle a su transformer le sable en château, exploitant mes idées de départ pour en faire des joyaux. Alors elle est essentielle dans cette aventure. Sans elle il n’y aurait pas de revue Persona avec cette si débordante créativité. À chaque numéro, il est donc normal de trouver son travail pictural personnel au dos de chaque revue, telle une signature.
En ce qui concerne le nouveau numéro pour l’automne 2024 (le n°27), carte blanche lui a été donnée pour la couverture et illustrer notre dossier sur les vampires, êtres nocturnes ayant la singularité de tendre un miroir aux humains. Elle a évidemment su honorer le sujet d’une sublime œuvre graphique devant laquelle tout le monde est subjugué.
Diasporadz : Votre travail est à saluer à plus d’un titre, la publicité ne vous enchaîne pas comme c’est le cas pour beaucoup de magazines, ce qui donne un souffle exclusif à la revue Persona, qu’en pensez-vous ?
Frédéric Lemaître : C’est évident que sans publicité à l’intérieur de la revue, nous sommes seuls maîtres de nos choix et intentions éditoriales. C’est un luxe que nous ne boudons pas, mais que nous avons choisi dès le départ, c’est donc totalement assumé de procéder ainsi. Nous n’avons à subir la censure et la pression de personne !
Diasporadz : Quels sont vos influences et vos références dans l’écriture et le journalisme ?
Frédéric Lemaître : Il y avait bien évidemment le travail prodigieux des premiers numéros des Inrockuptibles en ce qui concerne leurs longues interviews et aussi l’élégance iconographique qui était alors unique. J’aimais aussi beaucoup le graphisme pure et simple de la revue géante ÉGOÏSTE dont les numéros aujourd’hui valent une fortune ! Puisse Persona devenir aussi culte et recherchée dans quelques années.
Diasporadz : Votre avant-dernière publication était un double numéro pour le prix d’un. C’est très généreux et courageux, et puis il y a l’hommage émouvant, poignant, à votre ami Frank Darcel qui nous a quittés récemment. Un mot sur Frank Darcel, cet artiste, écrivain, musicien emblématique des années 80 en France.
Frédéric Lemaître : Frank Darcel a été l’homme de l’ombre pendant de nombreuses années sous l’ère du groupe Marquis de Sade, car son chanteur, Philippe Pascal, était si charismatique qu’il attirait toute la lumière sur lui.
Mais Frank en écrivait la musique, les arrangements et c’est d’ailleurs ce qui conduit Étienne Daho à lui demander de s’occuper de l’enregistrement de sa première démo puis ensuite de son deuxième album La notte, la notte. Frank a donc toujours été immergé dans la musique jusqu’au bout. J’ai découvert seulement tardivement que c’était un très grand romantique, plein de générosité et de fougue.
Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?
Frédéric Lemaître : Le magazine Persona est une aventure exceptionnelle qui donne la possibilité de rencontrer des artistes provenant d’univers différents et rien que ça c’est déjà énorme. Mais ce qu’il y a de plus beau, c’est que peu à peu, et à travers les rendez-vous des sorties trimestrielles, cette revue est également devenue un lieu de rencontres entre les artistes eux-mêmes, fédérant une curiosité réciproque et l’amour d’être ensemble, unis dans une même veine pour la vie de l’art et l’art de la vie.
La prochaine sortie de la revue Persona se tiendra dimanche 27 octobre dans le hall de l’hôtel Le Pigalle, 9 rue Frochot à Paris.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Le 25 octobre 2024
……………………………………………………………………….
Le poète Rezki Rekaï (Reski) : « Celui qui nie son passé, c’est celui qui se trompe d’avenir »

Le poète et écrivain Rezki Rekaï dit Reski revient avec une nouvelle publication chez thebookedition, « Des mots en quête de sens » qui tranche dans l’air ambiant, comme un nouveau souffle, celui de l’interrogation, du questionnement, pour bousculer les mots afin d’écarter les voiles pour libérer le sens.
De l’élan poétique à la dimension philosophique, le livre du poète Arezki Rekaï, dit Reski, est une bouffée d’air dans cette époque écorchée en quête de sens. Après le café littéraire de l’Impondérable de l’écrivain Youcef Zirem, où il s’est longuement exprimé, il a gentiment accepté de répondre à nos questions.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Diasporadz : Vous étiez l’invité de l’écrivain Youcef Zirem dans son café littéraire de l’Impondérable, ce fut une belle rencontre, je tenais déjà à vous remercier, les échanges avec Youcef était de haute volée, malgré les sujets philosophiques abordés, vous avez toujours gardé le sourire, restant concentré et imperturbable, comment faites-vous ?
Rezki Rekaï dit Reski : Tout à fait, ce fut une belle rencontre. D’ailleurs, si vous permettez, je profite de cette tribune pour remercier Monsieur Youssef Zirem, il a bien su animer et mener cette rencontre riche en échanges vers son succès et ce grâce à ses talents de journaliste et d’écrivain qui s’ajoutent à ses qualités humaines. Je n’oublie pas l’assistance qui m’avait honoré par sa belle présence, elle a été attentive et très intéressée, les questions ont été d’une grande qualité.
Donc, je dirai que tous les bons ingrédients ont été réunis pour permette à ce riche débat de se dérouler dans une certaine sérénité et ce malgré la complexité des sujets abordés.
Au mot « confrontation » je préfère celui « d’échange » d’idées, aucune idée n’est complète et surtout n’est définitive. Quand on met un peu de cœur, les rencontres finissent souvent bien.
Diasporadz : Vous venez de publier un nouveau livre chez thebookedition, « Des mots en quête de sens », un titre évocateur à l’élan philosophique certain mais aussi spirituel, comment s’est posé le choix de ce titre ?
Rezki Rekaï dit Reski : Les mots ne sont pas neutres, il y a ceux qui blessent et d’autres qui enchantent. Parfois on parle pour rien dire et d’autres fois en quelques mots on peut tout dire. Donc les mots ont un sens mais la question qui se pose : est-ce qu’on attribue à un mot tout son sens, et est-ce que ce sens est le même pour tous ?
Ce titre s’est imposé de lui-même, il répond bien à ce questionnement. J’avais publié un recueil qui a pour titre : Un mot une beauté un sens, ce nouveau recueil reste dans cet esprit.
Diasporadz : Vous avez beaucoup vécu en Belgique mais c’est plus Paris qui vous attire, on dit que Paris est la ville des poètes, qu’en pensez-vous ?
Rezki Rekaï dit Reski : J’ai vécu quelques années en Belgique, un beau pays, son peuple est sympathique avec beaucoup d’humour et une certaine autodérision. Si vous me permettez cette expression, je dirai un peuple facile à vivre.
Ma réponse à votre question est dans ce petit texte que j’avais écrit sur Paris :
La ville des arts et des cultures
Des sciences et des Lettres
De la mode et de la création
De la beauté et de l’élégance
Des langues et des accents
…
À Paris, le monde vit.
En effet, à Paris, on rencontre des artistes et des auteurs de tous bords, et en particulier ceux qui manient avec beauté et délicatesse le verbe.
Diasporadz : Les années passent mais la passion pour la poésie semble s’agrandir, est-elle vraiment devenue un second souffle pour vous ?
Rezki Rekaï dit Reski : J’aime les mots qui chantent, et cela est le propre même de la poésie.
J’aime la liberté, par la poésie cette liberté est totale.
J’aime les beaux rêves, grâce à la poésie ces rêves n’ont pas de limites.
J’aime les voyages, dans la poésie toutes les frontières sont abolies.
J’ai des doutes, par la poésie je me rassure.
J’ai des peurs et des craintes, la poésie les apaise.
La poésie est comme « une parenthèse enchantée » dans un quotidien parfois pressant et oppressant.
Diasporadz : Dans un monde qui va trop vite, qui semble nous faire croire qu’on ne peut vivre qu’en courant, en écartant la pensée, la poésie a-t-elle encore sa place ?
Rezki Rekaï dit Reski : Ce monde moderne qui court de plus en plus vite a effectivement perdu un peu de son humanité. Néanmoins, La vie demeure ce long quotidien en quête permanente de sens, des moments de réflexion sont nécessaires. L’humain a besoin de ces moments de répit pour mieux apprécier et savourer ce qu’il a et ce qu’il est. Oui, je pense qu’on aura toujours besoin de la poésie pour sublimer le présent et enchanter l’avenir.
Diasporadz : La Kabylie vous manque, pourquoi est-ce important de retourner vers la source ?
Rezki Rekaï dit Reski : Celui qui nie son passé, c’est celui qui se trompe d’avenir.
Et j’ajouterai ceci : la vie est un passé qui engendre un présent, un présent qui vit pour construire un avenir.
On est des citoyens du monde, mais on vient tous de quelque part.
Par la mondialisation, on a cru bannir les identités et les régions, mais aujourd’hui, on assiste à un effet inverse, celles-ci s’affirment de plus en plus. Voir l’état actuel du monde, ces défiances, ces conflits et cette haine, le monde a besoin plus d’humanité que de choses, je veux dire que la matière n’est pas et ne doit pas être plus importante que l’humain.
Oui La Kabylie, la Belle par ses paysages, ses traditions et ses valeurs humanistes comme le respect, la tolérance, le partage, l’entraide…peuvent inspirer le monde pour qu’il ne s’égare pas dans son inhumanité.
Diasporadz : Quel regard portez-vous sur la création artistique en Algérie ?
Rezki Rekaï dit Reski : Un grand pays qui regorge de beaucoup de talents, il suffit juste que l’environnement soit plus propice à leur épanouissement. Pour cela, il ne faut pas voiler ce beau soleil ni empêcher cette rosée sur ces bourgeons pour qu’ils se développent en fleurs afin qu’ils puissent sublimer nos quotidiens.
Restons optimistes, il y a beaucoup de belles initiatives à encourager et peut être à généraliser, je pense en particulier aux différents festivals et salons qui se tiennent à travers toute la région de la Kabylie, comme celui de la poterie, du théâtre amateur, du livre, du bijou, Racont’Arts…
Diasporadz : La poésie peut-elle aider à l’émancipation d’une société ?
Rezki Rekaï dit Reski : L’émancipation d’une société exige beaucoup d’efforts et parfois un dépassement de soi. Elle ne peut être qu’une œuvre collective qui en appelle à la contribution de multiples domaines tels : l’éducation, la culture et l’art, l’économie… Avec la réunion de toutes les bonnes volontés, tous les espoirs deviennent alors possibles et par conséquent réalisables.
En effet, La poésie peut apporter cette belle douceur qui apaise les âmes.
Diasporadz : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Rezki Rekaï dit Reski : Oui j’espère publier dans un avenir proche, un nouveau recueil qui sera dans le même esprit que les précédents.
Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?
Rezki Rekaï dit Reski : Je vous remercie Brahim de m’avoir offert cette tribune pour m’exprimer sur ces sujets qui nous tiennent à cœur.
Bonne continuation et beaucoup de succès à votre journal.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Livres publiés :
La rose des ténèbres, une nouvelle, thebookedition.
Éviter au monde un lendemain qui déchante, un essai, thebookedition.
Des mots Une beauté Un sens, poésies, thebookedition
Des mots en quête de sens, thebookedition
diasporadz.com
Le 20 octobre 2024
………………………………………………………………………….
Café L’Impondérable : « Des mots en quête de sens » du poète Reski

Répondant à l’invitation de l’écrivain Youcef Zirem au café littéraire de l’Impondérable, le poète Rezki Rekaï, dit Reski, nous a permis d’assister à un débat de qualité, aux échanges éclairés et apaisés dans une atmosphère conviviale et fraternelle.
Rezki Rekaï, dit Reski, est un poète qui sort des sentiers battus, tant il est vrai, il n’y a pas de différence entre ce qu’il écrit et ce qu’il est, c’est un homme gentil, d’une grande humilité, toujours souriant, au verbe tranchant, sa présence rassurante se fait remarquer car Reski connaît la valeur de l’amitié.
Reski est cet intellectuel humble qui a fait de la poésie un art de vivre et une manière d’être, c’est le poète errant qui sait d’où il vient et qui sait où il va puisant dans l’inspiration, la verve, la beauté, pour chaque mot, et la force pour chaque vers assainissant l’air rendant respirable l’atmosphère. Reski avance le pas assuré, écartant le doute et la peur, il sait qu’il est le fils de l’instant bravant le temps.
Originaire du village Igariden, Maâtkas, la poésie a toujours été pour lui comme une fidèle amie, qui l’aide à respirer et à traverser les nuages que tisse la vie sur nos cieux et nos routes.
Répondant à l’invitation de l’écrivain Youcef Zirem au café littéraire de l’Impondérable, une rencontre littéraire devenue maintenant depuis de longues années incontournable, au 320 rue des Pyrénées dans le XXe arrondissement tous les dimanches à 18h, nous avons assisté à un débat de qualité, aux échanges éclairés et apaisés dans une atmosphère conviviale et fraternelle.
Reski est venu cette fois présenter son nouveau recueil intitulé « Des mots en quête de sens », un titre évocateur, qui interroge, guide et déroute par sa portée philosophique qui nous invite à une halte salvatrice dans un monde meurtri qui se cherche.
Les échanges étaient lumineux, posant des questions, cherchant des réponses, cherchant les fleurs écartant les ronces, Youcef Zirem a mené le débat avec élégance et excellence comme toujours. L’assistance écoutait dans un silence quasi spirituel tant le sujet interpelle le cœur et l’esprit. Reski comme à son habitude accueillait les questions du public avec une joie, celle de l’amitié retrouvée.
Reski est ce fils de commerçant qui a fait des études en économie et gestion d’entreprise à l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, avant de continuer ses études en France où il a obtenu en 2008 un Diplômé de troisième cycle en Audit et contrôle de gestion à l’INSEEC Paris.Mais c’est la littérature et la poésie en particulier qui le passionnent. La poésie est devenue pour lui comme un second souffle.
Chaque poème témoigne d’un vécu et d’un chemin parcouru, chaque vers est comme une respiration salutaire de la terre au ciel. Reski, les ailes déployées déchirant les brumes pour l’éclaircie d’une liberté célébrée par chaque poème.
Reski nous invite à un retour vers soi, vers une quête spirituelle pour remplir nos yeux de l’immensité du ciel, vers une quête de sens censée nous sauver de la dérive et du naufrage, pour retrouver des valeurs qui nous rapprochent du cœur pour essuyer nos pleurs.
Reski est un poète qui est dans le monde avec ces défis et ses espérances, un proverbe africain dit «si tu ne sais pas où tu vas, alors retourne d’où tu viens », mais Reski n’oublie pas d’où il vient, ses valeurs berbères kabyles plusieurs fois millénaires l’aident à mieux voir et à appréhender l’exil dans toute son étendue.
La lecture de « Des mots en quête de sens » replace l’humain dans sa dimension d’être pensant. « L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant ». Cette citation de Blaise Pascal, philosophe du XVIIe siècle, souligne à la fois la faiblesse et la grandeur de l’homme. Reski sait d’où il vient et sait où il va parfois magnifiant mais éclairant par l’élan poétique et spirituel le chemin à parcourir, quel que soit le temps.
Brahim SACI
diasporadz.com
Le 18 octobre 2024
…………………………………………………………………………………….
Café L’Impondérable : Ahmed Aït Bachir est l’invité de Youcef Zirem
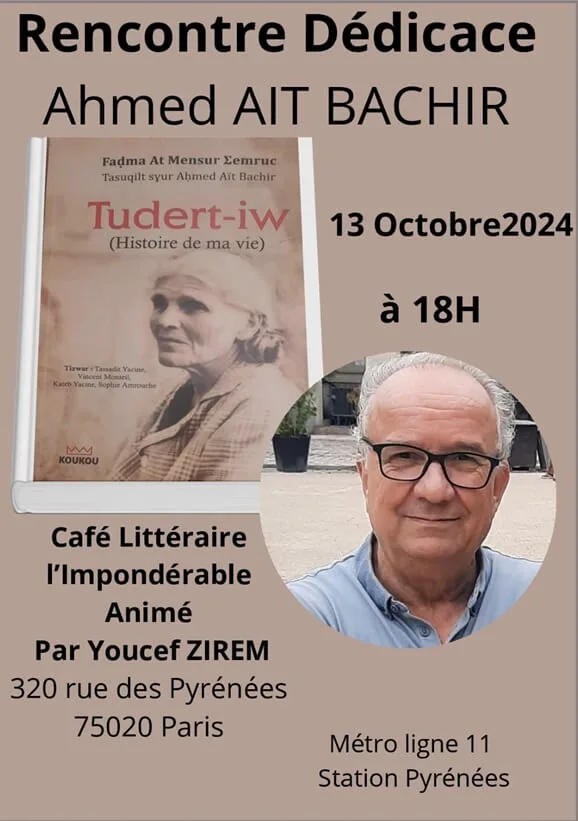
Tudert-iw. Affiche conçue par Siham Ait Bachir
Ahmed Aït Bachir viendra ce dimanche 13 octobre 2024 à 18h au Café L’Impondérable, au 320, rue des Pyrénées dans le vingtième arrondissement de Paris, répondant à l’invitation de l’écrivain Youcef Zirem.
Et pour cause, Ahmed Aït Bachir nous parlera au Café L’Impondérable de son magnifique livre, Tudert-iw, publié par les éditions Koukou, une traduction du français vers la langue kabyle du célèbre livre, Histoire de ma vie, de Fadhma Aït Mansour Amrouche, une autobiographie publiée à titre posthume en 1968.
Fadhma Aït Mansour Amrouche est une femme de lettres algérienne kabyle d’expression française née en 1882 à Tizi Hibel (dans l’actuelle commune d’Aït Mahmoud, en Algérie) et décédée le 9 juillet 1967 à Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine). Elle est aussi la mère des célèbres écrivains Jean El Mouhoub Amrouche, écrivain, poète, journaliste littéraire et homme de radio d’expression française, né le 7 février 1906 à Ighil Ali, Béjaïa, Kabylie, Algérie, un village des Monts Bibans au sud de la vallée de la Soummam, décédé le 16 avril 1962 à Paris et de Marie-Louise-Taos Amrouche, écrivain, chanteuse interprète de chants traditionnels kabyles, romancière, poète, née le 4 mars 1913 à Tunis, décédée le 2 avril 1976 à Saint-Michel-l’Observatoire (Alpes-de-Haute-Provence).
Le livre, Tudert-iw (Histoire de ma vie), est un récit poignant sans doute pensée en kabyle, où l’on retrouve l’âme kabyle où Fadhma Aït Mansour Amrouche raconte sa vie de femme déchirée par les contraintes et l’absurdité de l’époque, elle raconte une vie de luttes et de combats sauvée par l’attachement à son identité kabyle. C’est grâce aux poèmes et aux chants anciens kabyles qu’elle a pu supporter l’amertume et le poids de l’exil.
Ahmed Aït Bachir, en fin connaisseur de la langue et de l’imaginaire kabyles, saura combler les attentes des lecteurs qui sont nombreux à attendre ce beau livre dont la photo de couverture en dit long, tellement évocatrice avec ce regard qui porte loin, telle un tableau des plus grands maîtres.
C’est une rencontre qui s’annonce enrichissante. Comme à l’accoutumée, après une présentation et un échange entre Ahmed Aït Bachir et Youcef Zirem, commenceront les questions du public pour un beau débat. S’en suivra une vente dédicace dans une atmosphère conviviale et fraternelle.
Brahim Saci
Informations pratiques :
● Date : Dimanche 13 octobre 2024
● Heure : À partir de 18h
● Lieu : Café de l’Impondérable, au 320 rue des Pyrénées, 75020 Paris
● Entrée libre et gratuite
diasporadz.com
Le 11 octobre 2024
…………………………………………………………………………………………

Crédit photo : Studio Harcourt
L’artiste Denys Beaumatin : « Je me réjouis de l’instant présent »
Par
Brahim Saci
Denys Beaumatin est producteur, éditorialiste, réalisateur et auteur. Il est un artiste éclectique qui ne passe pas inaperçu, d’abord par son allure, d’une élégance qu’on croirait sortie d’une autre époque, de lui émane une aura qui éclaire sa présence, on peut dire que Denys Beaumatin est le fils de l’espérance, les échanges avec lui sont sans ombrages, de toute beauté.
Denys Beaumatin porte bien son nom, de son regard qui porte loin se dégage cette dimension poétique qui rend le sourire à la vie dissipant le gris, laissant le ciel aux ailes.
Après des études de communication, d’audiovisuel et multimédia, Denys Beaumatin a travaillé́ dans tous les secteurs du cinéma (exploitation pour UGC, distribution pour UIP, et production avec notamment Bizibi Productions) avant que ne s’ouvre devant lui les portes salvatrices de la création.
Tour à tour comédien dans plusieurs pièces de théâtre dont Le Retour De La Planète Marie-Antoinette Louis 17 (Festival d’Avignon 2021, 2022), soutenu par la SACD et en anglais The Return Of The Planet (Festival d’Édimbourg 2022-Le Fringe), TOC d’Augustin d’Ollone (Festival d’Avignon 2006, 2007, 2008).
Du théâtre au cinéma, puis vint l’écriture où il semble se retrouver, de 2009 à 2014 il est rédacteur en chef du magazine mensuel lifestyle Le Bonbon, ses interviews et ses articles bien menés laissent des traces dans le cœur et l’esprit.
Par la suite, il travaille comme photographe indépendant pour différentes marques comme le groupe chinois Kweichow Moutai, L’Oreal. Denys Beaumatin passe d’un art à un autre avec une facilité déconcertante qui force l’admiration.
C’est l’imagination fertile et bouillonnante qu’il passe à la réalisation d’un court-métrage en 2018 au Château Loudenne, intitulé Je sais pourquoi je vis, sélectionné et primé dans différents Festivals de Cinéma internationaux.
Depuis 2019, il est aussi ambassadeur, producteur éditorial et modèle pour la marque Petrusse, entreprise familiale, créatrice de foulards, sélectionnée à La Grande Exposition du Fabriqué en France au Palais de l’Élysée, en octobre 2024. Il représente cette dernière dans le monde entier pour aussi conseiller les différentes personnalités lors d’événements cinématographiques dont Petrusse est partenaire.
Denys Beaumatin comme le peintre, qui passe d’une couleur à l’autre, vient de terminer l’écriture d’une nouvelle pièce Le Retour de la Planète du Masque De Fer Doré, destiné à être joué au Château Mauriac en 2025.
Denys Beaumatin est cet artiste qui se situe hors du moule et des sentiers battus, il éclaire, il s’interroge, il mélange les couleurs pour une élévation du cœur et de l’esprit, quasi spirituelle. La création artistique dans son ensemble est son univers.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un artiste lumineux, magnifiant les arts, qui est Denys Beaumatin ?
Denys Beaumatin : Je vous remercie pour vos mots. En fait, je me définis, comme un aristocrate du cœur, un être dont le but est de vivre pleinement sa royauté intérieure grâce à la création artistique.
À travers l’anoblissement de son cœur via la création, on peut, je pense, unifier son âme, sa parcelle divine, à son corps terrestre.
Avec la naissance sur terre, on perd ce fil à l’âme, à notre énergie divine, avec les années. Comme si cette énergie infinie était condensée, enfermée, cachée dans un petit corps le temps de la vie sur terre.
Être artiste, créer, m’aide à retrouver petit à petit ce fil divin, à le réveiller. Retisser une toile créative à ma parcelle divine est vraiment un souffle précieux.
Je suis évidemment encore plus heureux quand je peux transmettre ce souffle aux autres. Développer et transmettre l’amour de soi à l’humanité grâce à ma création artistique est ma mission de vie je pense.
En fait, plus précisément, quand je crée, joue un personnage, réalise un film, prends des photos, écrit une pièce de théâtre, j’ai la sensation de m’anoblir. Mon cœur devient sacré de tout. Comme si j’étais connecté à un grand tout, à l’Univers, l’essence, « l’ADN » de nos vies…
Tel un chevalier céleste, j’aime l’idée qu’on puisse être adoubé par le divin. C’est beau je trouve. Cette phrase résonne en moi, elle me fait vibrer, dans ce que j’ai de plus essentiel.
Dans la création artistique, en fait, pour moi, on vit ce qu’aurait pu vivre le roi Louis XIV en acceptant les souhaits de Jésus lors de sa Visitation à Marguerite Marie Alacoque en 1689 : ajouter symboliquement son sacré Cœur Divin aux étendards français pour les rendre victorieux.
C’est le même principe, quand on crée, on peut se connecter, s’aligner à son âme divine, alors on vit une forme d’illumination sur terre. On est assurément victorieux, l’amour de l’Indicible nous guide. À travers la création, on vit un instant de lâcher prise, d’Éternité, d’Unité. C’est ce que je ressens à mon humble niveau, car je ne me sens qu’au début de ce processus.
Le Matin d’Algérie : S’appeler « Beaumatin » peut aider à se faire une place dans le milieu difficile des arts, parfois la qualité du travail ne suffit pas, qu’en pensez-vous ?
Denys Beaumatin : Oui mon nom est une énergie, une invitation au sourire, à la légèreté. Quand on est léger, on s’élève plus facilement. Notamment dans le regard, le sourire de l’autre.
Ce nom est un beau cadeau céleste. Souvent, les gens que je rencontre pensent que c’est un pseudo, une blague. Mais c’est aussi vrai que notre naissance en ce monde.
Les Aurores des Possibles m’accompagnent. Je m’appelle Denys Beaumatin comme un Beau Matin ! Par mon nom, que l’on se rencontre ou pas, je vous porte chance. C’est bien non ?
Pour répondre à la deuxième partie de votre question, je ne cherche pas de place. J’ai arrêté de le faire. Je me réjouis de l’instant présent désormais. La question c’est comment puis-je composer avec l’instant ? C’est l’instant qui compose avec moi. Disons que l’on compose ensemble, on lâche prise ensemble. De fait, je prévois peu.
Quand je fais une création sur le moment et la rend intelligible rapidement auprès d’un public, c’est merveilleux, miraculeux… Effectivement, la qualité du travail ne suffit parfois pas, mais les souvenirs de ces durs labeurs de la création, à la présentation au public sont impérissables. Une vraie épopée ! L’aventure est extraordinaire. Parfois frustrante, dure, cruelle, mais mérite d’être vécu.
Je me souviens d’avoir été financé par la SACD… pour Le Retour De La Planète Marie Antoinette Louis XVII à la Comédie d’Avignon au Festival d’Avignon 2021, 2022. Malgré le fait que j’ai dû couper cette pièce d’une heure au dernier moment, je ne garde que des bons souvenirs :
De voir des anges se demander comment ils allaient retrouver le fugitif de l’enfer sur terre, lequel leur avait filer entre les plumes, en essayant de sauver la mère, choisi dans le public par ce même fugitif, qui devait en accoucher, était très drôle. De faire jouer Dieu par un enfant encore plus drôle
Voir les anges arriver sur terre et se remémorer leurs vies antérieures terrestres comme celle de la Reine Marie-Antoinette ou de son fils Louis XVII, heureux de se retrouver avec leur nouveau corps terrestre, était très émouvant. Tout comme de jouer la pièce en anglais au Festival d’Edimbourg (Fringe) en faisant jouer la reine Mary Stuart à la place de la reine Marie-Antoinette, revenue aussi sur terre pour sauver son peuple de l’oppression.
Sans parler de leur mission de vie de récupérer le fugitif dans une course contre la montre, tout en sauvant le monde du changement climatique dont la cause cachée par le gouvernement serait le rapprochement cyclique d’une planète dans notre système solaire, instants pleins de suspense et peut-être un jour d’intérêt public, qui sait ?
Le Matin d’Algérie : Vous avez fait des études de communication, d’audiovisuel et multimédia, mais c’est la création artistique qui vous anime, quel a été l’effet déclencheur ?
Denys Beaumatin : En général je réponds longuement aux deux premières questions et après c’est plus court. Prendre conscience que l’on pouvait créer à partir de rien, grâce à son imagination m’a transcendé, révélé à moi-même. Et en plus, vivre de cela et plaire aux autres c’était vraiment parfait comme destinée. J’ai pris conscience que je pouvais en 1988 être acteur de ma destinée en ce sens.
Par la suite plusieurs événements déclencheurs m’ont traversé et raffermi dans cette voie :
– Danser sa vie à 11 ans, sur une musique classique de Prokofiev, dans la salle du Pin Galant, mise-en-scène de Micheline Castel.
– Jouer sa vie à 20 ans, dans le spectacle Choisir La Vie, sur une musique électronique de Prodigy, mise-en-scène par Odile Detchenique, écriture de la Troupe Pas Bête La Mouche, Bordeaux.
– Réaliser sa vie à 34 ans, dans mon film court, Je Sais Pourquoi Je Vis, au château Loudenne, plusieurs fois nominés et primés à l’étranger. Présence de la composition virtuose du pianiste turque Huseyin Sermet.
– Composer sa vie à 41 ans pour la marque Petrusse, dirigée par l’incroyable directrice artistique Florence Lafragette, en créant de mes photos d’art, deux foulard lit de vin, intitulé Beaumatin et l’autre Noé, avec des réminiscences imprimées de tablette sumérienne, akadiennes, à propos du Déluge.
– Aimer sa vie à 43 ans en jouant sa pièce de théâtre en anglais The Return Of The Planet avec le public sur scène au Festival D’Edimbourg, le Fringe en 2022. Avec la réincarnation en live de la Reine Mary Stuart qui avait enfin retrouver toute sa tête, pour sauver le Royaume Uni, d’un tsunami apocalyptique.
– Célébrer sa vie à 45 ans, lors de la mise en place d’un événement artistique théâtral et cinématographique au Château Mauriac en 2025.
Le Matin d’Algérie : Vos créations sont le moins que l’on puisse dire d’une originalité époustouflante, à quoi est due cette magie ?
Denys Beaumatin : À l’ouverture du sacré cœur d’amour divin “en soie”. C’est comme cela que je définis l’âme. On est pluriel, féminin, masculin, les couleurs de l’aura changent se modifient au cours des années, des pensées, mes créations évoluent de la même façon.
À ma sensibilité, au fait que j’aime lire entre les lignes. Heureux d’un chemin spirituel et personnel singulier au carrefour de nombreuses religions et philosophies, je me considère aujourd’hui comme un artiste d’investigation. Je navigue sur les flots de la création spirituelle, entre comédie historique et suspense. À chaque résolution, un nouveau mystère se déploie.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les artistes qui vous influencent ?
Denys Beaumatin : Beaucoup. Terrence Malick, Stanley Kubrick, Tom Ford, Ruben Ostlund, Mathieu Amalric, François Truffaut, Agnes Jaoui, Claude Lelouch, Luis Bunuel, Brigitte Bardot, Geneviève Grad, Sharon Stone… Louis XVII, Le Masque de Fer, Florence Lafragette, Élisée Léonard Octave Beaumatin, mes amis, ma famille…
Mes contemporains, les gens de mon quotidien que j’ai la chance de croiser dans la rue, dans le métro, … La beauté, la fulgurance est omniprésente en ce monde. Je pourrais passer des heures dans un café pour contempler les différents êtres traversant la rue : femme, homme, animaux, éléments… J’apprends beaucoup d’eux. Beaucoup de Françaises et Français sont des gens fabuleux. Des acteurs et actrices de leur destinée merveilleuse. J’en suis témoin tous les jours. Si on leur permettait de voir la façon dont ils déambulent dans la rue, se meuvent dans l’espace, ils pourraient contempler le souffle qui les habitent, les propulsent, et je suis persuadé qu’ils seraient fiers d’eux-mêmes en voyant cela.
J’aime profondément la France et le pays dans lequel je vis. La beauté de notre pays est un bleuet évanescent en constante renaissance.
Le Matin d’Algérie : De la mode, à la photographie, au théâtre, au cinéma, à l’écriture, vous semblez naviguer sur ces différentes expressions artistiques avec aisance, le visage souriant, comment faites-vous ?
Denys Beaumatin : C’est simple quelle que soit l’expression artistique, je suis happé, saisi, par une forme d’oubli, de vibration élévatrice, rédemptrice et le miracle s’opère. Et à force de faire on sent une maîtrise de son art s’installer.
Par exemple de poser une caméra discrètement devant un château sans rien imaginer m’a permis de voir les déplacements de personnes, tel le jardinier en train de travailler. Une sorte de chorégraphie improvisée s’est mise en place et après il était facile de scénariser en ajoutant d’autres personnages devant l’édifice. Puis la musique fit son apparition. Le clip très court Made In Château, genre film muet, était né.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur les artistes qui vous accompagnent dans votre court-métrage « Le Retour de la Planète », Madeleine Taittinger, Cyril Fargues, Thierry Taranne, Célia Sauthon, comment s’est faite la rencontre ?
Denys Beaumatin : Des coups de cœur pour des comédiens et comédiennes professionnelles et en dehors qui correspondaient dans leurs énergies aux personnages historiques qu’ils devaient composer, voire dans leurs vies antérieures… Ils avaient déjà le bagage nécessaire pour jouer les personnages ou avaient gravité autour de ces personnages de l’histoire dans leur précédente vie, il y a 200 ans environ. C’est ce que je me plais à penser. C’est ce que je ressens au plus profond de mon âme.
On pourrait ajouter aussi Bérengère Griffon qui jouait le rôle de Charlotte Corday dans la pièce de théâtre. Chacun et chacune, et véritablement en 2021, après le confinement, avait une allure singulière et très sensée dans la composition de leur personnage. En vérité, ils ont eu peu de temps, mais ce n’était pas si nécessaire, car leur instinct profond connaissait cette période historique, ils ont joué le jeu de réutiliser les mêmes costumes qu’à l’époque.
Le Matin d’Algérie : « Les yeux sont le miroir de l’âme » vous aimez cette citation de Cicéron, pouvez-vous nous en parler ?
Denys Beaumatin : Cette citation pour accéder à son âme, à sa parcelle divine, que tout un chacun peut déployer s’il en prend conscience, est la phrase qui résume le sens de la vie.
Avant de créer généralement, quand je dis « Les yeux sont le miroir de l’âme » : “je me connecte et je m’aligne parfaitement avec mon âme”, je sens le lien avec une force énergétique qui se déploie, s’unifie en moi et autour de moi. C’est ce chemin pour accéder directement à ma parcelle divine, au-delà de toute matrice. Et cette citation m’aide beaucoup.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Denys Beaumatin : La mise en place d’un événement artistique théâtral et cinématographique au Château Mauriac en 2025 autour de mes trois pièces de théâtre immersives :
Le Retour De La Planète Marie-Antoinette, Louis XVII…
Itinéraire drôle et captivant sur les solutions pour s’adapter et célébrer notre changement climatique grâce au retour de personnages historiques connus.
Le Retour De La Planète du Masque De Fer Doré
Itinéraire plein d’humour et de suspense sur les solutions pour relancer notre croissance économique grâce au retour de personnages historiques connus, notamment le Masque de Fer.
Le Retour De La Planète de Louis XVII, enfin revenu
Itinéraire passionnant autour de la survie de Louis 17 après son évasion de la prison du Temple. Libre interprétation des textes de Soppelsa et d’Esteban à ce sujet.
Le Retour De La Planète de François Mauriac, et pleins de sketches et d’extraits autour de son livre pour enfants Le Drôle de François Mauriac, Prix Nobel de Littérature, qui a vécu ponctuellement dans ce lieu. Il s’en est même inspiré pour écrire Génitrix, l’un des ses premiers grands best sellers, publié en 1923.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Denys Beaumatin : Trois mot et un texte de ma pièce de théâtre Le Retour De La Planète Marie-Antoinette, Louis XVII…, où l’un des anges, appelé Pierre Benoit une fois sur terre, transmet un poème à une personne pour l’aider à le déclamer lors de son rendez-vous amoureux.
C’est un texte romantique, là, à lire à haute voix, pour renforcer la confiance en “soie” et autour de “soie”. Il célèbre l’amour en “soie” de notre divin cœur, offert à l’autre, à travers les mots envolés, tel un papillon, d’un souffle et verbe précieux.
(Peut-être utilisable pour les lecteurs, lors de la prochaine saint valentin
“ PIERRE BENOIT
Votre beauté m’hypnotise
D’un feu sublime,
Qui m’électrise, ou qui me brise !
Et c’est bientôt,
L’eau à l’âme, que je constate :
Que le désir, écarlate, est parfois si cavalier qu’il en oublie les formes,
Et se transforme en blâme.
Pierre Benoit ferme les yeux, les rouvre, subitement, habités.
PIERRE BENOIT
Soudain, mes rougeurs assassines,
Laissent transparaître,
La douleur de ne plus être à la hauteur.
Mes mots ne sont plus que maux.
Oui ! J’avoue, d’un bref regard,
J’ai peur de vous,
Mon souffle est coupé.
Je vais tomber, m’effondrer.
Je me laisse le choix de mourir ou de fuir…
Silence.
PIERRE BENOIT
Et c’est dans une ultime prière…, en moi,
Qu’un inspir grandit…
Et c’est en puisant le souffle d’un amour sans exil, Que de nouvelles ondes, angéliques, m’animent !
Silence.
PIERRE BENOIT
J’affronte de nouveau votre œil,
Mon Dieu, point de rejet, tu es toujours là !
Ton minois amusé, n’est plus hypnotique.
Dieu soit loué. Désir dompté tu es, et sourire je suis ! Et le ciel de tes yeux est une étoile sur ma bouche.”
“L’Âme ne vieillit pas, l’Éternité nous appartient”.
Une citation qui pourrait être publiée sur le site beaumatindalgerie.com.
En hommage aussi aux belles âmes de la famille Légier et de leurs amis algériens avec qui ils travaillaient la vigne de beau matin du côté de Parmentier, Sidi Bel Abbès, et qui font désormais partie des mémoires éternelles de ce beau pays.
Pour information, je serai au Palais de L’Élysée avec la fée et directrice artistique de Petrusse le 25 et 26 octobre. L’entreprise Petrusse fait partie des sélectionnés par L’Élysée du Fabriqué en France en 2024.
Ce que me dit Florence c’est que chaque foulard créé par Petrusse raconte une histoire et accompagne la Grande Histoire de chacun, de nos destinées incroyables, dont nous sommes les héros, les acteurs principaux.
Ainsi, après réflexions, j’ai l’intime conviction que quel que soit le temps, la matière, nous pouvons être enveloppés, traversés, transportés par ce lien lumineux qui anoblit. Chaque foulard de Petrusse est un supplément d’âme, un supplément de beauté merveilleux, dans la vie, dans l’histoire de ceux qui les portent. J’en suis vraiment convaincu.
On parlait de phrase tout à l’heure, mais il est aussi évident qu’un objet peut initier le beau en soi et autour de soi, renforcer la confiance en “soie”, donc célébrer le divin lumineux en chacun de nous.
Entretien réalisé par Brahim Saci
lematindalgerie.com
Mardi 15 octobre 2024
Le Retour de La Planète | La Comédie d’Avignon | BilletReduc.com
leretourdelaplanete.com
issuu.com/denysbeaumatin
vimeo.com/user24070718
…………………………………………………………………………………………

Yannick Trigance : « Construire une société du partage et de la fraternité»
Yannick Trigance était l’invité de l’écrivain Youcef Zirem dans son café littéraire parisien de l’Impondérable, qui est devenu maintenant depuis plusieurs années un rendez-vous culturel incontournable dans la ville lumière.
On a vu un homme convaincu, passionné, donnant l’échange avec sagesse, savoir et humilité sur un sujet crucial laissant le public attentif pour ne rien rater du débat. Yannick Trigance est venu présenter son livre publié aux éditions de l’Aube (Fondation Jean-Jaurès), intitulé « Mixité sociale et scolaire: quels leviers pour quel projet ?. »
L’école, est un sujet que Yannick Trigance connaît bien, il a un riche parcours dans l’éducation et dans son engagement politique auprès du parti socialiste.
Il a enseigné pendant 25 ans en éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis, puis directeur d’école maternelle et à l’école élémentaire, il devient après cette longue expérience inspecteur de l’Éducation Nationale en 2008 avant d’intégrer l’administration territoriale en 2010 comme directeur général adjoint d’une commune de la Seine-Saint-Denis, chargé de l’éducation, de la petite enfance et de l’insertion.
Il devient Secrétaire national adjoint à l’éducation du Parti socialiste en 2012, il est un proche de François Hollande, dont il est l’un des principaux soutiens en Seine-Saint-Denis lors de la primaire citoyenne de 2011. Il est son conseiller éducation dans son équipe de campagne lors de l’élection présidentielle de 2012. En avril 2016, il juge toujours François Hollande comme meilleur candidat du PS pour la présidentielle de 2017.
Suppléant du député Bruno Le Roux, il devient député à la faveur de l’entrée de ce dernier au gouvernement Bernard Cazeneuve le 6 décembre 2016, Après la victoire de Benoît Hamon à la primaire citoyenne de 2017, il est nommé responsable thématique adjoint « Éducation » de sa campagne présidentielle.
À l’occasion des élections régionales de juin 2021, Yannick Trigance est réélu au Conseil régional Ile-de-France sur la liste d’Audrey Pulvar au premier tour et sur la liste de gauche fusionnée des Yvelines au second tour. Il siège dans la commission lycées.
Par ailleurs il est formateur d’élus sur les questions de politiques éducatives, et publie régulièrement des articles sur les questions concernant l’éducation, nous pouvons dire que c’est un penseur ancré dans l’engagement politique, secrétaire National école, collège, lycée, membre du Bureau national et du Secrétariat national, secrétaire fédéral chargé des élections pour la Seine-Saint-Denis, il est Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur depuis le 14 juillet 2014.
Yannick Trigance publie en septembre 2024, un ouvrage aux éditions de l’Aube (Fondation Jean-Jaurès), intitulé, Mixité sociale et scolaire: quels leviers pour quel projet ?.
Yannick Trigance est cet érudit infatigable investi d’une belle mission, celle de la beauté du vivre ensemble, de la rencontre des couleurs, pour casser le déterminisme social français et redonner ses notes de noblesses à l’école républicaine censée donner les mêmes chances pour tous faisant des différences un atout non un handicap.
Le Matin d’Algérie : De l’enseignement à l’engagement politique, qui est Yannick Trigance ?
Yannick Trigance : Je dirais simplement : un citoyen engagé au service de l’intérêt général, porté par les valeurs de la République que sont la liberté, légalité, la fraternité auxquelles je rajouterai la laïcité, ciment de notre société.
Mon engagement professionnel et mon engagement politique ont toujours été très étroitement liés avec un objectif : permettre à chaque enfant, quel que soit l’endroit où il vit et le milieu d’où il vient, de réussir son parcours en devenant un citoyen éclairé, critique et émancipé.
Le Matin d’Algérie : À une époque où l’on perçoit les enseignants comme des techniciens, l’enseignement semble être pour vous une vocation est-ce vrai ?
Yannick Trigance : Une enquête récente montrait que plus de 80% des enseignants aiment leur métier : c’est un engagement humaniste qui s’inscrit dans la philosophie des Lumières et qui vise à permettre l’émancipation de chaque jeune par la raison critique et la liberté de conscience.
En ce sens, on peut à mon sens parler de vocation quand bien même elle ne peut suffire à elle seule : la formation tant initiale que continue des enseignants est absolument indispensable
Le Matin d’Algérie : J’ai assisté à votre rencontre littéraire, invité de l’écrivain Youcef Zirem dans son café littéraire parisien de l’Impondérable, je tiens d’abord à vous remercier car au-delà de l’art de la rhétorique, vous avez su subjuguer le public en exposant les problématiques tout en ouvrant des perspectives concernant l’école et l’éducation en général, vous n’avez pas la langue de bois, avez-vous parfois le sentiment des vous battre contre des moulins à vents ?
Yannick Trigance : Je pense qu’il est des sujets pour lesquels nous devons persévérer quand bien même nous pouvons à certains moments ressentir une forme de découragement qui très rapidement s’efface pour laisser place à la force des convictions et aux valeurs qui fondent notre engagement.
Le Matin d’Algérie : Votre livre « Mixité sociale et scolaire: quels leviers pour quel projet ?. », tout le monde devrait le lire, le meilleur est toujours possible n’est-ce pas ?
Yannick Trigance : Oui, ne jamais renoncer, toujours continuer le débat, les échanges, dans le respect, pour convaincre et cet enjeu de la mixité sociale et scolaire mérite de poursuivre tant l’enjeu est fondamental : il y va du type de société que nous voulons pour aujourd’hui et pour demain.
Le Matin d’Algérie : Vous avez dit dans un de vos articles, « l’école publique n’a besoin ni de grandes déclarations, ni d’effets d’annonces sans lendemain », alors de quoi a-t-elle réellement besoin ?
Yannick Trigance : L’école publique, ses enseignants et au-delà, l’ensemble de la communauté éducative ont besoin de temps et de « respiration ».
C’est pourquoi le « à chaque ministre, une nouvelle réforme » n’est plus possible. Le temps de l’école n’est pas le temps du politique et à partir du moment où l’objectif reste bien la réussite de tous nos jeunes, alors il faut laisser le temps aux enseignants et à leurs élèves de s’approprier la réforme mais également qu’elle soit évaluée dans le temps afin de mesurer les régulations, modifications à apporter.
Et cela doit se faire dans une co-construction et non pas de manière descendante ou injonctive comme cela est trop souvent le cas malheureusement.
Par expérience, les réformes les plus bénéfiques pour nos élèves sont celles qui sont élaborées avec les enseignants dans un processus de collaboration.
Le Matin d’Algérie : Vous prônez la mixité scolaire : « Mettre dans les mêmes classes des enfants issus de milieux différents est la meilleure manière de créer du commun », expliquez-nous ?
Yannick Trigance : Ce que j’essaie de montrer dans mon livre, c’est que mettre sur les mêmes bancs d’une même école les enfants de classes sociales différentes afin de « créer du commun », c’est construire une société du partage, du respect et de la fraternité.
Travailler cette question de mixité sociale, c’est affirmer la volonté politique de permettre à des générations d’élèves de grandir ensemble sur le même territoire, dans une même institution, l’École, en se côtoyant au quotidien.
« Créer du commun », c’est réaffirmer que travailler à une plus grande mixité sociale et scolaire est d’autant plus important qu’en constituant des établissements et des classes où se rencontrent des jeunes de milieux socio-économiques différents, on améliore la réussite scolaire des jeunes d’origine modeste.
À travers la mixité sociale et scolaire, c’est l’égalité, la fraternité, la liberté et l’émancipation individuelle et collective que nous défendons. Et nous ne pouvons nous résoudre à voir notre école, pierre angulaire de notre République Française à laquelle nous devons tant, verser dans une logique de partition et de ségrégation sociale et scolaire.
« Créer du commun », c’est faire de l’école un lieu d’unité, de convivialité et d’apprentissage d’une vie véritablement citoyenne. Une école de l’altérité, de l’émancipation et de la coopération à rebours d’une école de l’individualisme, de l’entre soi et de la compétition.
Et si le séparatisme social et scolaire n’est bon pour personne, en revanche il est bon pour la République que les enfants de tous milieux grandissent ensemble le temps de la scolarité obligatoire. Nous avons besoin de cette mixité sociale car l’École ne peut transmettre une appartenance commune à la République sur des processus d’exclusion ou de ségrégation.
Le Matin d’Algérie : Vous voulez démocratiser la réussite scolaire, améliorer l’orientation des élèves, la formation des enseignants et rompre définitivement avec le déterminisme social français par la mixité, dans un monde qui va trop vite qui freine la pensée, est-ce encore possible ?
Yannick Trigance : Oui bien sûr, c’est possible, et les nombreuses expériences déployées dans certains territoires montrent qu’une école de tous pour tous ne relève pas de l’utopie mais bel et bien d’un projet politique fondé sur un objectif clair : la lutte contre les inégalités.
Et travailler à plus de mixité sociale comme je le dis dans mon livre, c’est porter un projet de société où chacun.e trouve sa place à l’école dans une altérité, où l’éducabilité de chaque jeune reste une certitude et où l’Autre est vécu comme une source d’enrichissement personnel à rebours de l’entre-soi et du séparatisme social : c’est l’un des piliers sur lequel les progressistes doivent construire leur projet politique pour les temps à venir.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les penseurs qui vous influencent ?
Yannick Trigance : Ils sont nombreux donc je citerai d’abord et avant tout Jaurès, Blum, Ferdinand Buisson et plus près de nous Robert Badinter, formidable personnalité. Et je rajouterai Albert Camus, mon écrivain préféré .
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Yannick Trigance : J’effectue actuellement un « tour de France » pour débattre à partir de mon livre de cette question centrale de la mixité sociale et scolaire.
Ces rencontres permettent de maintenir ce sujet au cœur de l’actualité immédiate dans époque de « zapping ».
Et puis je pense à un second ouvrage sur le thème de l’éducation.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Yannick Trigance : Un grand merci au « Matin d’Algérie » de me donner la possibilité de parler de ce sujet dont l’enjeu est absolument crucial pour les générations d’aujourd’hui et de demain !
Entretien réalisé par Brahim Saci
Livre publié :
Mixité sociale et scolaire: quels leviers pour quel projet ?.
Éditions de l’Aube (Fondation Jean-Jaurès)
Jeudi 17 octobre 2024
lematindalgerie.com
________________________________________________

Claire Fourier : « La littérature m’aide à trouver un sens à la condition humaine »
Claire Fourier est d’origine bretonne, diplômée d’Histoire et de l’École nationale supérieure des bibliothèques, elle a longtemps enseigné la littérature, c’est une écriture brillante prolifique pour le bonheur des amoureux des belles lettres, d’une langue poussée à l’excellence.
Il y a des écrivains qui sont véritablement hors des sentiers battus qui paraissent presque irréels tant ils sont hors du moule que l’époque et la société imposent. Nous voyons malheureusement tant d’intellectuels qui s’enflent d’orgueils et de vanité en mutilant la langue et la libre pensée.
Claire Fourier se distingue et s’illumine, ses écrits sont si vrais que chacun peut s’y voir et se reconnaître, ce sont des histoires humaines authentiques sans artifices ni ornements illusoires.
Les livres de Claire Fourier sont une bouffée d’oxygène, ils interpellent l’âme humaine, c’est aussi un baume salvateur pour le cœur qui se réchauffe de page en page tout en restant lucide sans se perdre entre les lignes.
Claire Fourier rend sa valeur au verbe, élevant la langue dans la sensualité, dans un élan quasi spirituel, laissant les sens en éveil, même la plume s’émerveille, les nuages s’écartent et se dissipent laissant la place au soleil.
Claire Fourier magnifie les genres, surfant, voguant aisément entre romans, récits, essais, poèmes, ses livres sont hors catégories, hors des limites fixées pour une littérature standardisée.
Claire Fourier est dans le temps et hors du temps, ses ailes déployées sans équivoque nous invitent à beauté, à la réflexion, à la liberté, à la passion.
Le Matin d’Algérie : Vous avez beaucoup enseigné la littérature, la passion de l’écriture vous habite, qui est Claire Fourier ?
Claire Fourier : Qui suis-je ? Oh, une femme habitée par la tendresse pour le genre humain. La littérature m’aide à trouver un sens à la condition humaine, à nos misères, à répondre à la question : à quoi bon, ce que nous vivons ? De ce fait, la philosophie m’habite plus que la littérature. Je ne suis pas vraiment une romancière : fabrique, raconter des histoires pour divertir ne m’intéresse pas, et j’en serais incapable.
Le Matin d’Algérie : Vos livres sont époustouflants de beauté, de magie, comment réussissez-vous cela ?
Claire Fourier : La magie ! Si elle s’expliquait ! Mais y a-t-il de la magie dans mes livres ? Vous m’honorez. Je suis consciencieuse, c’est tout… Hélas, je me sens tellement en deçà de ce à quoi j’aspire.
Quant à la beauté ! J’essaie, oui, où que ce soit, dans mon comportement, mes pensées, mon écriture, sinon d’atteindre, d’approcher la beauté, synonyme de noblesse, selon moi. Dur, dur ! D’autant qu’il faut donner une impression d’aisance. Mais peut-être est-ce de l’effort dissimulé que surgit la magie qui a toujours l’air d’une chose facile ?
Le Matin d’Algérie : Le temps ne semble pas avoir de prise sur vous, comment faites-vous ?
Claire Fourier : Oh si, le temps a prise sur moi ! Du reste il est le sujet majeur de mes livres. Le temps nous érode (je m’en désole quand je me vois dans le miroir !), il use nos élans, mais nous ne valons quelque chose qu’en assumant les effets du temps sur notre personne. Rejeter le temps nous rétrécit, l’accepter nous grandit. J’essaie donc de tirer de l’âge, autrement dit, de l’expérience et des déconvenues, un maximum de bienfaits. Je dis volontiers qu’il n’est de guerre juste que de guerre contre soi-même, – guerre où nous devons affuter des armes menues pour non pas nier, mais transfigurer le travail du temps, l’alléger et le rendre transparent, et être toujours et partout au mieux de ce que nous pouvons être… tout en sachant que ce mieux est souvent dérisoire. Vivre, c’est travailler inlassablement à s’améliorer, et rien d’autre.
Le Matin d’Algérie : Vous vous démarquez des écrivains en vogue qui sont plus dans l’air du temps et le souffle des vents, votre écriture bouleverse tant elle est vraie et intemporelle, qu’en pensez-vous ?
Claire Fourier : Oui, j’essaie d’être fidèle dans l’écriture à ma part la plus difficile : l’exigence de vérité. On revient à ce que je disais plus haut : la sagesse consiste à faire du temps un tremplin pour l’intemporel (pour le divin). Ce qui est actuel m’intéresse, bien entendu, mais je tâche de faire que l’actuel ouvre sur l’intemporel et l’universel. En donnant à l’instant une valeur dans la durée. – Mettre les choses et les événements en perspective aide à les comprendre. Mettre en parallèle le présent et le passé aide à appréhender l’avenir. Je l’ai fait notamment dans Tombeau pour Damiens, où je rends justice, dans un portrait fouillé, à l’homme qui fut écartelé pour avoir égratigné le roi Louis XV et qui, au matin de sa condamnation, répondit aux juges qui lui annonçaient la nature de son supplice : « La journée sera rude. » J’ai mis en perspective le supplice d’un homme du XVIIIe siècle et nos menus supplices quotidiens, lesquels si souvent nous font pareillement dire au matin : la journée sera rude.
Le Matin d’Algérie : Votre écrit sur l’Abbé Pierre sur Facebook, ce saint homme qui a voué sa vie à aider les plus pauvres m’a profondément touché, « Pauvre vieillard seul, si seul dans sa chambre d’hôpital au soir d’une vie de sacrifices, giflé par une infirmière qui s’est sentie outragée. Mais où donc est l’outrage ? » l’humain semble si oublieux dans une époque dénuée du sacré, quel est votre avis ?
Claire Fourier : Cette affaire me touche. Je ne suis pas née pour juger, mais pour comprendre. Et qu’au soir d’une vie consacrée à son prochain et nourrie de sacrifices, un vieillard, l’abbé Pierre, atteint de la maladie de Parkinson soit giflé dans sa chambre d’hôpital par une infirmière parce qu’il a touché son sein, voulu trouver un peu de consolation à sa solitude, et qu’ensuite cette infirmière (une femme tout de même censée réconforter) se vante de l’avoir giflé, me paraît abominable et un outrage au sacré qui loge en chacun de nous. (J’aurais pris la tête du vieillard sur mon sein avec un sourire et trois mots gentils.)
L’enfant et le vieillard sont particulièrement sacrés. Or, l’enfant est devenu ludique et le vieillard n’est plus respecté. Le blasphème est à la mode, au nom de la liberté d’expression. Il y a là, selon moi, un outrage à la part divine qui loge dans l’être humain.
Le sacré dépasse l’individu, mais exige le respect de la personne, toujours fragile et défaillante.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les écrivains qui vous influencent ?
Claire Fourier : Les écrivains russes qui m’ont enseigné la compassion, la grande pitié.
Montherlant qui m’a enseigné l’écriture lancée, limpide. Nietzsche qui m’a enseigné l’indépendance d’esprit, le refus de penser comme le troupeau.
Simone Weil pour les raisons dites plus haut : le respect du sacré et de la beauté – deux choses qui vont ensemble, selon elle. D’autres encore, bien entendu.
Le Matin d’Algérie : Vos livres éveillent, éclairent, entre philosophie et spiritualité, non pas dans une dualité mais dans une complémentarité, qu’en pensez-vous ?
Claire Fourier : Je me suis longtemps intéressée à la théologie, cela a accentué un besoin de vivre porté par la spiritualité. J’ai fait naguère dans un monastère de la Chartreuse un séjour de dix jours qui m’a beaucoup marquée. J’ai du goût pour l’ascèse et la vie spirituelle. – Ce qui n’est pas antinomique avec la vie sensuelle. J’ai ainsi écrit quelques livres dits érotiques mais que je qualifie plutôt de sensuels, car l’érotisme est souvent violent tandis que la sensualité apaise l’agressivité et la cruauté du monde.
Bien entendu, dans la vie publique j’approuve la laïcité, mais je n’aime pas la laïcardise. Et je regrette qu’au nom de la laïcité, on n’enseigne pas à l’école l’histoire comparative des religions, sans sectarisme, sans dogmatisme. Quel progrès cela ferait faire aux jeunes esprits curieux ! C’est un enseignement délicat certes, pourtant nécessaire.
La spiritualité et la vie intérieure nous sont vitales, elles nous distinguent de la bête, de même que le souci de la transcendance. Il faut en donner le goût aux enfants.
Le Matin d’Algérie : Votre livre « Tout est solitude » publié chez les éditions Tinbad est incroyable, car on ne sent pas du tout seul en le lisant, à quoi est due cette magie ?
Claire Fourier : Vous me récompensez en disant cela, car je n’ai pas écrit ce livre d’un claquement de doigt ; ce fut un dur labeur. J’ai voulu analyser pour le lecteur le secret dont il souffre, et ce secret, c’est la solitude inhérente à la condition humaine. J’ai voulu aider le lecteur à apprivoiser sa solitude, plutôt qu’à la fuir, parce qu’on souffre encore plus en la reniant qu’en l’assumant. J’ai considéré qu’il était de mon devoir de mettre au service du lecteur le petit don que j’ai pour les mots afin de l’aider à « faire avec » la solitude, en lui disant bien qu’il n’est pas seul à être seul, que nous appartenons tous à une communauté de solitaires. Vous me signifiez que j’ai un peu réussi. Tant mieux.
Je plaide non pour le vivre-ensemble pesant, mais pour une légère communion dans le sentiment de solitude. Je l’ai fait à ma manière, avec une part d’humour, d’impertinence, de drôlerie, et peut-être de grâce, ce qui expliquerait la magie dont vous parlez ?
Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Claire Fourier : J’ai continument des projets. Mais finis les récits épuisants qui exigent une longue documentation. Je reviens à ma veine profonde, les « Mélanges » : recueils de pensées, de sensations, d’observations, de saynètes, nourris du quotidien et dépassant le quotidien, disons : des esquisses, des éclats de romans, fondés sur la compréhension d’autrui.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Claire Fourier : Je le laisse à un homme qui avait ses racines en Algérie, Albert Camus : « Quoi qu’il prétende, le siècle est à la recherche d’une aristocratie. Mais il ne voit pas qu’il lui faut pour cela renoncer au but qu’il s’assigne hautement : le bien-être. Il n’y a d’aristocratie que du sacrifice. L’aristocrate est d’abord celui qui donne sans recevoir, qui « s’oblige ». »
J’ajoute, dans le sillage de Camus : il faut tâcher d’écrire en aristocrate et faire que les grains de poussière que sont les mots, s’agglomèrent à la Voie Lactée, pour retomber en pluie d’étoiles et éclairer la solitude, la nuit de nos semblables, nos pareils… tellement dépareillés.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Mardi 24 septembre 2024
lematindalgerie.com
_____________________________________________________

Le pianiste François Kerdoncuff n’est plus
Le pianiste François Kerdoncuff s’est éteint le 12 septembre à l’âge de 70 ans des suites d’une longue maladie, il fut inhumé le 18 septembre à Brest, que sa belle âme repose en paix, sa disparition marque la fin d’une belle époque.
François Kerdoncuff est d’origine bretonne, du Finistère, il se distingue très jeune et se révèle comme l’un des plus grands pianistes occidentaux, par son approche subtile et sa maîtrise rare du piano.
De Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Franz Schubert, Frédéric Chopin, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Joseph Haydn, Johannes Brahms, George Frideric Handel, Claude Debussy, Antonio Vivaldi, Franz Liszt, Hector Berlioz, Felix Mendelssohn, Maurice Ravel, Robert Schumann, Gustav Mahler, Igor Stravinsky, Henri Purcell, Gioachino Rossini, Antoni Dvorak, Sergueï Rachmaninov, Richard Wagner, Dmitri Chostakovitch, Sergei Prokofiev, Camille Saint-Saëns, Béla Bartók, Erik Satie, Guy Ropartz…,le piano, cet instrument noble traverse les siècles sans jamais prendre une ride.
François Kerdoncuff fut l’élève de Nadia Tagrine à la Schola Cantorum et de Vlado Perlemuter au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris (CNSM, Paris) où il obtient son premier prix de piano en 1969.
François Kerdponcuff était un pianiste virtuose, il ne faisait qu’un avec son piano, il incarnait le savoir et la passion musicale, son répertoire était riche et varié, interprétant, Johann Sébastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel mais aussi Guy Ropartz, magistralement, avec une maîtrise technique forçant l’admiration dans un jaillissement d’émotions laissant l’oreille et le cœur dans l’émerveillement.
François Kerdponcuff s’est produit dans de nombreux festivals en France (festivals de La Roque d’Anthéron, Saint-Denis, Menton, Aix-en-Provence, Nohant, l’Orangerie de Bagatelle, Abbaye de la Prée, Vézère, Fénétrange…)
En musique de chambre, il a joué avec les plus grands, les quatuors Benaïm, Sine Nomine, Arpeggione, Manfred ; les violonistes Jean-Marc Phillips, Nicolas Dautricourt, Jan Orawiec, Alexis Galpérine ; les violoncellistes Raphaël Pidoux, Henri Demarquette, Lluis Claret, Yvan Chiffoleau, Raphaël Chrétien ; les chanteurs Mireille Delunsch, Marc Mauillon, Agnès Mellon, Sylvie Sullé, Vincent Le Texier, Brigitte Balleys ; les comédiens Lambert Wilson, Robin Renucci.
Il fut également pendant quelques années directeur artistique du Festival des Musicales de Blanchardeau à Lanvollon dans les Côtes d’Armor, il laisse une quinzaine d’enregistrements, CD, sous le label Timpani.
Parallèlement, il a enseigné le piano au Conservatoire Municipal Georges Bizet du 20e arrondissement de Paris et au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR).
François Kerdoncufffut directeur du Conservatoire Municipal Camille Saint-Saëns du 8e arrondissement de Paris de 2005 à 2017 où il a enseigné également le piano, et c’est précisément là où j’ai eu la chance de le rencontrer en 2005, c’est mon ami Michel Capelier, musicien, compositeur, chef d’orchestre, professeur d’écriture musicale, paix à son âme, qui a dirigé le Conservatoire Municipal du 8e pendant 20 ans, de 1985 à 2005, qui me l’a présenté.
Michel Capelier et François Kerdoncuff ont assisté tous les deux au récital que j’ai donné dans ce conservatoire, entouré par 7 musiciens, le 07 juin 2006 à 20h, pendant plus de 2 heures, un concert unique célébrant l’ouverture culturelle de Paris sur la musique berbère d’expression kabyle, rendu possible grâce à Michel Capelier directeur et à l’association des parents d’élèves. Une date mémorable gravée à jamais dans mon esprit, je les revois encore assis côte à côte au premier rang, me regardant avec une attention toute particulière pendant mon concert.
Au-delà du rapport professionnel, une amitié était née entre François Kerdoncuff et moi, des années de partage d’amitié, je n’oublierai jamais son ouverture culturelle, sa gentillesse, son écoute et ses encouragements dans ma création musicale.
Le 16 décembre 2015, je fus invité à chanter une chanson en kabyle au bœuf de Noël du conservatoire, François Kerdoncuff, alors directeur, m’a présenté en me rendant un bel hommage ; ses mots chaleureux, dignes du gentleman et du savant de l’art musical qu’il était résonnent encore dans ma tête et sont à jamais gravés dans mon âme et mon cœur.
François Kerdoncuff incarnait à la fois, le savoir, le génie musical, l’humilité, les valeurs, l’esprit et le cœur.
Brahim Saci
Le 20 septembre 2024
diasporadz.com
________________________________________________________

Crédit photo : Matilde Fasso
La mezzo-soprano Doris Lamprecht : chanter rend heureux définitivement !
Doris Lamprecht est une célèbre mezzo-soprano, dont l’aura illumine tout ce qui l’entoure, tant la grâce, le talent et l’humilité s’emmêlent pour ne faire qu’un.
Sa maîtrise vocale atteint les sommets et les plus hautes cimes, une harmonie quasi céleste et spirituelle, quand on l’entend nous sommes saisis et transportés comme par magie par des émotions qui jaillissent pour baigner le corps et l’esprit laissant les sens en éveil, l’œil et l’oreille s’émerveillent, c’est la voix du soleil.
Doris Lamprecht est l’une des plus grandes chanteuses mezzo-sopranos occidentales, bénie par les arts écartant tout brouillard pour ne laisser que l’éclaircie salvatrice d’où les espoirs jaillissent. C’est une voix qui relie la terre au ciel jusqu’aux univers sans fins et limites.
Quand j’écoute Doris Lamprecht je ne peux m’empêcher de penser à Marian Anderson, Agnès Baltsa, Teresa Berganza, Olga Borodina Grace Bumbry, Brigitte Fassbänder, Waltraud Meier, Martha Mödl, Gertrud Burgsthaler-Schuster, Angelika Kirchschlager, tant son talent est grand. Doris incarne tout à la fois le travail, la maîtrise, le don et le talent, des capacités vocales très vastes, ajoutant des couleurs et de la vie aux répertoires qu’elle visite, qu’elle chante et incarne.
Après des études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où elle passe son prix de chant dans la classe de Jane Berbié, à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris auprès de Michel Sénéchal, elle suit des Masterclasses avec des professeurs de renom tel que Christa Ludwig, Daniel Ferro, Lorraine Nubar, Sena Jurinac, Anthony Rolfe Johnson, Véra Rosza, Heather Harper, Nancy Evans, et se perfectionne en Mélodie et Lied auprès de Gérard Souzay, Dalton Baldwin, Gerald Moore, Martin Isepp et surtout Ruben Lifschitz.
Doris Lamprecht se distingue par sa présence sur scène et ses qualités vocales dans un très vaste répertoire, qui va de Monteverdi, Bach, Haendel de (Scipione à Beaune), aux compositeurs contemporains (créations du Maître et Marguerite de York Höller au palais Garnier, des Lettres de Westerbork d’Olivier Greif, de La Frontière de Philippe Manoury).
Par son talent elle a marqué de son empreinte la Junon du Platée de Rameau, mis en scène à l’Opéra de Paris par Laurent Pelly – avec lequel elle joua au théâtre.
Elle s’est notamment fait remarquer dans Mme Boulingrin (Les Boulingrin, création de Georges Aperghis à l’Opéra-Comique, Lady Pamela dans le Fra Diavolo d’Auber, à l’Opéra-Comique et à l’Opéra Royal de Wallonie, et Ermerance (Véronique) mise en scène par Fanny Ardant au Théâtre du Châtelet. À l’Opéra de Paris, dans Die tote Stadt, Exceptionnelle dans Brigitta.
À l’aise en italien, en français, en allemand, elle interprète avec succès Verdi (Rigoletto à Strasbourg, La traviata à Orange), d’Offenbach (Les Brigands à l’Opéra Bastille, La Belle Hélène à Zürich sous la direction de Nikolaus Harnoncourt, La Périchole à Marseille, La Vie Parisienne à Tours), de Mozart (La Flûte enchantée à Aix-en-Provence, Lyon et Orange), de Alban Berg (Lulu à Metz), ou encore de Humperdinck (Hänsel et Gretel à l’Opéra des Flandres).
Elle s’est fait également remarquer dans de nombreux rôles dont Dame Marthe (Faust à Lille, Amsterdam et Paris), Gertrud (Hamlet à Saint-Etienne et Moscou), Marcelline (Les Noces de Figaro à Tours et Reims), La Duègne (Cyrano au Châtelet et au Teatro Real de Madrid), Madame Larina dans Eugène Onéguine à Strasbourg, Avignon et Genève, Madame de Croissy (Dialogues des carmélites à l’Opéra de Nantes et Angers), Madame de la Haltière (Cendrillon au Liceu de Barcelone), La Marquise de Berkenfield (La Fille du régiment à l’Opéra de Paris), mise en scène de Laurent Pelly, avec Natalie Dessay et Juan Diego Florez.
Doris Lamprecht est régulièrement à l’affiche à Paris, notamment la Sorcière dans Hänsel et Gretel à L’Opéra de Paris, ainsi que dans Faust et à l’Opéra, mise en scène de Jérôme Deschamps pour Les Mousquetaires au Couvent, Hedwige dans Guillaume Tell, Jacqueline dans Le médecin malgré lui au Grand Théâtre de Genève, L’Opinion Publique dans Orphée aux Enfers à Nancy et Montpellier et à Nantes-Angers Opéra.
Cette chanteuse lyrique née à Linz en Autriche d’une mère compositrice de chansons folkloriques autrichiennes et d’un père fonctionnaire a su mener avec brio une carrière internationale, ses qualités vocales et son talent scénique l’amènent sur les plus grandes scènes mondiales.
Doris Lamprecht est professeur de chant au Conservatoire à Rayonnement Régional CRR de Paris, au PSPBB – Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt, au Conservatoire de Musique du 8ème et 9ème arrondissement CMA8 et CMA9 à Paris.
Doris Lamprecht est membre fondateur aux côtés d’Ariane Jacob, Marc Surgers, Daniel Gardiole, Soyoung Lee, Sarah Niblack et André Serre-Milan, du Festival Chant de la Terre qui propose la 3e édition du 13 au 15 septembre 2024, toujours dans le cadre idyllique du Jardin d’agronomie tropicale de Paris, au 45 bis avenue de la Belle Gabrielle 75012 Paris, pour de belles rencontres où se mêlent les parfums, les couleurs et les styles musicaux.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes une célèbre chanteuse mezzo-soprano, vous sillonnez le monde, vous paraissez infatigable, qui est Doris Lamprecht ?
Doris Lamprecht : Je ne suis que l’instrument qu’on a bien voulu me confier à ma naissance et que je continue à travailler à travers les hauts et les bas d’une vie accomplie. Toujours heureuse et curieuse de prendre de nouveaux défis. J’ai la chance de pouvoir renouveler ma passion tous les jours.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes membre fondateur de ce beau Festival Chant de la Terre, qui en est à sa 3e édition, parlez-nous un peu de ce festival ?
Doris Lamprecht : C’est un Festival fondé il y a trois ans par une amie pianiste Ariane Jacob.
Le jardin d’Agronomie tropical du Bois de Vincennes est un lieu absolument magique et très peu connu par les parisiens.
Vous y trouvez les vestiges de l’exposition coloniale de 1907 en partie restaurés. Les concerts auront lieu au Pavillon Indochine et en plein air.
Les artistes viennent des quatre coins du monde et vous feront découvrir des compositeurs et leurs partitions qui sont elles-mêmes le fruit de la rencontre des cultures.
Le Matin d’Algérie : Le concert d’ouverture de cette troisième édition de ce Festival du Vendredi 13 septembre à 19h30 au Pavillon Indochine est “Chants d’Espagne et de Kabylie” avec la célèbre Amel Brahim Djelloul et le guitariste Thomas Keck, un mot sur cette chanteuse soprano Amel Brahim Djelloul qui mêle la tradition et le classique.
Doris Lamprecht : Amel et moi nous nous connaissons depuis la production « Véronique » d’André Messager, donnée au Théâtre du Châtelet. Elle m’a tout de suite fascinée par sa spontanéité, sa sincérité son talent et surtout son humanité. C’est une grande « Dame » autant connue dans le monde de l’Opéra que des concerts et récitals.
Je suis très heureuse qu’elle ait accepté de partager son amour pour la musique traditionnelle kabyle et de nous faire voyager grâce à un large éventail de son art et ses talents. J’ai hâte de l’accueillir et surtout de l’écouter.
Le Matin d’Algérie : Comment est née cette passion pour l’art lyrique ?
Doris Lamprecht : Comme vous le savez, je suis Autrichienne. Sans prétention aucune je peux vous assurer que la musique en général a une grande place dans la culture des Autrichiens.
J’ai débuté petite soliste à l’église, je suis passée soliste de notre chorale du lycée. Il était facile de dire : pourquoi ne pas tenter un Conservatoire supérieur ?
Le Matin d’Algérie : Quels sont les chanteurs lyriques qui vous influencent ?
Doris Lamprecht : J’ai toujours été en admiration devant Kathleen Ferrier et Christa Ludwig. Ensuite ce sont des rencontres sur scène. José Van Dam, immense artiste et collègue, Margaret Price avec laquelle j’ai eu la chance de partager la scène dans « Ariane à Naxos » et tou(s)tes les autres qui m’ont tellement appris rien qu’en les observant.
Je suis malgré ma longue carrière, comme un enfant jouant à la locomotive. Je m’émerveille de tout et mes antennes restent ouvertes sans jamais se blaser.
Le Matin d’Algérie : Que pensez-vous de l’enseignement du chant dans les conservatoires parisiens ?
Doris Lamprecht : Nous avons beaucoup de chance à Paris, car chaque conservatoire d’arrondissement a une classe de chant. Les professeurs sont de qualité et les modules complémentaires proposés préparent aux grandes écoles toutes celles et ceux qui se montrent digne de notre art. La seule chose que je regrette est le temps imposé.
Les chanteurs ne sont pas de petits élèves de 5 ans qui débutent avec une demi-heure et dont la concentration a des limites.
Malheureusement, nos jeunes recrues entre 18 et 20 ans ne feront qu’une demi-heure comme les petits, alors que le temps de comprendre son corps, son propre instrument, nécessite beaucoup de patience. Personnellement, je dirais qu’un minimum de quarante-cinq minutes seraient beaucoup mieux pour avancer plus vite.
Le Matin d’Algérie : Y a-t-il un pont entre le chant traditionnel dit folklorique et le chant lyrique ?
Doris Lamprecht : Le chant lyrique trouve forcément ses origines dans le chant traditionnel. Le chant folklorique raconte des histoires mettant en musique des situations avec des textes. S’en suivent des Madrigaux en Italie, le premier Opéra vers 1598…
Le Matin d’Algérie : Que pensez-vous de ce proverbe égyptien « N’est malheureux que celui qui ne sait pas chanter » ?
Doris Lamprecht : J’adore les proverbes orientaux. Effectivement chanter est également une thérapie pour moi. On rayonne on respire on vit. Chanter rend heureux définitivement !
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Doris Lamprecht : Je suis actuellement en répétition à l’Opéra de Paris pour « Les Brigands » une opérette de Jacques Offenbach. Je suis très heureuse de faire partie de cette aventure. Ayant chanté le rôle principal, il y a trente ans dans cette même maison et la même opérette, je me retrouve toujours sur la même scène, cette fois-ci dans un rôle beaucoup plus modeste. Mais quel plaisir de voir tous ces jeunes talents autour de moi. La boucle se boucle.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Doris Lamprecht : Il y a de très belles voix en Algérie qui soigne cette culture lyrique. J’ai cette année même une nouvelle étudiante au CRR de Paris (Conservatoire à rayonnement régional) que je serais heureuse d’accompagner le plus loin possible.
Qui sait ? Une interview d’elle dans quelques années. Je vous donne rendez-vous.
Entretien réalisé par Brahim Saci.
lematindalgerie.com
jeudi 12 septembre 2024.
……………………………………………………………………………..

Louis Albert de Broglie. Crédit photo : Deyrolle
Rencontre avec le prince Louis Albert de Broglie
Louis-Albert de Broglie est cet homme érudit, humaniste, qui tire son savoir de la terre et du ciel tel un ange battant des ailes, qu’on croirait sorti d’un conte, tant ce passionné rend le merveilleux possible.
Ce fils de la terre, défenseur du patrimoine universel, multiplie ses efforts pour préserver cette nature généreuse et belle qui remplit le regard lumineux et le cœur heureux, quand on donne on reçoit, œuvrer sans penser au résultat, dans la grâce et l’humilité.
Rien ne prédestinait ce banquier à la préservation environnementale, à la bioculture dans le respect de la nature, et pourtant il arrive avec un regard nouveau, innovant qui déchire les non-sens pour redonner sa valeur au sens, dans une époque qui court vers l’abondance superficielle laissant l’humain sur le bord du chemin.
Louis-Albert de Broglie redonne sa place à l’humain, qu’il arrache du mensonge des illusions de la société sauvage des marchés, pour en sortir le vrai, ralentissant le temps pour un regard en arrière salutaire vers les valeurs et le lien avec la terre et le ciel pour construire l’espoir d’un meilleur avenir.
Louis-Albert de Broglie est comme un ange investi d’une mission quasi divine, le visage apaisé rayonnant de bonté et d’humilité, avec cette noblesse d’âme héritée de ses ancêtres dont l’exemple même améliore notre regard sur le monde. Il est issu d’une illustre famille ; la maison de Broglie compte cinq académiciens, un ministre, un prix Nobel, trois maréchaux, un député et deux évêques.
Cet aristocrate, fils de Jean de Broglie (qui a été l’un des signataires des accords d’Évian avec Krim Belkacem) et de Micheline Segard, a grandi à Paris où il a fait ses études, diplômé de l’école de l’ISG (Institut supérieur de gestion). Il travaille comme banquier de Paris à Londres par l’Inde et l’Amérique latine. Les projets foisonnent dans sa tête et n’arrête pas de se lancer de nouveaux défis.
Louis-Albert de Broglie se souvient des vacances au château familial de Broglie en Normandie. C’est sans doute là qu’est né cet amour de la terre et de la nature et de la volonté de les préserver dans le respect environnemental, militant écologiste, habile entrepreneur.
C’est en 1992, qu’il rachète le Château de La Bourdaisière, classé monument historique, situé en Touraine, au cœur des châteaux de la Loire, il en a fait un hôtel. Louis-Albert de Broglie s’est totalement investi, cœur et âme dans l’écologie, il crée une ferme, un vrai laboratoire d’expérimentation, il a commencé à collecter des graines de tomates pour les planter, et c’est en 1996 qu’il crée le Conservatoire national de la Tomate avec aujourd’hui 650 variétés de tomates cultivées. On le surnomme le prince jardinier.
Louis Albert de Broglie s’est intéressé à la biodiversité en créant dans le parc du château un jardin de plus de 300 variétés de Dahlias, sorti tout droit comme par magie des tableaux des impressionnistes, de Claude Monet, d’Auguste Renoir, de Vincent Van Gogh, dans un jaillissement des couleurs émerveillant les sens, le cœur, les yeux et les cieux, dans un éveil quasi spirituel et un magnifique verger d’environ 80 arbres fruitiers qui forment une belle collection.
Louis Albert de Broglie rachète en 2001 Deyrolle, une institution scientifique et pédagogique située au 46, rue du Bac à Paris qui existe depuis 1831, un temple de l’observation de la nature, et une référence dans le domaine de l’art.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes comme un personnage sorti d’un conte, on vous surnomme le prince jardinier, qui est Louis Albert de Broglie ?
Louis Albert de Broglie : Un peu des deux je suppose, mais heureux d’être avant tout un terrien avec le bagage d’un curieux. Rêveur certes, mais qui tente de comprendre ce qui est sous l’écorce, c’est-à-dire ce que représente l’extraordinaire richesse de la vie, qu’il nous faut apprendre pour mieux la préserver. Pour l’Avenir. Nous avons tant reçu du passé, nous avons tant à transmettre à nos enfants et nous sommes pleins de contradictions. Alors, je cherche l’équilibre dans ce triptyque que j’ai fait mien, Nature Art Education, comme un mantra, mais surtout comme un regard engagé sur la société et sa responsabilité qu’elle doit avoir pour les générations futures.
Le Matin d’Algérie : De la banque au jardin, pouvez-vous nous expliquer ?
Louis Albert de Broglie : Tout est affaire de culture et donc de semer pour récolter. La banque m’a montré le chemin de l’entrepreneuriat, c’était il y a 33 ans. Puis je suis devenu mon propre guide. Le jardin, qui a été à ma naissance un terrain de jeu, me rassure sur le temps long, celui qu’il faut apprivoiser alors que le temps du ‘zapping’ est devenu monnaie commune. Le jardin nourrit et soigne, il émerveille, il nous apprend le partage, la frugalité, la résilience.
Le Matin d’Algérie : En parcourant votre domaine on se rend vite compte que vous avez le regard du peintre, qu’en pensez-vous ?
Louis Albert de Broglie : Quel compliment vous me faites. La nature dans toutes ses compositions, de la matière inerte comme vivante, constitue les tableaux les plus merveilleux qui soient, puisse-t-on les observer. En vous parlant, je regarde au loin une colline plantée de pins parasols, et il me semble contempler le jardin de mousse du temple bouddhiste de Kyoto, Saiho-ji kokedera, je décortique dans ma mémoire ce qui m’émeut et je voyage de par le monde comme dans un tableau de la Renaissance.
Le Matin d’Algérie : Est-ce les souvenirs du château familial de votre enfance qui vous ont poussé à acquérir le Château de La Bourdaisière ?
Louis Albert de Broglie : Peut-être, je ne sais point. Les mystères de nos intuitions, ou de nos repères. Je suis le dépositaire d’un patrimoine et je me sens responsable d’en défendre d’autres, et donc de tenter de faire vivre dans le monde d’aujourd’hui ce qui a constitué la trace du monde d’hier. Cela veut dire être moderne et faire rentrer dans la modernité un monument historique.
Au cœur des châteaux de La Loire, le Château-Hôtel de La Bourdaisière est mon laboratoire autour des enjeux d’écologie environnementale et sociale. Ce sont des défis passionnants – et je l’espère inspirants pour les visiteurs – qui m’ont conduit à créer le Conservatoire de la Tomate, le Conservatoire du Dahlia, le Festival de la Forêt et du Bois, la micro ferme bientôt forêt jardin, les expositions (actuellement Deyrolle, Leçons d’Anatomie, son corps son premier capital), le parcours de l’Art et bientôt l’Ecole Nature Art Education par Deyrolle à destination de tous les publics pour préserver la biodiversité et apprendre la conduite du changement.
Le Matin d’Algérie : Vous paraissez infatigable, vous êtes si souriant et jovial, qu’est-ce qui vous anime ?
Louis Albert de Broglie : Comprendre comment nous préparer (nous et nos enfants) à vivre dans un monde de plus en plus agité. Le faire en cultivant ce qui est essentiel pour bien vivre : un jardin nourricier, une bonne santé physique et mentale, une éducation de l’essentiel qui se résumerait de manière triviale comme bien bouger, bien se nourrir, bien dans sa tête.
Le Matin d’Algérie : Face aux défis de cette époque folle de la surconsommation, d’une production industrielle qui détruit la terre et les hommes, l’écologie, la défense des écosystèmes, et la bioculture sont-elles des réponses ?
Louis Albert de Broglie : Il n’y a pas qu’une réponse, mais des réponses pour une vision commune, prendre soin de la Terre, prendre soin des hommes. Créer et recréer des écosystèmes de vie, bas carbone, fondés sur ce qui demeure fondamental pour vivre en bonne santé.
S’intéresser à l’extraordinaire diversité du vivant pour se sustenter, pour étudier l’orthographe, l’histoire, la géographie, les mathématiques, la chimie, la philosophie, les sciences naturelles…, pour grandir plus fort en observant les milieux et le vivant, comme autant de raisons de moins se préoccuper des travers de la consommation et des chimères que sont les excès de la démesure, de l’hybris.
Le Matin d’Algérie : Parlez-nous du Conservatoire National de la tomate que vous avez créé ?
Louis Albert de Broglie : Juste l’expression de la méconnaissance de ce dont nous avons hérité. Il y a 30 ans, pour beaucoup, la tomate était ronde, rouge et sans saveur. Aujourd’hui, notamment à travers les travaux du Conservatoire de la tomate, nous comprenons qu’il existe plus de 20.000 variétés anciennes, de toutes les couleurs, toutes les formes et de goûts bien différents. Les qualités organoleptiques de ce fruit sont immenses mais révèlent l’intérêt que nous devons porter à la diversité, source de découvertes dans de nombreux domaines.
Il y a tant à entreprendre dans tous les chapitres de la recherche quand on étudie les propriétés d’une espèce, d’une variété que ce conservatoire est juste un exemple qu’il faut continuer à cultiver ! au service de notre santé et de notre bien-être.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur Deyrolle, cette extraordinaire institution scientifique et pédagogique
Louis Albert de Broglie : Un mot ne ferait pas gratitude à cette exceptionnelle maison au langage universel qui fut présente à travers les musées, les écoles dans plus de 120 pays entre 1840 et 1970. Deyrolle a fondé l’engagement scientifique, pédagogique et artistiques de très nombreuses personnes à travers le monde, notamment avec la création de matériel scientifique dédié à la faune, la flore, la chimie, la physique, le corps humain… Ses célèbres planches pédagogiques, qui voient le jour dès la fin du XIXe siècle pour orner les murs des écoles et universités, ont été traduites historiquement en espagnol, portugais, arabe, anglais. Deyrolle pérennise aujourd’hui cet engagement avec la création de collections naturalistes autant que d’œuvres artistiques. Je me suis employé depuis 2001 à retrouver l’ADN de cette institution et la faire rentrer dans le XXI° siècle à travers deux nouveaux métiers :
- Créer un langage universel pour la préservation de la biodiversité et la conduite du changement par des outils comme les ouvrages, les nouvelles planches et les livrets pédagogiques, la conception d’expositions sur une écologie positive (l’exposition Dessine-moi ta planète qui croise le regard du Petit Prince et celui de Deyrolle et qui fera le tour du monde), les collaborations avec les entreprises engagées à partir de l’iconographie historique.
- Créer les contenus pour la mise en place d’écosystèmes bas carbone : ce sont les projets d’aménagement de territoires que nous concevons pour les aménageurs, les villes, les entreprises (voir deyrolleterritoires.com) à travers une méthodologie fondée sur notre triptyques Nature Art Education, qui permettent une autre vision du territoire, transversale, plus résiliente, plus humaine, plus respectueuse du vivant.
Depuis 2001, Deyrolle a été partenaire de la COP21 pour l’éducation ; a retrouvé les chemins de l’école (kit pédagogique sur les enjeux environnementaux et sociétaux) ; a une convention cadre avec l’UNESCO pour la diffusion des sciences. C’est donc une institution puissante, moderne qui ambitionne de servir la cause de tous les projets au service d’un monde plus équilibré.
Le Matin d’Algérie : Que pensez-vous de cette citation de Charles Darwin : « L‘amour pour toutes les créatures vivantes est le plus noble attribut de l’homme » ?
Louis Albert de Broglie : Charles Darwin a appareillé sur le Beagle en 1831, date de la naissance de la maison Deyrolle ! Je suis évidemment sensible aux mots de Charles Darwin et je déplore que nous fassions partie des créatures vivantes dérogeant quotidiennement à l’amour que nous devrions porter à autrui, que ce soit les hommes, les animaux, ou les plantes.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Louis Albert de Broglie : Oui, ils sont nombreux, et espérons tous dans la même direction, donner du sens à la Vie et ce pour l’Avenir. À suivre sur les sites de Deyrolle et de Deyrolle Territoires.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Louis Albert de Broglie : Merci à vous de tant de bienveillance. Il y a tant à faire partout où il y a la Vie. Nous nous devons de construire des mondes plus respectueux de la Terre et des hommes. Le monde de demain, toujours plus connecté, plus rapide dans ses interactions, par la technologie, par le progrès doit se souvenir que l’excès de vitesse peut nuire à l’équilibre, que le vivant, sur lequel se sont érigées nos sociétés, est fragile, que notre condition l’est, contrairement au roseau qui plie et ne rompt point.
Entretien réalisé par Brahim Saci
labourdaisiere.com
deyrolle.com
deyrolleterritoires.com
leprincejardinier.fr
Jeudi 22 août 2024
Lematindalgerie.com
……………………………………………………………………………..

Crédit photo : Hamid Ait Said
Le célèbre chanteur Brahim Bellali n’est plus
Le célèbre chanteur Brahim Bellali n’est plus, il s’est éteint aujourd’hui le 19 août à l’âge de 90 ans, à Saint-Denis (Seine-Saint- Denis) que sa belle âme repose en paix.
Brahim Bellali était originaire de Guenzet, Ath Yaala. Guenzet héritière de la tradition intellectuelle de la Kalâa des Beni Yaala, depuis le XIe siècle comme l’atteste Ibn Khaldoun dans son Histoire des Berbères et des Dynasties musulmanes.
Cette région fut depuis plusieurs siècles un centre de diffusion du savoir.
Guenzet est située au nord-ouest de Sétif dans la chaîne des Babors, entourée des communes de Harbil, Ain legradj (Setif) et El-Maïn, Tassamart, Zemmoura (Bordj Bou Arreridj).
La disparition de Brahim Bellali signe la fin d’une époque, où la musique est une école, transmise de maître à maître. Sa rencontre avec le compositeur chef d’orchestre Amraoui Missoum un maître incontestable et un monument de la musique chaâbi, Farid Ali, Cheikh Arab Bouyezgarène, a été déterminante et lui a ouvert la voie d’une belle carrière artistique avec des compositions révélant un perfectionnement recherché, et une cime atteinte par beaucoup de travail et de sueurs versées.
Brahim Bellali a marqué son époque, comme Cheikh El Hasnaoui, Slimane Azem, Allaoua Zerrouki, Salah Sadaoui, Chérif Kheddam, il est l’un des piliers de la chanson kabyle, il a su apporter sa touche, son empreinte, par son talent et des compositions de qualité restant une référence pour la chanson et la musique algérienne particulièrement kabyle.
Certaines de ses chansons comme, Lemεanda n tismin ig xlan tudrin, Lɣiba tḍul, Ṛuḥ ay itri ṛuḥ, a wi izuṛen at yaala, diffusées régulièrement par la Chaîne 2, ont marqué les mémoires et résonnent dans l’espace-temps.
Je me souviens de nos retrouvailles en 2010 chez le poète Hamid Ait Said rue de Paris à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Brahim Bellali et Chérif Kheddam qui a composé pour lui, venaient souvent dans ce bar où se côtoient les arts et la culture, l’on pouvait voir l’amitié profonde qui les liait, comme il est rare d’en voir aujourd’hui. Ces moments précieux avec ces deux grands hommes sont gravés dans le cœur et l’esprit.
Brahim Bellali était un gentleman, au visage souriant, généreux, toujours avec une belle parole, il encourageait toujours. Il était l’artiste aimé de tous. Il a enrichi considérablement la chanson kabyle depuis la fin des années 50. Il laisse derrière lui un grand répertoire témoin d’une époque rude et généreuse.
Son engagement dans la Fédération de France du FLN jusqu’à l’indépendance de l’Algérie témoigne de son attachement et de son amour pour son pays.
Brahim Bellali restera cet artiste au grand cœur, aussi grand était son talent, aussi grande était son humilité, il a eu un parcours lumineux sans ombres.
Brahim Saci.
lematindalgerie.com
Le 19 août 2024.
…………………………………………………………………………………….

Daoud Mekhous au café littéraire l’Impondérable de Youycef Zirem. Photo DR
Daoud Mekhous, la langue kabyle en bandoulière
Daoud Mekhous invité de l’écrivain Youcef Zirem au café littéraire parisien de l’Impondérable nous a ébloui par sa maîtrise d’une langue kabyle ciselée, travaillée qui n’a rien à envier aux langues internationales, par son imaginaire fertile qui ne demande qu’à se développer et s’élever pour atteindre les plus hautes cimes.
Le passage de l’auteur Daoud Mekhous au café l’Impondérable a renforcé en nous la conviction que la littérature d’expression berbère, plus particulièrement en langue kabyle a de beaux jours devant elle.
La langue berbère plusieurs fois millénaire ne cesse d’occuper du terrain, celui de la création, de la poésie, du roman et de la nouvelle et ceci dans ses différentes langues que ce soit en Algérie, ou ailleurs. Nous sommes loin de la littérature orale, depuis, la Méthode de langue kabyle, de Saïd Boulifa en 1913 et le premier roman, Asfel de Rachid Aliche paru en 1981. Les premiers instituteurs, comme Boulifa, Ben Sedira, ont laissé des textes de littérature orale, comme les poèmes de Si Mohand collectés et publiés par Boulifa.
Mais le premier texte littéraire fut celui de Belaïd Aït Ali ; mort prématurément à 39 ans en 1950, auteur d’un seul ouvrage que le Fichier de Documentation Berbère publia en 1962 sous le titre : Les cahiers de Belaïd ou la Kabylie d’antan. Cet ouvrage est un recueil de poèmes (isefra), de contes (timucuha) et de « nouvelles » (amexluḍ, un mélange descènes de la vie quotidienne en Kabylie)un genre innovant difficile à définir.
Mouloud Mammeri, figure emblématique de la défense de la culture berbère, insuffla un nouvel élan à la littérature berbère. Il recueille et publie, en 1969, les textes du poète kabyle Si Mohand, comme l’ont fait Boulifa en 1904 et Mouloud Feraoun en 1960, en tant que linguiste, Mouloud Mammeri a fixé la graphie berbère (Alphabet berbère latin), même si celle-ci est encore en évolution.
On a vu apparaitre ces dernières années beaucoup d’écrivain en langue kabyle, après tant de peines, cette langue s’approprie un espace resté vierge.
Daoud Mekhous fait partie de cette littérature kabyle émergente, c’est un passionné, très productif, qui magnifie les genres littéraires, passant aisément d’un genre à l’autre, du roman à la nouvelle. Son intervention au café littéraire de l’Impondérable et l’échange avec Youcef Zirem et le public, étaient claires et lucides, si la littérature kabyle souffre d’un manque de lecteurs elle est par contre en pleine expansion, améliorant la qualité, amenant une grande diversité, et un plus grand choix qui ne peut que ramener des lecteurs.
Daoud Mekhous, cet enfant des At Wertiran, au nord-ouest de la wilaya de Sétif en basse Kabylie, cette belle région frontalière de trois wilayas, Béjaïa, Sétif et Bordj Bou Arréridj, une région où résonne encore les noms de Hocine Al Wartilani, un savant du XVIIIe siècle, Abdelhamid Benzine, résistant, militant politique, écrivain et ancien rédacteur en chef d’Alger Républicain.
Abdelhafid Amokrane, compagnon et bras droit de Amirouche Ait Hamouda dans la Wilaya III historique, Cheikh Fodil Al Ouartilani, grand savant algérien de son époque, Cheikh El Mouhoub Ulahbib, un savant du XIXe siècle, connu pour avoir constitué une bibliothèque, d’une riche collection de manuscrits pluridisciplinaires.
Cette belle région célèbre pour ses savants continue d’enfanter des lumières, Daoud Mekhous en fait partie, cet amoureux de sa terre, de sa langue, de sa culture, est l’un des écrivains en langue kabyle les plus prolifiques, son style ne cesse de s’améliorer et de s’affiner au fil des livres pour le plus grand bonheur d’un lectorat exigeant et grandissant.
BRAHIM SACI
diasporadz.com
Le 19 août 2024
…………………………………………………………………………………….

Si Boualem Cheurf. Photo DR
Une pensée pour Si Boualem Cheurf : « Ne pleurez pas si vous m’aimez »
Si Boualem Cheurf (zi Boualem) s’est éteint comme une lumière à Azazga le mardi 17 octobre 2023, subitement à l’âge de 72 ans, que sa belle âme repose en paix.
Si Boualem Cheurf est parti bien trop tôt, lui qui aimait tant la vie et les gens. La terre et le ciel se rappelleront de ce sage, érudit, cet homme hors du commun, au cœur pur, au regard brillant, qui aimait la nature.
J’ai eu la chance de connaître, ce grand monsieur d’art et de culture, qui aimait la liberté de pensée, élégant et discret dont l’aura inspire le respect. Une longue et fidèle amitié était née entre nous à une époque où l’amitié se conjuguait avec la générosité.
Je garde des souvenirs mémorables de ce grand humaniste, qui avait toujours le sourire, un homme d’une grande intelligence, une âme noble qui aimait les gens et la terre. C’était un topographe et un architecte de talent, lorsque fraîchement diplômé il aurait pu partir comme tant d’autres, tenter sa chance et se perdre ailleurs, mais il s’est accroché à cette terre à la fois rude et généreuse, il aimait profondément son pays soucieux de contribuer à sa construction. Il est devenu une source d’inspiration et un repère pour plusieurs générations. Il était plein d’humilité et affable désireux de toujours partager.
Les souvenirs se bousculent dans ma tête, dans ma jeunesse quand je venais en vacances en été, nous parlions beaucoup et c’était à chaque fois une joie de le retrouver. Zi Boualem était un homme éclairé, souvent en avance sur son temps dans ses réflexions et sa façon de voir les choses toujours avec le souci de les améliorer. Nous passions des heures à discuter à la belle étoile, parfois dans le noir complet, seuls nos échanges et les sons de la nature, les cigales, les chacals et autres froissements des buissons et broussailles caressés par le vent rompaient le silence, cela ajoutait une dimension quasi spirituelle à nos discussions interminables. Nous nous quittions tard dans la nuit en pensant au plaisir de nous retrouver le lendemain à la nuit tombée. Je rentrais alors avec une petite lampe de poche ou dans le noir complet laissant les chemins me guider.
Hélas, ces dernières années, les temps ont beaucoup changé, mes retours en Algérie devenaient rares. L’idée de ne plus te revoir mon ami m’est insupportable, tu es parti sans prévenir, des hommes de ta trempe se font rares, tu incarnais les valeurs kabyles, d’entraide, de générosité, d’amour de fraternité, tu aimais tout le monde et tout le monde t’aimait, tu étais aussi devenu l’ami de mon frère si Mokrane, ton absence sera dure à supporter.
Ibn Arabi, théologien, juriste, poète, soufi, métaphysicien et philosophe arabo-andalou, auteur d’environ 850 ouvrages a dit : « La mort n’est pas un anéantissement mais uniquement une séparation. »
Le théologien et écrivain britannique Henri Scott Holland a écrit : « Ne pleurez pas si vous m’aimez, Je suis seulement passée dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné, Parlez-moi comme vous l’avez toujours fait. N’employez pas un ton différent, ne prenez pas un air solennel et triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé comme il l’a toujours été, Sans emphase d’aucune sorte, sans une trace d’ombre. La vie signifie tout ce qu’elle a toujours signifié. Elle est ce qu’elle a toujours été. Le fil n’est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de votre pensée simplement parce que je suis hors de votre vue ? Je vous attends. Je ne suis pas loin, Juste de l’autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. Essuyez vos larmes. »
La mort n’est jamais une fin c’est juste un passage vers une autre dimension. L’écrivain et poète français Christian Bobin disait : « La vie a deux visages : un émerveillant et un terrible ». Mais le merveilleux finit par s’imposer, le soleil finit par briller. Les paroles et les actes ne diaprassent pas ils survivent dans la mémoire des vivants.
L’écrivain, journaliste et philosophe français Jean D’Ormesson disait : « Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants. ».
Si ton départ laisse un vide immense, notre village Tifrit Naït Oumalek, ta famille, tes amis, et au-delà, se souviendront de toi, ton passage ici-bas fut lumineux. Repose en paix Si Boualem Cheurf.
BRAHIM SACI
Le 19 août 2024
diasporadz.com
…………………………………………………………………………………….
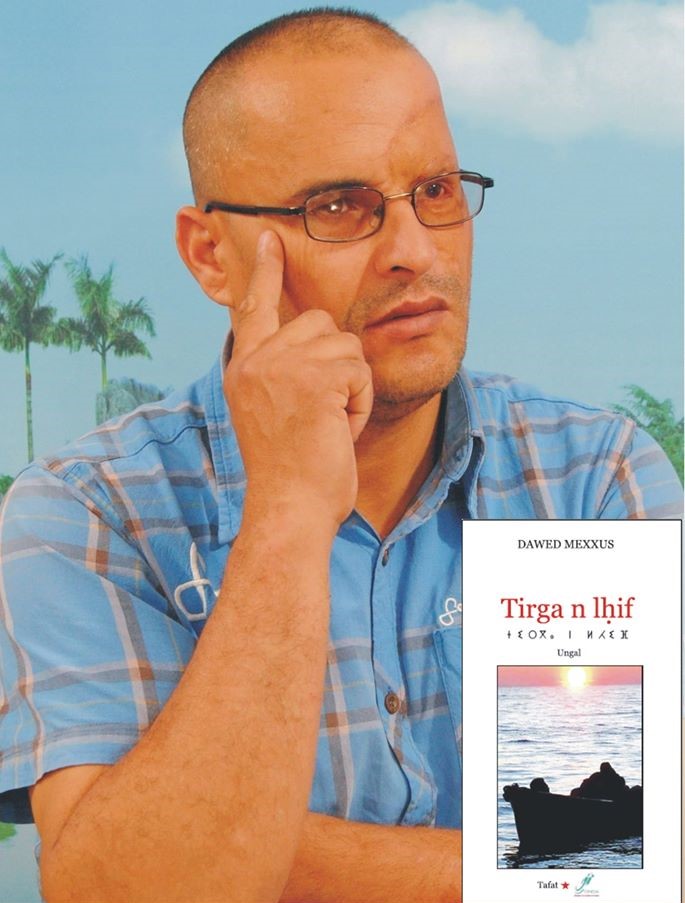
L’écrivain en langue amazighe Daoud Mekhous. Photo DR
Daoud Mekhous : « L’augmentation du lectorat en langue amazighe est encourageant »
De passage au Café littéraire parisien L’Impondérable de l’écrivain Youcef Zirem, l’auteur en langue amazighe Daoud Mekhous a croisé la route de notre ami le poète et journaliste Brahim Saci qui a tenu à l’interviewer.
Entretien
Diasporadz : Vous êtes un auteur prolifique, qui est Daoud Mekhous ?
Daoud Mekhous : Je m’appelle Daoud Mekhous, j’ai grandi dans les bras des sommets des montagnes de Kabylie, fils d’une famille paysanne, du village Aghalad Imedjat, Laarch n’At Brahem de la commune D’Ain Alegradj At Wertilane, dans la wilaya de Sétif.
Je suis né au printemps, lorsque les fleurs printanières fleurissent partout, les arbres sont feuillus, la couleur verte se mélange aux couleurs des fleurs et la beauté de la nature est tissée et héritée, encore une fois, célébrant la vie et cela arrive chaque printemps.
D’une bénédiction verte à une saison sèche et glaciale, ma vie fut soudainement bouleversée, transformée en enfer, je n’avais que huit ans lorsque je fus brûlé accidentellement, tranchant l’innocence, échappant de justesse à la mort, mon visage et ma main gauche furent grièvement brûlés, depuis, je souffre chaque fois que je vois un feu, non parce qu’il m’a brûlé, mais parce qu’il me rappelle les stigmates laissés sur mon visage et sur ma main, des cicatrices qui m’ont volé mon enfance.
C’est péniblement, avec sueur et courage que je suis arrivé au baccalauréat que je n’ai pas obtenu à cause de mes besoins médicaux. Mais j’ai appris beaucoup au lycée où j’ai fait de belles rencontres, s’est développée cet amour pour les livres et la lecture, je traduisais les poèmes des poétes Arabes en kabyle que je transcrivais en Tifinagh.
J’allais au contact des écrivains en langue Amazighe, assistant à des conférences sur la culture amazighe, j’ai été notamment très influencé par Tahar Oussedik, j’ai eu la chance d’assister à l’une de ses conférences à Beni Ourtilane en 1994, peu avant sa mort survenue le 26 octobre 1994.
Tahar Oussedik a laissé de précieux livres, Apologues, Oumeri, Bou-Beghla : (l’homme à la mule) : le mouvement insurrectionnel de 1850 à 1854, Le royaume de Koukou, Les poulains de la liberté, 1871 : mouvement insurrectionnel de 1871, L’la Fat’ma N’Soumeur, Des héroïnes Algériennes dans l’histoire.
Ma passion pour les livres s’est agrandie, je lisais des romans en arabe à cette époque, il n’y avait pas beaucoup de livres en Kabyle, même si j’ai lu le livre, Askuti, de Said Sadi, qui est le premier livre que j’ai lu en kabyle, je lisais aussi des magazines, Asalu, ACB…, Je me suis fait la promesse décrire dès le premier moment favorable, particulièrement dans ma langue maternelle, le kabyle.
L’opportunité s’est présentée avec ma réussite au concours de Superviseur d’éducation, mon rêve a donc commencé à se réaliser. J’ai commencé à travailles au CEM Beni Brahim. Les projets d’écriture ont alors occupé mon esprit. J’étais membre de plusieurs associations locales, la plus récente étant l’association du tourisme D’Ain Alegradj dont j’étais le secrétaire général, nous avons travaillé avec des étrangers dont la Fondation Abbé Pierre et l’association française génération 2010, nous avons pu construire 18 logements à caractère social pour les nécessiteux, grâce à l’aide précieuse de ces associations.
Notre association ATA a commémoré et mis en avant le patrimoine culturel de la région avec des festivals et des fêtes à chaque occasion. Tout mon vécu a agi comme un terreau nourrissant l’imagination et l’inspiration pour faire germer les livres.
Diasporadz : En vous lisant, on sent que la littérature kabyle a encore de beaux jours, comment arrivez-vous à partager votre passion avec le lecteur ?
Daoud Mekhous : Le lecteur de mon pays, surtout dans notre région, est généralement bon et généreux mais très exigeant quant à la qualité des publications, romans, nouvelles, récits, poésie.
On constate qu’il y a beaucoup plus de lecteurs depuis l’introduction de notre langue dans les écoles, lycées et universités, dans la recherche scientifique, par l’écriture avec alphabet latin, notamment avec l’introduction des romans dans les mémoires de fin d’études et de recherche pour les étudiants.
Mes romans sont ainsi inscrits dans les mémoires de fin d’études, notamment dans les universités de Bejaia, Tizi Ouzou, Boumerdes, Bouira, et même dans les universités de Batna et d’Algérie, ce qui m’encourage à écrire davantage.
Diasporadz : Pourquoi ne pas écrire en Tifinagh ?
Daoud Mekhous : On valorise la langue par sa fixation à l’écrit. L’alphabet latin est pratiqué, surtout en Algérie, depuis plus d’un siècle. Certains se posent la question, mais l’adaptation de l’alphabet latin est la plus usitée principalement en Algérie dans la plupart des publications littéraire et scientifiques, ce qui permet d’écrire le berbère de la même façon, quel que soit la langue. Le souci de définir de diffuser une graphie à base latine, usuelle a été partagé par tous les berbérisants et producteurs autochtones depuis le début du XXème siècle.
La graphie berbère avec l’alphabet latin tend à se stabiliser et à s’homogénéiser, grâce à des travaux scientifiques, les travaux d’A. Basset (dans les années 1940 et 1950), celle du Fichier de Documentation Berbère en Kabylie (de 1947 à 1977), de l’œuvre et de l’enseignement de Mouloud Mammeri, et enfin, depuis 1990, celle de l’INALCO, (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), ont été décisives ce qui a permis de réduire les divergences dans la graphie des langues berbères. La quasi-totalité de l’enseignement, des publications et des éditions se fait en caractères latins. C’est en fait le système le plus facile à adapter à la structure de la langue et c’est le système qui répond le plus au critère d’universalité.
Diasporadz : Vos livres sont époustouflants, comment faites-vous pour passer d’un genre littéraire à un autre avec cette facilité déconcertante ?
Daoud Mekhous : Tout d’abord, je salue tous mes chers lecteurs. J’adore lire, des livres, des histoires, de la poésie, des romans, des nouvelles, je suis un grand passionné de la littérature.
Un écrivain ne peut pas composer un roman sans lire, car à travers la lecture, l’écrivain ou le romancier tire ses idées de choses existantes et les établit dans le monde de l’imagination et de la représentation avant de commencer à écrire et de les imaginer comme un film cinématographique, et elles se cristallisent dans son esprit jusqu’à ce qu’il établisse une imagination précise.
Ainsi, lire des livres, des romans, des histoires et même de la poésie, mais aussi regarder des films, des documents cinématographiques, écouter la nature, écouter de la musique et des musiciens aident l’écrivain en diversifiant dans son esprit des méthodes, des objets et les fondements de l’imagination pour que le cœur puisse battre, que l’esprit puisse penser et que la main puisse écrire.
Diasporadz : Beaucoup se plaignent d’un manque de lecteurs, quel est votre avis ?
Daoud Mekhous : Le manque de lecteurs, surtout dans notre pays est dû à plusieurs facteurs, parmi lesquels la méthodologie de l’éducation, qui commence dans les écoles primaires, et l’orientation actuelle des écoles vers l’arabisation de manière plus objective dans tous les domaines.
La langue berbère a longtemps été marginalisée, ce qui a affecté la lecture et le manque d’installations culturelles, récréatives et sportives qui construisent une pensée dialogique solide pour l’enfant. Les circonstances sociales difficiles de la famille et le déséquilibre entre croissance économique et développement social sont aussi des facteurs qui jouent un rôle dans le manque de lecteurs. Mais les chose s’améliorent tout n’est pas noir.
La généralisation de tamazight sur le territoire national constitue un facteur favorable à l’augmentation du lectorat en langue tamazight, particulièrement en kabyle. Nous constatons une augmentation du lectorat en langue amazighe.
Diasporadz : L’Algérie est un pays qui se recherche, en proie aux bouleversements, mais qui mérite beaucoup mieux, la littérature peut-elle aider à l’émergence d’un nouveau souffle ?
Daoud Mekhous : Evidemment, un pays comme l’Algérie est un continent qui possède tous les atouts, les fondements et les conditions pour une vie bonne et meilleure, comme beaucoup de pays dans le monde, il possède des trésors souterrains et aériens et il possède également les énergies de la jeunesse si elles étaient exploitées de la meilleure façon ou utilisées comme énergie pour la construction, c’est un potentiel inépuisable.
Aujourd’hui nous pourrions beaucoup mieux vivre, mais malheureusement, nous voyons toute une jeunesse dans une paupérisation insupportable, mourant sur les mers à la recherche d’un avenir meilleur, ceux qui ne périssent pas en mer découvrent que l’eldorado convoité n’est parfois qu’une illusion, le constat est souvent amer.
Les conditions de vie se dégradent, la cherté de la vie est insupportable. Les mendiants jeunes et moins jeunes remplissent nos rues. L’Algérie ce beau pays est encore un pays qui se recherche, il peut faire beaucoup mieux c’est certain et ce ne sont pas les énergies qui manquent.
Diasporadz : Quels sont les auteurs qui vous influencent ?
Daoud Mekhous : Dans les années quatre-vingt-dix, je lisais de nombreux auteurs et traducteurs arabes, Al-Manfaluti, Al-Majdulin, Al-Sha’ar, Al-Fadhila et d’autres. Ces dernières années, j’ai lu de nombreux romans dont Askuti de Saïd Saadi, Mmis N Igellil de Mouloud Feraoun, traduit par Moussa Ould Taleb, IḌ D WASS, Tagrist, urɣu de Amar Mezdad, Tiziri de Zohra Aoudia, Amsebrid de Chabha Ben Gana.
Le romancier qui m’a beaucoup influencé c’est Aumer U Lamara, Tagara n Yugurten, Aqadir n Roma.
Diasporadz : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Daoud Mekhous : Le niveau littéraire a commencé à s’élever de plus en plus au niveau de la littérature amazighe, c’est une très bonne chose.
J’essaie de terminer un roman fantastique en kabyle, que j’ai commencé en 2019, ce sera le premier de ce genre en tamazight.
J’ai d’autres projets, un recueil de nouvelles et de poèmes, et même un projet d’écriture d’un scénario pour le roman, Tirga n Lḥif, sur le phénomène de la Harraga.
Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?
Daoud Mekhous : Tout d’abord je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de m’exprimer sur un sujet pertinent, le livre, dont la bonne santé détermine le bonheur d’une société. Toute littérature améliore et aide une société dans son émancipation, et à l’émergence d’une nouvelle conscience vers un avenir meilleur où le bonheur sera à portée de tous. Le livre réconcilie l’être humain avec lui-même et le rend meilleur. L’augmentation du lectorat en langue amazighe montre que le peuple algérien dans sa diversité linguistique se réapproprie sa culture amazighe plusieurs fois millénaire, et retrouve son imaginaire amazigh. Mouloud Mammeri disait « une culture n’est pas un patrimoine, une culture n’est pas un héritage. Une culture c’est quelque chose que l’on vit, et c’est quelque chose que l’on fait vivre. »
L’Algérie est un immense pays, la porte de l’Afrique, l’espoir est permis.
Entretien réalisé par Brahim Saci
diasporadz.com
Le 17 août 2024
…………………………………………………………………………………….

Rachida Belkacem. Crédit photo : Pierre Lenoble
Rachida Belkacem : « Rompre la cage sémantique de l’écriture »
Rachida Belkacem est cette poétesse aux vers simples, profonds et libres, à portée de tous, dont les ailes battent comme un rappel au monde, déchirant les vacarmes et autres temps orageux.
La poésie de Rachida Belkacem dissipe les nuages pour retrouver ce ciel d’azur dont la lumière rappelle ce soleil d’Afrique, ce continent mère, chaleureux, à la terre bienfaitrice faisant jaillir des oasis pour étancher la soif du désert et celle des âmes assoiffées en quête de sens. La source spirituelle retrouvée est un baume aux maux par des mots et des silences.
La poésie de Rachida Belkacem est un jaillissement de lumière, c’est un geyser réchauffant la terre, c’est une oasis rafraîchissant les déserts. La poésie et la spiritualité se mêlent et s’entremêlent, interdépendantes dans l’équilibre et l’harmonie parfaite. C’est un beau voyage intérieur qui reflète l’extérieur d’où la nécessité de polir le miroir, pour que la perception ne soit pas faussée ou voilée.
En parcourant son livre « Phronésis » paru récemment chez les éditions Mindset, j’ai senti des parfums de jadis émanant des jardins du soufisme, et nous voyons passer çà et là les ombre de Rumi et d’Omar Kheyyam, même si le titre « Phronésis » nous renvoie aussi et surtout vers la philosophie grecque d’Aristote, Socrate et Platon, dialectique, l’éthique, la science, et les quelques divergences qui ne sont pas antinomiques. Ces philosophes nous ont appris à voir et à s’interroger. On constate une grande proximité de la philosophie avec la spiritualité. La philosophie partage avec la spiritualité la place accordée à l’âme et à l’esprit pour une élévation libératrice dans un rapprochement de la vérité. « Connais-toi toi-même », disait Socrate.
Rachida Belkacem est née en Hauts-de France, vivant en Ile-de-France, diplômée en santé au travail à l’université Paris-Est Créteil. Elle est investie depuis quelques années dans le monde de la culture en France et au Maroc. Ancienne chroniqueuse radio, décorée des Hauts insignes de Divine Académie à Paris, membre de jury du prix littéraire « D’ailleurs et d’ici ». Elle a publié un roman « La révolte des secrets » et a collaboré à l’ouvrage « Maroc de quoi avons-nous peur » sous la direction Abdelhak Najib et Noureddine Bousefiha chez les Éditions Orion, membre du jury du « Prix International de Poésie ARS in Versi ». En 2023, elle préside brillamment le Prix littéraire René-Depestre pour les éditions Milot à Paris permettant aux auteurs de tous les continents une visibilité et une mise en lumière.
Rachida Belkacem nous invite par sa poésie à un voyage intérieur initiatique et profane dans un élan d’amour unifiant et rapprochant les peuples.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes poétesse, diplômée en santé au travail, activant dans le milieu culturel franco-marocain, pour un rapprochement entre les deux rives, qui est Rachida Belkacem ?
Rachida Belkacem : Attirée par l’humain, j’ai depuis toujours aimé mettre des mots sur les émotions. De plus, j’aime particulièrement réunir les artistes des deux rives et bien plus et ceci pour faire progresser la culture sous forme de cénacle en dépassant les logiques de continents.
De plus, le 18 juin 2024, j’ai eu l’occasion et l’opportunité d’échanger avec le premier ministre français Mr Gabriel Attal pour réitérer mon intérêt de mettre l’accent sur la culture en France et avec ma deuxième casquette mon rôle en matière de prévention en santé au travail : permettre plus de moyens humains et matériels. J’en profite pour le remercier du temps accordé.
Le Matin d’Algérie : D’où vient cette envie d’écrire ?
Rachida Belkacem : Le plus important en ce qui me concerne, c’est de donner à l’insensé du sens, j’ai toujours eu envie d’écrire comme un irrépressible besoin qui a trouvé son chemin à travers mes différents écrits.
Une envie de partage, je me sens profondément investie d’écrire sur les vertiges et les bouleversements de la vie pour y extraire du beau. Une manière de donner mots et voix à des choses abstraites.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les auteurs des deux rives qui vous influencent
Rachida Belkacem : En ce qui me concerne j’ai une vision internationale j’aime lire Romain Gary, Victor Hugo, Mririda N’Ait Attik autant que Mouloud Mammeri, Tahar Djaout, Mohamed Choukri et Mohammed El Harraq Al-Alami : finalement ces différents auteurs ont déposé dans mon imaginaire un univers spirituel, riche, libre et poétique.
Le Matin d’Algérie : Comment faites-vous pour passer avec cette facilité qui subjugue du roman à la poésie ?
Rachida Belkacem : Une fois de plus en tant qu’auteur j’aimerais parler de ma perception de l’écriture sans limites ni frontières.
Je recherchais un agencement particulier entre les mots comme une manière de rompre la cage sémantique de l’écriture, la poésie me permet cela : une liberté unique.
Je ne prétends pas qu’une discipline est supérieure à l’autre, je retirerais autant de satisfaction de savoir manier à la fois la narration et le style d’un roman que de pouvoir créer de beaux poèmes.
Si la poésie est l’univers des mots, la nouvelle et le roman sont l’empire de la narration.
La poésie permet des textes courts comme des mantras pour s’adapter à la vie quotidienne des lecteurs.
Le Matin d’Algérie : Après votre roman « La révolte des secrets » vous publiez « Phronésis », comment s’est fait le choix de ce titre évocateur ?
Rachida Belkacem : Je suis allée puiser directement dans la mythologie grecque un terme résumant à la fois la prudence et la sagesse.
Le manuscrit est construit comme une grossesse conduisant le lecteur à se libérer de ses épreuves de vie et reprendre possession de son existence comme une renaissance.
Le Matin d’Algérie : Votre livre « Phronésis », s’ouvre sur une citation de la poétesse russe Marina Tsvetaïeva « Chaque chose doit resplendir à son heure, et cette heure est celle où des yeux véritables la regardent », pourquoi ce choix ?
Rachida Belkacem : Je tiens particulièrement à remercier les Editions Mindset de m’avoir fait confiance et accompagnée dans cette si belle aventure humaine.
Effectivement, cette poétesse russe m’inspire depuis toujours de son exil à sa destinée tragique. La notion de temporalité est centrale dans ses écrits, de plus dans son œuvre elle pousse ses écrits à un degré d’intensité qui me fait écho.
Commencer mon livre par les thématiques de temps, de beauté et de perception avec cette citation a permis d’introduire mes écrits dans le tumulte de l’âme, de nos interrogations à nos instants de bonheurs furtifs.
Le Matin d’Algérie : En parcourant « Phronésis », j’ai vu les ombres de Rumi et d’Omar Kheyyam, qu’en pensez-vous ?
Rachida Belkacem : Incontestablement, je m’en inspire, modestement il s’agit du même univers que ces auteurs, mon univers est onirique, poétique, spirituel voire parfois philosophique.
Par ailleurs, j’aime cette pensée inspirante de Rûmi : « L’univers n’est pas à l’extérieur de vous. Regarde en toi. Tout ce que tu veux, tu l’es déjà. »
Le Matin d’Algérie : Un mot sur l’artiste peintre Ilham Laraki Omari qui a illustré « Phronésis », parlez-nous de cette belle rencontre ?
Rachida Belkacem : Il s’agit d’une artiste marocaine brillante et talentueuse participant au salon d’automne de Paris chaque année, ayant exposé au Grand Palais des Champs Elysées et un peu partout dans le monde la Russie, l’Espagne, l’Autriche, USA … Ce fut d’abord une collaboration de femmes artistes ayant la même sensibilité, Ilham Laraki par son art sublime la valeur du temps. Ses peintures s’inscrivent dans le même univers que mon écriture, nous avons travaillés autour de la thématique du mouvement, du souffle, du chaos et de la beauté qui s’y extrait. Je la remercie d’ailleurs vivement pour cette collaboration.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes Franco-Marocaine, quel regard portez-vous sur le Maroc d’aujourd’hui ?
Rachida Belkacem : Un Maroc résolument comme un lieu de talents s’inscrivant dans un continent comme un trait d’union entre l’Europe et l’Afrique : faisant rentrer le pays dans une nouvelle ère.
Depuis plusieurs années ; le Maroc souverain, continue de multiplier les réformes afin de répondre à certaines attentes de sa population. J’y séjourne actuellement, j’y dépose un regard à la fois attachant et doux. J’y trouve refuge et mon écriture se nourrit de l’atmosphère des lieux.
Le Maroc attire des grands investisseurs dans certains domaines, il recèle en lui un florilège d’histoire et de traditions ouvert sur une forme de modernité.
Il est important de continuer à encourager les talents africains.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Rachida Belkacem : Absolument, je viens de signer un projet à Paris, toujours sur la thématique de l’écriture en collaboration avec une artiste peintre marocaine, il s’agit de l’aboutissement d’un beau projet qui j’espère plaira aux lecteurs, une belle surprise pour cette rentrée littéraire.
J’ai également le privilège d’être invité comme auteur le 22 septembre au festival Arabesque avec la participation d’artistes internationaux brillants encourageant la visibilité des artistes et promeut le dialogue interculturel.
Je remercie The MarKaz Review pour cette invitation et l’organisation de cette conférence qui aura lieu à Montpellier le 22 septembre 2024.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Rachida Belkacem : Je souhaite encourager à la lecture des auteurs de tous les continents, je vois fleurir des talents de tous les pays. Il faut se souvenir que le livre reste une impulsion et une force aidant tout homme à se dépasser : un espace de liberté unique : ne jamais s’en priver !
Ce dont je suis certaine : la lecture peut ouvrir tout un ciel, continuer à se nourrir de mots et se remplir de morceaux d’étoiles comme un goût d’éternité et d’apaisement.
Merci infiniment au journal Le Matin d’Algérie qui m’a donnée l’opportunité d’évoquer mon parcours, mes projets et de mon amour des mots.
Entretien réalisé par Brahim Saci
lematindalgerie.com
Le 16 août 2024
…………………………………………………………………………………….

Crédit photo : Arwa Ben Dhia
Arwa Ben Dhia : un hymne à l’amour et à la beauté
Arwa Ben Dhia est une poétesse qui émerveille par une poésie qui nous parle, dans un style épuré allant à l’essentiel, à la portée de tous. Il y a comme une magie dans ses poèmes, on peut ouvrir le livre à n’importe quelle page, nous sommes accueillis à chaque fois sans artifices, sans illusions et autres figures de styles censées forcer l’admiration, troublant, égarant, nous empêchant d’entrer en profondeur dans le texte.
Chez Arwa Ben Dhia, tout est clair, nul besoin d’ornements, elle réussit à nous surprendre par la limpidité stupéfiante des vers qui retiennent l’attention du lecteur qui s’identifie agréablement, trouvant comme un remède aux maux ou un baume aux blessures. L’élan poétique chez Arwa Ben Dhia est criant de vérité, éclatant, brillant par l’éclat du soleil d’Afrique.
Arwa Ben Dhia est une scientifique polyglotte. Elle parle six langues, l’arabe, le français, l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’italien. Elle écrit principalement en français, mais aussi parfois en anglais, en arabe et en espagnol. Elle réussit à s’approprier l’imaginaire même de chacune de ces langues pour mieux faire jaillir en toute liberté l’émotion sans les obstacles épistémologiques et identitaires.
Cette écrivaine vient de la Tunisie, cette terre du soleil qu’elle quitta à l’âge de 23 ans pour la France, pour continuer avec succès son cursus universitaire, puisqu’elle est ingénieure télécoms et docteure en électronique, exerçant aujourd’hui le métier d’ingénieure brevets.
Cette Franco-Tunisienne magnifie la langue de Molière, il est si beau de voir des scientifiques comme Arwa Ben Dhia se passionner pour la littérature et la poésie, mais cela est loin d’être contradictoire ou antinomique. En effet, Pierre de Ronsard, Jean de la Fontaine, Victor Hugo, Lucrèce, Nodier, Delille, Ǧalāl al-Din Rūmī, ont tous loué les sciences dans leurs écrits :
« La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle », disait Ǧalāl al-Din Rūmī.
« Cherchez autour de vous de riches connaissances
Qui, charmant vos loisirs, doublent vos jouissances.
Trois règnes à vos yeux étalent leurs secrets.
Un maître doit toujours connaître ses sujets :
Observez les trésors que la nature assemble.
Venez : marchons, voyons, et jouissons ensemble. » écrivait Jacques Delille.
Omar Khayyâm fut poète et savant, considéré comme « l’un des plus grands mathématiciens du Moyen Âge », Ibn Sina alias Avicenne fut poète, physicien, astronome. La science et la poésie sont liés dans une relation de quasi complémentarité. « La science décrit la nature, la poésie la peint et l’embellit » écrivait Georges-Louis Leclerc de Buffon.
Arwa Ben Dhia est autrice de trois recueils de poésie dont « Silence Orange » édité par Mindset. On peut dire sans rougir qu’il s’agit d’une littérature qui se situe dans la transcendance sans s’opposer à l’immanence des philosophes comme Spinoza, mais dans un lien spirituel nécessaire. « Silence Orange » a reçu le prix international poétique et artistique de la revue poéféministe Orientales lors de la journée des droits de la femme en mars 2024.
La poésie de Arwa Ben Dhia est un hymne à l’amour et à la beauté. D’ailleurs, dans « Silence Orange », elle s’auto-proclame prophétesse de l’Amour. Ses vers sont empreints d’une spiritualité profonde, sans dogme, dans l’Un, dans l’union totale. Sa poésie est comme un guide qui étanche la soif des égarés de cette époque effrénée sans boussole.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes une scientifique mais c’est la poésie qui vous passionne, qui est Arwa Ben Dhia ?
Arwa Ben Dhia : Votre question me paraît philosophique et me rappelle une réflexion de Gibran qui a dit qu’il était rendu muet une seule fois par un homme qui lui avait demandé qui il était.
Je répondrais simplement que je suis une âme sensible en quête perpétuelle de savoir et de beauté. J’essaie non seulement de comprendre le monde dans lequel je vis, mais aussi de faire évoluer ma pensée et d’enrichir ce monde en y apportant mon humble empreinte.
Le Matin d’Algérie : Vous avez quitté la Tunisie, terre de tant d’histoire et d’espoir, quel regard portez-vous sur la Tunisie actuelle ?
Arwa Ben Dhia : En réalité, je n’ai jamais quitté la Tunisie qui vit en moi en permanence. Je porte pour ma Tunisie un amour viscéral, inconditionnel, coulant dans mon sang, comme celui que je voue à mon père et à ma mère. C’est ma terre natale. Comme vous l’avez si bien dit, elle est riche de son histoire millénaire. Elle est riche de ses enfants qui font d’elle une terre d’espoir. Quoi qu’il arrive sur le plan politique, je demeure optimiste, car le père de l’Indépendance – Paix à son âme – (et c’est drôle que je réponde à cette question le jour de son anniversaire) a misé sur l’éducation pour construire un pays solide. Les Tunisiens continuent à accorder à l’éducation de leurs enfants la plus haute importance et c’est pour cette raison que je reste confiante pour l’avenir du pays.
Le Matin d’Algérie : Silence Orange est époustouflant de vérité, de la magie se dégage à chaque page, dans un élan spirituel transcendant, on en sort apaisés, comment réussissez-vous cette transfiguration ?
Arwa Ben Dhia : Merci pour ces éloges et ravie que vous l’ayez apprécié ! Je pense qu’il suffit d’être sincère et authentique dans ce qu’on veut transmettre comme messages, afin que son écriture touche autrui. D’ailleurs, cela ne concerne pas que l’écriture, je crois que c’est le secret de la réussite de toute entreprise dans la vie.
Le Matin d’Algérie : Deux citations de Christian Bobin ouvrent votre livre, « C’est même chose que d’aimer ou d’écrire. C’est toujours se soumettre à la claire nudité d’un silence, c’est toujours s’effacer » et « Ce n’est pas pour devenir écrivain qu’on écrit. C’est pour rejoindre en silence cet amour qui manque à tout amour », un mot sur ces citations et Christian Bobin
Arwa Ben Dhia : Christian Bobin est l’un de mes écrivains favoris. J’aime sa conception spirituelle de la vie. J’ai choisi ces deux citations comme épigraphe de mon recueil, car elles mettent en exergue le lien inextricable qui existe entre le silence, l’amour et l’écriture, thèmes centraux dans « Silence Orange ». Je dirais même que ce sont les piliers de ce que j’appelle ma triade sacrée ou « Sainte Trinité » : la lumière du silence et l’amour dans le cœur, soutenus par la puissance de l’écriture.
Le Matin d’Algérie : La citation d’Ernest Hemingway « Soyez amoureux, crevez-vous à écrire, contemplez le monde, écoutez la musique, regardez la peinture, ne perdez pas votre temps, lisez sans cesse, ne cherchez pas à vous expliquer, écouter votre bon plaisir, taisez-vous… » semble résumer votre livre, comment s’est fait le choix de cette citation et de cet auteur ?
Arwa Ben Dhia : Voilà, vous l’avez compris, je suis friande de citations ! C’est vrai, je collectionne des citations en toutes langues que je note soigneusement dans un carnet. Et en effet, cette citation d’Hemingway résume l’esprit de ce que j’ai voulu transmettre dans « Silence Orange » : elle rend hommage à la grandeur du silence, à l’amour, à l’écriture, à la lecture, à la contemplation, à l’art, bref à la vie ! Tout est dit dans cette pensée condensée d’Hemingway. Vous m’avez aussi demandé un mot sur Hemingway, j’en profite alors pour dire que c’est un grand écrivain qui, comme moi, a vécu à Paris et a été charmé par sa beauté. Permettez-moi de terminer ma réponse par une autre citation inestimable d’Hemingway : « Il n’y a que deux endroits au monde où l’on peut vivre heureux : chez soi et à Paris ».
Le Matin d’Algérie : Vous maîtrisez plusieurs langues, votre recueil, Silence Orange, comporte d’ailleurs des poèmes en anglais et en arabe, est-ce un avantage pour la création ?
Arwa Ben Dhia : Oui, j’en suis convaincue, car pouvoir raisonner et s’exprimer en différentes langues stimule le cerveau. Donc, c’est forcément favorable à la création. L’apprentissage des langues est sans doute un sport cérébral dont je suis férue. Par ailleurs, lorsqu’on apprend une nouvelle langue, c’est toute une nouvelle culture avec sa richesse et sa splendeur qui s’offre à nous. Cela favorise l’empathie et la paix entre les peuples. Je n’aurais jamais pu écrire mes poèmes en espagnol si je n’avais pas décidé d’apprendre cette langue par amour et envie de découvrir davantage la culture latinoaméricaine et hispanique.
Le Matin d’Algérie : Silence Orange est troublant mais en même temps, on entrevoit un éveil spirituel, une délivrance dans un coucher de soleil, comment s’est fait le choix de ce titre ?
Arwa Ben Dhia : Il fallait absolument que je fasse apparaître le mot « Silence » dans le titre, car c’est le leitmotiv de l’ouvrage. En effet, je rends hommage au silence dans une ère en manque de ce silence spirituel, propice à la méditation. Je brise aussi un autre silence, celui qui a été imposé à la femme que je suis, élevée dans une société conservatrice interdisant aux femmes de parler librement d’amour et de sexualité et de remettre en cause les dogmes religieux.
Quant au choix de la couleur orange, il s’est fait spontanément, car Ariane, la protagoniste du recueil qualifie l’histoire d’amour épistolaire qui la lie avec Nawfal, son étranger, de songe de couleur orange. Mais après m’être documentée sur le symbolisme de cette couleur, je me suis rendue compte qu’elle comprend trois dimensions intéressantes. La première est celle de la spiritualité, car l’orange ou le safran est une couleur sacrée en hindouisme. Donc, cela rejoint bien l’idée du silence contemplatif dont je parlais ci-avant.
Comme disait Paul Valéry à propos de ce silence : « Écoute ce bruit que l’on entend lorsque rien ne se fait entendre… plus rien. Ce rien est immense aux oreilles ». La deuxième dimension est celle du mouvement. Donc, « Silence Orange » est un silence actif, iconoclaste, libérateur, qui crie et dénonce les abus à travers une plume incisive.
Comme disait Marguerite Duras : « Écrire, c’est hurler sans bruit ». Enfin, la troisième dimension est celle de l’optimisme et effectivement, je suis de nature optimiste et j’ai fait en sorte de finir chaque texte de « Silence Orange », aussi tragique soit-il, sur une note positive, une note d’espoir. Comme disait Elias Canetti : « Tout ce qu’on prend en note, tout ce qu’on met par écrit contient encore un petit grain d’espoir, quand bien même il ne serait venu que du seul désespoir ».
Le Matin d’Algérie : En vous lisant, nous ressentons la présence mystique de Ǧalāl al-Din Rūmī, est-ce un hasard ?
Arwa Ben Dhia : Non, car je me suis beaucoup imprégnée de la pensée de Rumi et du soufisme d’une manière générale qui rejoint ma foi panthéiste. Donc, c’est normal que Rumi m’influence et d’ailleurs, il est cité dans un de mes textes dans « Silence Orange » : « Le silence est le langage de Dieu, tout le reste n’est que pauvre traduction ».
Le Matin d’Algérie : Quelles sont vos influences dans la littérature et la poésie en général ?
Arwa Ben Dhia : Je puise mon inspiration dans la nature, mon vécu et mes lectures. Je suis évidemment influencée par les philosophes et les poètes que je lis en différentes langues. Parmi les philosophes, Nietzsche est celui qui a le plus d’écho en moi et sa pensée est très présente dans mes poèmes. Il y a aussi Spinoza, Schopenhauer et Camus. Parmi les poètes français, Lamartine, Baudelaire et Verlaine.
En arabe, c’est incontestablement le poète palestinien Mahmoud Darwich qui me marque le plus. D’ailleurs, j’ai traduit de nombreux poèmes darwichiens en français et mon premier poème arabe est inspiré de « Rita et le fusil » et figure en annexe de « Silence Orange » avec une traduction française dans le recueil. En anglais, c’est Robert Frost et Lord Byron. En espagnol, c’est Borges, Neruda, Lorca et Machado.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur Hana Oueslati, qui a dessiné cette belle illustration de couverture.
Arwa Ben Dhia : Hana est une amie tunisienne qui a eu la gentillesse d’illustrer « Silence Orange » et surtout le talent de créer un dessin illustrant parfaitement les messages de liberté et d’amour que véhicule le recueil, à partir de ce que je lui avais résumé en quelques mots seulement. J’étais très contente de voir ce qu’elle avait dessiné : une femme dont les pieds baignent dans la mer méditerranée par un beau coucher de soleil orange, avançant son buste comme pour affirmer et assumer sa féminité et dont le corps se désagrège par derrière pour laisser s’échapper des oiseaux symbolisant la liberté qu’elle s’offre et qu’elle offre au monde.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Arwa Ben Dhia : Oui, puisque je continue toujours à écrire. C’est une activité dont je ne saurais me passer. Donc, j’espère qu’il y aura prochainement des publications, individuelles ou en co-écriture.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être
Arwa Ben Dhia : D’abord, je voudrais vous remercier de m’avoir accordé cet entretien et j’aimerais inciter les gens, surtout les jeunes personnes, à lire de la poésie, car je trouve que c’est un vecteur de beauté par excellence et notre salut se trouve dans la beauté. Comme je raffole de citations, je finirai par celle de Charlie Chaplin sur la poésie étayant ma pensée : « La poésie est une lettre d’amour adressée au monde » et celle de Jacques Prévert « La poésie, c’est le plus joli surnom qu’on donne à la vie ».
Entretien réalisé par Brahim Saci
lematindalgerie.com
dimanche 4 août 2024
………………………………………………………………………..
/image%2F1720502%2F20240730%2Fob_165b0d_451373983-1041969840596289-45151192147.png)
Crédit photo : ARTE
Paul Ardenne : « Avançons, main dans la main »
Écrire sur Paul Ardenne, cette figure emblématique, savant de l’art, n’est pas une chose aisée, tant l’aura de cet universitaire infatigable, éclectique aux multiples facettes, pour ne pas se contenter d’une discipline, ne cesse de rayonner, et son nom revient à chaque fois qu’un questionnement, un doute, surgissent pour troubler la pensée forgée par le moule des sociétés modernes qui ne voient plus dans l’art que son instrumentalisation, passant outre le créateur et la création.
Des spécialistes érudits comme Paul Ardenne sont indispensables lorsqu’ils sont eux-mêmes et non pas pris dans les tourbillons de l’époque qui va trop vite, filant vers le superflu et oubliant l’essentiel. Paul Ardenne a été agriculteur, avant ses études universitaires poussées, il comprend donc la terre et le ciel et il s’abreuve à la bonne source, celle pure de toute beauté.
Paul Ardenne me fait penser à Gaston Bachelard, ce philosophe de génie au parcours atypique, qui s’est interrogé sur le concept d’obstacle épistémologique pour analyser les obstacles à la connaissance scientifique, autant de séductions qui empêchent la progression de la connaissance, pour un rapprochement philosophique, littéraire, de l’imagination, de la création, dans un élan de non dualité vers la complémentarité.
Paul Ardenne est né dans une famille d’agriculteurs charentais, il exerça un temps la profession d’agriculteur. Il étudie les lettres, l’histoire et la philosophie dans les facultés de Poitiers et de Toulouse avant de faire une thèse en histoire de l’art à l’université de Picardie d’Amiens (« La création plastique contemporaine, formes et contraintes », 1960-2000) sous la direction de l’historienne de l’art Laurence Bertrand-Dorléac avec laquelle il continue de travailler.
Agrégé d’Histoire et docteur en Histoire de l’Art, commissaire d’exposition, spécialisé dans l’art contemporain. Il a enseigné l’histoire de l’art contemporain à la Faculté des Arts de l’université d’Amiens. Paul Ardenne se focalise sur l’art contemporain, il est le témoin et analyste de la culture de son époque, il donne des conférences dans tous les domaines de l’art et de l’architecture, ainsi que dans le domaine de la vidéo d’art.
Écrivain, romancier et essayiste, Paul Ardenne collabore depuis longtemps à des revues et magazines. Son écriture ne cesse d’évoluer dans un souci et une volonté sans cesse renouvelés d’appréhender le réel.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes Bertrand Gervais, Paul Ardenne, figure incontournable de l’histoire de l’Art, qui est Paul Ardenne ?
Paul Ardenne : Un individu sur 8,16 milliards, le nombre d’habitants de notre planète à cette heure. Autant dire une figure négligeable et pourquoi le déplorer ? L’identité est une énigme insondable. Je suis né là, en France, sous un nom que je n’ai pas demandé (et que j’ai modifié), à tel moment de l‘espace-temps cosmique (au moment où s’achève la Guerre franco-algérienne, pour fournir un repère). Un si petit moment, sachant que notre univers compte quatorze milliards d’années d’existence selon le modèle cosmologique fourni par la relativité générale.
J’aurais pu naître ailleurs, à un autre moment ou pas du tout. Dans les Aurès ou en Kabylie il y a dix siècles, ou à Luzon ou Punta Arena il y cinq ou trois mille ans. Qui est-on ? « Dieu seul sait », prétend un proverbe universel, étant entendu qu’il n’est même pas sûr que Dieu se soit donné la peine d’exister. L’identité ? Me concernant, c’est l’errance totale. Ce qui a cette conséquence positive, m’interdire tout arrogance, toute posture fondée sur le lieu de naissance, son moment, la race (il n’y a de toute façon qu’un seul ADN humain) et moins encore l’origine sociale.
Je suis un Terrien sur une planète ayant déjà compté avant moi cent vingt milliards d’autres Terriens, sûrement pas une personnalité incarnant avec un orgueilleux quant-à-soi on ne sait quelle suprématie, blanche, bourgeoise, occidentale, intellectuelle, de genre, de clan, de religion ou que sais-je encore. « Moi » ? Une unité parmi une infinité d’autres, et qui ne revendique rien sinon le maximum de santé, de bonheur et de paix pour tous comme pour moi, sans violence ni prédation si possible (ne rêvons pas trop, cependant : l’inégalité et l’injustice, qui perdurent, sont de puissants facteurs de violence).
Le Matin d’Algérie : Je n’ai pas pu m’empêcher d’évoquer le philosophe Gaston Bachelard en pensant à vous, vous avez tous les deux un parcours atypique, mais soucieux d’être témoins actifs engagés de leur époque, mais lui pense que la vérité scientifique n’est pas le fait de l’expérience, c’est l’expérience qui doit être corrigée par l’abstraction des concepts, n’y a-t-il pas une contradiction avec le travail de l’historien ?
Paul Ardenne : On peut adhérer à ce point de vue, au regard de cette donnée notoire : le monde, le réel ne sont pas ce que veut l’humain, ils ne sont pas d’abord ce qu’encodent notre savoir et notre intelligence mais un devenir matériel qui a sa propre substance, sa mécanique intrinsèque carburant au prorata de lois avec lesquelles l’humain, tard venu dans l’histoire des faits cosmiques, n’a rien à voir.
L’humanité est une conséquence. Ce qu’elle nomme « vérité scientifique » est une somme d’acquis fondés sur l’observation, la recherche et la taxinomie, ce classement des choses sues par entrées spécifiques. C’est là, qu’on le veuille ou non, le résultat d’une « expérience » du monde (experire, « faire l’essai de », nous dit l’origine latine de ce terme), que cette expérience soit volontariste (on cherche), aventureuse (on prospecte dans l’espace-temps) ou hasardeuse (la sérendipité, qui fait que l’on découvre sans s’y attendre).
Vivre c’est expérimenter le réel de toutes les manières possibles, même à ne faire que respirer – respirer aujourd’hui, de la sorte, c’est endurer l’anthropocène et la qualité dégradée de l’air résultant des pollutions d’origine humaine.
L’historien est quant à lui, dans cette perspective, celui qui se repose de l’expérience : les faits ont eu lieu, il est « après ». Ces faits, propose-t-il, recensons-les et mettons-les en ordre en essayant de voir du mieux possible ce qu’ils nous enseignent, ce qu’ils nous disent de nous, ce à quoi ils nous invitent, pour le présent et le futur.
Le Matin d’Algérie : Vous avez enseigné l’histoire de l’art, vous avez beaucoup publié, d’où vient cette passion pour l’art ?
Paul Ardenne : D’une déception absolue. Celle de l’impossible autonomie de l’humain. J’ai grandi, vous l’avez rappelé, dans un milieu paysan, au milieu des animaux, des végétaux, de la terre. Le premier constat que fait l’enfant, dans un tel milieu, c’est celui de sa faiblesse, de son incapacité à ne pas dépendre de tout. De son environnement naturel, de son environnement familial, de tous les dispositifs qui « font » un homme, de l’apprentissage d’une langue complexe à celle des usages sociaux, sur le mode d’une domestication interminable, d’une « orthopédie », disait Miguel de Unamuno. Regardez maintenant les animaux, les végétaux – et constatez leur autonomie. Eux vivent de ce que commande leur survie biologique. Pour le reste, nul besoin de lois, d’écoles, d’académies, de règlements. Pas besoin de représentations – la pie qui marche là dans mon jardin n’a pas écrit ni lu À la recherche du temps perdu. S’en porte-t-elle plus mal ?
J’en viens à l’art et avant lui, en amont, à l’artiste, au créateur culturel au sens large du terme – l’écrivain, le plasticien, le musicien, le dramaturge… indifféremment. Des créateurs de représentations. Ces individus ne peuvent supporter de vivre le monde tel qu’il est et survivent uniquement de le reformuler, d’en modifier la substance par le biais de leurs œuvres, en y ajoutant quelque chose.
Le signe de l’inadaptation majeure. L’art m’intéresse pour cette raison d’abord, comme aveu de l’impossibilité de vivre le réel. Comme faiblesse. Comme pauvreté. Comme stratégie de survie et fabrique de la possibilité de vivre. L’artiste est par excellence l’inadapté, pas dans un sens romantique (l’incompris, le voyant, etc.) mais bel et bien d’abord celui qui doit créer ses représentations pour pouvoir vivre. Cette inadaptation a cette qualité, vous le savez bien, vous qui êtes poète : elle génère le métamonde de l’art, des productions a priori sans productivité mais qui ont ce pouvoir inespéré de nous soulever, de nous valoir un possible accès au sublime. L’art est une formule de transit entre la faillibilité humaine et le pouvoir de générer l’absolu esthétique. La pie de mon jardin n’aura jamais pleuré à l’écoute de la mort d’Isolde mise en musique par Richard Wagner ? Moi si, et je ne m’en plains pas, au bout du compte. Nos mondes cohabitent sans se concilier, avec leurs tactiques de vie respectives.
Le Matin d’Algérie : Le monde va à toute vitesse, l’intelligence artificielle fait peur lorsqu’elle crée des œuvres d’art, elle se nourrit pourtant de l’intelligence humaine, est-ce seulement la peur de nous-mêmes ?
Paul Ardenne : L’IA est un outil, en tout et pour tout. Un outil de plus dans la longue liste des outils dont l’humanité s’est dotée depuis Néandertal et sans doute avant celui-ci déjà. Vitruve le maçon-architecte, en son temps, dessine le plan de ses bâtiments à la main, sur la pierre, quand l’architecte d’aujourd’hui utilise pour ce faire un logiciel génératif appliqué à la conception architecturale : simple logique du progrès technique, dont la finalité générique est d’améliorer la faisabilité, tous domaines confondus. Le « GAN Art », l’art généré par l’IA, qui a déjà une bonne dizaine d’années d’existence, est un outil au service des artistes… ou pas, s’agissant de ceux qui préfèrent refuser cet outil. L’important, en l’occurrence, est moins l’outil que les mobiles qui font qu’on l’utilise ou le résultat que l’on vise en y recourant.
Que les IA fabriquent des œuvres d’art de manière de plus en plus autonome, pourquoi pas ? Aucune raison de s’en inquiéter. Cela n’empêchera en aucune manière l’amoureux du fusain ou le musicien de dessiner ou de composer à l’ancienne. Quant à l’amateur d’art, il fera son choix dans une offre élargie. Il ne faut pas craindre cette concurrence, qui d’ailleurs n’en est pas une. Une démultiplication de l’offre et des opportunités créatives, plutôt.
Le Matin d’Algérie : L’Art évolue, l’art urbain, l’art contextuel, ou sommes-nous encore à la définition des concepts ?
Paul Ardenne : Nous avons élargi la gamme des concepts d’« art » et il faut espérer que cela ne cessera pas – parce que c’est là, somme toute, un signe de vitalité symbolique. La modernité a intronisé le principe de la rupture, le culte du nouveau, l’amour de la variation. S’en déduit une culture de l’instabilité des signes, avec toujours plus de conflits, de différences, de porosité, jusqu’à cette « culture de la prospérité virale » sur laquelle j’écrivais il y a trente ans, dans les années 1990, au moment de son surgissement, à l’heure de l’affirmation « postmoderne » de notre civilisation – le fait qu’en tendance, l’on verse aux combinatoires culturelles, au mix, aux métissages esthétiques parfois les plus inattendus… Ce qui n’empêche pas les cultures plus conventionnelles de perdurer en parallèle, ce qui est une donnée au demeurant normale : chacun sa chapelle, ses chapelles, selon l’humeur et le contexte.
Si nous avons atteint ce jour, à force d’émancipation, l’âge démocratique de l’art, alors il est normal que l’art prenne du point de vue pratique comme esthétique une multitude de formes, de voies, jusqu’à brouiller la définition même de ce qu’est l’« art ». L’art urbain ou encore l’art dit « en contexte réel » (celui qui se fait en corrélation avec des réalités précises, pour les mettre en perspective) ne sont à cette entrée qu’une partie de la production artistique.
L’expansion et la dissémination de la création artistique (toujours plus d’œuvres, en tous genres) sont à la fois un signe d’accomplissement (on donne au monde sa foultitude de représentations) et de désarroi (on ne sait plus au juste quelle représentation du monde doit prévaloir). L’espoir conjugué au désespoir : l’art me dit qui je suis mais tout compte fait, le dit-il vraiment ?
Le Matin d’Algérie : La connaissance de l’histoire de l’Art et l’art en particulier peuvent-ils aider à l’émergence d’une nouvelle conscience ?
Paul Ardenne : C’est indéniable. L’homme est un être de représentations, un Narcisse singulier qui se regarde et tout en se regardant, qui choisit la manière qui lui semble la meilleure de s’esthétiser. L’art est un dispositif spéculaire, son effet est l’effet-miroir : je me posture dans l’œuvre d’art, avec elle, je me jauge par rapport à elle, au musée, au concert, dans mon salon lorsque je lis Le Bruit et la Fureur de Faulkner. Cette œuvre-là parte-t-elle de moi, m’identifie-t-elle, fabrique-t-elle en moi de l’émotion, donc de la vie mise en mouvement ? Plutôt que d’émergence d’une nouvelle conscience, je parlerais plus volontiers d’états de conscience. Le contact avec l’œuvre d’art, s’il agit, génère une friction vibrante, qui émoustille, qui rompt le barrage de la stabilité mentale – un temps ou plus longtemps, selon l’œuvre, selon l’effet qu’elle produit sur nous, passager ici, durable là. L’ami(e) de la vie comme mouvement adhère.
Le Matin d’Algérie : On ne peut parler d’art sans évoquer la liberté, le monde se radicalise, se refroidit, la France des Lumières a failli tomber dans le gouffre de l’extrême-droite, comment sommes-nous arrivés là ?
Paul Ardenne : De multiples hypothèses, sur ce point, sont recevables : le trop de mouvement et trop vite, la perte des références symboliques, la peur de l’autre (l’immigré, africain notamment), la défiance religieuse (à l’égard de l’islam, en France notamment), la réalité belliqueuse actuelle (Ukraine, 7 Octobre-Gaza, violences intercommunautaires ou religieuses d’Afrique sahélienne, équatoriale et de l’est…).
La forte poussée du conservatisme enregistrée en Europe ces dernières années (mais aussi en Argentine comme aux États-Unis avec les partisans de Donald Trump) résulte à cet égard d’un sentiment très fort de perte d’identité, et de repères. Au mouvement démocratique qui prône l’ouverture s’oppose un mouvement réactionnaire qui aspire à un retour en arrière, à la ressaisie de « valeurs » que ce populisme va considérant comme perdues ou en danger de disparition telles que l’autorité, la morale, le mérite ou encore le contrôle étatique des corps. L’historien, sur ce point, nous rappellerait qu’il n’y a rien de nouveau à ces fièvres régressives et que l’histoire en est pleine, à commencer par l’histoire de France (la révolution puis la contre-révolution, la république bourgeoise contre la Commune, Pétain et Vichy contre le Front populaire, etc.). Ce qu’il convient d’entériner, pour la circonstance, c’est le caractère labile du « politique », l’impossible accès à la stabilité. C’est toute l’histoire de l’être humain, au fond, celle du conflit perpétuel – avec lui-même, avec autrui.
Le Matin d’Algérie : La pensée libre est sans cesse menacée et, avec elle, l’expression artistique, la loi des marchés semble s’imposer, la connaissance de l’histoire peut-elle nous éclairer afin de sortir de la nuit ?
Paul Ardenne : Je crains que non. L’histoire, qui indexe la réalité du monde passé, témoigne pour l’heure d’une réalité décidément problématique, plus tendue en tout cas que portée à la concorde interhumaine. Cette histoire rend compte de distorsions continuées que nous n’avons pas jusqu’à présent su surmonter, rien n’indiquant au surplus que l’on puisse les surmonter sous peu. Je songe notamment à l’inégalité matérielle globale, au contrôle économique aux mains de quelques-uns (les « marchés » dont vous parlez à juste titre) et à l’hypocrisie des États dominants en matière de lutte environnementale.
Sans oublier la permanence de ces pratiques de pouvoir ambigües utilisant la culture comme vecteur : l’entertainment, la propagande de type Soft Power, sur fond d’affermissement du « culturel » (le spectacle) contre la « culture » (la réflexion). Le signe, pour le moins, que les âmes de bonne volonté ont encore du pain sur la planche si l’enjeu est de rendre notre monde vertueux. L’éthique, aujourd’hui, est une grande souffrante, elle se voit maximalement mise à mal.
Le Matin d’Algérie : Quelles sont vos influences dans le domaine de l’art ?
Paul Ardenne : Je parlerai à titre de romancier, si vous le voulez bien – à titre de « créateur », donc. Longtemps, je me suis réglé sur la littérature « de fond », Dostoïevski, Proust, Beckett, Canetti…, jusqu’à ce que je renonce à écrire de la fiction, pendant une longue période. Au juste, je n’avais rien à dire, je voulais exister en tant qu’auteur et rien de plus. Un comportement narcissique, pitoyable. Marx a raison quand il prétend, dans L’Idéologie allemande, que les artistes sont avant tout des produits de leur époque, des répétiteurs de la grande Parole collective, celle aujourd’hui que fabriquent les médias de masse et que relaient pour l’essentiel servilement les réseaux sociaux.
Puis j’ai changé mon fusil d’épaule, pour des raisons qui restent obscures pour moi. Je me suis remis à « fictionner » mais selon un principe simple : ne jamais écrire pour produire (deux ans peuvent passer sans que j’écrive une seule ligne de fiction) et n’écrire qu’à partir d’impulsions incompréhensibles.
Une phrase ou une simple formule énigmatique que je trouve dans ma tête le matin, au réveil, au tomber d’un rêve, en l’occurrence. Comment je suis oiseau. Roger-Pris-dans-la-Terre. La Face radieuse de Marie saintes. L’Ami du bien. Juste ces phrases-là. Puis je développe, ou pas. Je n’ai rien de très intéressant à raconter, au fond. Écrire est pour moi, à la fois, un passe-temps et une thérapie introspective.
Le Matin d’Algérie : Albert Einstein disait « C’est l’art suprême de l’enseignant d’éveiller la joie dans l’expression créative et la connaissance », qu’en pense l’enseignant ?
Paul Ardenne : Qu’Albert Einstein a raison, même si le but n’est pas toujours atteint ! Entre les multiples phalanges des humains, les enseignants sont pour moi les êtres les plus précieux et nécessaires qui soient – à condition qu’ils ne fassent pas idéologues ou démagogues, ce qui advient fréquemment (l’enseignant est aussi un individu, avec son histoire, ses convictions propres).
L’éducation, si elle sait être sage, informée, rationnelle et respectueuse, est une des voies du salut social, et les enseignants, les héros de la société ouverte et mature, contre ses ennemis. Je révère ceux qui aident, qui servent, qui ont pris l’option du Care avec la claire conscience que répliquer à la fragilité pour en amoindrir le domaine est le plus grand engagement humain possible. À cet égard, j’ai raté ma vie. C’est aide-soignant que j’aurais dû être, pour servir.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Paul Ardenne : Je publie cet automne Redux, le récit administratif de la vie d’une communauté d’écologistes radicaux, installés dans l’ouest français durant les années 2010, dont le désir a été de créer un nouveau mode de vie fondé, si l’on résume, sur l’anthropophobie, la haine de l’humain. La quête de ces « Redux », ceux littéralement qui « reviennent » (à l’essentiel ?) : être humain en cessant d’être des humains. Et j’ouvrirai en février prochain, à Marseille (Friche de la Belle de Mai), l’exposition collective « Âmes vertes. Quand l’art affronte l’anthropocène », consacrée aux nouvelles configurations de l’art dit « écologique ». Une création essentielle, en accord avec le principal combat à mener dare-dare et sans fléchir, le combat contre le réchauffement climatique pourvoyeur des désastres actuels que l’on sait, de la hausse folle des températures aux migrations de la misère en passant par les mégafeux et les variations accélérées du niveau des mers, aux effets côtiers destructeurs.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Paul Ardenne : Oui, tous mes remerciements d’abord pour cet entretien, et pour le travail que vous a coûté sa préparation. Et puis, un mot pour mes amis Algériens, arabes comme kabyles. Peuples de France et d’Algérie, essayons de trouver enfin la voie de l’apaisement. Plus de soixante ans ont passé depuis les Accords d’Évian, retrouvons la voie de l’amitié, de la coopération, des échanges. N’oublions pas la violence des combats et l’injustice coloniale, jamais. Respectons nos morts réciproques s’ils n’ont pas été des monstres et des tortionnaires. Et avançons, main dans la main, en solidarité.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Dimanche 28 juillet 2024
lematindalgerie.com
……………………………………………………………………………………..
/image%2F1720502%2F20240725%2Fob_675a7f_450336010-550842467268539-575601277087.png)
Crédit photo : Catherine Poulain
Alexis Denuy : « Perpétuer l’esprit français »
Alexis Denuy est un écrivain, poète, artiste-peintre, qui est le moins que l’on puisse dire, d’une originalité frappante tant il ne fait qu’un avec son art. Ses créations artistiques sont lumineuses de vérité dans une époque où l’ombre l’emporte sur la lumière
C’est un personnage qu’on croirait sorti d’une autre époque, d’un autre espace-temps, s’il paraît en marge c’est pour bousculer et s’extirper des sentiers battus où s’enlisent la plupart pour des raisons multiples, souvent par compromissions et avidités.
On pourrait dire qu’Alexis Denuy croit à la rédemption par l’Art. L’humain, si souvent perverti par les illusions et les fausses lumières du monde, peut devenir meilleur en retirant les masques et les armures pour permettre au soi de se libérer, de se révéler, pour écarter les voiles du mensonge et mieux voir.
Il est cet artiste infatigable qui croit en l’humain qui continue son chemin tel un Don Quichotte combattant avec le verbe et la plume. D’expositions en lectures, Alexis Denuy a aussi beaucoup publié passant de la poésie au récit, au roman avec une facilité déconcertante.
Ses créations ont toutes en commun ce souffle jaillissant plein de vie qui met des couleurs hors des miroirs, libérant des espoirs.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes artiste peintre, poète, écrivain, rempli de talent, qui est Alexis Denuy ?
Alexis Denuy : J’ai toujours été dominé par l’envie irrépressible de créer. Je dessinais et écrivais déjà depuis l’âge de 10 ans, à l’époque j’habitais à Conflans Ste Honorine dans les Yvelines, en région parisienne, fabriquant des petits magazines peints à la gouache et à l’encre de chine et écrits à la main que je vendais autour de moi. J’ai ensuite imprimé ce magazine et l’ai distribué dans les maisons de la presse et les librairies. J’ai toujours été préoccupé de donner à voir mon travail et pas seulement de le fabriquer, j’ai toujours considéré l’Art également comme une communication, j’ai toujours pensé en même temps la création et sa diffusion. Plus tard, toujours passionné d’image, de graphisme et de peinture, avec également toujours chevillée au corps une passion restée intacte de lecteur, lisant tout ce que je pouvais trouver sous la main. Ensuite j’ai eu plusieurs ateliers, d’abord à Angers puis à Barcelone et enfin à Paris, tout en publiant aux Editions spéciales mes premiers livres « Prends ça » en 1994, « Les protestes » en 2009, « Existe » en 2010 avant de sortir « Propos en liberté » en 2022 chez Unicité. Comme je pratique à la fois l’écriture et la peinture j’ai plusieurs carrières en parallèle.
Le Matin d’Algérie : Vos créations sont saisissantes, resplendissantes de vérité, hors des moules imposés et des sentiers battus, quel est votre secret ?
Alexis Denuy : J’approfondis chaque sujet et ne me laisse pas entrainer sur la voie du stéréotype, je n’accepte pas d’être dupe, dupé, et mon esprit critique est toujours en alerte donc je ne peux tout simplement pas glisser dans la facilité car immédiatement une lumière rouge s’allumerait si j’allais du mauvais côté. J’ai avant tout une exigence de vérité, c’est ce qui guide mon esprit et je suis toujours en quête de savoir, savoir plus, savoir mieux, me positionner dans le bon angle, comme un tireur d’élite pour viser la bonne cible et ne pas récolter que son ombre. Et je ne peux, ni ne veux, ni n’accepte de me taire.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un rêveur mais lucide, vos livres éclairent mais aussi mettent en garde contre la paresse de l’esprit, il faut être vigilant et attentif pour ne pas sombrer, l’Art est-il salvateur d’après vous ?
Alexis Denuy : L’Art est pour moi tout à fait nécessaire, j’ai besoin de créer et de regarder ce que les autres créent, cela fait partie de moi, de mes besoins élémentaires, comme le pain et l’eau, c’est le tout de ma vie. Je ne suis pas dans le consensus, je regarde le monde bien dans les yeux sans hésiter à gifler mon esprit et ma réalité pour sortir de l’hypnose et en écriture particulièrement je mets à nu le langage, je l’ouvre pour mettre en évidence l’hypocrisie à travers la trame du quotidien, je veux toucher au cœur par la puissance du rythme. Je cherche à comprendre comment fonctionnent les choses. Si j’étais né ailleurs j’aurais été autre mais je ne suis pas de nulle part et je me dois de perpétuer l’héritage de la maison France, sa logique, sa clarté, sa légende, son exemple, l’esprit français.
Le Matin d’Algérie : Votre livre « Propos en liberté », paru aux Éditions Unicité, c’est tout un macrocosme bravant l’espace-temps où vous mélangez admirablement les genres, le roman, le récit, le théâtre, où on sent l’homme de théâtre habitué à la rhétorique, mais ici, c’est pour magnifier des propos vrais, est-ce pour troubler le lecteur afin d’accaparer encore plus son attention sur des thèmes abordés qui touchent tout le monde ?
Alexis Denuy : Je compose mes figures et leurs différentes facettes comme des couleurs sur une palette afin de donner plus de relief à mes propositions, pour moi l’expression est tout. En France, la liberté d’expression n’est pas totale, au contraire des U.S.A. et je suis pour une liberté d’expression totale depuis toujours, sans laisser aucun sujet de côté, par volonté farouche de franchise, peut-être un reflet de ma part maternelle protestante. En effet, une de mes aïeules, Marie Durand, fut enfermée à la tour de constance pendant la guerre de religion, sa captivité a duré 38 ans parce qu’elle restait fidèle a sa foi, elle a gravé avec ses doigts dans la pierre sur la margelle du puits de la prison l’inscription « RESISTER ».
J’ai la même détermination de liberté totale d’expression de toutes les idées, opinions, croyances, quelles qu’elles soient, dans la logique du vrai débat, sans censure ni autocensure. Je veux toucher les gens et j’utilise tous les registres d’écriture pour se faire comme un personnage de la commedia dell’arte. On manque moins de récit que de force c’est cette vitalité que je veux transmettre, physiquement, par mes mots, au lecteur. C’est un transfert d’énergie, je propose un contre discours au discours dominant, discours de domination utile au maintien du statu quo, je propose une parole d’émancipation et je fais en sorte que mon discours ait une consistance matérielle suffisante pour que le lecteur y trouve la force de se recommencer, de se remettre en question. Les mots sont importants, comment on vit, comment on se raconte, ont une existence aussi forte que les faits, qui peuvent toujours d’ailleurs être remarqués sous plusieurs angles, ma langue parle de la toxicité qu’on nous impose partout. Je propose un contrepoison.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur Paul Ardenne qui a préfacé votre livre, « Propos en liberté »
Alexis Denuy : C’est très important d’être soutenu dans sa démarche, je pense que le mot liberté dans mon titre lui a parlé c’est pour lui il me semble la notion la plus importante avec celle de responsabilité. Paul Ardenne est quelqu’un qui n’est pas dans l’acquiescement, l’accommodement sans examen, bien qu’occupant un rôle dans la transmission du savoir par ses recherches dans le monde de l’art, du marché de l’art, de la nature, du sacré, de la prospective scientifique, du corps humain et de ses transformations. Il aime citer La Boétie le discours de la servitude volontaire.
Il garde et c’est central son libre arbitre, toujours parfaitement articulé et suffisamment de fluidité pour ne jamais prendre les choses pour acquises, c’est extrêmement rare et précieux. Il est toujours ouvert même à ce qu’il ne représente pas lui-même mais qui lui semble enrichir le débat, c’est un peu Voltaire « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous puissiez l’exprimer ».
Dans son livre « Heureux les créateurs ? artistes, encore un effort » Paul Ardenne prouve qu’il peut remettre son propre statut en cause ce qui montre sa rectitude « La bonne norme serait que l’artiste ait le pouvoir, et non d’abord ceux qui gravitent autour de lui. L’artiste contemporain n’a que des amis : critiques d’art, commissaires d’exposition, marchands, collectionneurs – tout ce beau monde le requiert, efficace et conciliant.
Chacun de ces acteurs, dans le « système » de l’art, a sa place. Certains orientent le goût quand d’autres le construisent, le consacrent, le monnayent ou le confisquent à leur profit (…) Quel constat la période récente impose-t-elle ? Ceux qui gravitent autour de la création artistique ont sans doute pris trop d’ascendant sur celle-ci. Et acquis à la fin trop de pouvoir, à commencer par la détention de l’espace critique (revues, médias), de l’espace d’exposition (lieux d’art contemporain, biennales), de l’espace institutionnel (aide à la création, résidences d’artistes, commande publique), de l’espace matériel enfin (galeries, collectionneurs).
L’artiste n’est plus le seul à avancer ses options, sa matière grise et son offre plastique. Le voici devenu non plus un décideur mais un outil. ».
Il me semble que cette parole de Paul Ardenne, assez rare dans le milieu artistique, surtout quand on en fait partie, sans être partisan de leur fonctionnement en l’occurrence, est assez forte et digne d’être méditée.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les artistes, écrivains et poètes qui vous influencent ?
Alexis Denuy : D’abord les contes, c’est ce qui vient en premier, ma mère me lisait les contes de Grimm, d’Andersen, qui, de par leur magie, donnent à l’enfant qu’ils imprègnent l’espoir de déchirer le voile, l’impression de traverser la rive entre réel et imaginaire et de pouvoir, lui aussi, réaliser ses souhaits.
Au cinéma, j’ai retrouvé la même sensation de pouvoir donner vie à ses rêves dans le film Mary Poppins de Walt Disney d’après le livre de Pamela L. Travers., enfant j’adorais les contes mettant en scène des vœux qu’on peut réaliser comme les contes de Grimm « La table enchantée » ainsi que « Le vaillant petit tailleur », autrement nommé « Sept d’un coup », qui présente un personnage astucieux sachant se sortir des mauvais pas, également « Le chat botté » et « Le petit poucet » de Charles Perrault. Adolescent, j’ai dévoré « Le pays où l’on n’arrive jamais » d’André Dhôtel ainsi que « le grand Meaulnes » d’Alain Fournier, tous les deux dans le même registre du merveilleux de l’enfance.
Aujourd’hui, j’aime lire des entretiens d’auteurs, de personnalités ou d’anonymes, je raffole des anecdotes qui m’éclairent sur la psychologie humaine ainsi que les faits divers des journaux qui sont souvent comme des contes d’une façon différente. Comme littérature orale, j’aime les conversations de bistrot, je l’ai évoqué dans mon livre « Les protestes », j’en fait des notes, sortes de croquis que j’intègre à mes analyses sur la société, j’aime également chiner des livres dans les brocantes, on y découvre des curiosités constamment.
En littérature, je citerais trois phrases de mes trois principales références : Rimbaud « j’ai de mes ancêtres gaulois l’œil bleu-blanc », Brecht « Celui qui connaissant la vérité la nomme mensonge est un criminel », Artaud « Pensez de moi ce que vous voudrez ».
Le Matin d’Algérie : Un mot sur Catherine Poulain et le collectif NAO ?
Alexis Denuy : Catherine Poulain et moi formons un duo punk-banlieusard de superhéros qui s’est exprimé dans nos performances en commun, deux gavroches, tenaces et teigneux, tous droits sortis de Victor Hugo qui font face à la mitraille sur la barricade et résistent au système en préparant la pierre pour la lancer dans son troisième œil.
Nous avons tous deux le même esprit de résistance face au pouvoir établi, nous ne nous en laissons pas conter et nous nous redressons, malgré les attaques nombreuses que nous avons subi lors du développement de notre travail, avec toujours la volonté de faire mieux et de ne pas se laisser endormir par les hommes heureux, les hommes peureux.
Avec Catherine nous avons fondé Now Artists Outsiders, N.A.O., un collectif artistique, avec la volonté de constituer un corpus qui s’est exprimé par des performances, des vidéos, des expositions ainsi que la publication d’un manifeste dans la revue d’Art contemporain canadienne Inter. Nous avons eu la reconnaissance de Paul Ardenne qui nous a inclus dans sa catégorie d’« Art contextuel », en l’occurrence pour les performances-actions, produites en manifestations, lors du mouvement des gilets jaunes, ce qui a permis d’offrir une représentation artistique à ceux que l’on n’écoute pas.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et avenir ?
Alexis Denuy : J’ai des projets sur le long terme en peinture et en écriture, ce sont pour moi comme des courant porteurs, il faut atteindre une certaine fluidité, c’est un travail au jour le jour. Il faut aussi prendre le temps de l’Art, qui est le temps du recul, comme depuis l’en-deçà, des voix appellent le vivant incarné, lui souffle l’inspiration et lui indique le chemin. Je ressens cela comme un disparu qui viendrait en moi me raconter ce qu’il a vu là-haut, nous sommes obligés, si nous avons une bonne boussole intérieure, de véhiculer ce message essentiel aux vivants et ainsi certainement apportons nous notre pierre à l’édifice de l’humanité.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Alexis Denuy : Il y aura toujours un dernier mot, la mort clos notre œuvre, arrête notre écriture comme on souffle une bougie. Nous sommes déjà dans une époque de spectres et le faux se constate partout, nous sommes pris dans ses plis. La farce est l’impératrice de l’époque, elle nous domine de sa puissance impériale et universelle, nous ne sommes plus que les reflets de ses simulacres, parfois on sort la tête de son marais mais la période est écrasée par le poids de son autorité.
Le mensonge règne et veut régner. Ce pouvoir est une mystification qui prétend être la vérité et au nom de ce statut absolu, autoréférencé et suprême, ce gouvernement global de la supercherie s’arroge le droit de censurer toute contestation de son droit tyrannique, or il y a le légitime et il y a le légal et quand la loi est illégitime elle n’a plus aucune crédibilité à administrer. Les menteurs et les adorateurs du culte du mensonge font les lois pour les hommes mais ne possèdent pas et ne posséderont jamais la légitimité de l’esprit.
Pour vos lecteurs du Matin d’Algérie, je leur souhaite d’être vrais, en relation avec leur authentique personnalité, loin des mots d’ordres. Il est important et même indispensable de rester en contact avec la nature et l’Art et de vibrer haut pour pouvoir se réaliser.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Mercredi 24 juillet 2024
lematindalgerie.com
…………………………………………………….

Crédit photo : Gilles Reboisson
Catherine Poulain : « Réinventer la beauté abîmée »
Artiste contemporaine, peintre, photographe, réalisatrice, écrivain, Catherine Poulain est une artistique accomplie, dont la création artistique bouillonne dans toute sa diversité, des genres et des couleurs.
Catherine Poulain est née à Paris, elle ne cesse d’arpenter les rues, passionnée par l’Art Urbain, vivant presque un rêve éveillé, celui de faire de la rue une galerie à ciel ouvert, laissant des traces bravant le temps, mettant des couleurs là où certains murs vieillissants délabrés oubliés comme pour leur donner un nouveau souffle, une nouvelle vie.
Sa passion pour le dessin et la peinture se révèle dès l’enfance, puis vient l’écriture dès l’âge de 13 ans où son amour pour les textes et la poésie s’accentue et s’approfondit, puis à 21ans, l’élan créateur la pousse vers la photographie.
Après un BTS (Brevet de technicien supérieur) en architecture intérieure et photographie, elle devient décoratrice de spectacles vivants sur de nombreuses productions, notamment à l’Opéra national de Paris, sur des spectacles du metteur en scène Robert Wilson et du chorégraphe Josef Nadj, Il n’y a plus de firmament, qui feront le tour du monde.
Catherine Poulain a également été scénographe de théâtre auprès d’une dizaine de compagnies de théâtre musical et de théâtre contemporain, sur des textes de Beckett, Shakespeare, Brecht, puis a travaillé dans l’équipe de décoration de longs métrages de cinéma, dont, Le Pacte des Loups, de Christophe Gans et, Les Enfants du Siècle, de Diane Kurys, puis se plonge de nouveau dans la sculpture, la peinture, la photographie, la performance, progressivement en artiste indépendante et engagée.
Catherine Poulain fait parallèlement des lectures dans des librairies, théâtres et bars restaurants. Les thèmes de la lutte, de la liberté, de l’espoir, de la fraternité, de l’amour, jaillissent de ses créations comme un phare guidant à travers les récifs dans une époque déchirée par l’illusion, le superflu, et le paraître.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes une artiste éclectique, on peut même dire que vous magnifiez les genres, qui est Catherine Poulain ?
Catherine Poulain : Je suis d’un tempérament à explorer, à aller au fond des sujets, à rencontrer des gens passionnés dans tous les milieux. À travers les voyages et les lectures, j’ai beaucoup appris. J’ai toujours eu le désir de me dépasser avec audace, de faire évoluer positivement la société et c’est dans l’action que je me sens vivante. Après les épreuves et la vie citadine trépidante, l’écriture et la création artistique est une continuité naturelle et un refuge où j’ai plaisir à me retrouver au calme. J’aspire dans le silence de la solitude à transcender les émotions bouillonnantes vers la dimension spirituelle.
Le Matin d’Algérie : Vous passez aisément d’un art à un autre, comment faites-vous ?
Catherine Poulain : Ayant plusieurs cordes à mon arc, si un évènement, une rencontre m’inspire, j’écris, photographie, filme ou dessine. C’est dans le mouvement ou dans le rêve que je trouve l’intuition créatrice. Cela forme un stock, des idées, de la matière, dans lequel je puise par la suite pour imaginer un projet à construire, en cherchant comment et avec quel soutien le développer. Selon les ouvertures trouvées, je passe d’un art à un autre. Avec l’énergie et les moyens dont je dispose, jamais je ne m’ennuie.
Le Matin d’Algérie : Paul Ardenne, historien d’Art contemporain, vous situe dans le courant de l’Art contextuel, qu’en pensez-vous ?
Catherine Poulain : Heureusement, Paul Ardenne a remarqué notre travail à la suite d’actions performances que nous avons réalisées avec Alexis Denuy dans l’espace public en tant que Collectif NAO. Paul Ardenne est reconnu dans l’Art contemporain et écrivain, une confiance renouvelée par plusieurs rencontres, lui a permis de trouver les mots appropriés pour situer et définir notre démarche empirique dans l’Art contemporain. Cela donne du crédit à notre travail, ancré dans le réel, engagé, en lien avec les actualités, aux luttes pour un meilleur avenir, en situation d’intervention et de participation, en conséquence dans le courant de l’Art contextuel.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes une artiste engagée, l’engagement jaillit de vos œuvres, l’art n’est-il pas déjà un engagement en soi ?
Catherine Poulain : Il faut beaucoup de persévérance pour émerger dans le monde de l’art, se battre pour obtenir ce que l’on veut. Réinventer la beauté abîmée est un enjeu important pour moi, réparer les blessures. Le faire en groupe, j’ai eu l’occasion de l’expérimenter dans l’engagement bien sûr. C’est en travaillant dans des milieux chaotiques au milieu de personnes instables et imprévisibles que j’ai dû me forger une posture solide et que j’ai dû me fixer des objectifs pour évoluer en les entraînant vers la recherche de solutions aux problèmes et l’amélioration de conditions de vie. On perçoit ma volonté et ma ténacité dans mon écriture sans aucun doute. L’art passe en effet par l’engagement, subtilement par les messages à décrypter au second degré.
Le Matin d’Algérie : L’art urbain est-il pour vous l’expression d’une liberté à portée de tous ?
Catherine Poulain : Faire partie du paysage urbain, interpeller les passants par un visuel, poser sa marque au détour de rues pittoresques, choisir son emplacement, c’est modifier un peu le regard sur la ville, la rendre plus poétique. C’est un mode d’expression qui comporte aussi le risque de vivre des situations compliquées et repréhensibles. Après la chute du mur de Berlin, je suis allée à Prague, Berlin et Barcelone, y poser mes mots et pochoirs, où l’esprit de liberté flotte comme un étendard, alors en vogue et autorisé à certains endroits dès 1989. C’est le dépassement de la norme et la révolte qui m’ont motivé. Puis en voyant les pochoirs de Miss Tic à Paris, cela m’a encouragé à me faire connaitre du grand public à travers l’art urbain. Cette pratique est démocratique car ne nécessite pas d’atelier coûteux dont l’artiste parisien est souvent privé. À l’avenir, je souhaiterai peindre de grands murs en hauteur avec une nacelle, grâce à des commandes ou cartes blanches.
Le Matin d’Algérie : Vous venez de publier « Recueil de craie », qui est bouleversant par des poèmes criant de vérité portant l’émotion à son paroxysme, le lecteur les yeux humides retient les larmes le cœur en pleurs attendant des bonheurs, votre poésie est déchirante mais laisse apparaitre des éclaircies d’espoirs, vous semblez habitée par la muse, est-ce vrai ?
Catherine Poulain : C’est le dépassement de la norme et la révolte qui m’ont motivé. Mon premier livre « Recueil de craie » est un objectif que j’ai accompli après avoir dû quitter Paris, ce que j’ai vécu comme un exil de ma ville natale aimée. Après multiples déceptions, c’est en relisant mon journal intime commencé à l’adolescence que j’ai pris conscience qu’il comprenait des textes poétiques intenses des années 80 à 2010, méritant d’être sélectionnés et publiés dès maintenant. Il est disponible en librairies.
Je pensais que lorsque je serai âgée et malvoyante, j’écrirais des livres, qu’auparavant il faut utiliser ses yeux pour créer et se mouvoir. Puis un jour, le déclic est venu, j’ai compilé mes textes les plus émouvants et écrit de nouveaux pour en faire mon livre. J’ai choisi ce titre dans le vœu de recréer la beauté abîmée, en pensant à l’abîme de souffrance ressentie dans le passé et à la force que j’ai dû déployer pour surmonter les obstacles. Mon but étant de donner au lecteur de l’espoir et le goût de vivre.
Après un atelier d’écriture avec Catherine Bédarida, j’ai pu faire aboutir ce recueil avec l’écoute d’autres femmes bienveillantes, à en tirer le fil. L’idée étant de laisser la trace de moments éphémères comme la craie, où une lueur d’espoir apparaît, en apportant une perspective à la jeunesse en questionnement. Aux enfants de la terre qui ne sont pas nés dans l’opulence ou à ceux qui malgré une situation paraissant confortable ont été maltraités insidieusement.
J’ai côtoyé durant plus de vingt ans, la culture kabyle algérienne donnant de l’importance au cocon familial protégé par la mère transmettant les traditions. Cette douceur et organisation de cette société m’a intéressé car j’ai pu saisir ce que nous avons perdu avec le bouleversement des repères protecteurs. Après mai 68 et les déviances permissives des années 70, l’intimité de la femme et des hommes a été malmenée. Avec parallèlement malgré tout une avancée au niveau des droits vers plus d’indépendance.
La banalisation de l’exhibition et de la pornographie avec une nudité agressive dans la publicité et utilisant le corps de la femme pour vendre des objets a été destructrice pour l’harmonie des relations entre hommes et femmes. Une forme d’art en est le reflet où l’âme est absente, le corps abîmé et robotisé prédominant, c’est à l’opposé de ma recherche. En banlieue, le choc des cultures a été d’autant plus grand avec la mixité organisée, rencontrant incompréhensions et violence des rapports humains avec malgré tout des collaborations et échanges intéressants. J’ai perçu la violence des cités dans l’expérience de Samira Bellil, liée à la problématique de l’immigration. La politique mondiale globalisante déplaçant ou éliminant les populations natives aboutit à des tragédies et guerres fratricides insoutenables dans le monde entier.
À travers l’écriture, en contraste, je valorise les sentiments, la beauté, l’harmonie, le discernement, l’intelligence à chérir. Sortir des rapports de possession et de consommation, retrouver la confiance et la fierté d’être qui on est. Arrêter la culpabilisation perpétuelle de soi-même ou d’autrui. Stopper l’exploitation de la misère. En rimes, en prose ou en haïkus, en anglais, allemand ou italien, j’écris dans ce recueil sous différents angles.
L’inspiration vient lorsque je suis connectée à ce qui est d’ordre divin, mystique, non pas dans l’enfermement dans des dogmes religieux, mais dans la foi au sens large, au-delà du reste.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur Alexis Denuy avec qui vous travaillez régulièrement.
Catherine Poulain : J’ai rencontré l’artiste et écrivain Alexis Denuy, il y a une quinzaine d’années. Il est devenu l’ami et complice de certaines de mes créations depuis sept ans, de façon complémentaire. Il a du génie, sait aller à l’essentiel, direct dans l’écriture et dans l’action. Nous avons co-fondé le Collectif Now Artists Outsiders, organisé des évènements, des performances et travaillons sur des textes, vidéos et projets en commun. Nous cherchons sans cesse des espaces de création et de diffusion pour présenter notre travail et parfois d’autres artistes que nous choisissons.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les poètes et les artistes qui vous influencent ?
Catherine Poulain : Les poésies de Prévert, Eluard, Hugo qui ont nourri mon écriture. J’ai aimé l’écriture de Duras, Rilke, Tanizaki. Les textes des chansons d’Higelin, Renaud et Barbara m’ont hanté durant l’adolescence.
Parmi les artistes contemporains, j’ai apprécié l’Abstraction lyrique de Pollock. Dans l’Art urbain, j’ai rencontré Miss Tic, Jérôme Mesnager entre autres. Dans l’Art contextuel, j’ai travaillé avec Fred Forest.
Le Matin d’Algérie : L’art est l’expression de la liberté par excellence, c’est le langage universel unissant le genre humain, peut-il aider à l’émancipation d’une société ?
Catherine Poulain : L’Art fait comprendre ce qui est difficile à expliquer, la liberté peut avoir un caractère universel. L’Art est libre lorsqu’il ne dépend pas de subventions, ni ne répond à une commande. Il peut s’exprimer tant qu’il ne dépasse pas les limites de la vulgarité, de l’atteinte au respect mutuel. Dans une société, ses membres doivent cohabiter le plus harmonieusement possible. L’émancipation a lieu quand les artistes sont indépendants avec leur identité propre. L’émancipation ne doit pas se tromper de cible, relire l’histoire, ne pas écouter les conseils de charlatans. L’Art unit ceux qui sont curieux de se connaître quand l’écoute mutuelle est fluide.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Catherine Poulain : Les projets en cours auxquels je participe chaque année sont la fête des artistes au château de Belleville de Gif sur Yvette en Essonne le premier week-end de juin de chaque année et j’expose à la galerie Le Lavomatik arts urbains à Paris.
Les projets à venir sont une exposition de peinture à la Halle des Blancs Manteaux à Paris le dernier week-end de septembre. Il y a les portes ouvertes de mon atelier à la ZA Vaubesnard de Dourdan, le premier week-end d’octobre et divers projets d’interventions artistiques et l’écriture d’un nouveau livre imagé.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Catherine Poulain : Je remercie Le Matin d’Algérie de m’avoir proposé cet entretien. Vive l’Art et l’écriture qui font voyager !
Entretien réalisé par Brahim Saci
Dimanche 21 juillet 2024
………………………………………………………………………………

Amar Benhamouche : « Un peuple cultivé ne sera jamais dupé ou dépravé »
Amar Benhamouche est natif d’Akbou (Aqbu), une ville et une commune de la wilaya de Béjaïa (Bgayet) dans la vallée de la Soummam. Dans une région célèbre de par son histoire, cette ville est délimitée à l’est par la Soummam, au sud par l’oued Sahel (Asif Ɛebbas) et proche des communes d’Ouzellaguen, d’Amalou, de Bouhamza, d’Ighram, d’Aït R’zine, de Seddouk, de Chellata et de Tazmalt. Autour d’Akbou on trouve l’Azib Benali Chérif, Tifrit, Taharacht et Azaghar.
Amar Benhamouche est psychologue de formation mais c’est la poésie qui l’anime et le passionne. Si cela peut paraître étrange aux non avertis, il n’en est rien en vérité : la psychologie et la poésie se complètent, les deux guérissent par les mots. Comme l’écrivit Confucius : « Trois cents poésies peuvent être résumées en un mot : la pensée pure. »
Dans son article sur la relation entre psychologie analytique et la création poétique-artistique, Carl Gustav Jung considère que la psychologie et la poésie sont étroitement liées.
Amar Benhamouche est un poète militant. Dans un élan d’amour pour cet art majeur que l’époque avec ces médias lourds tend à ignorer, il porte au-devant de la scène cette parole libre aussi vieille que l’humanité. En 2015 il a publié une pièce de théâtre en kabyle, Irus d Tanatus.
Amar Benhamouche est par ailleurs le secrétaire général de l’association Apulivre, présidée par Hacene Lefki, avec qui il a lancé en 2022 la première édition du festival de poésie « La Tour Poétique ». Il vient de publier, dans le cadre de la troisième édition de ce festival de poésie, « Poésie : Luttes et combats », un ouvrage préfacé par Rachida Belkacem, aux éditions Milot.
« Poésie : Luttes et combats » est un ouvrage collectif poétique. C’est la rencontre de plusieurs écrivains et poètes de différents pays, Amar Benhamouche, Maggy de Coster, Sarah Mostrel, Pedro Vianna, Kamel Bencheikh, Yasmine Madaoui, Geneviève Guevara, Claire Boitel, Arwa Ben Dhia Rachida Belkacem, Hanen Marouani, Leila Elmahi et Alain Pizerra.
« Poésie : Luttes et combats » est un livre passionnant qui élève et redonne ses lettres de noblesse à la poésie, il est comme une bouffée d’oxygène qui laisse entrevoir un avenir propice où la poésie pourrait reprendre sa place première, sa place d’art majeur.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes psychologue de formation, poète, militant et animateur associatif, qui est Amar Benhamouche ?
Amar Benhamouche : Né en Kabylie dans une modeste famille de paysans. Mon père, un poète et un militant de la cause berbère, m’a initié dès ma tendre enfance à la lutte politique, au combat pour notre notre identité et notre langue berbère et il a accordé un soin particulier à la transmission de l’amour de la lecture.
Diplômé en psychologie clinique (Master II) et d’un autre diplôme en psychologie de l’enfant, je suis auteur de presse, poète, passionné de littérature et féru d’Histoire. Actuellement, je suis le secrétaire général de l’association Apulivre présidée par Hacene Lefki.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes très actif, vous faites des allers-retours entre Rouen où vous vivez et Paris, sans jamais vous plaindre, le visage souriant, est-ce la poésie qui vous donne tant d’énergie ?
Amar Benhamouche : Ce n’est pas seulement la poésie, mais toute cette envie de participer à la promotion de la culture, particulièrement du livre et de la lecture. Il ne faut surtout pas oublier que j’ai eu la chance de naître dans une région très active dans domaine culturel ; du village au collège, du lycée à l’université par la suite. Mes diverses expériences dans le mouvement associatif et le privilège que j’ai eu de rencontrer de grandes personnalités actives dans les domaines politiques et culturels m’ont influencé et ont façonné ma personnalité d’aujourd’hui. Je suis le produit d’une Histoire, et je m’estime heureux d’avoir contribué modestement, à l’aune de mes possibilités et de mes savoirs, à enrichir la scène culturelle contemporaine.
Le Matin d’Algérie : Le célèbre psychiatre et psychologue Carl Gustav Jung a noté le lien étroit qu’il y a entre la psychologie et la poésie, quel est votre avis ?
Amar Benhamouche : Freud fait le parallèle entre le rêve et la littérature. Il qualifie toute production littéraire, dont la poésie bien évidemment, de « rêves éveillés « . En effet, la poésie est une forme de catharsis, une libération de nos douleurs et une expression de nos désirs inconscients réprimés, interdits et refoulés à travers un mécanisme de sublimation.
Dans, Malaise dans la Civilisation, Freud écrit « La sublimation des pulsions est un trait particulièrement saillant du développement de la civilisation, c’est elle qui rend possible que les activités psychiques supérieures, scientifiques, artistiques, idéologiques, jouent un rôle tellement important dans la vie civilisée. »
Ainsi, la poésie peut constituer une thérapie ; individuellement en écrivant et collectivement en la partageant avec les autres.
Le Matin d’Algérie : Il faut du courage et de la ténacité pour s’investir autant autour de la poésie, Parlez-nous du Festival, La Tour Poétique, que vous avez créé.
Amar Benhamouche : Victor Hugo a dit : « Quelques peuples seulement ont une littérature, tous ont une poésie ». La poésie est ce langage universel, cette beauté des mots qui survole les cieux et traverse les frontières pour bâtir des ponts de fraternité et de solidarité entre les peuples.
Paris est une des capitales de la beauté, des arts et de la littérature. La grandeur de la Tour Eiffel, la beauté de Paris, la générosité des parisiens s´ y joignent pour offrir à tous ceux qui la parcourent une balade en vers. D’où le nom du festival « La Tour Poétique « , qui fait référence à la Tour Eiffel.
Cependant les membres de l’association ressentaient fortement le manque d’espaces réservés à la poésie et aux poètes. Ils ont ainsi formulé unanimement l’idée de lancer un festival de poésie. Une année après la création de notre association, nous avons proposé cette idée du festival à la responsable de la MVAC du 15ème arrondissement de Paris (Maison de La Vie Associative et Citoyenne du 15e arrondissement de Paris) Madame M. Thiam, qui a très vite validé la proposition.
Les trois éditions du festival de poésie » La Tour Poétique » organisées par notre association « Apulivre «, en septembre 2022, en juin 2023 et en juin 2024, furent des occasions en or pour rencontrer de belles âmes et de belles plumes. Ces trois éditions nous ont permis de conjuguer le verbe écrire en amour, de composer une ode à la tolérance.
Le Matin d’Algérie : Vous venez de publier un bel ouvrage poétique collectif où vous avez réussi à réunir plusieurs écrivains poétes, comment avez-vous pu rendre possible ce beau projet ?
Amar Benhamouche : À la rentrée littéraire de septembre 2023, nous avons débattu, au sein de l’association, l’idée d’un livre collectif à éditer pour la troisième édition du festival. Sur mon initiative, nous avons conçu la thématique « Poésie, luttes et combats », nous avons alors proposé à des auteurs et des poètes parmi la constellation des auteurs du festival de contribuer. Il restait à trouver une maison d’édition.
Au mois d’octobre 2023, j’ai contacté des poètes qui tous montrèrent un vif intérêt et un grand enthousiasme pour ce projet. Un mois plus tard, les éditions Milot acceptèrent ce projet de livre collectif, sous deux réserves : privilégier le qualitatif sur le quantitatif, et créer préalablement un comité de rédaction et de sélection des textes à publier. Vers le mois d’avril les textes furent sélectionnés par le comité et corrigés. Quelques jours avant le festival, comme un cadeau, le livre a été publié sous ma direction, préfacé par l’auteure et poète franco-marocaine Rachida Belkacem et illustré par le peintre et dessinateur Hamid Aftis, ce projet a abouti en seulement six mois. Le livre se structure en trois parties ; une première contient des textes de réflexion, une deuxième, un hommage au poète français Frédéric Tison qui nous a quittés en décembre 2023, et la dernière partie est réservée aux textes poétiques.
Le livre a été publié quelques jours avant le début de la troisième édition du festival de poésie, La Tour Poétique, qui s’est déroulé à Paris, dans le 15ème arrondissement, du jeudi 13 au samedi 15 juin 2024.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur l’association, Apulivre, dont le titre est tellement évocateur, justement, comment s’est fait le choix de ce titre ?
Amar Benhamouche : L’idée de l’association Apulivre est née sur les falaises d’Étretat où Hancene Lefki, l’actuel président de l’association, m’a proposé l’idée de lancer une association culturelle. J’ai apprécié cette belle idée et nous avons débattu par la suite avec d’autres amis qui nous ont orientés et aidés dans les démarches administratives.
Le choix du nom de l’association n’a rien d’anodin. En effet, c’est un mot-valise qui emboîte d’une part « Apulée » et d’autre part « Livre ». Et ceci en référence à Apulée de Madaure (Mdaourouch), un orateur, écrivain, philosophe médio-platonicien numide, reconnu comme le premier romancier de l’humanité avec son roman « l’Âne d’or » ou « les Métamorphoses ».
Apulée porte la symbolique de ce pont que nous voulons bâtir entre les deux rives, la rive Sud et Nord de la Méditerranée ; un pont de littérature et de culture pour la fraternité entre les peuples.
Le Matin d’Algérie : Quel regard portez-vous sur la production poétique en général et en Algérie en particulier ?
Amar Benhamouche : Malgré le pessimisme qui règne dans les milieux poétiques en France, je pense que la production est prolifique. Nous constatons surtout qu’il y a de plus en plus de jeunes auteurs. Les contacts que notre association a entretenu avec les maisons d’édition et les poètes ont montré que les gens continuent à écouter et lire la poésie et à acheter des recueils. En ce qui concerne la baisse du nombre des lecteurs, je pense qu’il ne concerne pas seulement la poésie mais toute la production littéraire. Petit à petit, l’écran a remplacé le livre.
En ce qui concerne l’Algérie, je n’ai pas assez d’informations et de contacts avec des poètes. Mais je sais que la poésie y est moins présente dans les librairies. En effet, ce sont les réseaux sociaux et quelques festivals de poésie organisés ici et là qui permettent aux poètes de faire connaître leur production poétique.
Le Matin d’Algérie : La poésie peut-elle aider à l’émancipation d’une société ?
Amar Benhamouche : Je pense que la poésie est un outil de lutte. Dans ma contribution in « Poésie : luttes et combats », je mets en exergue l’importance de la poésie dans l’éveil des consciences, dans le monde entier, mais plus particulièrement en Kabylie. En effet, j’y parle du rôle important joué par deux poètes et chanteurs, en l’occurrence Lounis Ait Menguellet et Lounes Matoub, dans la conscientisation et l’accompagnement des masses populaires dans la lutte pour la liberté.
Le Matin d’Algérie : “L’Amour, la poésie, c’est par ce seul ressort que la pensée humaine parviendra à reprendre le large.” Disait l’écrivain poète français André Breton, qu’en pensez-vous ?
Amar Benhamouche : Aujourd’hui, l’expression de la haine s’étend et est même tolérée partout dans le monde. En parallèle, les conflits internationaux, les crises sociales et le climat de guerre endolorissent le rapprochement entre les humains. Hélas ! Rien de bon ne se présage pour ce monde… Mais fort heureusement, la poésie existe pour contrer la haine et dire non à la guerre. Dans les tréfonds de l’âme du poète surgit l’amour et l’expression de la tolérance. La poésie réunit ce que les idéologies nauséabondes séparent. Dans ma poésie on retrouve l’éloge de l’amour, de la révolution et de la tolérance.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les poètes qui vous influencent ?
Amar Benhamouche : Comme mon père était poète, j’ai été précocement bercé par la voix de la poésie. En effet, mon père nous récitait souvent à la maison ses poèmes et nous expliquait leur sens. Les chanteurs-poètes kabyles m’ont fait découvrir davantage la poésie dans sa dimension engagée et révolutionnaire, particulièrement Lounis Ait Menguellet et Lounes Matoub.
Par la suite, j’ai découvert d’autres sommités de la poésie kabyle comme Ahmed Lahlou et Ben Mohamed. L’amour de la langue française m’a aidé à découvrir Kateb Yacine et Tahar Djaout, Victor Hugo, Charles Baudelaire et Jacques Prévert. J’ai aussi voyagé en Amérique Latine en lisant les traductions de deux grands poètes chiliens qui m’ont beaucoup marqué, Pablo Neruda et Nicanor Parra. Je suis bien sûr aussi habité par la beauté de la langue arabe, une langue de poésie que j’ai découvert à travers les mots de Mahmoud Darwich, Ahmad Matar, Nizar Qabbani et Hamouche Tazaghart.
Mon réseau d’amis et de poètes m’a permis de découvrir de belles plumes, Kamel Bencheikh, Arwa Ben Dhia, Rachida Belkacem, Maggy De Coster, Sarah Mostrel, Claire Boitel, Consuello Arriagada et tant d’autres…
Le Matin d’Algérie : Avez-vous de projets en cours et à venir ?
Amar Benhamouche : Effectivement, tant que la vie ne s’arrête pas, les projets ne s’arrêtent pas. Avec mon ami, le sculpteur et le dessinateur Hamid Aftis, nous sommes en train de finaliser le projet d’une bande dessinée sur le chanteur-poète Lounes Matoub. En ce qui concerne la poésie, je travaille actuellement sur mon propre recueil un recueil de poésie bilingue, arabe/français, intitulé « L’Amour et la Révolution ».
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Amar Benhamouche : Mon dernier mot ne peut être qu’un appel aux parents. Qu’ils fassent de la lecture et de la culture une priorité dans l’éducation de leurs enfants. Un peuple cultivé ne sera jamais dupé ou dépravé.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Samedi 20 juillet 2024
lematindalgerie.com
……………………………………………………………………………………

Thierry Eliez : « L’essence du jazz est avant tout africaine »
Il y a des artistes qui brillent par le talent, la modestie, l’humilité et la générosité, qui redonnent le sens noble à leur art. Thierry Eliez fait partie de ces artistes lumineux par le travail, la sueur versée du labeur pour toujours avancer semant cultivant composant innovant dans un élan d’élévation quasi spirituel, saisissant les couleurs, les genres musicaux, sans jamais sourciller mais surtout et avant tout dans un souci constant de pureté pour en extraire la beauté pour la partager là où se rencontrent le cœur et l’esprit.
Thierry Eliez est ce musicien, pianiste, compositeur, chanteur de génie qui ne cesse de nous émerveiller par un talent grandissant au fil des années qui font de lui l’un des plus grands pianistes de jazz. Le voir jouer émerveille le regard et l’oreille tant il ne fait qu’un avec le piano dans une symbiose éclatante de beauté d’équilibre et d’harmonie, passant aisément du classique au jazz,
Le tout dans l’union, celle des arts, dissipant les brouillards pour combler les sens baignés dans cette musique qui semble jaillir de la terre pour embrasser les cieux.
Thierry Eliez est né à Arcachon, il commence le piano à l’âge de quatre ans, puis l’Orgue Hammond après avoir vu l’organiste Rhoda Scott. Il suit des études de piano classique pendant 8 ans avec différents professeurs en cours particuliers, tout en se perfectionnant sur le Hammond, avant de découvrir le jazz.
Excellent dans l’improvisation, amateur de musique anglaise, il devient l’un des pianistes du jazz européen les plus en vogue.
Thierry Eliez signe ses premiers contrats en tant que pianiste à l’âge de 17 ans et se fait rapidement connaître sur tout l’ouest de la France, de Bayonne à Cholet, puis dans toute la France et l’Europe.
En 1985, il rejoint Paris, occupe les clubs de jazz parisiens où il est très vite repéré comme le plus jeune virtuose du Jazz français.
En 1986, il enregistre avec le violoniste Didier Lockwood l’album 1234, c’est le début d’une longue amitié, à la rythmique, Jean-Marc Jafet et André Ceccarelli.
La symbiose est telle que naît en 1989, le Ceccarelli Trio, suivi de trois albums mythiques qui marqueront durablement le Jazz : Dansez sur moi (avec Claude Nougaro et Toots Thielmans), Hat Snatcher (Victoire de la Musique du Meilleur Album Jazz et Django D’or en 1992) et 3 around the 4, en hommage aux Beatles.
Dès 1990, Thierry Eliez collabore avec la chanteuse américaine Dee Dee Bridgewater, sur scène et en studio jusqu’en 2004 : pianiste, compositeur, arrangeur et directeur musical. Quatre albums sortiront : Keeping tradition, Love & Peace (Tribute to Horace Silver – avec Horace Silver), Dear Ella, et Live at Yoshi’s. Il composera pour elle la chanson « For your Love » qu’elle enregistrera en duo avec sa fille China Moses pour Sol en Si.
La chanteuse et violoniste Catherine Lara fait appel à Thierry Eliez, la même année. Il se joint à elle pour mettre en musique le spectacle « Les Romantiques » en 1993, jouera sur plusieurs de ces albums et co-composera les musiques des albums Maldone et Graal. Catherine Lara et Thierry Eliez composeront de nombreuses musiques ensemble que ce soit pour elle-même, pour Johnny Hallyday, des musiques de films et de séries… principalement pour TF1, ainsi que la comédie musicale La Légende du Graal, sur un livret de Jean-Jacques Thibaud.
En 2004, Muriel Robin lui demande de composer la musique de son nouveau spectacle, Au secours. Plus tard, ils travailleront ensemble à la création de 12 chansons pour le projet d’album de Muriel Robin, album qui ne verra pas le jour.
Thierry découvre la chanteuse Ceilin Poggi. Il créera alors le Duo Jadden avec Ceilin Poggi à la voix, choisissant de réarranger de grands thèmes du jazz et de la pop des années 70-90. En 2007, leur duo devient quintet et s’enrichit d’un violoncelle (Yan Garac), de percussions (Xavier Sanchez), et d’une contrebasse (Dominique Bertram) mélangeant les accords, les temporalités et les influences musicales.
Thierry Eliez forme le trio progressif « Eliez » avec son frère Philippe Eliez à la batterie et Daniel Ouvrard à la basse. Un premier album nommé Hot Keys, patchwork des univers musicaux qui l’ont nourri depuis son enfance, sort en 2009. Puis un second album original et underground « Night Fears » sorti en 2012.
Le compositeur Éric Serra fait appel à Thierry Eliez pour créer le projet Trans Jazz rock RXRA. Formé de sept musiciens, ils réarrangent les grands thèmes des bandes originales des films de Luc Besson écrites par Éric Serra.
Dès lors, Europacorp fait appel à lui pour interpréter des passages musicaux de Angel-A, de Bandidas et Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec.
Thierry Eliez sillonne la France et collabore avec différentes formations dont le Paris Jazz Big Band dirigé par Pierre Bertrand et Nicolas Folmer.
Michel Legrand fait appel à lui dans son album Legrand Nougaro en hommage à Claude Nougaro où il sera à l’orgue hammond, avec son ami André Ceccarelli à la batterie, le contrebassiste Ron Carter, entre autres.
En décembre 2019 il intègre le groupe Magma. Thierry Eliez s’est révélé aussi bien dans la composition ou l’interprétation de musiques de films (Éric Serra, Lalo Schifrin, Michel Legrand, Astérix aux Jeux olympiques, Tout pour plaire, Le Rôle de sa vie, Bandidas, Taxi Blues, Angel-A, etc.), la composition de musiques de spectacles (Légende du Graal, Au Secours), Comme grand improvisateur de jazz (Didier Lockwood, Dee Dee Bridgewater, Ceccarelli trio, Horace Silver, Paris Jazz Big Band, Paco Séry, Magma, Sylvain Luc, …), le jazz World (Ultra Marine, The Syndicate…), qu’auprès d’artistes de la scène française (Charles Aznavour, Catherine Lara, Alain Chamfort, Patrick Bruel, Johnny Hallyday, Roberto Alagna, Nathalie Dessay, Ceilin Poggi…).
Pianiste, organiste, claviériste, chanteur, compositeur, auteur, arrangeur, Thierry Eliez est un musicien hétéroclite qui fait appel à tous les styles musicaux avec naturel et facilité : du jazz en passant par la chanson, la fusion, la musique classique ou encore le rock, pour lequel il garde une passion vivante.
Thierry Eliez est un pianiste de jazz virtuose qui illumine la musique par son génie créateur dans la recherche sans cesse renouvelée d’un regard passionné d’une beauté partageant l’amour.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un artiste éclectique, dont l’aura ne cesse de rayonner à travers la France, l’Europe et le monde, qui est Thierry Eliez ?
Thierry Eliez : Un musicien curieux de toutes les musiques. Ayant commencé vers l’âge de 5 ans en essayant de rejouer à l’oreille ce que j’entendais à la radio, j’ai développé assez tôt une mémoire musicale importante, ce qui me permettait d’aborder rapidement différents styles musicaux … le jazz, la musique classique, la musique progressive, mais aussi la chanson bien sûr.
C’est en grande partie grâce à cette « oreille absolue » que j’ai pu appréhender toutes ces formes musicales. Cette aptitude m’a été très utile dans ma carrière, j’apprenais et retenais rapidement les morceaux, copiant souvent moi-même mes relevés et partitions.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes passé du classique au jazz, mais tout en sauvegardant l’union sans rupture, racontez-nous ?
Thierry Eliez : J’ai toujours aimé les mélanges de styles, et j’ai eu la chance de connaître une époque où ces différents genres musicaux se sont littéralement « télescopés » : le jazz, le rock, le classique fusionnaient d’une façon souvent expérimentale et passionnante.
Dans les années 70, J’étais un jeune adolescent qui découvrait des groupes tels que Magma, une musique toujours inclassable aux influences aussi riches et diverses que Stravinsky, John Coltrane ou Otis Redding. Emerson, Lake& Palmer, le trio de ProgRock anglais, qui combinaient la musique classique, baroque ou contemporaine avec le son de cette époque : batterie, basse, orgue Hammond – instrument que j’affectionne particulièrement- et les tous premiers synthétiseurs construits par Robert Moog.
J’ai aussi beaucoup écouté Frank Zappa à cette époque, qui de son côté mixait savamment le rock, le blues, la musique contemporaine, et même le « doo wop », avec talent et ironie…
J’ai réellement commencé à m’intéresser au Jazz vers 15-16 ans, en découvrant d’abord son pendant du moment, communément appelé « Jazz Rock », à travers des groupes mythiques comme Weather Report ou le Return to Forever de Chick Corea. Ce n’est que par la suite que je suis venu au jazz plus originel.
Le Matin d’Algérie : La passion vous anime, il y a des rencontres musicales déterminantes qui marquent, parlez-nous de ces rencontres ?
Thierry Eliez : Je pense que chaque rencontre musicale est importante et peut être vécue comme une expérience, un apprentissage quel que soit le style de musique. J’ai appris beaucoup en travaillant avec des artistes tels que Didier Lockwood, André Ceccarelli, Michel Legrand, Dee Dee Bridgewater, Catherine Lara, et toutes les formations avec lesquelles j’ai eu l’occasion de jouer, tout en leur amenant aussi ma propre vision et mon expérience.
J’ai eu la chance de croiser Keith Emerson, en juillet 2000. Nous avons déjeuné ensemble et échangé pendant plusieurs heures sur notre passion pour la musique. C’était un moment assez unique, me retrouver ainsi avec un des « héros » de mon adolescence à discuter autour d’une langouste et d’une bouteille de Chardonnay à Santa Monica !
Le Matin d’Algérie : Un mot sur le groupe de rock, Magma, et la chanteuse Ceilin Poggi…
Thierry Eliez : J’ai rejoint le groupe Magma en 2019, et je peux dire que c’est assez troublant de partager soudain la scène avec d’autres « héros » de mon adolescence, Stella et Christian Vander. Pour l’anecdote, Stella, chanteuse originelle du groupe, hésitait à m’appeler, pensant que ça ne m’intéresserait peut-être pas…Elle était surprise et ravie de découvrir qu’il n’en était rien, et que j’étais au contraire très enthousiaste !
Avec Ceilin Poggi, c’est une belle et longue histoire, car nous nous connaissons depuis 20 ans… Nous aimons beaucoup travailler, jouer, composer ensemble, nous participons beaucoup mutuellement à chacun de nos projets.
J’aimerais aussi préciser que Ceilin est productrice et coordinatrice de mes albums personnels, à travers le label DoodRecord qu’elle a créé il y a quelques années.
De mon côté, je participe en tant qu’arrangeur à son album actuel, « Sänd », sur des chansons qu’elle écrit et interprète. C’est un superbe projet dont on va entendre parler et qui sortira à la rentrée 2024.
Le Matin d’Algérie : Certains disent que l’Europe est à la musique classique comme l’Amérique est au jazz, est-ce toujours vrai ?
Thierry Eliez : Je pense que c’est beaucoup plus nuancé et subtil. De tout temps, l’improvisation musicale, un des éléments principaux du jazz, a existé dans le monde entier, sous des formes différentes selon les régions du monde. Il est certain que Bach, Mozart, Chopin et bien d’autres étaient de grands improvisateurs.
D’un autre côté, il y a beaucoup de musiciens de jazz qui ont su utiliser les éléments mélodiques et harmoniques du classique pour les amener à leur écriture. Je pense notamment à Duke Ellington, qui a savamment intégré des couleurs impressionnistes à sa musique, mais aussi au Modern Jazz Quartet et à leurs nombreuses références au classique.
Puis, plus tard, des immenses pianistes comme Bill Evans, Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett, ont montré par leurs interprétations ou compositions leur connaissance de la musique classique. Je pense notamment à Chick Corea interprétant Bartok, Herbie Hancock et le Concerto en Sol de Ravel, ou bien encore Keith Jarrett et sa version des Préludes et Fugues de Bach. Sans oublier que l’essence du jazz est avant tout africaine.
Le Matin d’Algérie : Les conservatoire parisiens s’ouvrent depuis quelques années sur les musiques actuelles et les musiques du monde, qu’en pensez-vous ?
Thierry Eliez : C’est de toute façon une belle initiative, ça prouve une recherche d’ouverture de la part d’une institution qui s’est figée pendant trop longtemps dans la rigueur au détriment de la curiosité et du plaisir de la découverte. La musique a besoin de tous ces éléments pour rester vivante.
J’aimerais souligner qu’un des premiers musiciens de Jazz à revendiquer cette ouverture était le regretté Didier Lockwood, avec qui j’ai eu le plaisir de jouer de nombreuses fois. De plus, c’était un très bon ami.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Thierry Eliez : Oui, je travaille sur un nouveau projet, assez différent de tout ce que j’ai fait précédemment. Une nouvelle aventure pour moi ! Et puis, nous continuons sur le projet de Ceilin, à élaborer ensemble les arrangements de ses chansons.
Une tournée avec Magma prendra place entre 2024 et 2025, des concerts avec Eric Serra, puis des concerts au Mexique et au Québec avec Ceilin Poggi autour du projet Emerson Enigma.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Thierry Eliez : Quelques références discographiques personnelles.
« Improse » (Album Piano Solo)
« Improse Extended » (Album en Trio avec André Ceccarelli et Ivan Gélugne)
« Berceuses & Balladines Jazz » (Duo Piano/Voix avec Ceilin Poggi)
« Balladines et Chansons douces » (Duo Piano / Voix avec Ceilin Poggi)
« Emerson Enigma » (avec Ceilin Poggi et Le Quatuor Manticore)
« Sur l’Ecran Noir » (Hommage aux Chansons écrites par Claude Nougaro et Michel Legrand. Avec plusieurs invités).
Entretien réalisé par Brahim Saci
wikipedia.org/wiki/Thierry_Eliez
Jeudi 18 juillet 2024
lematindalgerie.com
…………………………………………………………………………………………………..

David Louwerse : « Toute musique est belle dès lors qu’elle trouve le chemin de notre âme »
David Louwerse fait partie de ces génies de la musique classique dont l’humilité est aussi grande que leur talent atteignant les cimes de la volupté où l’émotion est portée à son point le plus élevé laissant le mélomane et le profane dans l’émerveillement.
Sa maitrise du violoncelle laisse l’oreille et le cœur admiratifs. David Louwerse se passionne pour la création musicale en général dans toute sa diversité n’hésitant pas à relever des défis, le tout dans une volonté de pousser le jeu et l’interprétation musicale vers l’excellence pour en saisir toute la beauté, dans les sonorités, dans une exaltation de l’esprit mettant les sens en éveil.
David Louwerse est titulaire d’un Premier Prix à l’Unanimité en classe de violoncelle et d’un Premier Prix à l’Unanimité en classe de Musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, ainsi que de la Lucy G. Moses Award de l’Université de Yale.
Il est actuellement le violoncelliste de, l’Ensemble Variances,
sous la direction artistique du compositeur Thierry Pécou , il se produit comme soliste ou musicien de chambre en France : à l’Opéra de Lyon, à la Maison de Radio France, à l’Arsenal de Metz, au Lille Piano Festival, aux Détours de Babel de Grenoble, aux Journées Musicales de Dieulefit, au Festival Flam’ de Blaye, au Théâtre des Arts de Rouen, à l’Auditorium Rostropovitch de Paris, à Ault en Musiques !, au Festival Offenbach d’Étretat, aux Nocturnes de la cathédrale de Rouen, au Festival d’Ambronay, à la cathédrale de Riez, à La Force.
Il se produit aussi au Canada et aux États-Unis, au Bourgie Hall de Montréal, au Music on Main de Vancouver-Ottawa, au Chamber Festival/Bargemusic de New-York, au Ferst Center for the Arts d’Atlanta, au Town Seattle Hall de Los Angeles, à Washington, en Asie (Taipei, Kaoshung, Yilan) ainsi que dans différentes villes européennes : à l’Unerhôrte Music de Berlin, au Festival Arabesque de Hambourg, au Festival d’Heidelberg, au Château de Sans-Souci de Potsdam (Berlin), au Gregynog Music Festival, au St John’s Smith Square de Londres, à St George’s Church de Bristol, au Brighton Festival, au Lisinki Hall de Zagreb, au Festival Ossiach de Villach (Autriche) et à Utrecht et Maastricht…
David Louwerse est également le directeur artistique du festival, Ault en Musiques !, qu’il a créé, qui se déroule le premier week-end du mois de juillet au sud de la Baie de Somme, et anime les Musiciens de l’Instant, association de musiciens excellant dans l’art de la musique de chambre.
Il enseigne le violoncelle aux conservatoires de la ville de Paris et la musique de chambre au Pôle Sup 93 ainsi qu’à l’École Normale de Musique de Paris.
Il reste l’un des plus grands violoncellistes, dont le savoir musical ne cesse de s’enrichir aux contacts de musiciens de différents horizons, à l’écoute de la nature, avec la pratique et l’expérience des années, magnifiant sa sonorité, dans un souci de perfectionnement mais aussi de partage du cœur et de l’esprit.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un violoncelliste de renom, qui est David Louwerse ?
David Louwerse : Je ne me pose pas trop la question de savoir si je suis un violoncelliste de renom, je suis simplement un garçon qui aime jouer du violoncelle pour lui et pour les autres, partager des émotions avec le public, enseigner le plaisir d’en jouer aux plus jeunes et rencontrer des gens différents au travers de la musique.
Le Matin d’Algérie : La musique a besoin de compositeurs mais aussi de musiciens interprètes, quelle est la part de l’interprétation dans une œuvre musicale ?
David Louwerse : Je dirai que c’est un peu comme au théâtre, il y a tellement de manières de dire et de faire vivre un texte. Une chose est sûre, les œuvres que nous jouons nous parlent de nous, de nos émotions, de tout ce que nous partageons. Notre mission est de pouvoir les jouer en toute sincérité au moment du concert afin d’être proche du public.
Le Matin d’Algérie : Quand on vous écoute, nous sommes emportés par le jeu poussant l’émotion à son paroxysme, peut-on dire que vous avez trouvé votre sonorité propre ?
David Louwerse : Nous avons tous besoin de trouver notre voix, et c’est particulièrement vrai pour les instrumentistes à cordes car nous devons créer entièrement notre sonorité. J’ai été bercé enfant par la sublime sonorité de Mstislav Rostropovitch, mais aussi Issac Stern ou Yo Yo Ma, et au fil des années je cherche le moyen d’être le plus proche du public, de lui parler avec mon violoncelle en quelque sorte, de le toucher au plus profond de lui-même. La beauté de la sonorité y contribue beaucoup !
Le Matin d’Algérie : On parle du violoncelle français, y a-t-il une particularité française ?
David Louwerse : Oui je le pense. L’école du violoncelle français se distingue par une forme d’élégance, de clarté dans le son, d’expression des sentiments juste en évitant certains excès. De plus, certains violoncellistes étaient de grands pédagogues en plus d’être de magnifiques concertistes ! On pense tout de suite à nos André Navarra, Paul Tortelier, Philippe Muller ou encore Xavier Gagnepain.
Le Matin d’Algérie : Jean-Sébastien Bach a dit « J’ai beaucoup travaillé. Quiconque travaillera comme moi pourra faire ce que j’ai fait. », qu’en pensez-vous ?
David Louwerse : C’est une belle leçon d’humilité !
Exercer une profession artistique demande un travail gigantesque ainsi qu’une remise en question sur notre pratique constante. Concernant des grands compositeurs, comme Jean-Sébastien Bach, ce sont d’immenses travailleurs mais n’oublions pas qu’à la base, ils ont du génie !
Le Matin d’Algérie : Les conservatoires parisiens s’ouvrent depuis quelques années sur les musiques actuelles et les musiques du monde, qu’en pensez-vous ?
David Louwerse : Je trouve cela très bien ! Je pense que toutes ces musiques nous parlent des mêmes choses : nos émotions, nos espoirs, nos passions… c’est juste le vocabulaire musical qui change. Toute musique est belle dès lors qu’elle trouve le chemin de notre âme.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur le festival, Ault en Musiques, que vous avez créé
David Louwerse : Ault est un très joli village en bord de mer dans le nord de la France. Le festival Ault en Musiques, s’y déroule au début du mois de Juillet dans plusieurs lieux (deux chapelles, une église, une bibliothèque et une salle de concert ainsi que des concerts en plein air) et en tant que directeur artistique, je cherche à ce que chacun de ces lieux trouve la musique qui lui convient, que ce soit de la musique classique, du jazz, de l’improvisation en encore des musiques du monde. De plus, avec mon ami le plasticien Fontaine de la Mare, nous développons la présence de sculptures, peintures, photographie au moyen de différentes expositions durant le festival.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
David Louwerse : Oui bien sûr, une multitude de projets pour les années qui viennent ! Beaucoup de concerts, d’enregistrements, de projets très différents de tous styles…tout en continuant à prendre soin de mes chers élèves !
Je pense faire plus de place à la musique improvisée ou encore à quelques collaborations avec des pianistes de jazz.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
David Louwerse : Le rôle de la culture et du spectacle vivant est de nous rassembler et de partager, de nous exprimer…. C’est si important dans ce monde qui nous divise de plus en plus
Pour finir, je tiens à remercier Le Matin d’Algérie d’avoir proposé cet entretien. Cela fut un plaisir et un honneur.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Lundi 15 juillet 2024
Lematindalgerie.com
……………………………………………………………………………..

Michel Margotton : « La poésie me paraît essentielle »
Michel Margotton (alias M. de Saint-Michel), est un poète d’une grande profondeur, c’est comme une méditation poétique qui s’offre au lecteur. Michel Margotton fait partie de ces rares poètes qui écrivent sous pseudonyme, ce qui intrigue, en ajoutant une part de mystère forçant et élevant l’élan poétique vers les plus hautes cimes où le lecteur tente de saisir ou seulement d’appréhender un sens enfoui ou une rime vagabonde déchirant l’air transfigurant toute la beauté.
Il y a un jaillissement de lumière dans la poésie de Michel Margotton, où les esprits avertis et non avertis s’apaisent et s’immergent emportés par les flots où chemine l’éveil spirituel comme un voyage vers le soi et l’expérience humaine.
La poésie défriche notre jardin intérieur, améliorant notre perception du monde, Michel Margotton nous emporte à travers ses vers libérés des entraves des illusions humaines vers une démarche spirituelle aboutissant à une quête entre le visible et l’invisible, où l’apparent et le caché annihilent la dualité.
La poésie de Michel Margotton fait sortir le meilleur de nous-même, en nous projetant vers l’Un et vers le Tout, tout nous apparaît alors lié dans une parfaite harmonie de la Terre à l’univers.
Michel Margotton est né à Marseille, il a effectué sa scolarité, dans le primaire et le secondaire, à Arles cette ville d’art et d’histoire, située sur le Rhône, dans la région de Provence au sud de la France, une ville réputée qui a inspiré Van Gogh, qui a influencé l’art contemporain exposé à la Fondation Vincent Van Gogh. Autrefois capitale provinciale de la Rome antique, Arles est également renommée pour ses nombreuses ruines romaines, notamment l’amphithéâtre d’Arles, qui accueille aujourd’hui des pièces de théâtre et des concerts.
Après des études de Lettres à la Faculté Paul Valéry de Montpellier, Michel Margotton a enseigné pendant une trentaine d’années dans les Académies de Lyon et d’Aix-Marseille. Déjà poète adolescent, il a été très tôt attiré par l’écriture et, notamment, l’écriture poétique.
Les recueils de Michel Margotton invitent donc à la réflexion à l’élévation tant spirituelle que philosophique. La nuit et le jour s’entrechoquent, la vie et la mort se côtoient dans l’harmonie, dans une relation d’interdépendance, sachant que l’une ne peut être sans l’autre.
La conscience humaine se trouve bouleversée, bousculée, interrogée, cherchant des réponses dans un monde en toute vitesse, en perte de repères, où l’illusion et le mensonge tendent à remplacer le vrai. La poésie se dresse heureusement salvatrice pour ramener les équilibres perdus.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un poète à la fois grave et lumineux, vous écrivez depuis longtemps, mais vous n’avez publié que tardivement, qui est Michel Margotton ?
Michel Margotton : Il est toujours difficile, voire impossible, de dire qui l’on est vraiment. C’est sans doute pour cela que la poésie me paraît essentielle : elle seule permet de plonger au plus profond de soi, par-delà les images toutes faites que chacun se fait de lui-même. Traverser le miroir des apparences et des concepts, telle est pour moi la finalité de l’écriture poétique. Lorsque j’écris, je pars en quête de moi-même – quête qui ne peut, évidemment, jamais atteindre totalement son but : il y a en moi (comme en tout être humain) une part toujours mystérieuse que le poème ne définit pas, ne circonscrit pas mais suggère… « Je est un autre » comme dit Rimbaud.
Le Matin d’Algérie : Vous écrivez sous pseudonyme est-ce pour vous extraire du réel pour que puissent librement battre vos ailes comme pour ne pas être souillé par le monde qui vous entoure ?
Michel Margotton : Le pseudonyme permet de bien différencier le « moi social » du « moi créateur », pour reprendre la terminologie de Marcel Proust : le premier représente l’homme extérieur, l’homme public vivant à la surface des choses, résumé à sa biographie ; le second est l’être intérieur, caché aux yeux du siècle, celui-là même d’où naissent les œuvres – le moi véritable : sous le masque visible, à peu près semblable à tous les masques, le visage réel, unique entre tous.
Michel Margotton va, vient, s’agite sur la scène du monde, M. de Saint-Michel écrit.
Le Matin d’Algérie : On sent votre passion pour la mythologie grecque, pouvez-vous nous en parler ?
Michel Margotton : En effet, j’aime particulièrement les mythologies grecque et romaine (C’est d’ailleurs la même, les Romains ayant le plus souvent repris à leur compte les divinités grecques en se contentant de changer leurs noms : Zeus devenant Jupiter, Athéna Minerve, Arès Mars etc…)
C’est en 6ème que m’est venu cet intérêt lorsque j’ai commencé à apprendre le latin et cet intérêt n’a fait que croître au fil des ans. La fiction mythologique nous apprend, à mon sens, beaucoup plus sur l’âme humaine (ses passions, ses craintes, ses désirs…) que tous les livres de psychologie réunis. Sous le couvert de récits fabuleux, elle met à nu les ressorts les plus enfouis de notre psyché ; elle exprime à merveille nos interrogations essentielles face à la Vie, à la Mort – au Destin. Loin d’être simplement une collection de contes plus ou moins curieux d’un temps révolu, elle dévoile l’intimité de ce que nous sommes. Elle est donc Poésie.
Le Matin d’Algérie : Vos recueils élèvent la philosophie et la spiritualité, Friedrich Nietzsche disait « Dieu a aussi son enfer : c’est son amour des hommes », qu’en pensez-vous ?
Michel Margotton : Le chrétien que je suis est d’accord sur ce point avec l’auteur de « L’Antéchrist » ! Le Christ, par sa passion et sa mort, a bien, pour le salut des hommes, vécu l’enfer – mais cet enfer-là débouche sur une lumière surpassant toutes les ténèbres du monde.
Pour adhérer à cela, il faut, bien sûr, accepter l’idée d’incarnation : celle d’un dieu désireux, par amour, d’endosser, à l’exception du péché, la condition humaine – et la souffrance en fait partie…
Le Matin d’Algérie : La France pays des droits de l’homme et des lumières, vient de vivre un moment critique et charnière de son histoire, où l’extrême droite a failli prendre le pouvoir, à votre avis, comment sommes-nous arrivés là ?
Michel Margotton : Les gouvernants français des trente ou quarante dernières années (de droite, du centre ou de gauche) se sont peu à peu coupés du peuple. Enfermés dans un élitisme bon chic, bon genre, ils ont refusé d’entendre, plus ou moins consciemment, ses plaintes et ses colères. Avec arrogance, ils ont pensé qu’en eux seuls résidaient l’intelligence, la raison, la culture ; la « plèbe » n’avait qu’à suivre ce que les « doctes » lui professaient… Ainsi n’ont-ils pas voulu (ou pas osé ?) répondre à ses problèmes quotidiens : immigration incontrôlée, insécurité galopante, effondrement du pouvoir d’achat, dépossession de souveraineté au profit d’une Europe hors-sol et mercantile… D’où la montée des populistes. (Tous les pays européens, d’ailleurs, sont, peu ou prou, dans le même cas de figure.)
Le Matin d’Algérie : Quels sont les poètes qui vous influencent ?
Michel Margotton : Baudelaire est depuis mon adolescence mon poète de chevet : je considère Les Fleurs du Mal comme le livre phare de la poésie française, à la croisée du classicisme et de la modernité, où se mêlent sensualité et mysticisme, vertige de la vie et hantise de la mort…
Parmi les autres poètes français qui ont, sinon influencé, du moins nourri ma création, je peux citer pêle-mêle Ronsard, Hugo (surtout celui des Contemplations), Mallarmé (un maître du Verbe), Lautréamont, O. V. de Lubicz-Milosz (un immense poète trop peu connu, hélas !), Saint-John Perse, Pierre Jean Jouve…
Sans oublier, chez les écrivains étrangers, Dante dont la Divine Comédie est l’un des plus hauts sommets de la poésie universelle !
Le Matin d’Algérie : La création poétique et l’art en général, peuvent-ils changer notre regard sur le monde ?
Michel Margotton : Oui, je le crois fermement. L’art, en effet, nous permet de sortir de nous-mêmes et de nous mettre en contact avec les différentes facettes du réel. Chacun d’entre nous, seul enfermé dans son coin, seul claquemuré dans son ego, a une vision nécessairement univoque du monde ; l’art nous fait prendre conscience de sa diversité, de sa pluralité, de sa complexité : de sa richesse. Il nous ouvre à l’infini des possibles de l’existence…
Mais attention, il ne faut pas être naïf et s’illusionner : si l’art change certes notre regard sur le monde, il n’a pas le pouvoir de changer le monde !
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Michel Margotton : Je suis en train de préparer un recueil comprenant des formes poétiques courtes : monostiques, haïkus, distiques. C’est Twitter qui, il y a quelques années, m’a donné cette idée : comme il était impossible de poster des textes allant, à l’époque, au-delà de 140 caractères, je me suis vu « contraint » de composer des poèmes très brefs – dont le haïku, ce type de poésie d’origine japonaise que j’apprécie particulièrement.
Ce recueil devrait paraître fin 2024 ou début 2025…
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Michel Margotton : De nos jours, en Europe (je ne sais s’il en est ainsi sur votre continent), la poésie paraît ne pas exister aux yeux du plus grand nombre. Elle est proprement invisible. Invisibilisée par la quasi-totalité des principaux médias qui n’en parlent jamais.
Je veux espérer, contre toute espérance, qu’elle reviendra un jour à l’honneur et reprendra la place qui est sienne : la première.
Entretien réalisé par Brahim Saci
http://mdesaintmichel.eklablog.com/
Livres publiés :
– 2018 : D’Éros & de Thanatos [poésie] (Edilivre)
– 2019 : Mémoire d’un corps anonyme [poésie] (Ed. Spinelle )
– 2021 : Nuit obscure [roman] (Ed. Maïa)
L’absolu dans la peau [poésie] (Ed. Atramenta)
– 2022 : Douze longs mois d’une vie éphémère [poésie] (Ed. Atramenta)
– 2023: Il faut détruire Babel [poésie] (Ed. du Net)
Cent précieuses paroles de Divine [poésie] (Ed. du Net)
– 2024: Dionysos et le Crucifié [poésie] (Ed. Atramenta)
lematindalgerie.com
Mardi 16 juillet 2024
………………………………………………………………………………

Jean-Luc Rogge : « Je suis un révolté, optimiste lucide, donc désespéré »
Jean-Luc Rogge est un écrivain passionné qui se démarque et émerveille par un style fluide qui accapare le lecteur, le retient pour ne plus le lâcher, tant la force de la narration est grande, jonglant entre le récit, le roman, la fiction et la nouvelle avec une dextérité rare qui attire l’admiration.
Jean-Luc Rogge est un écrivain belge. Il a vécu et grandi à Mouscron, cette petite ville enchanteresse francophone de Belgique située en Wallonie picarde, qui touche à la fois la frontière française et la frontière linguistique.
Mouscron est à 110 kilomètres à l’ouest de Bruxelles, à l’ouest de la province de Hainaut depuis le 1er septembre 1963, à la frontière entre la Belgique et la France. Avant cette date, elle faisait partie de la province de Flandre-Occidentale. Les villes françaises de Roubaix et Lille se trouvent respectivement à 9 et 23 km de Mouscron.
Déjà enfant introverti et rêveur, avide d’évasion, il trouve dans la littérature une raison d’être transfigurant les paraitres et les voiles pour appréhender le réel, le vrai, pour échapper aux monde des illusions et des incertitudes pour atteindre un équilibre et une harmonie dans la création, dans l’écriture, en donnant libre cours à une imagination déjà fertile où les idées sont prêtes à germer.
Jean-Luc Rogge a publié sept livres, six recueils de nouvelles, un genre qui lui tient tout particulièrement à cœur qu’il essaie de valoriser, et un roman, une sorte de thriller familial. Mes personnages sont à l’image des gens qui peuplent ce monde, se plaît-il à dire. C’est effectivement vrai, chacun peut se reconnaître dans ces livres tant les protagonistes nous paraissent proches et familiers sous plusieurs angles d’un abord facile, partageant le flot émotionnel immergeant les sens.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un écrivain de talent, vos livres en témoignent, qui est Jean-Luc Rogge ?
Jean-Luc Rogge : Parler de soi est toujours difficile. Comme vous l’avez déjà précisé, je suis Belge mais, comme de nombreux habitants de Mouscron, ancienne cité textile, ville frontière contiguë à Tourcoing, j’ai de la famille tant en Belgique qu’en France. Mais j’aime surtout me définir comme un simple citoyen du monde qui, comme tant d’autres, tente de se frayer le meilleur chemin possible dans ce monde chaotique.
J’aime lire, écrire, épier, observer, comprendre. La lecture et l’écriture ont toujours fait partie de mon quotidien mais ce n’est que lorsque ma carrière professionnelle a touché à sa fin que j’ai enfin trouvé le temps nécessaire pour assouvir pleinement ma passion et que j’ai pu franchir le pas vers l’édition.
Ami des animaux et de la nature, je déteste les simagrées, la perfidie, la turpitude, l’abus de pouvoir, l’extrémisme. Je suis un révolté, optimiste lucide, donc désespéré.
Le Matin d’Algérie : Vous semblez jongler aisément avec les genres littéraires, le récit, le roman, la nouvelle, la fiction, comment arrivez-vous à cette prouesse ?
Jean-Luc Rogge : À l’aise dans le format court, le changement de format ne me pose cependant pas de problème. Tout dépend, en fait, de l’histoire que j’ai à développer. Tantôt celle-ci ne nécessitera que quelques pages, tantôt bien plus. J’essaie, de toute manière, d’éviter tout paragraphe superflu.
Au départ de la plupart de mes histoires, des instantanés de vie qui m’ont interpellé et auxquels j’ai imaginé une suite incertaine. Au gré de mon imagination, je me laisse emporter vers des horizons divers et sans limites par chacun de mes personnages. J’aime alors que ceux-ci arrivent à me surprendre, et donc à surprendre le lecteur.
Pour écrire, j’utilise principalement la technique du récit à la première personne qui est particulièrement immersif et fait vivre les histoires au plus profond de ce que ressentent les personnages. Ceci implique que j’adapte mon écriture et mon vocabulaire au niveau de pensée de ceux-ci, ce qui engendre des récits à la liberté de ton et au franc-parler certain, et dont les protagonistes sont tantôt drôles, tendres et touchants, mais d’autres fois, aussi, pernicieux, diaboliques ou choquants.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les écrivains qui vous influencent ?
Jean-Luc Rogge : Bien que je le sois probablement inconsciemment, j’essaie de ne pas me laisser influencer par quiconque pour ne pas tomber dans une sorte de mauvaise copie de style d’un écrivain. Mais il est évident que des auteurs comme Philippe Djian et Olivier Adam, ou encore la Belge Barbara Abel et l’Américain Raymond Carver pour les nouvelles, sont mes maîtres littéraires pour mon écriture.
Le Matin d’Algérie : Vous aimez les chats, beaucoup d’écrivains, Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Colette, Jean Cocteau, Victor Hugo, Émile Zola, Ernest Hemingway, Kipling, Mallarmé, Malraux, Maupassant, Perrault, Poe, Prévert, George Sand, ont eu une grande passion pour les chats. Il est vrai que cet animal totem a une symbolique liée au mystère, à l’inconnu, à ce qui est caché, il peut être une grande source d’inspiration pour les créateurs, pouvez-vous nous en parler ?
Jean-Luc Rogge : Ma relation a toujours été forte avec les chats, ces êtres sauvages, solitaires, curieux, distants parfois, méfiants souvent, mais à la tendresse infinie et à la confiance illimitée dès lors qu’ils vous ont adopté. Mon vieux chat, âgé de 17 ans, m’a signifié l’importance de la conscience de l’instant présent. Chaque fois que je m’installe à ma table d’écriture, il se couche à mes côtés, la tête posée sur mon avant-bras et, par ses ronronnements, par ses demandes de caresse, me détend et m’apaise s’il m’arrive de buter sur un mot, une phrase ou une suite à donner. Pas de doute, pour moi, comme pour de nombreux auteurs, le chat est bien le meilleur ami de l’écrivain, source inépuisable d’inspiration.
Le Matin d’Algérie : La France, le pays des lumières, vient de vivre un moment crucial de son histoire où l’extrême droite a failli prendre le pouvoir. Le monde se refroidit, on s’éloigne du vivre ensemble, quel regard portez-vous en tant qu’écrivain sur la montée de la haine un peu partout dans le monde et particulièrement en Europe ?
Jean-Luc Rogge : La France, l’Europe, le monde est en crise. Face à leur misère croissante, aux inégalités qu’ils subissent, au sentiment d’abandon qui prédomine, et en l’absence de réponses à leurs appels de détresse de la plupart de leurs dirigeants, enfermés dans leurs tours d’ivoire, de nombreux citoyens se tournent, hélas, vers les extrêmes, non seulement sinistres xénophobes et vendeurs d’illusions, mais surtout danger pour toutes les nations.
Personnellement, en tant qu’écrivain, auteur de fiction, je ne puis que, de temps à autre, aborder indirectement ces sujets dans mes livres, mais, tous, comme citoyens, il nous faut tenter de ramener à la raison les égarés.
L’autre n’est pas un danger mais un enrichissement !
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Jean-Luc Rogge : De gros soucis, sur lesquels je ne m’attarderai pas, m’ont empêché de poursuivre normalement mon travail d’écriture ces derniers mois. Mon prochain livre ne devrait donc pas paraître avant l’année prochaine.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Jean-Luc Rogge : Ce fut un réel plaisir de répondre à vos questions. Je vous remercie chaleureusement pour cette interview. Et, surtout, que vive la littérature !
Entretien réalisé par Brahim Saci
jeanlucrogge.com
lematindalgerie.com
Mardi 9 juillet 2024
……………………………………………………………………………………………………….

Samia Ziriat Bouharati : « Connaître l’histoire pour comprendre le présent »
Samia Ziriat Bouharati était l’invitée de l’écrivain journaliste Youcef Zirem au café littéraire parisien de l’impondérable pour parler de son livre « Lettres d’un prisonnier de la guerre d’Algérie », de Derradji Bouharati, paru chez les éditions L’Harmattan.
Youcef Zirem a su conduire la discussion avec art et justesse comme à son habitude, Samia Ziriat nous a ému et bouleversé tout au long de l’échange laissant le public au bord des larmes. C’est un livre témoignage qui rassemble une série de lettres envoyées par Derradji Bouharati à sa femme l’amour de sa vie et à ses enfants, des geôles coloniales et des geôles de l’Algérie indépendante où il était emprisonné.
Ces lettres témoignent d’une époque écorchée, d’abord celle coloniale sous le joug des français et celle postcoloniale sous le joug de la dictature installée par l’Algérie indépendante. Samia Ziriat rend ainsi un vibrant hommage à son père en publiant ces lettres d’une force inouïe, poignantes, remplies de larmes et d’espoir.
Ces lettres sont un hymne à l’amour et à la liberté. Page après page, lettre après lettre, on se sent proche de cet homme à l’incroyable destin, on saisit le sens de sa douleur et de sa déchirure en partageant le poids de son sacrifice pour la lutte pour l’indépendance.
En 1962 l’indépendance est là, arrachée, on respire enfin, mais le souffle devient court, en 1963 Derradji Bouharati alors maire d’Hussein Dey, sacrifiant cette fois sa position confortable pour cet idéal de liberté qui ne l’a jamais quitté, rejoint Hocine Ait Ahmed et le Front des forces socialiste, un parti d’opposition qui venait d’être créé pour lutte contre la dictature de Ben Bella et Houari Boumediene.
Derradji Bouharati sera arrêté sur dénonciation en 1964. Le destin s’emmêle une nouvelle fois et c’est à la prison de Berrouaghia qu’il est détenu, là où il a passé six ans dans l’humiliation et la torture à l’époque coloniale, mais cette fois, il est emprisonné par les siens.
L’histoire douloureuse, émouvante de Derradji Bouharati, son combat, ses convictions, son sacrifice, son idéal de liberté, suscite bien des espoirs aujourd’hui.
Le Matin d’Algérie : Votre livre « « Lettres d’un prisonnier de la guerre d’Algérie », de Derradji Bouharati, est bouleversant, c’est un bel hommage que vous rendez à votre père en publiant ces lettres, qui est Samia Ziriat Bouharati ?
Samia Ziriat Bouharati : Généralement quand on nous demande de nous présenter, on commence par décliner notre identité à travers notre statut social, du genre tels que la fonction ou le métier, qui ne sont qu’une infime facette de notre personnalité.
Pour ma part je dirai, je suis Samia Ziriat Bouharati née à Alger, en 1966, à El Mouradia, dans ces années troubles de l’indépendance, au moment où après cette phénoménale euphorie de liberté, succèdera un climat dont je porte, à travers mon histoire familiale, encore les stigmates.
Le Matin d’Algérie : Il faut du courage pour publier ces lettres très intimes mais si précieuses pour l’histoire, comment avez-vous pu dépasser le poids des tabous, de la tradition et des coutumes ?
Samia Ziriat Bouharati : À aucun moment je n’ai senti avoir transgressé quoi que ce soit, pour me dire que j’allais dévoiler l’histoire intime de ma famille, en publiant des lettres amoureuses de mon père qu’il a adressées à ma mère pendant sa longue incarcération.
Comme vous le soulignez, je n’avais pas conscience de la préciosité de ce que je dévoilais, car sont-ils nombreux ces prisonniers de cette guerre d’Algérie qui ont écrit à leurs femmes, ou compagnes de telles lettres ?
Le Matin d’Algérie : Votre livre est un hymne à l’amour, à la liberté, mais il interroge aussi sur le sens du sacrifice de soi pour un idéal, il offre ainsi plusieurs lectures, qu’en pensez-vous ?
Samia Ziriat Bouharati : Oui tout à fait, ce livre justement permet de prendre conscience d’une chose essentielle, qu’au-delà du sacrifice pour des valeurs suprêmes telle que la liberté, ou la poursuite d’un idéal, le moteur intrinsèque qui fait que l’homme peut dépasser sa peur, braver les pires dangers, subir les pires atrocités, c’est l’amour, l’amour de Dieu, l’amour d’un homme pour une femme ou vice versa, l’amour d’une patrie, l’Amour l’antidote de la peur.
Le Matin d’Algérie : Écrire c’est guérir, quel est votre avis ?
Samia Ziriat Bouharati : Le basculement vers de nouveaux paradigmes, vers ce monde nouveau monde, où on nous impose l’immatérialité, les liens virtuels, ce monde que nous-mêmes, hommes et femmes nous ne choisissons pas, mais que nous subissons comme des consommateurs dociles, risque de nous déshumaniser car nous ne sommes plus en capacité de prendre de recul sur quoi que ce soit, entre autres, pour lire, pour écrire, pour guérir.
Il faut savoir que cet acte simple de l’écriture (aligner des mots, des phrases, exprimer des émotions, des sensations) nous ramène à l’instant présent, et ce que nous sommes en train de perdre, tellement déboussolés par l’avalanche, le tsunami d’une tonne quotidienne d’infos, de faits divers, qui sont là pour nous distraire, nous rendant ainsi incapables de toute pensée structurée, constructive.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur votre association
Samia Ziriat Bouharati : L’association s’appelle Origin’AL, comme origine algérienne, créée en 2003, à l’occasion de l’année de l’Algérie en France. Elle est basée dans le Val de Marne, à Bonneuil-sur-Marne.
Son but, promouvoir les valeurs de nos origines, pour dépasser les clichés réducteurs, le travail mémoriel, pour une coopération équilibrée franco-algérienne
Le Matin d’Algérie : Quel regard portez-vous sur l’Algérie d’aujourd’hui ?
Samia Ziriat Bouharati : Je suis de par ma nature, une optimiste invétérée, on dit qu’il faut connaître l’histoire pour comprendre le présent, mais surtout penser l’avenir et se projeter.
Un pays comme l’Algérie qui a subi l’une des plus cruelles colonisations, pendant une si longue période, minée dans ses profonds soubassements et repères identitaires, a par miracle, enfanté une génération qui a cru en elle pour mettre en échec l’une des plus grandes puissances de ce monde.
La graine de cette génération ne mourra jamais.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Samia Ziriat Bouharati : À titre personnel, j’aimerais continuer à écrire, cette fois-ci une autobiographie, dont le titre est déjà choisi : Adieu Tristesse, je souhaite présenter ce livre lors du prochain salon du livre d’Alger.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Samia Ziriat Bouharati : Je suis très contente d’avoir eu à répondre à cette interview, dont les questions ont fortement résonné en moi, des questions justes et précises, je recommande après l’écriture, la thérapie par l’interview mais de qualité comme celle-ci, je vous remercie.
Entretien réalisé par Brahim Saci
lematindalgerie.com
Vendredi 5 juillet 2024
…………………………………………………………………………………………

Zy Orion : « La poésie est ma source de vie »
Zy Orion est une poétesse qui interpelle le cœur et l’esprit tant sa poésie est profonde. Elle inonde le lecteur par un flot d’émotions qui le transporte hors du temps, l’extrait du réel pour mieux voir jaillir les espoirs.
Les regrets et le chagrin n’ont pas de prise sur Zy Orion, la poétesse sait apprivoiser la douleur et la souffrance pour nourrir la muse dans un élan créateur salvateur qui s’élève et se lève brillant comme un soleil.
Si le passé est présent seul l’instant est vrai, il se dresse fier rafraichissant l’air comme une bouffée d’oxygène allégeant les peines. Les années filent et nous laissent leurs fardeaux, leurs maux, transfigurés en douces brises pour raviver et maintenir la flamme créatrice. La nuit est écartée par l’aube attendant le jour pour célébrer l’amour.
Zy Orion vient de publier un fabuleux recueil de poésie « Le temps n’est qu’illusion, l’instant, la création ». Un titre très évocateur qui pousse la réflexion au-delà de l’élan poétique vers un champ philosophique vaste qui embrase la compréhension où s’entrechoquent les certitudes tordant les doutes et les fausses routes.
Pour Baudelaire, le temps est l’ennemi. « La différence entre passé, présent et futur n’est qu’une illusion », disait Einstein. Le tout est lié et dépend de notre perception, le temps s’écoule mais c’est nous qui passons et l’instant bravant tout est à la création bouleversant la raison.
« Le passé et le futur n’existent qu’en relation avec toi ; tous deux ne sont qu’un, c’est toi qui penses qu’ils sont deux. » disait le poète mystique soufi Djalâl-Al-Dîn Rûmî.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes une poétesse qui bouleverse par un élan poétique tranchant l’air ambiant, qui est Zy Orion ?
Zy Orion : Je tenais à vous remercier pour cette amorce littéraire assez évocatrice à mon propos car si je bouleverse poétiquement de cette manière l’air ambiant, je vois les joues de Zy Orion roser de pudeur.
Je suis une rêveuse, une passionnée, une créatrice sans limite qui aime jongler avec les mots, jouer avec les paradoxes et troubler les esprits.
Je suis une hyper-sensible qui colore sa vie de beauté, qui aime s’émerveiller dès l’aube un café à la main, la tête dans les étoiles et l’âme dans l’univers.
Le Matin d’Algérie : Vous écrivez sous un pseudonyme, est-ce pour garder une certaine distance par rapport au réel ?
Zy Orion : Zy Orion est un pseudonyme que j’ai créé avec une amie il y a 8 ans sans savoir que cela deviendrait mon nom de poétesse.
Ce n’est pas un moyen de m’échapper du réel ; c’est le nom d’auteure qui me colle à la peau, une constellation d’émotions.
Le Matin d’Algérie : « Le temps n’est qu’illusion, l’instant, la création » est le titre de votre recueil, c’est une vision philosophique qui bouscule la réflexion et la perception, pouvez-vous nous en parler ?
Zy Orion : Ce titre m’est venu dans l’esprit instantanément ; j’ai ressenti comme une évidence en l’écrivant, une sorte de vérité qui résonnait en moi.
Le temps est une croyance imposée dans les mémoires ; il n’est donc qu’illusion, à partir de là, ce qui compte selon moi c’est la création et l’instant présent.
L’humanité, poussée par la vitesse excessive du rythme effréné du système actuel, en a oublié sa créativité.
Il m’a donc semblé naturel d’écrire cette pensée. Chaque être est né du divin, la création est en chacun.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les poètes qui vous influencent ?
Zy Orion : Pour être complètement franche, je n’ai pas eu d’influence particulière; un soir en 2018 j’ai écrit quelques vers, et je ne me suis plus jamais arrêtée.
J’ai évidemment lu et appris des poésies à l’école, les recueils de Rimbaud, Andrée Chedid, Pablo Neruda, Apollinaire, Ana Akhmatova me parlent beaucoup mais c’est Paul Éluard que j’aime tout particulièrement.
Le Matin d’Algérie : Vous parlez surtout d’amour et du temps qui passe. « Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. » disait Guillaume Apollinaire, qu’en pensez-vous ?
Zy Orion : Apollinaire évoque une dualité entre le temps qui s’écoule comme la Seine et ses souvenirs amoureux qui persistent, comme beaucoup le pensent dans ces moment-là.
À contrario, ma pensée sur le temps est son antithèse : et si le temps n’était qu’un leurre, des minutes qui ne défilent pas, qui se mutent en des secondes qui n’existent pas, une illusion du temps qui nous effraie.
Aucune dualité dans ce cas où l’amour demeure une éternité ; une fenêtre ouverte sur le ciel.
Le Matin d’Algérie : Vos poèmes sont illustrés par de beaux tableaux d’artistes auxquels vous rendez également hommage en parlant d’eux, ce qui accentue le flot d’amour jaillissant de votre livre, pouvez-vous nous dire comment c’est fait la rencontre avec ces artistes ?
Zy Orion : Ma poésie est inspirée par l’image, la majeure partie du temps ; l’évidence m’a donc amenée à cette envie de libérer les mots uniquement sur des œuvres d’artistes à qui j’ai demandé de cocréer avec moi, contrairement à mes quatre premiers ouvrages.
Treize artistes peintres, dessinateurs et sculpteurs, que je salue avec toute ma gratitude, m’ont suivi dans ce projet ; certains sont partis de mes poèmes pour créer, je me suis noyée poétiquement, visuellement dans leurs œuvres.
Je crois que la cocréation est la source originelle ; j’aime profondément le partage de tous les sens, cela génère les plus belles émotions à mon avis.
Nous avons travaillé six mois à distance et je tiens tout particulièrement à remercier Daphné Marlière, écrivain biographe, rédactrice Web SEO sans qui ce projet n’aurait pas vu le jour.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Zy Orion : En effet oui, les projets affluent ces derniers temps à ma plus grande joie.
Je prépare l’arrivée de mon sixième recueil ; un projet de contes pour enfants est en chemin également, des ateliers d’écriture et d’autres idées que j’ai d’ores et déjà en tête vont émerger par la suite.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Zy Orion : La poésie est ma source de vie, je la respire au quotidien, c’est le plus beau cadeau qui m’est offert.
J’espère juste qu’à travers elle, je transmets ce qui me tient le plus à cœur, la beauté de la vie.
Entretien réalisé par Brahim Saci
lematindalgerie.com
Mercredi 3 juillet 2024
……………………………………………………………………………………………………………

Abdelmadjid Adda : « L’Étranger de Camus a été le moteur de mon inspiration »
Abdelmadjid Adda est natif de ce beau village, Ighil Ali chez les Ath-Abbès, situé au cœur du massif montagneux des Bibans, dans la wilaya de Bgayet (Bejaïa), Ighil Ali est un nom qui résonne tant il est porteur d’histoire, un village magnifiquement préservé grâce à la pugnacité de ses enfants. Chaque ruelle de ce village recèle un pan d’histoire.
La commune d’Ighil Ali fut le centre du royaume kabyle des Ath-Abbès, (Avec la Kalâa des Ath-Abbès) qui régna en Kabylie aux côtés du royaume de Koukou à Aït Yahia (actuelle commune de Aït Yahia, dans la wilaya de Tizi-Ouzou). Ighil Ali est donc un joyau architectural qui témoigne d’un riche passé, la casbah ressemble de très près à celle de Constantine ou d’Alger. Quand on évoque Ighil Ali on ne peut s’empêcher de penser à l’illustre famille Amrouche, notamment, Taos et El Mouhoub.
Abdelmadjid Adda, invité de l’écrivain Youcef Zirem au café littéraire parisien de l’Impondérable, a évoqué avec émotion Taos et Jean El Mouhoub Amrouche, pendant les questions du public, un monsieur natif du même village a même évoqué le grand père Amrouche qu’il a connu.
Abdelmadjid Adda a fait des études de droit à l’Université Panthéon Assas Paris II, il a publié un livre étonnant, émouvant, « Le téléphone piégé » où il raconte une histoire vraie, la sienne.
Ce livre est bouleversant, Abdelmadjid Adda se livre avec une dextérité rare. Dans un souci de préservation des traditions l’auteur se retrouve piégé dans les filets d’une histoire conjugale sans égale dans le déchaînement de haine et de violence.
« Le téléphone piégé » est un livre qui interpelle le cœur et l’esprit, pour un avenir réfléchi, apaisé et serein.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes natif d’un village, Ighil Ali des Ath-Abbès, prestigieux, aussi bien par l’art, la culture et l’histoire, vous venez d’ajouter votre pierre à cet enrichissement, en publiant un livre bouleversant, qui est Abdelmadjid Adda?
Abdelmadjid Adda : Père de trois enfants, je suis né au village Ighil Ali, quartier Thazayarth, où j’ai passé mon enfance, c’était la belle époque et la meilleure période de ma vie. À mon arrivée en France j’ai entamé des études de droit à la prestigieuse Université Paris II Assas car mon objectif était de travailler dans la fonction publique mais par la force des choses je me suis retrouvé dans le domaine des affaires.
Le Matin d’Algérie : Vous avez commencé des études de droit à l’Université Panthéon Assas Paris II, mais c’est la littérature qui vous passionne, comment est venue l’idée d’écrire ?
Abdelmadjid Adda : Depuis mon jeune âge j’aimais beaucoup lire et écrire des petites histoires, plusieurs années après j’avais envie de raconter mon histoire tragique mais l’inspiration n’était pas au rendez-vous, un jour je suis tombé sur le livre du grand écrivain Albert Camus, L’Étranger, quand j’ai commencé à lire ce livre, je me suis dit « pourquoi pas moi ? », j’ai trouvé finalement que c’était une histoire simple et que mon histoire pourrait aussi intéresser beaucoup de lecteurs. Je considère, L’Étranger, de Camus comme le moteur de mon inspiration.
Le Matin d’Algérie : « Le téléphone piégé », comment s’est fait le choix du titre ?
Abdelmadjid Adda : franchement Brahim c’est une bonne question, en fait le choix s’est imposé, car c’est ma mère qui s’est fait piéger au téléphone.
Le Matin d’Algérie : On peut dire que vous avez l’art de raconter, mais on sort de votre livre écorché, c’est une histoire déchirante, romanesque, mais vous éclairez quelques ombres de nos traditions, pouvez-vous nous en parler ?
Abdelmadjid Adda : Dans cette histoire je voulais passer plusieurs messages pour que les lecteurs ne tombent pas dans le même piège et j’ai aussi pensé que les gens qui me connaissent ont le droit de connaître la vérité.
Vous savez Brahim, les hommes comme les femmes peuvent être victimes des mariages arrangés, la première cause est liée à nos traditions, mais normalement même si on respecte nos traditions et nos parents, rien n’empêche de réfléchir et de prendre son temps pour prendre ses décisions. Mais les temps ont malheureusement changé, le matérialismes prime sur les valeurs morales.
Je suis content aujourd’hui car j’ai beaucoup de témoignages de lectrices et lecteurs qui se retrouvent dans cette histoire et ça fait vraiment un grand plaisir.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les écrivains qui vous influencent ?
Abdelmadjid Adda : Plusieurs écrivains kabyles, El Mouhouv Amrouche, Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, ils ont écrit des livres qui ont une grande influence sur notre société et on se réfère souvent à eux, même s’ils ne sont plus de ce monde.
Dans ce Roman je me suis aussi inspiré de l’écrivain journaliste Youcef Zirem dans son roman, Les portes de la Mer.
Le Matin d’Algérie : Concernant l’écriture, avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Abdelmadjid Adda : J’ai terminé le premier jet d’un roman avec ma fille Lylia, j’espère trouver le temps de continuer, pour l’avenir j’ai beaucoup de projets notamment une biographie de mon frère disparu.
Livres publiés :
– Le téléphone piégé, Independently published
– Chambre contre services, Independently published
Entretien réalisé par Brahim Saci
lematindalgerie.com
jeudi 27 juin 2024
…………………………………………………………………………………………

Kamel Mezani : « La chanson kabyle manque de création »
Il y a des chanteurs qui forcent l’admiration et qui impressionnent par leur modestie, leur humilité et leur discrétion. Kamel Mezani appartient à cette génération de chanteurs talentueux qui créent et composent sans chercher comme tant d’autres une quelconque gloire.
Kamel Mezani est originaire de Tibecharine de la commune Mizrana, village situé entre Tigzirt et les Aït Ouaguenoun, cette célèbre confédération qui regroupe les tribus kabyles du versant nord du Sébaou, délimité au Nord par la mer Méditerranée, au nord-est par la confédération des Iflissen lebhar à l’est par celles des Aït Djennad et au sud-ouest par les Amraouas et l’Oued Sebaou.
Mais Kamel Mezani a grandi à El Maâchra dans le village de ces grands-parents maternels, dans la commune de Makouda dans l’Aarch Attouche, situé dans la wilaya de Tizi Ouzou, à mi-chemin entre Tizi Ouzou et Tigzirt.
El Maâchra est également le village de Rabah Djaouti connu sous le nom de Rabah Boudjaoud, paix à son âme, un autre grand artiste talentueux reconnu dans la chanson, la comédie et le théâtre parti hélas trop tôt. Rabah Boudjaoud avait une forme d’humour bien particulière qui décrivait si bien la société et l’esprit kabyle.
Kamel Mezani a côtoyé de grands noms de la chanson kabyle, Hamidouche, Rahim, Matoub Lounès paix à leur âme, qu’il interprète brillamment. « Leur absence laisse un énorme vide artistique » me confie-t-il.
Kamel Mezani fût très proche de Rahim et de Hamidouche avec qui il a partagé l’amitié et l’amour de l’art, il n’oublie d’ailleurs jamais de leur rendre hommage dans ses concerts en interprétant leurs chansons.
Chanteur-auteur-compositeur animé par la passion et le souci de bien faire, il excelle dans l’art de la composition et du chant, il a un grand sens du rythme, si ses chansons invitent à la danse, elles invitent aussi à la réflexion par un verbe tranchant élevé et recherché interpelant le cœur et l’esprit dans une langue kabyle magnifiée dans un élan poétique et musical envoutant.
Kamel Mezani n’est pas seulement un artiste de talent, il est aussi un homme d’une générosité rare, il connaît et vit dans l’harmonie des valeurs kabyles.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un chanteur talentueux, vous avez le sens du rythme, vous excellez dans la composition, vous émerveillez votre public, depuis maintenant de longues années, qui est Kamel Mezani ?
Kamel Mezani : Je vous remercie, mais en réalité je ne suis qu’un poète, qui chante et compose depuis de longues années pour en premier lieu écarter l’ennui, l’exil et la solitude, aller au-delà des mots, pour saisir des sens et des couleurs que seuls la poésie, la musique et le chant permettent une approche pour espérer appréhender l’insaisissable pour ciseler à travers le chant un chemin vers un jardin de floraison d’équilibres et d’harmonies, vers un idéal commun, l’espoir.
J’essaie d’apporter un renouveau dans le regard, pour accepter le soi afin de s’améliorer pour un avenir prometteur où cesseront les injustices, c’est un cri qui résonne dans mes chansons.
J’ai sorti ma première cassette en 1996 à Paris dans le 18ème arrondissement chez Diane Music (Denise Laborie), une cassette sortie aussi en Algérie, l’accueil du public fut chaleureux, puis ce fut un long silence jusqu’à l’enregistrement d’autres albums, 2002, 2006, 2010 et 2016.
J’ai travaillé avec beaucoup de chanteurs kabyles qui sont aussi mes amis, dont Rahim paix à son âme, Ali Ferhati, Moh Oubelaid, Ahmed Amzal et d’autres.
Et je contenue depuis, tant bien que mal ce chemin de la chanson remplis d’embuches et d’obstacles.
Le Matin d’Algérie : Racontez-nous vos débuts dans la chanson ?
Kamel Mezani : C’est une longue histoire, en fait mon grand frère Slimane chantait depuis les années soixante-dix, lui-même a commencé très jeune la chanson, il n’a pas enregistré mais il animait des fêtes, il a tout de même composé quelques chansons qu’il chantait avec des jeunes du village. Il chantait avec des jeunes de l’époque, de sa génération, comme Amrous Ahmed qui a aussi beaucoup chanté. Il y a aussi Youcef Hadid, Yidir Saadoune, Moh Ourezki Saadoune, qui chantaient et animaient des fêtes.
Je me souviens de la venue de Belkhir Mohand-Akli paix à son âme, au village, il a invité sur scène Moh Ourezki Saadoune qui avait d’ailleurs le look de Louis Aït-Menguellet avec les moustaches. J’étais donc dans un environnement propice à la création artistique, la passion pour la musique et le chant était née.
Le Matin d’Algérie : Il y a eu l’immense artiste Ahcène Mezani paix à son âme, est-ce que le fait de s’appeler Kamel Mezani vous a aidé ?
Kamel Mezani : Oui certainement, c’est ce qu’on me dit souvent et c’est ce que je crois aussi. C’est évidemment un honneur de porter le même nom de famille. Ahcène Mezani paix à son âme a laissé une empreinte éternelle dans la chanson kabyle, il nous a laissé des chansons de toute beauté. J’essaie à mon tour d’être à la hauteur en privilégiant la qualité sur la quantité.
Quand j’ai commencé à enregistrer, le chanteur Moh Bouchiba, m’a conseillé de m’appeler Kamel Rawes en hommage au chanteur Arezki Rawes de son vrai nom Arezki Chabli originaire de Agouni Hemiche (Tala Bouzrou)
Arezki Rawes décède à l’âge de 25 ans le 29 octobre 1987, avec trois de ses amis dans un accident de voiture, à la sortie de Tizi Ouzou, laissant derrière lui trois cassettes.
Selon Moh Bouchiba le nom de « Kamel Rawes » m’aurait permis de mieux me faire connaître, je raconte le conseil de Moh Bouchiba juste pour l’anecdote, car le rapprochement avec le chanteur Ahcène Mezani était déjà un honneur, j’ai alors décidé d’être juste moi-même.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes très connu, pourtant on vous voit très peu sur les grandes scènes, pourquoi à votre avis ?
Kamel Mezani : Il me semble malheureusement qu’il n’y a qu’un seul cercle apparent, ce sont toujours les mêmes qui tournent mais cela incombe aux organisateurs de spectacles qui n’essaient pas d’élargir leur vision afin de donner la chance à d’autres.
On a ainsi même habitué le public à n’écouter qu’un seul son. Il y a aussi une certaine forme d’égoïsme, on se connait tous, mais celui qui a accès à une scène il veut la garder pour lui, comme une chasse gardée. Cette façon de faire appauvrit notre culture et n’agrandit pas ceux qui se comportent ainsi. L’histoire se souvient de tout.
Le Matin d’Algérie : Quel est votre regard sur la chanson kabyle d’aujourd’hui ?
Kamel Mezani : Il y a beaucoup d’espoir. Il y a une jeunesse rayonnante qui excelle dans le chant ou la musique, il y a de belles voix. Il y a juste un manque de créations, la chanson kabyle manque de création.
Il faudrait travailler les voix et arrêter avec les « effets robotiques », cela dénature la musique et la création artistique. On ne peut pas éternellement tricher. La chanson demande des efforts, dans la musique, dans la voix et le texte, nous avons des bons musiciens, de bons compositeurs, de bons paroliers et poètes ; tous les ingrédients sont là pour insuffler de belles créations.
Nous souffrons aussi d’un manque de fraternité, maintenant chacun tire la couverture à lui, chacun veut devenir une star.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Kamel Mezani : Les projets foisonnent, je prépare actuellement un CD de dix nouvelles chansons, cela fait un moment que je travaille dessus, j’espère avoir la force cet été pour mener à bout ce projet enregistré chez Irath Music en Algérie.
C’est un projet de longue haleine car j’aime beaucoup l’acoustique et il faut pour cela réunir les meilleurs musiciens, je suis optimiste quant à la qualité de ce CD une pléthore de jeunes musiciens et arrangeurs de talents qui sont capables et aptes à comprendre et à saisir la moindre nuance pour en augmenter les couleurs et la portée émotionnelle. Je tiens à préciser que ces chansons sortiront sous forme de clips, car il faut savoir s’adapter aux exigences de l’époque et ses moyens modernes pour répondre aux différentes plateformes de diffusions.
Les thèmes abordés sont variés, il y a évidemment l’amour, la société avec sa vision politique et humaine et la joie sans qui tout paraîtrait fade et amer.
Il y a aussi une chanson sur la JSK, cette équipe quasi légendaire et mythique qui symbolise l’union autour du combat identitaire berbère, d’où jaillissent des bonheurs, des pleurs et des espoirs.
J’ai également plusieurs dates de concerts cet été, des fêtes, des rencontres en Algérie comme chaque année.
Pour la suite, d’autres projets attendent pour se concrétiser car je continue à créer et à composer.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Kamel Mezani : Merci pour m’avoir donné l’occasion de m’exprimer, mon souhait le plus profond, qui me tient le plus à cœur et celui de la fraternité entre nous. Ce dresse un triste constat de la réalité actuelle, un individualisme grandissant semble séduire la plupart, chacun tire les choses vers soi, le froid de l’hiver envahit les cœurs et les esprits. J’espère que les prisonniers d’opinion retrouveront la liberté pour retrouver leurs familles et leurs proches pour que revienne la vie avec ses espoirs retrouvés. Il est temps que prenne fin les injustices pour que la joie retrouve sa place dans chaque cœur.
Entretien réalisé par Brahim Saci
lematindalgerie.com
Jeudi 20 juin 2024
……………………………………………………………………………………………………

Crédit photo : Kada
Elisa Biagi : « Le village est fondamental »
Le 17 mai 2024 à 19h, il pleuvait à Paris, le métro était bondé, j’ai dû me résoudre à prendre un taxi pour arriver à l’heure, je suis arrivé en avance, il y avait déjà beaucoup de monde qui attendait, impatient, l’ouverture des portes.
J’ai ainsi retrouvé devant le théâtre Pixel l’ami Kada, berbère chaoui grand militant de la cause berbère, excellent photographe et le grand artiste peintre Abderrahmane Ould Mohand, nous avons pu échanger quelques réflexions sur l’art.
J’ai enfin pu voir la célèbre pièce de théâtre écrite et interprétée par la talentueuse Elisa Biagi, Le fil rouge, un accueil très chaleureux me fut réservé. Il restait encore une date pour les prolongations, le 24 mai 2024 à 19h.
Le « Fil rouge » est ce fil reliant les générations, si le rouge évoque la couleur du sang, c’est aussi la couleur du crépuscule et de l’aube ouvrant le champ à tant d’espoirs.
Une heure de pur bonheur, un merveilleux voyage où l’émotion est élevée à son paroxysme, nous avions tous les yeux brillants par les larmes retenues, Elisa Biagi, la petite-fille du valeureux si Lhafidh, Abdelhafidh Yaha, paix à sa belle âme, était remarquable par son jeu bouleversant, si vrai, si puissant. On a pu remarquer sa belle voix, envoûtante, puissante, quand elle entonne un chant lyrique en kabyle.
Cette pièce force l’admiration, tout était magique, le jeu, l’interprétation d’Elisa Biagi, la musique de Laurie-Anne Polo, la mise en scène d’Anaïs Caroff.
Elisa Biagi raconte un pan douloureux de l’histoire de la guerre d’Algérie, l’histoire émouvante de sa grand-mère Nouara Yaha qu’aucune épreuve n’a pu briser, cette femme courageuse, connaissant le prix de l’honneur et de la dignité, suivant les pas de son mari le célèbre Abdelhafidh Yaha combattant résistant.
C’est aussi un hommage à la femme, à ses luttes, à son courage, à son sacrifice durant la guerre, c’est également un hommage à l’illustre famille révolutionnaire Yaha, qui a combattu pour faire tomber le joug du colonialisme français.
Nous étions attentifs et bouche bée devant ce monologue captivant, les sens en alerte pour ne rien rater, ni un souffle, ni une respiration, ni un son, ni un mouvement.
« Il y avait un autre peuple qui vivait là, mais il ne nous côtoyait pas… »
Cette phrase a résonné déchirant l’air comme la lame du glaive, tranchant le cauchemar, arrachant le rêve pour qu’un jour le soleil se lève.
Si Lbachir, l’arrière-grand-père, fut gazé par l’armée française, dans une grotte où il s’est réfugié plusieurs jours résistant avec son seul fusil de chasse. La maison de la famille Yaha fut brûlée, Abdelhafid, le grand-père est au maquis, la famille recherchée, tente de se réfugier chez des amis dans d’autres villages, rattrapée elle subit la torture.
Feu Abdelhafid Yaha est ce brave homme valeureux révolutionnaire, d’une gentillesse, d’une générosité inouïe, que j’ai eu la chance de croiser à Paris, il a laissé deux livres d’une importance majeure pour la recherche, la mémoire et la vérité historique, coécrits avec le journaliste Hamid Arab, « Guerre d’Algérie 1954-1962 » chez les éditions, Riveneuve, et, FFS contre dictature, de la Résistance armée à l’opposition politique, chez les éditions Koukou.
Elisa Biagi rend hommage à sa grand-mère maternelle, à la famille Yaha, aux femmes combattantes gardiennes des traditions et des libertés, dans un cri, un écrit époustouflant, d’une justesse et d’une vérité inouïes, laissant le public dans l’admiration, l’émerveillement et les larmes, tant l’émotion est grande et les messages véhiculés résonnent à travers le temps pour garder la réflexion et le cœur en éveil par-delà les épreuves.
La petite-fille et sa grand-mère se retrouvent reliées par un fil rouge, s’écoulent alors la transmission et l’héritage défiant les orages pour un ciel sans nuages.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes une comédienne et une écrivaine de génie, musicienne, on a eu un aperçu de votre talent de conteuse, de chanteuse, qui est Elisa Biagi ?
Elisa Biagi : J’ai commencé le théâtre à huit ans, mes parents pensaient qu’il s’agissait d’un simple passe-temps mais au fur et à mesure que les années passaient je continuais à vouloir en apprendre plus. J’ai donc aussi pris des cours de chant, de piano, fait des stages à l’étranger dès mon plus jeune âge.
Après un an d’école de cinéma à Rome, où j’ai grandi, j’ai été prise au Cours Florent à Paris où j’ai été formé pendant trois ans au théâtre français et anglais avec une double formation.
Le Matin d’Algérie : Le fil rouge est l’histoire de votre grand-mère maternelle, c’est un cri, un écrit puissant, douloureux, écorché mais en même temps rempli de vie et d’espoir, racontez-nous ?
Elisa Biagi : Quand je suis arrivée en France, il y a quatre ans, j’ai eu l’énorme chance de pouvoir passer énormément de temps avec ma grand-mère. J’ai été élevée dans une famille où l’on a toujours beaucoup parlé de politique.
Ma grand-mère est une femme incroyablement forte qui a toujours parlé de politique et a été un soutien immense pour mon grand-père.
Il m’était nécessaire de raconter son point de vue. À travers elle, je raconte non seulement ses souffrances, mais aussi celles de toutes les femmes algériennes pendant cette période. Bien évidemment ce spectacle parle de toutes les femmes, en toute guerre, d’hier, d’aujourd’hui et malheureusement de demain. C’est à nous, en racontant leur histoire, d’essayer d’interrompre le cercle de la haine.
Le Matin d’Algérie : Votre grand-père Abdelhafidh Yaha, dit Si Lhafidh, fut l’un des fondateurs du Front des forces socialistes avec Hocine Aït Ahmed. Il était officier de l’Armée de libération nationale (ALN) et un symbole de la lutte révolutionnaire. Il a toujours défendu et souligné le rôle déterminant et le sacrifice des femmes pendant la guerre d’indépendance, que l’histoire en général et les hommes en particulier tendent à oublier ou à minimiser. Vous, vous rendez hommage à toutes ces femmes, est-ce pour leur rendre justice ?
Elisa Biagi : On connait tous les noms des grands hommes de la Révolution, ceux-là même qui ont donné leur vie dans la lutte pour la Libération. Mais même si certaines femmes ont été reconnues pour leur lutte, beaucoup d’autres, sont restées dans l’ombre, et en quelque sorte censurées, effacées.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes Italo-Algérienne, vous êtes née à Rome, vous rendez hommage à votre grand-mère italienne musicienne et à votre grand-mère algérienne kabyle, poétesse conteuse, à votre village Takhlijt Ath Atsou, où Fadhma N’soumer, l’héroïne de la résistance contre l’occupant français, a livré sa dernière bataille, est-ce important pour vous le village ?
Elisa Biagi : Le village est fondamental. Comme je dis dans le spectacle, j’ai eu la chance de passer mes étés entre deux villages : Pianaccio, en Italie, village des Partigiani (résistants pendant la Seconde Guerre mondiale) et Takhlijt Ath Atsou où Fathma n’Soumer et l’ensemble des femmes du village sont arrêtées en 1857.
Mon enfance a été marquée par les fêtes du village, les énormes figuiers sur lesquels je grimpais pour cueillir les fruits, ma grand-mère qui nous attendait à notre arrivée et notre grand-père qui nous amenait nous promener là où quelques années auparavant, ils avaient affronté l’armée française. Ce village, perdu dans les montagnes, et avec lui toutes ces femmes et tous ces hommes qui y vivent, sont pour moi ma maison et ma force.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur la musicienne Laurie-Anne Polo et la metteure en scène Anaïs Caroff qui vous accompagnent
Elisa Biagi : J’ai eu l’immense honneur de pouvoir travailler avec deux femmes incroyables. J’ai rencontré Anaïs en première année des Cours Florent. On a fait notre première scène ensemble et on ne s’est plus quittée depuis.
Quand j’ai écrit le texte, choisir Anaïs à la mise en scène était évident. On a opté pour une mise en scène très épurée. Le rôle d’un metteur en scène est aussi de diriger un acteur et elle a été capable de me diriger tout en restant à l’écoute de ce que je voulais raconter, et cela, sans déformer, ou modifier mon récit.
Ça a été un travail de symbiose.
Laurie-Anne est rentrée dans le projet quelques mois avant la première (le 1er octobre 2023). Au début on ne savait pas si on voulait une musique live ou pas, après quelques conversations ça a été évident.
En principe, elle ne devait jouer que de la flûte traversière (instrument qu’elle a appris en deux semaines). Ensuite, quand elle est devenue partie intégrante du projet elle a commencé à travailler sur un véritable habillage sonore, en rajoutant la batterie et la kalimba et en travaillant un bruitage live. Son travail est extraordinaire. Je suis très chanceuse de pouvoir partager cette expérience avec toutes les deux.
Le Matin d’Algérie : Quelles sont les personnalités du monde du théâtre français, italien et algérien qui vous influencent ?
Elisa Biagi : En ayant baigné dans les trois cultures, depuis toute petite, je pense qu’au début, je ne faisais même pas de distinction sur ce que j’écoutais à la maison, c’était normal de passer de Matoub à Lucio Dalla et à Aznavour.
Je pense m’être inspirée beaucoup plus du cinéma dans cette pièce, même si des auteurs comme Mouawad, Kateb Yacine et la mise en scène de Massimo Popolizio ont été très importants dans mon travail.
Wajdi Mouawad, a joué un rôle fondamental dans ma pièce. Quand je suis arrivée en France, j’ai essayé de récupérer tous les auteurs contemporains qu’on mentionnait en cours. Mouawad était une de ces références. Son écriture m’a fascinée, après avoir lu tous ses livres et avoir vu sa pièce « Mère » au Théâtre de la Colline, je me suis sentie comprise. Cette bi-nationalité dont je parle dans la pièce, le thème de la guerre, de la famille, de la quête identitaire (comme dans sa pièce « incendies ») … tous ces thèmes me parlaient énormément, et c’était tout ce dont je parlais dans mon spectacle. J’adorerais pouvoir travailler avec lui un jour.
Comment ne pas parler de Kateb Yacine c’est évident que ses créations, renvoient à la même matrice, même si l’exécution est totalement différente. Je citerais « Nedjma » et le recueil des trois œuvres « Le cercle des représailles ».
L’Italie, tout comme la France, a une histoire théâtrale ancestrale, je pense que cette culture est ancrée en moi. Je ne saurais pas dire quels auteurs m’ont inspiré le plus, l’écriture directe et réaliste de Verga, les intrigues de Pirandello, le social de Moravia et l’Histoire d’Elsa Morante.
Tout inspire, tout crée un lien « Le fil rouge » est aussi ce mélange culturel.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Elisa Biagi : Je pense que « Le fil rouge » ne va pas s’arrêter là, nous sommes en attente de réponses que ce soit en France, mais surtout en Algérie ou je rêverais de jouer la pièce, je suis aussi en train d’écrire la version italienne du texte, ce n’est pas une traduction, mais vraiment une réécriture. J’ai récemment joué dans le dernier film de Rachid Benhadj, un metteur en scène que j’estime énormément, dans le film « Belouizdad » produit par l’ENTV.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Elisa Biagi : J’aimerais remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec nous et qui ont rendu ce spectacle possible. J’aimerais aussi remercier les personnes qui sont venus nous voir au Théâtre Pixel (plus de 300 personnes), ma famille qui m’a soutenu depuis le début et qui me soutient encore maintenant. Mais surtout je remercie encore et encore ma grand-mère qui nous permet de raconter son histoire afin que la lutte de ces femmes ne tombe pas dans l’oubli.
J’aimerais laisser aussi les derniers mots à ma metteuse en scène Anaïs Caroff :
« Il est des histoires qui non seulement méritent d’être racontées mais surtout d’être entendues. Car il n’y a qu’en se mettant à la place de ceux qui ont vécus l’Histoire, celle des humains, celle de la chair, celle qui n’est pas écrite, celle qui n’est pas dite; qu’on peut se comprendre. Se comprendre entre nous et soi-même.
Qu’on le veuille ou non, nous sommes la somme de nos ancêtres, nous portons leurs horreurs, leurs joies, leurs victoires, leurs défaites, leurs lâchetés et leurs courages. Il n’y a qu’en parlant et surtout en écoutant qu’on peut soigner l’humanité. Car les blessures d’hier qui n’ont pas été pansées deviennent les haines de demain et toutes les trajectoires de vie sont des parallèles. »
Entretien réalisé par Brahim Saci
Vendredi 31 mai 2024
lematindalgerie.com
…………………………………………………………………………………

Emmanuelle Vanwinsberghe : «L’artiste a un devoir de beauté envers le monde »
Emmanuelle Vanwinsberghe est une artiste peintre poète qui porte dans les yeux le ciel, la terre, le soleil et l’univers, tant son regard est bienveillant irradiant ce qui l’entoure de lumière, celle rare des arts où la couleur prédomine.
Emmanuelle Vanwinsberghe est d’une famille où l’art se transmet de génération en génération, son père et sa mère sont de célèbres artistes peintres, Jacques Winsberg et Angele Gage. Mais l’héritage familiale ne suffit pas, c’est comme le don si l’on ne le cultive pas.
Emmanuelle Vanwinsberghe n’a jamais cessé d’apprendre et de s’améliorer pour atteindre les cimes afin de mieux percevoir et saisir le cacher et l’apparent dans un élan transcendant la réalité vers la vérité.
Une force quasi-spirituelle qui élève le génie créateur d’Emmanuelle Vanwinsberghe se dégage de ses tableaux, où les couleurs se mêlent et s’emmêlent comme pour tordre et bousculer la pensée et les certitudes tout en écartant le doute de chaque route pour accéder à l’union, le tout dans l’un, vers la voie, le chemin.
Emmanuelle Vanwinsberghe est une artiste vraie qui sait combien le souffle est fragile, elle sourit au jour naissant sans se soucier du temps, son regard rempli des arts sait saisir l’essentiel de l’instant, peuvent bien souffler tous les vents.
Le Matin d’Algérie : Vos créations sont de toutes beauté, qui est Emmanuelle Vanwinsberghe ?
Emmanuelle Vanwinsberghe : Il est très complexe de répondre à cette question ! (Rires…). Faut-il obligatoirement se définir au travers de ce que nous faisons de ce que nous produisons même artistiquement parlant ? Des fois la vie nous enfante au travers de rencontres humaines aussi bien que lors de rendez-vous divins. Ce sont des éclats de beauté semés çà et là sur notre chemin. De cette manière la vie nous transforme.
Spirituellement, je suis née à vingt-cinq ans et, c’est à l’intérieur de cet élan nouveau que j’aimerais pouvoir me définir ici.
Qui suis-je ? Une âme vivante cherchant à s’abandonner au mieux à son Créateur. Et c’est un véritable combat ; Le cœur humain a tellement de mal avec cet abandon là… Notre humanitude est souvent bien trop velléitaire !
Le Matin d’Algérie : Les couleurs occupent une grande place dans vos tableaux, mais il y a aussi des contrastes, Il y a un jaillissement d’émotions qui ne peut échapper à l’œil et le cœur du spectateur dans un ravissement inégalé, comment faites-vous ?
Emmanuelle Vanwinsberghe : Effectivement, les couleurs ont une place prépondérante dans mes tableaux. Mais la construction, le cadrage, la composition est très choisie ; elle est volontaire.
L’abstraction n’est pas juste un amalgame de couleurs chatoyantes. Des artistes comme Bonnard ou Vuillard (peintres impressionnistes) ont frôlé l’abstraction mais leur travail de composition en reste très rigoureux.
Pour ma part l’équilibre ou, le déséquilibre d’un tableau n’est pas le fruit d’un lyrisme chromatique récréatif.
Bien que sensible au réel (je pense à l’art figuratif) mon choix est au paysage intérieur. L’exprimer c’est tenter de restituer des émotions par la couleur, certes. Le mouvement, cette énergie de vie doit circuler. L’inspiration y est primordiale. S’il est exact que la peinture abstraite est intériorité, son jaillissement réclame un souffle mystérieux.
La respiration, l’espace, l’air étranger doit bouleverser nos constructions intérieures ce qui demande un abandon certain. (Rires…). C’est toujours une histoire d’abandon de soi !
Le Matin d’Algérie : Chaque époque a ses blessures et ses tempêtes, particulièrement la nôtre, où les libertés sont sans cesse menacées, l’illusion et l’image deviennent un moule qui s’impose, l’artiste est le fils du vent, il est indomptable, comment survit-il à ses changements des sociétés ?
Emmanuelle Vanwinsberghe : Pour ma part je me sens très mal-à-l’aise dans mon époque. Je fais de la résistance à ma façon, avec au cœur la fameuse fleur qui surgit du canon d’un fusil.
Vous trouvez ça ridicule ? Je porte en moi cette parole de sagesse : » Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux ».
Hugues Robert : « La colonisation est un crime contre l’humanité »
D’autre part, je consacre beaucoup d’amour et de soin aux toutes petites choses du quotidien. Ce sont les tout-petits riens souvent à peine visibles qui font toute ma joie. Le meilleur acte de résistance c’est la joie, et la paix intérieure aussi.
Le Matin d’Algérie : La création artistique est intemporelle, notamment la peinture, quels sont les peintres qui vous influencent ?
Emmanuelle Vanwinsberghe : Bien sûr, très jeune j’ai été éblouie par l’expressionnisme abstrait. Je pense à des peintres comme Antoni Tapiès, Rothko. Mes goûts sont très éclectiques, j’aime tellement Veermer, Rembrandt, Fra Angélico pour n’en citer que quelques-uns. Mais au final je pense avoir été plus certainement influencée par les écrivains.
Découvrir l’univers mental du Raskolnikov de Dostoïevski a été décisif. Romain Gary, Albert Camus, Émile Bernard, Boris Vian, Rainer Maria Rilke également, ainsi que Christian Bobin et François Chang. Je respire encore beaucoup aujourd’hui par l’œuvre écrite d’Isaac Bashevis Singer.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes aussi poète, racontez-nous ?
Emmanuelle Vanwinsberghe : La poésie est venue en moi très tôt, avant même mon alphabet. Mon père qui adorait et mémorisait avec aisance la poésie, déclamait. C’est un héritage oral. Molière, Racine, Baudelaire, Rimbaud, Garçia Llorca…
Grâce à mon âge avancé, j’ai le souvenir d’avoir été trimballée à Paris dans une soirée chez le peintre Hankel (fils du peintre Kikoïne) où se mêlait aux peintres le dernier bastion des surréalistes. Étaient-ce Philippe Soupault, René Char ? J’étais tellement enfant, je ne suis sûre de rien. Mais, l’éblouissement était là.
Mes goûts en matière de poésie ? Éluard me chavire, Chang, Bobin. J’ai un amour infini pour Flaubert que je considère comme poète. Lisez-le à voix haute: quel phrasé! La beauté des livres poétiques de la bible surpasse tout entendement.
Le livre de Job reste mon poème de référence…
Le Matin d’Algérie : Dans la famille Van Winsberghe l’art se transmet comme par magie, parlez-nous de vos parents, Jacques Winberg et Angèle Cage, ces célèbres peintres, qui ont laissé une empreinte profonde dans le monde de la peinture.
Emmanuelle Vanwinsberghe : De la famille, je ne pense pas qu’il y ait un don génétiquement transmissible ! Cependant, pour ma sœur mon frère et moi, il est certain qu’ayant grandis dans le monde pictural conjugué de nos parents, nos regards se sont ouverts à une certaine forme de beauté. Et à un art de vivre aussi.
Mes parents étaient des Parisiens qui ont fuis les mondanités de la capitale dès la fin des années cinquante. En effet, mon père Jacques Winsberg, issu de la seconde école de peinture de Paris et, après avoir obtenu le Prix de la Jeune Peinture, a rejoint sa terre de prédilection la Camargue. Ma mère Angèle Gage, artistiquement, s’est nourrie également de l’Espagne et d’autres pourtours méditerranéens.
Ce sont dans ces terres arides, faites d’oliviers, d’amandiers et de garrigues qu’en Provence nous avons vécu. Dans le mas familial, mes parents accueillaient des amis, des artistes et entre autres les Gitans d’Avignon et ceux d’Arles que ma mère a beaucoup dessinés et peints…
Le Matin d’Algérie : Un mot sur votre frère, Louis Winsberg, célèbre guitariste, et votre sœur Nathalie Van Winsberghe, artiste partie trop tôt, paix à son âme.
Emmanuelle Vanwinsberghe : Mon frère Louis Winsberg (qu’on ne présente plus), issu du jazz a poursuivi musicalement les amours méditerranéennes si chères à nos parents.
Louis, le 2 octobre qui vient jouera à La Cigale à Paris au sein de Sixun, le groupe mythique de jazz-fusion français.
Nathalie, ma sœur aînée, je me souviens, était douée dans beaucoup de disciplines artistiques comme le dessin, la peinture, la danse, le théâtre mais aussi le chant, l’écriture et la photo. Son désir ultime était de jouer du violoncelle…
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Emmanuelle Vanwinsberghe : Depuis 2018, je construis peu à peu une série de photographies abstraites sur le thème de la trace du temps. Ces images vont être fixées dans de précieux boîtiers, illuminés de l’intérieur afin d’obtenir un effet vitrail.
Comme autre travail en cours, mûrit un recueil de textes poétiques intitulé « Portraits d’artistes ».
Avec mes photos donc, je fais des objets lumineux enchâssés dans un écrin et, au travers de mes poèmes je tente l’insaisissable capture d’âme, toute en tendresse de mes bien-aimés.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Emmanuelle Vanwinsberghe : Le mot de la fin ? L’artiste, je pense a un devoir de beauté envers le monde. Il a également un devoir de vérité; l’artiste est non seulement légitime lorsqu’il élargit les cœurs, mais surtout lorsqu’il parvient à dilater les consciences, n’en déplaise à certains ! Il est important pour l’artiste de se moquer de toute gloriole personnelle : c’est mieux ainsi !
L’artiste je précise, a un devoir d’intelligence « de vie ». Celui de se présenter en offrande à une humanité souvent ternie par une certaine fatigue à penser, à aimer. Un bien tragique oubli en chemin de cette si précieuse détermination à devenir un être humain accompli.
Je voudrais terminer ici, en citant à ce sujet la pensée de Christian Bobin :
« L’intelligence n’est pas une affaire de diplômes. L’intelligence est la force solitaire, d’extraire du chaos de sa propre vie la poignée de lumière suffisante pour éclairer un peu plus loin que soi. »
Entretien réalisé par Brahim Saci
Mercredi 29 mai 2024
Lematindalgerie.com
………………………………………………………………………………………

Claire Tencin : « Nos actes ne cessent jamais de nous poursuivre »
Il y a des écrivains qui brillent par le talent et l’humilité, dont l’écriture tranche comme le glaive loin des sentiers battus et l’air du temps, Claire Tencin en fait partie.
L’écriture de Claire Tencin est vraie. Elle accapare, elle émeut, elle bouleverse, toujours dans un élan sans cesse revivifié maintenant la flamme, poussant la réflexion à son paroxysme pour ne rien manquer, ni le champ vaste du cœur, ni celui l’esprit.
Son écriture est sans concession et s‘affranchit des contraintes et servitudes de l’époque, elle prend son envol libre, battant des ailes comme pour nous rappeler que tout n’est pas perdu pour la libre pensée.
Claire Tencin est habitée, par la littérature, elle est Professeure de Lettres et de Français Langue Étrangère, elle revient à Paris après avoir passé des années en Inde dans le cadre de son travail de recherche en littérature.
Dans les deux récits, Je suis un héros, J’ai jamais tué un bougnoul (2012) et Affreville (2023), l’écriture de Claire Tencin est courageuse et engagée. On ne peut s’empêcher de penser à Albert Camus, au discours de Suède, à Boris Vian, Le Déserteur, à Eugène Ionesco, Rhinocéros, à Robert Desnos, ce cœur qui haïssait la guerre, à George Orwell, La ferme des Animaux.
Après avoir activement participé à la revue l’Atelier du roman et Diacritik, elle se consacre actuellement à sa mission de jury pour le Grand prix Afrique de 2025.
Le Matin d’Algérie : Vos livres bousculent et sortent des sentiers battus, qui est Claire Tencin ?
Claire Tencin : Je me considère comme une apprentie-écrivaine à chacun des livres que j’entreprends. Pour moi, il s’agit d’inventer une langue qui se prête comme un vêtement taillé sur mesure au sujet que je cherche à appréhender avec le « courage de la vérité » pour reprendre l’expression de Michel Foucault.
Je crois que la littérature doit être le lieu d’une parole juste et inouïe à rebrousse-poil des codes et de la doxa à la mode telle qu’elle s’impose dans les courants de pensée actuels qui jouent comme des leviers d’autocensure sur les auteur-e-s. Par ailleurs, les bureaux de sensitive readers qui s’installent depuis quelque temps dans les maisons d’édition s’apparentent de plus en plus à des appareils de censure dont on ne peut ignorer l’impact sur la liberté d’écrire.
Je prends plaisir à écrire en caressant à rebrousse-poil les attentes de l’air ambiant lisse et droit dans ses bottes. C’est en entrant dans mes personnages par le point de vue aveugle que je tâtonne à mains nues vers la langue à venir. Pour Affreville, j’ai excavé d’outre-tombe la voix de mon père là où elle m’emmenait en enfer et je l’ai ramenée à la surface des évidences comme une réparation contre la doxa morale.
La langue dans ce sens-là devient le personnage principal de mon écriture, comme dans un de mes récits Le silence dans la peau (2016), où j’explore l’indicible « mauvaise mère » par la voix d’un personnage que j’ai appelé tout simplement Le Récit.
Le Matin d’Algérie : Tous les professeurs de littératures n’écrivent pas, d’où vous vient cette passion pour l’écriture ?
Claire Tencin : Dans mon enfance, je rêvais déjà d’être écrivaine sans doute parce que j’étais une petite fille très solitaire. Dès que j’ai appris à lire, je me suis retirée dans les livres qui m’ouvraient un horizon tout aussi réel qu’imaginaire. Je ne sais pas si on peut appeler l’écriture « une passion » en ce qui me concerne, je dirais plutôt une nécessité, un besoin qui discipline ma vie et lui donne une orientation vitale.
Et pour parvenir à me sentir vivre, je me fixe l’enjeu d’aller sur des chemins de traverse et de me laisser surprendre par l’idée que je poursuis… je préfère m’exposer au danger d’être incomprise ou ignorée plutôt que de suivre la grande route sans embûches, comme j’ai entrepris de le faire avec mes deux récits Affreville et Le silence dans la peau. Je crois qu’on écrit ce que l’on est au final…
Le Matin d’Algérie : Après la publication de, Je suis un héros : J’ai jamais tué un bougnoul, vous publiez Affreville, qui est l’ancien nom de la commune de Khemis Miliana dans la wilaya de Aïn Defla en Algérie, où votre père était gendarme de 1954 à 1960. Ces deux livres intimes, courageux, où vous tentez d’interroger l’histoire sur la guerre d’Algérie à travers votre père dans un récit bouleversant sur les affres de cette guerre et des séquelles et souffrances engendrées, vous avez su dépasser les préjugés, stéréotypes et l’histoire officielle, comment avez-vous fait ?
Claire Tencin : J’ai vécu avec la guerre d’Algérie depuis l’enfance sans savoir qu’elle était à l’origine du mal de vivre de mon père pour ne pas dire de son désordre mental. Après sa disparition brutale, le premier récit que j’avais écrit (et qui est paru en 2012), Je suis un héros, je n’ai jamais tué un bougnoul, a été propulsé de mon corps avec une fulgurance inattendue.
C’est comme si une voix avait usé de ce passage pour exprimer les non-dits, et ce n’est pas tant un « je » qui se dit qu’un « nous » autour duquel se sont agrégés des mots à inventer contre le silence : celui de mon pauvre père, celui de notre passé colonial et celui de ma génération. Toute mon adolescence et le ressentiment que j’avais entretenu se sont échappés d’un bond de ce trou noir après que sa mort m’avait libérée de ce que j’avais cru connaître de lui.
Pendant des décennies, l’histoire officielle en France a forcé au silence ceux qui ont survécu à la guerre d’Algérie en faisant la sourde oreille à leur mal être et leur souffrance indigne. L’usage de la torture comme arme de guerre et les exactions commises sur les populations autochtones ont marqué au fer rouge les hommes que l’on a envoyés en Algérie.
Ce récit n’a pas de vocation politique même si toute écriture s’avère politique malgré elle. Il s’évertue au sens moral du terme à bâtir un récit familial et universel sur ce que la guerre fait aux enfants et fouille l’intimité d’un rapport qui ne fait pas rapport entre une fille et son père en posant la sempiternelle question de l’origine. La narratrice est-elle la progéniture d’un héros ou d’un tortionnaire de guerre ?
Aujourd’hui, ce qui fait rapport entre lui et moi, c’est ce récit que j’ai écrit et que je publie parce que mon histoire est l’histoire de toute ma génération confinée dans le silence. Malgré la rudesse avec laquelle je traite mon père, je lui accorde quand même le bénéfice du doute et je préfère à la condamnation manichéenne la suspension du jugement.
En 2012 paraissait aussi Les Héritiers du silence de Florence Dosse, une enquête sociologique menée avec le témoignage d’enfants d’appelés ou d’engagés de la Guerre d’Algérie. C’est alors que j’ai réalisé avec soulagement que je n’étais pas isolée, que mon récit pouvait résonner au-delà de la cuisine familiale comme une rédemption pour toute une génération née de ces pères-là, qui avait été exposée à la folie et à l’angoisse du silence.
C’est pendant l’aberrante torpeur et terreur du confinement de 2020 que j’ai ressenti plus concrètement l’absence de mon père et que j’ai eu besoin de remonter ce récit à rebrousse-poil. J’ai voulu retourner avec lui en Algérie en 1953 alors qu’il débarquait là-bas pour faire ses classes de gendarme.
Disons que je retournais sur le lieu du crime… et au bout de ce périple, j’ai souscrit à toutes les hypothèses sur sa responsabilité ou sur son déni sans pouvoir aboutir à un constat objectif, à savoir que mon père avait pu être un criminel de guerre, qu’il avait pu torturer.
À Sétif et à Affreville la ville où il a été affecté en Algérie de 1954 à 1960, j’ai inventé la syntaxe de ce jeune homme dans l’exercice de ses fonctions de gendarme départemental, probablement aussi imaginaires que cet homme imaginaire que je poursuivais, qui avait été mon père avant d’être mon père, cet homme qui prétendait ne pas avoir tué sans pouvoir en convaincre le monde ou s’en convaincre.
Le Matin d’Algérie : L’écriture peut-elle aider à se reconstruire après une histoire familiale écorchée par les traumas de la guerre ?
Claire Tencin : L’adhésion des lecteurs et des lectrices à ce récit, comme vous le faites aujourd’hui, me fortifie dans l’idée que la littérature a un rôle réconciliateur à jouer dans l’histoire. J’ai tenté de tracer un chemin entre nos deux peuples meurtris par une guerre dont les héritiers ne sont pas responsables et dont ils doivent encore aujourd’hui porter le poids de la mauvaise foi et de la lâcheté mémorielle.
À l’heure où les deux États s’engagent dans un dialogue de réconciliation qui n’est pas gagné d’avance, il me semble que ce sujet n’appartient pas seulement aux politiques mais aux générations qui ont hérité de cette guerre … la diaspora algérienne en France, les pieds noirs et les harkis exilés et les Algériens eux-mêmes.
Il est vrai que depuis quelques années, toute une littérature a éclos de part et d’autre dans ces « communautés » isolées sans parvenir à créer un lien de reconnaissance mutuelle… Je crois que la véritable reconstruction qui vaille doit poser la paix comme préalable entre les deux rives de la Méditerranée et je veux croire aussi que nos deux peuples y aspirent de tous leurs cœurs au-delà des partis pris politiques.
Frantz Fanon, dans Les Damnés de la terre nous dit : « […] Nos actes ne cessent jamais de nous poursuivre. Leur arrangement, leur mise en ordre, leur motivation peuvent parfaitement a posteriori se trouver profondément modifiés. Ce n’est pas l’un des moindres pièges que nous tend l’Histoire et ses multiples déterminations. Mais pouvons-nous échapper au vertige ? Qui oserait prétendre que le vertige ne hante pas toute existence ? »
Le Matin d’Algérie : Quels sont les écrivains qui vous influencent ?
Claire Tencin : Ce sont les écrivains qui m’ont appris à vivre et qui peuvent encore aujourd’hui m’apprendre le courage de la vérité à travers leur écriture et leur engagement intellectuel. Je suis une lectrice persévérante de Montaigne depuis des décennies que j’ai élu comme un père putatif. J’ai beaucoup lu la littérature française classique et les auteurs du XXe siècle sans pouvoir dire que je serais influencée par un-e auteur-e plus particulièrement.
Je suis très sensible aux prises de risque de Virginia Woolf, à la philosophie humaniste de DH Lawrence, à la puissance évocatrice de Malaparte, à l’inventivité de la langue de Marguerite Duras, à la prose incendiaire de Mohamed Dib, à l’écriture provocatrice et poétique du congolais Sony Labou Tansi, et pour ne citer qu’un roman courageux qui m’a marquée ces dernières années, Les bienveillantes de Jonathan Littell.
L’histoire est souvent une source d’inspiration pour moi. Je sonde ce qu’elle n’a pas encore dit par défaillance ou ce qu’elle a volontairement occulté par mépris ou prudence. Plus particulièrement sur les femmes et leurs engagements littéraires ou politiques dans leurs époques.
Avec mon roman Alexandrine de Tencin, femme immorale du XVIIIe siècle, j’ai entrepris de réhabiliter la réputation d’une salonnière et romancière inédite dans notre matrimoine que les jugements moraux avaient jetée dans le cachot de l’histoire.
En décembre 2024, paraîtra mon roman sur Marie de Gournay, éditrice de Montaigne et philosophe à l’aube du XVIIe siècle, dont l’engagement pour la défense des Essais est à peine souligné dans la postérité et son amitié très intime avec le célébrissime auteur carrément ignorée, sans parler de sa production philosophique très rigoureuse et dense qui n’a guère soulevé l’intérêt de l’histoire, à tort à mon sens.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur les éditions ardemment
Claire Tencin : Notre maison est encore toute jeune et nous avançons sans plan préconçu. Nous construisons la ligne éditoriale avec le temps au gré des projets qu’on nous propose et que nous avons envie d’accompagner et de défendre en collaboration avec les auteurs et les autrices.
Depuis deux ans, quelques projets n’ont pas abouti et d’autres sont encore en chantier et naîtront en 2024 et 2025… Nous n’avons pas d’impératifs quantitatifs, donc nous ne publions qu’au compte-goutte. Pour ma part, je suis effarée par le « génocide » des livres que l’on commet tous les ans au nom des lois du marché. Pourquoi publier autant de livres morts nés ?
Quant à ma mission, elle consiste à construire la collection « Les Ardentes » dédiée à la republication des autrices puissantes de notre histoire dans lesquelles nous nous reconnaissons, qui par leur écriture souveraine et leur liberté de parole ont défié les codes de leur sexe en outrepassant le territoire patriarcal. En janvier 2024, j’ai fait paraître un recueil de nouvelles d’Isabelle Eberhardt, Où l’amour alterne avec la mort, agencé sur la thématique des bédouines du désert saharien que l’autrice a tant parcouru à l’orée du XXè siècle. Un butin ethnologique et littéraire tout à fait majeur sur le patriarcat colonial et musulman.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Claire Tencin : Pour ma part, je viens à peine de terminer un roman sur les jeunes mineurs étrangers qui débarquent en France et que je côtoie depuis des années de par mon métier de professeure de français. Là encore, tout est mal dit dans les médias et extrêmement réducteur.
J’ai tenté d’écrire en effaçant tous les termes qui les enferment dans une vision globale, comme « les migrants » par exemple, et encadrée par le discours politique et sociologique d’ambiance. J’en ai fait des « sujets » à part entière porteurs d’une singularité émotionnelle, psychique et créative, comme ils le sont en réalité, et que nous ne pouvons contenir dans la doxa décoloniale victimaire ou dans la rhétorique sécuritaire de la société et des médias.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Claire Tencin : Un grand merci à vous de me donner la place de m’exprimer dans un média algérien.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Ardemment Editions
Lematindalgerie.com
Jeudi 23 mai 2024
…………………………………………………………………………………………..

Saïd Ourrad : « Ecrire nous donne l’illusion de prolonger le temps »
Le psychiatre Saïd Ourrad a publié un roman tranchant qui ne passe pas inaperçu « Résilience inachevée » chez l’édition Sydney Laurent. « Résilience inachevée » est un roman qui interpelle la conscience humaine et interroge le cœur et l’esprit.
Ce premier roman arrive après des années de réflexion, de tentatives, jusqu’à une complète maturité, celle qui dépasse et écarte enfin les hésitations, exhaussant ainsi un rêve de longues années, celui d’écrire et de mener à bout un roman.
Le docteur Said Ourrad arrive en France en 2001 où il se spécialise pour devenir psychiatre et Addictologue, Said Ourrad est installé à son compte à Montargis tout en travaillant en milieu hospitalier et dans un centre d’addictologie.
La littérature a toujours été une grande passion pour Said Ourrad et écrire est pour lui une manière de se sentir vraiment en phase avec lui-même. « Résilience inachevée » est donc le premier roman de Said Ourrad, ce qui lui ouvre la voie de la création littéraire. Ce livre est un voyage dans les méandres de la psychologie humaine.
Le titre « Résilience inachevée » est très évocateur mais en même temps porteur d’espoir, malgré un sujet crucial abordé par le livre celui de l’inceste et du viol. « Résilience inachevée » est un livre qui marque et qui laisse son empreinte, pour un premier roman, nous pouvons dire que c’est réussi.
Le Matin d’Algérie : psychiatre, addictologue, romancier, qui est Saïd Ourrad ?
Said Ourrad : Parler de soi est un exercice laborieux, car on a peur de tomber rapidement dans de la prétention. Romancier, c’est un peu trop dit car je n’ai publié qu’un seul, je pense qu’il faut en faire plus que ça pour mériter ce qualificatif.
Je peux dire que j’aime bien avoir plusieurs casquettes, je m’ennuie facilement dans l’unicité, qui est synonyme pour moi de bagne. L’écriture offre en elle-même une opportunité de diversité, par la palette de couleurs qu’elle propose.
Cette liberté de produire des textes pour donner son avis, s’exprimer et décrire le monde à sa façon, est une véritable bouffée d’oxygène. Dans cet exercice de jouer avec les mots, de concevoir des phrases et des textes, je me mets parfois dans un état d’extase.
Je me définis comme un hyperactif-calme (encore un oxymore), car ce qui ne manque pas d’impacter en partie sur ma famille, mais physiquement je suis d’un calme à faire jalouser un moine. Donc, ma tête bouillonne tout le temps de nouvelles idées, j’ai donc besoin d’un procédé pour les canaliser, trier, mettre de l’ordre, donc tenter de voir plus clair. Je ne sais pas qui a dit : j’écris parce que j’ai peur de devenir fou.
On se (nous) pose souvent la question pourquoi on écrit, même si je ne me considère pas comme écrivain, car pour le devenir il faut encore écrire et beaucoup.
Néanmoins, je pense qu’écrire nous donne l’illusion de prolonger le temps, du moins essayer de le ralentir et le retenir, fixer ces moments qui passent ; c’est une lutte perpétuelle contre l’angoisse de mort.
Les balbutiements commencent souvent dans l’enfance. Pour mon cas, je traine de profondes frustrations depuis l’enfance, non seulement celle de réussir dans les études, ce qui est pour moi insuffisant, mais aussi celle de faire partie de la catégorie des personnes qui produisent, innovent, proposent, étonnent, séduisent, décrivent, et ainsi crier et défendre cette profonde liberté, l’essence même de notre profond humanisme.
J’ai évolué dans une société kabyle où très tôt j’avais pris conscience de cette liberté dont je pouvais jouir et cette capacité à se questionner, à interroger ses profonds désirs et son monde, à aiguiser ses espoirs et ses projections, et d’essayer surtout de devenir ce qu’on voudra être.
Certes, cet exercice périlleux se vivait dans la solitude totale, car chaque pas en avant était scruté par les siens et doit être conforme aux règles édictées par l’entourage et donc avoir l’approbation de tous.
C’était grâce à la fac que ce besoin de liberté avait pris forme et pouvait s’exprimer un peu plus. Cette « grande école des adultes » était salvatrice pour beaucoup d’entre nous, car s’éloigner un moment de nos familles, de nos cercles proches, de nos reflexes ataviques, nous a permis de nous construire une personnalité singulière et quasi-indépendante. Mais beaucoup d’ex-étudiants, des amis proches parfois, l’ont payé de leurs chairs ; ils se sont vus excommunié du cercle familial, rejetés par leur milieu social, pour la simple raison qu’ils ont pris un chemin jugé contraire à celui défini par le cadre social. Les femmes étaient plus victimes que les hommes. Une violence subie qui mérite qu’on s’y penche pour mieux la cerner.
Pour mon métier de psychiatre-addictologue, il me permet d’être en contact avec une souffrance profonde des humains, dans laquelle les patients se débattent contre la maladie mentale et/ou compliqué de consommation de produits nocifs. Dans cet exercice d’apporter un soulagement à ceux qui en ont besoin, je me sens aussi en harmonie totale avec mes convictions profondes.
Le Matin d’Algérie : Vous venez de publier votre premier roman, on peut dire que c’est réussi, puisque vous abordez d’emblée un sujet de société crucial lié à toutes les époques, l’inceste et le viol, comment ce thème s’est-il imposé ?
Said Ourrad : Les sujets de société, les tabous, inhérents à la souffrance humaine, m’ont toujours interpellé et intéressé de près.
La résilience, cette faculté à transcender ses difficultés pour continuer à vivre, m’a toujours aussi intéressé.
La naissance de Résilience inachevée est partie d’un petit billet que j’ai posté sur fb, décrivant une adolescente apeurée, adossée à un mur, et puis la suite c’est mon petit logiciel « il faut à tout prix que j’aille cette fois-ci jusqu’au bout pour concevoir un roman » qui s’est chargé de compléter au fur et mesure les scènes de cette intrigue.
Lors de la première expérience, comme tout le monde le sait, on écrit n’importe quoi et n’importe comment et puis on passe un temps fou à corriger, à recorriger, à demander conseils, et si au bout d’un temps long notre espoir ne s’est pas essoufflé, on arrive enfin à un produit fini. Et puis tout le monde connait ce moment d’épuisement où on se dit à soi-même : maintenant il faut que t’arrêtes, cependant quelque chose te pousse à continuer.
Résilience inachevée est l’histoire de Céline qui a subi un inceste, avec toutes les conséquences sur le plan psychologique. Une fois adulte, elle va réaliser un film, en grande partie autobiographique, ainsi elle va porter son histoire à l’écran. Il y’a pas mieux que la fiction pour raconter une réalité. Mais au fur et à mesure des projections d’avant-premières, sa conscience va la titiller progressivement sur les détails de certaines scènes.
Les retrouvailles avec Ghilas, un Kabyle qui s’est amouraché d’elle et l’a initié à l’art cinématographique, va accélérer les choses. Ghilas lui-aussi porte, et profondément, les stigmates d’un « espoir violé ». Il a subi les affres de la décennie noire dans sa chair ; il a dû fuir l’Algérie avec sa maman à l’âge de 18 ans, après l’assassinat de son père journaliste par les islamistes. La souffrance de Ghilas et celle de Céline rentrent en symbiose.
Le Matin d’Algérie : Comment passe-t-on de la psychiatrie au roman ?
Said Ourrad : Il y a un point commun entre la pratique de la psychiatrie et la littérature et cette recherche pour cerner la personnalité du patient au fur et à mesure des consultations et le personnage principal dans un film. Dans certains films, il arrive aussi que le personnage soit aussi un patient.
Chez certains patients, leurs histoires personnels, la trajectoire de leur vie, les rebondissements, est un vrai film ou roman ; au fur et à mesure qu’on les voit, on prend connaissance de détails supplémentaires, quelquefois les plus intimes, comme dans un roman ou un film pour le personnage. Parfois, ce n’est qu’au bout de plusieurs entretiens que le patient lâche enfin l’élément ou un fait important de sa vie, qui peut expliciter et éclairer brusquement son parcours de vie et mettre le projecteur sur sa profonde souffrance. Comme dans une scène de cinéma ou une séquence importante dans un roman.
Mais profondément, la pratique de la psychiatrie est totalement différente de l’écriture : pour le premier on est avec le patient qu’on essaie de comprendre la genèse de sa souffrance pour ensuite lui apporter un réconfort par l’écoute, une psychothérapie de soutien, des médicaments, et autres méthodes de soins. Pour l’écriture, on est avec soi-même, souvent en introspection et en immersion totale dans les entrailles de sa propre vie ou de celles de ses personnages.
Le Matin d’Algérie : « Résilience inachevée » parlez-nous du choix de ce titre très évocateur ?
Said Ourrad : Résilience inachevée est un oxymore. Le titre est souvent très difficile à trouver. Pour ma part, je voulais un titre percutant, en relation avec le sujet traité et surtout l’actualité.
On parle de résilience pour un processus de réparation qui habituellement s’est achevé.
Mais en vérité, toute souffrance humaine brusque, agressive, qui a duré longtemps, peut laisser des séquelles, des stigmates, une empreinte, qui peuvent parfois être oubliées avec le temps, intellectualisées, mais qui peuvent ressurgir dans des moments de faiblesse (un deuil, un mariage, passage de l’adolescence à l’âge adulte, une violence symbolique ou réelle, un harcèlement…)
Le Matin d’Algérie : Quels sont les auteurs et les psychiatres qui vous ont influencés ?
Said Ourrad : Les auteurs qui m’ont influencé sont bien sûr d’abord les nôtres : Albert Camus, Mouloud Mammeri, Tahar Djaout, Rachid Mimouni, Boudjedra… Dans les années 90, à la fac, on dévorait leurs livres qui passaient de main à main. Jeunes étudiants, on a eu la chance d’assister aux différentes conférences de quelques-uns de ces gens de culture, qu’on regardait avec de gros yeux, ils étaient nos idoles, on voulait leur ressembler.
J’avais à ce moment-là compris pourquoi ces gens écrivaient ; ils avaient cette capacité de se connecter à nos aspirations, nos racines et interroger ce qui nous faisaient vibrer intérieurement. Ils étaient porteurs d’espoir.
J’ai été très marqué par le roman la mise à nu de Abdelhamid Benhadouga, un livre qui m’a totalement bouleversé. En le lisant, j’avais l’impression d’ouvrir enfin les yeux et de défoncer les portes de la famille algérienne secrète. Pour le montagnard que j’étais, curieux mais d’une naïveté maladive, ce livre, même si c’est une fiction, m’a permis de comprendre que la souffrance de chacun se vivait dans l’isolement, l’hypocrisie, la cachotterie, le mensonge, Lhaf. La famille est une pièce de théâtre où chacun joue un rôle.
Bien sûr pour la littérature internationale, il y a plusieurs auteurs qui me fascinent ; hormis les classiques, je peux citer Milan Kundera que j’ai découvert avec l’insoutenable légèreté de l’être et Risibles amours. Il y a aussi Alberto Moravia, l’écrivain italien qui manie la dérision et l’humour.
Pour les psychiatres, ils sont très nombreux à se donner aussi à cet exercice d’écrire, soit des romans ou des livres qui traitent bien sûr du champ des neurosciences ou de la psychothérapie ou autres méthodes de soins. L’un d’eux, Raphaël Gaillard. Psychiatre, à 48 ans il vient d’être nommé à la prestigieuse académie française.
Le Matin d’Algérie : Le champ de la psychiatrie est si vaste, quel regard portez-vous sur ce domaine très particulier concernant l’Algérie, après tant de traumatismes vécus ?
Said Ourrad : Sur des domaines très variés, l’Algérie reste à la friche. Pour rester dans le domaine du psychisme, il y a beaucoup à dire. En Algérie les psycho-traumatismes sont souvent vécus dans la souffrance et la solitude totale. Peu de choses sont mises en place pour que des gens dans le besoin puissent avoir un espace d’écoute, où leur confidentialité sera respectée.
Un principe connu de tous les professionnels de la santé mentale : toute souffrance, toute violence physique ou symbolique subie, non prise en charge, enfouie au plus profond de soi, peut aboutir tôt ou tard à un comportement répétitif. La violence subie, qu’elle soit politique ou autre, va malheureusement générer de la violence.
Un exemple typique : en Algérie l’humilié par exemple est persuadé que la justice ne se fera jamais, persuadé qu’elle n’existe pas ; pour se faire justice et se soulager, il ne rêverait que d’une chose, humilier lui-même un autre comme lui, de la même manière qu’il l’a été. La victime qui se transforme à la moindre occasion en bourreau.
Le travail de mémoire de la décennie noire par exemple n’a jamais été pris en charge, encore une fois on a caché le sang sous le tapis, pour éviter de regarder la réalité en face et en discuter.
Malheureusement dans les futures années, on est guetté par la répétition des mêmes évènements qu’autrefois, avec la même violence ou pire, qui peut jeter le pays dans une véritable guerre civile. Bien sûr la tâche incombe aux politiciens, au pouvoir central, aux décideurs, de trouver des solutions pour éviter de revivre ces situations. Tout ce qui est proposé est l’accentuation de la religiosité pour contenir la colère, toutes les frustrations, des citoyens.
Par procuration par nos parents et par transmission, notre génération post-indépendance avons été profondément impactés par la guerre 1954-1962. Les événements des années 90 ne sont pas à dissocier de ceux de la guerre délibération et de toute la violence qui est venue après.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Said Ourrad : L’écriture, comme tu le sais bien, est une maladie chronique, dès qu’on l’attrape on ne s’en défait plus. Plusieurs projets bouillonnent dans mon esprit.
J’ai fini un 2ème roman depuis plus d’un an, que j’ai mis au vert, car je n’arrive toujours pas à trouver un éditeur sérieux, je réfléchis sérieusement à une autoédition.
Actuellement je suis en train d’écrire un autre roman où l’histoire se situe à Hasnaoua, université de Tizi-Ouzou en Algérie, où j’ai passé toute la décennie noire. Un roman qui me tient particulièrement à cœur et dont je rêvais depuis très longtemps. Ça sera une fiction où je glisse des scènes de vie réelle et quotidienne, sur un fond de bouleversement politique des années 90. L’accent sera mis sur l’impact de ses évènements sur la psyché de chacun de nous, et donc sur les relations sociales, amicales, la conception de l’avenir, la notion de l’espoir, de la démocratie, des croyances…
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Said Ourrad : Je me sens toujours un peu gêné de parler de l’Algérie, le pays que j’ai quitté il y a 23 ans, car je n’ai aucune leçon à donner à quiconque sur n’importe quoi.
Je peux juste dire que la production culturelle et artistique, les rencontres, sont importantes pour que chacun et chacune trouve et retrouve une place où sa sensibilité pourra s’exprimer. En chacun de nous somnole un artiste, un écrivain, un sculpteur.
Souvent, on est son propre censeur, on s’interdit d’explorer ce désir par peur du ridicule ou de ne pas y arriver jusqu’au bout de son projet. Je ne compte pas le nombre d’amis, de connaissances, de personnes de toutes les cultures, qui m’avouent avoir un projet d’écriture ou autre mais n’osent pas sauter le pas et commencer.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Lematindalgerie.com
Le 20 mai 2024
…………………………………………………………………………………….

Hugues Robert : « La colonisation est un crime contre l’humanité »
Hugues Robert vient de nous surprendre avec un beau livre témoignage « Le Journal d’un pacificateur » chez les éditions Max Milo. Ce livre raconte une période douloureuse de la colonisation française en Algérie. Hugues Robert nous livre dans ce livre poignant et déchirant, « Le Journal d’un pacificateur », l’histoire de son père Jean-Marie Robert décédé en 1991, sous-préfet pendant la guerre d’Algérie, entre 1959 et 1962 et préfet de Maine-et-Loire entre 1975 et 1982.
Jean-Marie Robert, fut sous-préfet d’Akbou, de la vallée de la Soummam, en Kabylie de 1959 à 1962, il fut l’un des premiers hommes d’État à tirer la sonnette d’alarme sur les exactions de l’armée française pendant la guerre d’Algérie.
Jean-Marie Robert a essayé d’apporter plus de justice et de droits malgré un contexte sanglant où la lutte armée faisait rage, luttant contre vents et marrées contre certains généraux.
Jean-Marie Robert, ce haut fonctionnaire, continua à agir dans l’ombre pour venir en aide aux familles de harkis, abandonnées en Algérie ou parquées dans les camps insalubres de Rivesaltes et du Larzac. Il fut le premier à s’élever contre le triste et tragique sort réservé aux harkis.
Hugues Robert nous offre un pan d’histoire à travers moult documents et des centaines de lettres laissés par son père Jean-Marie Robert.
Invité par l’écrivain Youcef Zirem au café littéraire parisien de l’Impondérable, Huges Robert a ému l’assistance par un langage du cœur et des messages d’amour, quand il évoque son enfance à Akbou, il était assis à côté de Tarik Mira, fils du colonel Abderrahmane Mira, surnommé le Tigre de la Soummam par l’armée française, qui fut chef de la Wilaya VI de 1956 à 1957, puis de la Wilaya III du début 1959 au 6 novembre 1959 date à laquelle il est tué lors d’un combat près du col de Chellata au nord d’Akbou; dont le corps ne fut jamais retrouvé.
Hugues Robert a souligné l’humanisme de son père qui a toujours œuvré pour plus de justice durant toute sa vie, il a également apporté des éclairages qui laissent entrevoir de l’espoir et un rapprochement entre les deux rives.
« Le Journal d’un pacificateur » est un livre très documenté qui est le bienvenu pour enrichir l’histoire et s’offrir aux chercheurs, aux universitaires, en quête de savoir et de vérité. Son écriture limpide le met à portée de tous.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes journaliste, écrivain, mais vous avez aussi eu d’autres métiers, qui est Hugues Robert ?
Hugues Robert : À vrai dire, et je l’ai compris beaucoup plus tard, si j ‘ai eu plusieurs métiers, agent de train à la SNCF, menuisier-charpentier, rénovateur de l ‘habitat ancien, Imprimeur, Agent de Voyage, Éducateur d’enfants, éditeur, journaliste, c‘est pour réparer mon enfance dans la guerre, et revisiter inconsciemment mon enfance au Maroc et en Algérie. Mes plus belles années et les plus terribles furent celles de 59 à 62 en Algérie, à Akbou. Le 19 mars 1962, je croyais, avec mes 8 ans, qu’on allait enfin vivre libre et égaux en Algérie. C’était mon rêve ! Déjà je ne supportais pas l‘injustice et la misère que vivaient mes frères et sœurs algériens. J ‘ai été élevé par mes parents dans l ‘horreur de l ‘injustice et du mensonge.
Le Matin d’Algérie : Comment est née cette passion pour l’écriture ?
Hugues Robert : C ‘est le silence de notre enfance qui a nourri mon désir d’écriture. L‘injustice visible et pourtant qu‘on taisait ! Chaque fois qu’on parlait de l ‘Algérie, j ‘avais des larmes silencieuses et amers qui coulaient sur mes joues. Le silence tue, et mes premiers écrits d’adolescent furent des écrits militants contre la peine de mort, la guerre du Vietnam, le coup d’état militaire du Chili, les assassinats de Franco. Cela résonnait avec mon enfance algérienne, la guerre et mes camarades musulmans.
Le Matin d’Algérie : Vous venez de nous surprendre par la publication de votre livre témoignage sur un pan d’histoire crucial entre l’Algérie et la France « Le Journal d’un pacificateur », racontez-nous ?
Hugues Robert : Oh, je ne connaissais pas mon père, et comme il était dur avec nous, je pensais qu’il avait été dur avec les Algériens. C’était tout le contraire. Je l‘avais compris en venant à Akbou dans les années 1990, en rencontrant des gens du FLN, et beaucoup d’autres qui m‘avaient dit que mon père était « un vrai ami de tous les Algériens, » et des Kabyles de la vallée de la Soummam.
Et en ouvrant ses archives en 2017, lors de ma retraite j‘ai découvert, qu’il était un partisan de l‘Algérie algérienne, et qu’il a été effrayé de la guerre que nous menions. La torture, les camps de regroupement, et il écrivit à l‘Élysée pour dire que « jamais les Algériens ne pourraient pardonner à la France ce qu’avaient fait les militaires et ce qu’avait laissé faire l‘administration ». Il réclamait des vivres, des couvertures, des crédits pour reconstruire les villages et maisons détruites, 6667 dans son arrondissement… et plus de 10.000 morts… Il fut meurtri, de ces crimes contre la population civile.
Et il essaya non seulement de panser les plaies, mais surtout de préparer l’indépendance de l ‘Algérie, avec des gens comme Hocine Maloum, le maire d’Akbou qu’il savait contribuer financièrement au FLN, car pour lui comme pour eux, c’était le FLN et de Gaulle qui pouvaient rendre à l ‘Algérie son indépendance.
Jean-Marie Robert fut également meurtri des vengeances, et de l’assassinat de Hocine Maloum et des représailles inutiles contre les dits « harkis ». Après 132 ans de colonisation, pour lui, il fallait savoir pardonner et réparer. « La pire de nos guerres ! » écrivait-il…et il a eu jusqu’à sa mort, un amour et un respect incroyable, pour le peuple algérien et les kabyles de la vallée de la Soummam.
Le Matin d’Algérie : Je dirais que c’est un livre courageux, et cet hommage à votre père est d’une dextérité inouïe, malgré une période écorchée, qu’on croirait dépourvue d’amour, vous réussissez à captiver le lecteur, à le retenir, à ouvrir son esprit et son cœur, les choses aurait pu évoluer autrement n’est-ce pas ?
Hugues Robert : Oui, si les Français, les Européens avaient écouté d’abord l ‘émir Abdelkader, le Cheikh El Haddad, Ferhat Abbas et d’autres qui prônaient la sagesse. Mais voilà l‘Europe se battait entre eux pour coloniser le monde, et la guerre d’Algérie qui a commencé en 1830, et non le 1er Novembre 54… Après la guerre de conquête des Bugeaud, la guerre de domination des Jules Ferry, il a fallu la guerre de libération du FLN…Il n‘y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Mon seul regret, c’est qu’on n‘ait pas appliqué les principes du congrès de la Soummam, de 1956 : l’intérieur qui prime sur l‘extérieur et le civil sur le militaire…et que les Européens d’Algérie, menés par les grands propriétaires et les faucons n‘aient pas compris que sans égalité, il ne peut y avoir de liberté et de fraternité.
La colonisation est un non-sens politique et un crime contre l’humanité. Quand on va chez quelqu’un, c’est parce qu’on est invité, et non pas pour casser sa porte, voler ses terres, et violer sa conscience.
Le Matin d’Algérie : Votre père s’est élevé contre les injustices, contre le sort des harkis abandonnés des deux rives, ils étaient plus de 200 000 supplétifs engagés dans l’armée française entre 1954 et 1962. L’article 2 des accords d’Évian les protégeait, (1) « nul ne [puisse] être inquiété, recherché, poursuivi, condamné (…) en raison d’actes commis en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu » (déclaration des garanties). Ou « à interdire tout recours aux actes de violence collective et individuelle », s’ensuivit une débâcle, pourquoi d’après vous ?
Hugues Robert : Ancien moine à Cîteaux, c’était un humaniste qui a fait traduire des militaires français tortionnaires devant la justice, dénoncé les camps « concentrationnaires » de regroupement et les bidonvilles dits « villages nègres », et s ‘est insurgé contre l‘abandon et les représailles contre les dits « harkis »
Des deux côtés de la Méditerranée, si on n‘a rien compris, ou on n‘a rien voulu comprendre aux problèmes des harkis… c ‘est parce qu’on a voulu minimiser la terrible colonisation de 132 ans, la responsabilité première et totale des dirigeants français… de Bugeaud, mais aussi de 1871 et les deux guerres mondiales de 14/18, la guerre de 39/45…. L‘Algérie c’était la France, comme disaient les colons, et même des départements français, avant ceux de la Savoie et de la Haute Savoie, qui ont pu tromper beaucoup de monde. Et puis je connais beaucoup de familles algériennes qui ont donné un fils à la France pour survivre, et plusieurs à la Révolution et à la Résistance pour la dignité et l‘honneur. S’il y a eu quelques salauds, il fallait juger juste ceux-là… Beaucoup de ceux qui ont été assassinés ou emprisonnés étaient restés pour construire l‘Algérie algérienne. L’Algérie s’est privée de forces vives nécessaires à sa reconstruction après cette abominable guerre. Mais le peuple algérien le sait et le comprend. Seuls les politiciens entretiennent les ambiguïtés et la division, là où il faudrait réunir et construire.
Le Matin d’Algérie : Il y a malgré tout une histoire d’amour entre l’Algérie et la France malgré un passé torturé, votre livre « Le Journal d’un pacificateur » laisse apparaître des éclaircies pour un avenir meilleur, qu’en pensez-vous ?
Hugues Robert : C’est vrai, nous avons un passé commun, même s’il est douloureux, mais I have a dream, demander pardon au peuple algérien, même si je ne suis pas responsable de ceux qu’ont fait mes aïeux ; et puis pouvoir partager mes parties de billes ou de dominos avec mes copains d’école, à l’école Mouloud-Feraoun d’Akbou, manger un bon couscous et rire…
Dans mon prochain livre, un roman réalité «Le rire du chacal » je finis ainsi alors que je suis dans un camp avec des amis algériens (fils du FLN, du MNA, Harkis, sans parti pris, émigrés etc…), et qu’une grive m ‘interpelle :
« Piaou, Piaou… Piaou, Piaou ! Hugo Intrigué appelle ses amis, en mettant son doigt sur la bouche, « Chut ! Chut Suivez-moi ! ». Il avait compris. Et ils le suivirent, et les Piaou, Piaou, Tics, Tics, les amenèrent tout près, dans une clairière, éclairée par la lune. Là, stupéfaction : une tribu de petits animaux aux reflets roux ou gris argenté, jouait, riait. Des petits loups ? Ou bien des chiens ? Non des chacals. Ils caquetaient et semblaient rires comme des humains. On lui avait dit, enfant, que lorsqu’il n’entendait plus le hululement des chacals, c’est qu’ils n ‘avaient plus peur, et s’il entendait, leur glapissement, sorte de caquètement, c’est qu’ils étaient dans la paix et la joie. Ils jouaient et riaient comme des enfants qui ont retrouvé l‘espoir. »
Et oui je crois à cette paix et à cette réconciliation entre nos deux peuples. Et que de temps perdu.
Le Matin d’Algérie : Quel regard portez-vous sur l’Algérie d’aujourd’hui ?
Hugues Robert : Un regard d’espoir, justement, car le 8 mars 2019, j‘étais à Alger. Place Maurice Audin. Une femme algérienne est venue vers moi. « Vous êtes Français ? » « Non je suis d’Akbou ! », lui ai-je répondu avec un grand sourire complice. « Permettez-moi que je vous embrasse, me dit-elle en ajoutant : « vous savez monsieur… En 1962 on a libéré nos terres, en 2019 on libère nos cœurs et nos esprits. »
Je ne peux avoir que confiance en un peuple qui chasse la France sans animosité, et en m’accueillant comme il m’a accueilli : « Tu es ici, chez toi! »
La jeunesse est la force de ce pays et je crois qu’elle ne se fera pas manipulée par les passions tristes et la haine recuite. Dommage que les politiciens d’un côté comme de l‘autre de la Méditerranée ne le comprennent pas.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Hugues Robert : Oui, jusqu’à ma mort… travailler pour la paix et la fraternité entre nos deux peuples. La rencontre entre Tarik Mira, fils du grand colonel Abderrahmane Mira, du colonel Georgesco, sergent de la Harka 205 d’Akbou qui travaillent en ce sens me comblent de joie.
Je ne peux oublier la colère de mon père quand les militaires ont exposé le corps de Abderahmane Mira le 6 novembre 1959 à Akbou et à Taghalat. « Ce n ‘est pas comme ça, qu’on va construire la paix, la réconciliation et l’indépendance » a-t-il dit !
Et puis avec mon ami Hocine, fils de harki dont l‘oncle fut chahid, nous rêvons de devenir Franco- Algériens. Ce serait beau avant de mourir de réconcilier en nous, nos deux pays, qui nous sont chers.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Hugues Robert : Que Dieu protège l ‘Algérie et que la France regarde son passé colonial afin d’éviter le racisme qui le guette.
Et vivent la vie et la fraternité de nos deux peuples !
Entretien réalisé par Brahim Saci
1 – Le Monde Afrique, le 18 mars 2022
Guerre d’Algérie : les 60 ans des accords d’Evian
La matindalgerie.com
Mardi 14 mai 2024
………………………………………………………………………………………
.jpeg)
Raphaël Saint-Rémy : je me reconnais mieux dans le mouvement que dans l’immobilité
Raphaël Saint-Rémy fait partie de ces génie créateurs si discrets qui préfèrent briller dans l’ombre. Il est un artiste complet. Chez lui s’entremêlent les arts dans une complémentarité sans dualité, le tout tendant vers l’union, vers l’harmonie.
Les compositions et les écrits de Raphaël Saint Rémy sont empreints de spiritualité, une vision philosophique se dégage à l’aise vers un élan menant la réflexion vers des cimes qui bousculent la compréhension cassant les impasses, où les mots ont des sonorités qui apaisent les braises du mental.
Le profane et le mélomane trouvent des lucarnes dans les ombres où jaillissent des éclaircies. Dans les œuvres de Raphaël Saint-Rémy il y a l’apparent et le caché, les mots offrent ainsi plusieurs sens.
Né à Orléans, Raphaël Saint-Rémy étudie le piano, le hautbois, les ondes Martenot, l’électroacoustique et l’écriture dans différents conservatoires, Orléans, St-Maur, Boulogne-Billancourt, ainsi qu’au CNSMD de Paris (Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris).
Raphaël Saint-Rémy se passionne tout d’abord pour la musique contemporaine (en particulier au sein du sextuor Jeanne Loriod), puis participe aux côtés de Michel Moglia aux « Chants thermiques de l’orgue à feu ».
Après une période d’interruption, il renoue avec l’activité musicale, essentiellement dans le domaine de l’improvisation. Il joue avec Raymond Boni (CD « Clameur »), Jean-Claude Jones (CD « Serendipity »), Benjamin Bondonneau, Géraldine Keller et Jean-Luc Cappozzo (CD « Comité Zaoum »), Michaël Nick, Beñat Achiary.
En 2005, commence son immersion dans la littérature, le genre théâtral semble s’imposer, il écrit six pièces de théâtre : « Alpha » (paru aux éd. Le Chant du Moineau, 2018), « Delta », « Kappa », « Psi », « Thêta », « Zêta », formant le cycle « Le mont Olympe ».
Raphaël Saint-Rémy innove en suite en se lançant vers un autre genre littéraire, celui dit de fiction, « Des espèces en voie d’apparition » (bestiaire imaginaire) éd. Le Chant du Moineau, 2016 & L’Oscillographe 2022.
« Contrechamps », éd. Université Gustave Eiffel (Collections de l’Ifsttar), 2020.
« Éclipses » éd. L’oscillographe, 2022.
« La galerie des modèles » (dans le cadre du projet « Entreponts » de l’Université G. Eiffel) éd L’Oscillographe 2023.
« Vaste laps » éd. L’oscillographe, 2023
Inédits (fiction) :
« Le fils du Greco » (2023).
Raphaël Saint-Rémy réalise aussi avec Benjamin Bondonneau deux émissions sur France Culture (Création on air) : « Animaux en voie d’apparition », et « L’orthographe des émotions » (2017).
En 2021, il compose avec Michaël Nick une série de 20 pièces pour violon et piano, dans le cadre d’un projet soutenu par le laboratoire LVMT, (laboratoire pluridisciplinaire, est une unité mixte de recherche entre l’École des Ponts ParisTech et l’Université Gustave Eiffel), et l’Université Gustave Eiffel.
Raphaël Saint-Rémy enseigne depuis 2004 la culture musicale dans un conservatoire parisien.
Les arts en général nous aident à mieux appréhender le monde. Et les œuvres de Raphaël Saint Rémy nous plongent entre l’ombre et la lumière, les sens en éveil, pour tout capter et ne rien rater de ce qui bouscule et élève la réflexion.
Le Matin d’Algérie : De Orléans à Paris, vous avez étudié au conservatoire, le piano, le hautbois, l’écriture musicale. Qui est Raphaël Saint-Rémy ?
Raphaël Saint-Rémy : Il est toujours difficile de dresser son propre portrait… Les informations « administratives », comme la date et le lieu de naissance, ne nous apprennent pas grand-chose sur un être quel qu’il soit. Plus important est peut-être de souligner, en ce qui me concerne, que la pratique de la musique, à partir de ma sixième année (pratique encouragée par ma mère, malgré des conditions de vie assez difficiles), a favorisé en moi le développement de mon imaginaire ; imaginaire qui par la suite s’est déployé dans des directions plus variées que je ne l’imaginais étant enfant.
D’abord la musique classique, puis la musique contemporaine, l’expérimentation sonore avec l’Orgue à feu, l’improvisation, et aujourd’hui l’écriture, qui a presque pris le pas sur la musique. Mais rien ne dit que les choses n’évolueront pas encore !
Finalement, il se pourrait qu’à l’image de tout être humain je me reconnaisse mieux dans le mouvement que dans l’immobilité, dans l’inconstance que dans l’image fixe…
Le Matin d’Algérie : Vous venez du classique, pourquoi cette passion pour la musique contemporaine ?
Raphaël Saint-Rémy : Si j’essaie de me souvenir de mes premiers contacts avec la musique dite contemporaine, se dégagent deux ou trois choses : parmi les quelques disques vinyles que nous possédions (cinq ou six, guère plus), se trouvait, de façon assez étonnante, le « Pierrot lunaire » de Schönberg, pour voix et ensemble instrumental. J’ai encore dans l’oreille la modulation très spécifique de la voix de la chanteuse (technique du « Sprechgesang »), et l’univers poétique très énigmatique pour moi qui se dégageait de cette musique. Je suis allé également plusieurs années de suite aux « Journées de musique contemporaine d’Orléans » qui m’ont ouvert aux sonorités neuves et expérimentales. Autre souvenir marquant : ma découverte, toujours à Orléans, de l’opéra de Berg « Wozzeck ». Œuvre qui m’a profondément marqué, qui n’a cessé de m’accompagner depuis lors, et que j’ai passé des journées entières à analyser.
Par la suite, j’ai découvert, en entrant au Conservatoire de Paris, les Ondes Martenot, instrument qui, là encore a ouvert en moi des espaces inconnus. J’ai appris cet instrument auprès de Jeanne Loriod (la belle-sœur d’Olivier Messiaen), et fait partie pendant cinq ans de son sextuor, qui se consacrait exclusivement aux musiques du 20ème siècle. Mon esprit s’était dès lors définitivement tourné vers la création. Il me semblait naturel et évident de pratiquer une musique composée par mes contemporains. Cela m’intéressait davantage que l’interprétation d’œuvres anciennes.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les compositeurs et les écrivains qui vous influencent ?
Raphaël Saint-Rémy : Je ne suis pas sûr que les compositeurs ou les écrivains qui comptent pour moi soient forcément ceux qui influencent directement mon travail.
Bien sûr j’éprouve une grande admiration pour bon nombre de compositeurs (difficile de n’en citer que quelques-uns, mais j’évoquerais Gesualdo, Bach, Schubert, Berg, Messiaen, Varèse, Crumb, Sciarrino, Lachenmann), mais aussi pour des musiciens de jazz (Thelonious Monk, Billie Holliday, Roland Kirk, Eric Dolphy, Albert Ayler…) ainsi que pour des musiciens de musique traditionnelle (le Pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan, l’Azerbaïdjanais Alim Qasimov, l’Indien Hariprasad Chaurasia, la Mauritanienne Dimi Mint Abba). Certaines musiques ou pratiques théâtrales asiatiques me touchent particulièrement : le Bunraku japonais et le Pansori coréen.
Du côté des écrivains, ceux qui ont certainement eu l’impact le plus important sur moi sont Franz Kafka, Thomas Bernhard, James Joyce, Samuel Beckett, Giorgio Manganelli. Je reviens souvent vers eux ; ils m’auront accompagné durant tout mon existence. Tous ces créateurs, et avant tout peut-être leur formidable puissance de travail, sont des stimulants. Mais je ne suis pas loin de penser que pour un auteur, l’influence vient autant de ses lectures ou des œuvres qu’il écoute ou contemple que du monde qui l’entoure, des êtres qu’il côtoie, des merveilles du monde animal, végétal ou minéral. Quant à savoir de quelle façon tout cela se retrouve précisément dans un livre ou une musique, c’est un autre problème.
Le Matin d’Algérie : Nous pouvons dire que vous êtes quelqu’un d’éclectique, comment faites-vous pour passer de la composition musicale, au théâtre et à la littérature de fiction ?
Raphaël Saint-Rémy : Parfois les choses se font sans que je le veuille ! Récemment la comédienne Marie-Angèle Vaurs et le metteur en scène Michel Mathieu ont adapté pour la scène un texte que j’avais écrit (« La mère du passeur », extrait du livre « Éclipses »). Je n’avais pas imaginé un seul instant un prolongement de ce type !
Par ailleurs je ne me considère pas comme un compositeur. Ma pratique musicale est bien davantage liée à l’improvisation. Quelques tentatives récentes de compositions ne suffisent pas à faire de moi un compositeur !
Reste que j’aime beaucoup en effet passer d’une activité à une autre, ou d’un texte long à une série de textes courts, d’un instrument de musique à un autre, etc. Sans doute cela a-t-il à voir avec des énergies différentes, qui se stimulent l’une l’autre. Pour autant je ne pourrais pas affirmer qu’il en ressort une unité générale. S’il y a partage d’une même sève, cela se fait par des racines et des échanges souterrains qui me demeurent obscurs…
Le Matin d’Algérie : Un mot sur votre fils Ismaël, musicien talentueux qui après avoir étudié la guitare classique s’est lancé dans l’apprentissage du oud ?
Raphaël Saint-Rémy : Ismaël a découvert le oud lors d’un concert. Il a ensuite appris l’instrument auprès du magnifique professeur Fadhel Messaoudi. Aujourd’hui il est étudiant en ethno-musicologie. Sa thèse de doctorat portera principalement sur le « Medeh » des Haratins de Mauritanie. Je suis très heureux de le voir s’épanouir dans ce sujet d’étude particulièrement passionnant. Sa pratique du oud se poursuit bien entendu, avec le désir de trouver dans ce domaine un chemin qui lui soit propre.
Le Matin d’Algérie : Le compositeur Claude Debussy disait, « La musique doit humblement chercher à faire plaisir, l’extrême complication est le contraire de l’art », qu’en pensez-vous ?
Raphaël Saint-Rémy : Cela nécessiterait de prendre chaque terme et de bien le définir ! J’ai une immense admiration pour la musique de Debussy, qui a révolutionné en profondeur le langage musical. Mais la phrase me paraît trop définitive pour ne pas être suspecte… D’où vient le plaisir ? Toujours de la simplicité ? Ce n’est pas dit ! Si la complication est sans doute problématique, la complexité ne l’est pas forcément ! Quant au « contraire de l’art », il implique que l’on sache bien ce que le mot art signifie, ce qui n’est pas gagné !
Je dois dire que je me méfie un peu de ce besoin de définir ce qu’est l’art, et encore plus des recommandations que l’on se croit autorisé de donner pour en produire un « véritable ». Il me semble que c’est le peintre Jean Dubuffet qui disait : « Nommez l’art, et aussitôt il s’enfuit » !
Le Matin d’Algérie : Les conservatoires parisiens s’ouvrent depuis quelques années sur les musiques du monde et les musiques actuelles, ce qui peut construire des ponts ou des passerelles entre les genres musicaux, quel est votre avis là-dessus ?
Raphaël Saint-Rémy : J’y suis évidemment tout à fait favorable. Depuis toujours les musiciens (y compris ceux de musique dite – bien maladroitement – « savante ») sont curieux des musiques d’ailleurs, s’en inspirent, vont y chercher des pistes nouvelles. Beaucoup de musiques extra-européennes sont de tradition orale. Leur apprentissage implique d’autres méthodes, d’autres approches, dont la culture occidentale, basée sur l’écrit, gagnerait parfois à s’inspirer. Quoi qu’il en soit, les passerelles dont vous parlez ont toujours existé. Musiques profanes et sacrées, de danse et de concert, se sont toujours inspirées mutuellement, et ont parfois évolué de l’un à l’autre de ces genres. Il existe donc des passerelles, mais également des migrations, des déplacements, avec des proximités ou des différences qui évoluent, sont à reconsidérer. Mouvements passionnants à observer. C’est la vie même, et non le musée !
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Raphaël Saint-Rémy : J’ai achevé fin 2023 un long texte de fiction ayant pour sujet principal l’œuvre du peintre El Greco ; et je termine en ce moment un au Raphaël Saint-Rémy : un texte lié à la peinture – moderne cette fois. Pour le reste, j’ai des projets bien sûr, mais il est toujours dangereux d’en parler avant de les avoir réalisés !
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Raphaël Saint-Rémy : On sait que les « derniers mots » sont en général loin d’être les derniers ! Bien au contraire ils suscitent, à peine prononcés, de rapides et salutaires contradictions. Je ne me risquerais donc à en lâcher un qu’en ayant la parfaite conscience qu’il appellera tôt ou tard sa réfutation. Ceci étant, à présent qu’il faut choisir, je ne constate qu’aucun ne me vient. C’est donc avec un signe de ponctuation, ouvert et fertile, que je vous propose de terminer : celui d’interrogation. N’est-il pas le plus beau ?
Entretien réalisé par Brahim Saci
Lematindalgerie.com
Dimanche 12 mai 2024
………………………………………………………………………………………………………….

Geneviève Guevara : « Je propose, tu disposes, rien ne s’impose »
Geneviève Guevara fait partie de ces écrivaines, poétesses, artistes peintres qui fascinent tant la passion les anime. Elle porte dans son regard cette lumière bienfaitrice et créatrice qui irradie autour d’elle.
Après une licence en philologie romane et une agrégation, un certificat en langue arabe et islamologie, elle étudie l’art dramatique, au Conservatoire de Namur, puis enseigna le français à l’Institut Saint-Louis de Namur. Mais la poésie a toujours été là, elle a toujours fait partie d’elle.
Geneviève Guevara a une relation étroite, de cœur et d’esprit, avec l’Afrique du Nord. Est-ce ce soleil d’Afrique qu’elle porte dans ses yeux ? Probablement, car Geneviève Guevara est une artiste chaleureuse qui porte la générosité dans son regard.
Elle est poète et peintre et ce n’est pas le fait du hasard, les arts sont liés comme par magie, ce que le peintre transmet par le jeu des couleurs, le poète le transmet par les mots. Le poète joue avec les mots qu’il manie, qu’il tord et magnifie avec cette aisance et facilité déconcertante mais qui retient l’œil averti et le passant pour un moment de pur bonheur qui semble arrêter l’heure, l’oreille n’entend plus le tictac de la pendule pour n’entendre que cette mélodie, cette harmonie qui se dégage du poème ou du tableau.
L’art s’abreuve et s’écoule dans l’éternité, il retient et ralentit le temps qui devient l’ami, l’œuvre d’art n’a point de dualité puisqu’elle converge vers l’union où la beauté prend tout son sens.
Les créations artistiques de Geneviève Guevara se sont gorgées du soleil d’Afrique contrastant avec le froid de la Belgique, d’où cette richesse du mélange des cultures et des couleurs qui promet un avenir meilleur.
La poésie et les tableaux de Geneviève Guevara dégagent un cri d’espoir, même quand le soir tombe avec son chagrin, la plume et le pinceau pensent au soleil du matin, au nouveau jour naissant qui émerveille l’enfant et le regard innocent dans l’éblouissement de la perception remodelée par l’expression artistique d’où jaillissent mille ombres et lumières qui célèbrent la vie.
Le Matin d’Algérie : Vous avez enseigné des années le français, le savoir littéraire, vous avez étudié l’art dramatique, vous écrivez depuis l’enfance, mais vous avez mis le temps pour vous révéler, pour publier, vous êtes multiple, qui est Geneviève Guevara ?
Geneviève Guevara : En effet, j’ai mis beaucoup de temps pour publier parce que j’étais fort occupée pendant toutes ces années. J’ai beaucoup observé, je suis une très très grande observatrice, j’observe les gens, le monde dans lequel on vit.
J’ai beaucoup lu, énormément lu, j’ai découvert des êtres différents. J’aime bien avoir des points de vue différents que je peux confronter. Je dis souvent, que ce soit à mes élèves, à mes enfants… que c’est très important de lire des choses diamétralement opposées : ne pas se cantonner à un seul domaine que ce soit d’un point de vue littéraire ou autre, et ne jamais estimer qu’on a la vérité. Une personne qui estime qu’elle détient la vérité, c’est une personne qui se ment à elle-même et qui ment aux autres consciemment ou non.
Oui, je suis observatrice, je suis curieuse aussi, je suis très respectueuse des autres mais (et ça, c’est vraiment devenu fondamental chez moi) je ne veux plus me taire pour ne pas blesser les autres. J’estime hyper important d’être authentique lorsque l’on pense quelque chose, il importe de le dire avec bienveillance. Et si l’autre est blessé, c’est qu’il a quelque chose à travailler… C’est comme ça maintenant que j’envisage les choses. Avant j’étais trop dans l’observation et je croyais que c’était mieux de me taire pour ne pas blesser mais j’étais dans un amour pour autrui qui n’était pas juste en fait.
J’aime l’authenticité, la congruence, la cohérence. J’aime partager ce que je sais mais sans l’imposer à autrui. Si l’autre estime que je lui impose c’est parce que lui a peut-être cette tendance à vouloir imposer à autrui ses idées… Une de mes phrases porteuses est celle-ci : « Je propose, tu disposes, rien ne s’impose » Par ailleurs, j’ai énormément contemplé des œuvres d’art depuis l’adolescence j’ai été très intéressée par tout ce qui est artistique : peinture, sculpture, danse, musique, tissage, céramique…et surtout l’écriture. J’ai toujours énormément lu depuis mes cinq ans. J’ai beaucoup écrit pendant mon adolescence des poèmes et un roman.
Et puis, pendant trente ans, je n’ai presque rien écrit mais j’ai énormément lu encore et encore. J’ai beaucoup travaillé adolescente la laine (filage, tissage, tricot, broderie…). J’ai un goût de l’ornementation depuis toujours. Quant à la peinture, elle s’est invitée tardivement dans ma vie, depuis 2018 en fait et il m’a fallu plusieurs mois pour me sentir légitime dans cet art. J’ai passé le cap de la légitimité maintenant.
Vous disiez qu’il m’a fallu du temps pour me révéler, ce n’est pas tellement ça, c’est plutôt à manifester qui je suis, à me révéler à moi-même ce qui comme toute personne, c’est le travail d’une vie. Mais j’aurais pu déjà manifester avant. En tous les cas de manière beaucoup plus publique. Je pense que je me suis montrée à mes élèves, à mes enfants, à mes proches… mais pas autant que je le fais maintenant.
Le Matin d’Algérie : La littérature, la poésie, la peinture, vous animent, racontez-nous ?
Geneviève Guevara : La littérature, c’est depuis toujours. Au plus loin que je remonte dans mes souvenirs, la lecture a toujours été quelque chose de sacré. J’ai énormément lu depuis l’âge de cinq ans et demi, à partir du moment où j’ai appris à lire, j’ai dévoré les livres. Je pouvais être dans une salle comble et avec plein de monde et de bruit autour de moi, j’arrivais à me concentrer suffisamment sur la lecture et celle-ci n’a jamais été une lecture superficielle.
La poésie est entrée dans ma vie vers l’âge de treize ans. J’ai écrit beaucoup de poèmes mais je n’ai rien publié sauf un poème dans le livre de l’école. Jusqu’à l’âge de vingt ans, j’ai beaucoup écrit : de la poésie et un roman. Puis, après une année d’université, j’ai arrêté pour me consacrer uniquement à ma vie estudiantine, ma vie amoureuse, puis ma vie professionnelle et ma vie familiale… Et je n’ai presque rien écrit pendant plus de trente ans.
Je lisais toujours autant, peut-être même plus. J’avais des cours à préparer et cela prend beaucoup de temps. Et je me suis investie dans beaucoup de projets interculturels notamment. Et puis, la vie a fait qu’il y a eu énormément de ruptures dans ma vie à partir de 2015 : la vie a été extrêmement difficile pour moi. Et comme il y a eu beaucoup de ruptures, il y a eu du temps pour moi.
Étrangement je n’ai plus beaucoup lu de 2015 à 2022, par contre j’ai énormément écrit surtout de la poésie (certains jours, j’écris jusqu’à six poèmes. Et puis, il y a l’écriture de mon roman commencé il y a déjà maintenant presque six ans… mais c’est une somme ! Il comprendra plusieurs volumes d’ailleurs. Ce roman est assez inclassable. On pourrait le qualifier d’historique puisqu’il traite de plusieurs époques : antiquité, moyen âge, renaissance, fin 19ème- début 20ème, notre époque aussi.
C’est un roman d’amour, un roman philosophique, surtout un roman initiatique. J’espère l’avoir terminé cette année Quant à la peinture, j’étais uniquement observatrice très intéressée mais jamais je n’aurais pensé passer à l’acte de peindre (croyance limitante : » je suis incapable de peindre »…). Mais dans ce moment de rupture, de chaos, de manière assez étrange, sont arrivés dans ma vie plusieurs artistes nord-africains qui m’ont fortement incitée à peindre.
Le Matin d’Algérie : Vous avez une histoire d’amour avec l’Afrique du Nord, nous retrouvons ses rayons de soleils dans vos créations, vous portez cette lumière dans vos yeux, à quoi est due cette magie ?
Geneviève Guevara : Cette histoire d’amour a débuté dès l’adolescence, vers l’âge de dix-sept ans, par l’écoute d’une chanson du groupe Djurdjura. Un véritable coup de foudre. J’ai écouté énormément ce groupe, j’ai même interprété au conservatoire au cours de déclamation un des textes de ce groupe traduit en français. Par ailleurs, la littérature maghrébine m’a fort intéressée. Et l’amour s’est personnalisé aussi. L’Afrique du nord Oui. Le Maroc et depuis 2017, c’est l’Algérie qui est entrée très fortement dans ma vie. Un immense éblouissement qui n’a fait que s’intensifier.
L’Algérie a fortement chamboulé ma vie, on peut le dire. Et je suis d’ailleurs très contente d’avoir eu ce chamboulement même si ça a été quelquefois très inconfortable. Mais bon, je pense que c’était nécessaire notamment pour me relancer dans l’écriture, me lancer dans la peinture (ce sont beaucoup d’artistes algériens qui m’ont incitée à peindre). Enfin, je suis autant attirée que j’attire les nord africains, et plus particulièrement les Algériens, c’est même incroyable parce que c’est constant !
Le Matin d’Algérie : Vous semblez passer de la poésie, à la peinture, au roman, avec une facilité déroutante, d’où cet élan intellectuel exceptionnel qui semble lier le tout en gardant les spécificités de chacune des expressions, comment faites-vous ?
Geneviève Guevara : Parce que je ne me donne aucun frein. J’ai décidé d’être dans la spontanéité, dans l’intuitif, de me laisser porter. Je refuse qu’il y ait des canalisations, des voies balisées…
À une galeriste qui voyant mes tableaux et disait : « mais vous allez dans tous les sens… vous vous cherchez ! », j’ai répondu :
» pas du tout, je ne me cherche pas, je m’amuse ! »
Elle n’a pas compris…
Je trouve que c’est extrêmement important de s’amuser. Je trouve ça extrêmement triste quand on veut absolument canaliser les artistes ou les écrivains en voulant qu’ils peignent ou écrivent toujours d’une certaine façon. Chacun a à être libre entièrement. C’est quelque chose de primordial : on ne brime pas tout ce qui est artistique en soi (et on est tous des artistes). Donc, qui a accepté son côté artistique n’a pas à être canalisé par les autres. C’est lui qui décide de ce qu’il a envie de faire.
Moi, je n’ai pas envie du tout qu’on me dise : « tu dois faire ça comme ça. » Je peins ou j’écris comme je le sens à ce moment-là et avec plaisir.
C’est très très important le plaisir pour moi.
Je ne sais pas si je garde la spécificité de chacune des expressions parce que je fais des ponts entre la peinture et la poésie : j’intègre régulièrement dans mes tableaux des poèmes, des extraits de mes poèmes.
Le Matin d’Algérie : L’Afrique du Nord jouit de cette lumière exceptionnelle recherchée par les peintres, les poètes et les génies littéraires mais malheureusement dans une liberté entravée, toute cette région peine à se démocratiser et se referme de plus en plus sur elle-même, les arts et l’expression artistique en général peuvent-ils aider à l’émancipation de l’Afrique du Nord pour une prise de conscience salutaire d’ouverture culturelle ?
Geneviève Guevara : Concernant cette lumière exceptionnelle en Afrique du nord, c’est évident : on a bien vu les peintres des 19e et 20e siècle… Et c’est vrai que la liberté est entravée… Je parlerai en premier de mon pays et plus particulièrement de mon école. Quand j’ai commencé à enseigner en 1989, je donnais des cours d’art dramatique, d’histoire de l’art et d’esthétique. Ces cours n’existent plus depuis 1995 ! Référons-nous maintenant à cette fameuse pandémie et les confinements : les inessentiels… La littérature, les arts… Je constate tout de même que depuis 2020, il y a énormément de gens qui ont commencé à écrire, leurs écrits sont publiés (ce n’est pas toujours de bonne qualité selon moi, ce qui ne signifie pas que ça ne puisse pas présentement faire du bien à d’autres que moi). Je ne suis pas dans cette énergie d’empêcher ceux qui ont commencé à écrire et qui vont commencer à peindre.
Je pense que c’est nécessaire pour retrouver la créativité en chacun mais c’est important de voir par après quelle est la forme artistique la meilleure pour soi. La promotion de la culture, des arts de manière générale est en recul dans le chef de bien des dirigeants dans le monde. C’est important là maintenant de s’exprimer. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d’essayer, qui ont des croyances limitantes du style : » je ne suis pas capable de, je ne suis pas doué. » Croyance récurrente. J’avais moi-même cette croyance. Si je peins c’est grâce à des nord-africains surtout algériens qui m’ont beaucoup encouragée à me lancer dans la peinture. Mais j’avais cette croyance limitante et je me disais » je ne suis pas capable » … Le mois dernier, je terminais ma 4e exposition ! Ce qu’il faut c’est oser ! Oser sortir de ses croyances limitantes. Ne pas avoir peur de ce que les autres peuvent penser.
Pour revenir à l’Algérie ou à l’Afrique du nord de manière générale, Je pense, au risque de choquer, que ce n’est pas que ceux qui gouvernent qui entravent les autres. Les gouvernants ne reflètent que ce que la majorité du peuple choisit. Ce que je veux dire, c’est que chacun a sa part de responsabilité.
Je vais donner plusieurs exemples. Quand je lis les Kabyles qui râlent parce qu’on construit trop de mosquées en Kabylie et accusent ceux qui les construisent, je réponds tout simplement que si les Kabyles n’ont pas envie que des mosquées soient construites, il ne faut pas y aller, idem pour les écoles coraniques : on n’a pas envie que ses enfants aillent à l’école coranique ? On ne laisse pas ses enfants y aller. Je donne un autre exemple, concernant cette fois mon pays, la Belgique : l’âge de la retraite est fixé à 67 ans. Nous n’avons rien fait pour refuser cette limite. C’est nous qui acceptons certaines choses qu’on nous impose.
Si maintenant il n’y a qu’une personne qui se révolte, c’est sûr que c’est difficile de changer les choses mais si maintenant de manière beaucoup plus générale il y a plus de personnes qui ne sont pas d’accord, on s’extirpe de cette énergie de brimade.
Je pense que c’est à chacun de travailler sur soi-même. Pour revenir à la question, Oui les arts et expressions artistiques aident à l’émancipation des peuples, des individus et pas rien qu’en Afrique du Nord. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que dans les dictatures pures et dures, les artistes sont persécutés voire supprimés. Il y a une autre censure qui n’est pas politique et que j’ai tristement constatée depuis déjà un certain temps en Algérie. C’est cette tendance à discréditer celui ou celle qui réussit et/ou diffère de la ligne de pensée de ses détracteurs.
Je n’évoquerai que trois cas : une jeune chanteuse lauréate d’un concours de télé-crochet lynchée, un jeune poète qui malgré sa mauvaise maîtrise de la langue française osait publier sur son mur : lynché et enfin une amie artiste très fréquemment critiquée sur sa façon de peindre. Je pourrais encore parler de Yasmina Khadra…. L’ouverture culturelle est l’affaire de tous. Elle a à s’effectuer respectueusement. L’intelligentsia a un rôle d’ouverture à promouvoir avec sagesse et bienveillance; le monde artistique a à poursuivre en association son expansion. Je crois en l’impact de festivals comme celui de Raconte Arts.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Geneviève Guevara : Après avoir eu cette année deux expositions de peinture ainsi qu’un symposium artistique en Tunisie, la publication d’un nouveau recueil de poèmes et plusieurs événements littéraires à Bruxelles, dont une conférence que j’ai intitulée » la poésie, des ressentis à la joie « , ce mois de mai sera consacré principalement à la poésie : trois moments poétiques à Bruxelles ( 1 à Uccle, 2 à Anderlecht dont une journée dans la maison de Maurice Carême qui aboutira à la publication d’un recueil collectif). Et puis, en collaboration avec mon amie Ana Lina, j’ai lancé Paris Poésie, le premier après-midi poétique) d’une longue série j’espère) le 19 mai.
En juin, toujours la poésie à l’honneur : la Tour Poétique à Paris en plus de mes rendez-vous poétique mensuels à Bruxelles. À l’occasion de la troisième édition de la Tour Poétique, un recueil collectif sera disponible auquel j’ai contribué : trois de mes poèmes et une réflexion à propos de la poésie. Au niveau plus personnel, je vais continuer d’animer des ateliers d’écriture, de connaissance de soi… Je vais me consacrer à la finalisation de quelques recueils de poèmes parce que j’ai énormément écrit et qu’il est grand temps de présenter maintenant au public cette production. Et enfin, je souhaite ardemment terminer l’écriture de mon roman » MoTsaïques. »
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Geneviève Guevara : Oser. Oser être soi-même, oser dire qui on est, oser découvrir différentes choses, ne pas rester toujours dans le même domaine. Et pourquoi pas lire mes poèmes par exemple… Ne pas avoir peur de la poésie parce que la poésie n’est pas un domaine réservé à une élite. La poésie rend libre. Je pense à Alexandros Panagoulis, cet opposant grec qui, lors de la dictature des colonels, a composé énormément de poèmes lors de son incarcération, poèmes qu’il étudiait par cœur. Ses poèmes lui ont permis de tenir le coup lors des séances de torture… La poésie n’est pas qu’écrite (je pense à Si Mohand qui n’écrivit pas sa poésie).
La poésie est multiple, elle peut se trouver dans toutes les formes artistiques : peinture, photographie… elle peut se retrouver dans une manière d’être, dans la manière d’arranger son logis, sa façon d’être avec les autres… Le mot « poésie » vient de ποιεω, poîéô (en grec) qui veut dire « faire, fabriquer, créer ». La poésie, c’est la création. Elle est à oser.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Lematindalgerie.com
Le mardi 07 mai 2024
…………………………………………………………………………………………
.jpg)
Amine Esseghir : « L’Algérie mérite un meilleur sort »
Amine Esseghir est un journaliste écrivain algéro-canadien, il vient de nous surprendre avec bonheur par la publication d’un livre témoignage, poignant, déchirant, Revenir entier, chez les éditions l’Harmattan.
Revenir entier, interpelle la conscience et l’esprit dans un souci de pousser la réflexion à son plus haut niveau, tant les faits relatés laissent le lecteur écorché, dans une spirale infernale où seules la violence et le non-sens semblent s’exprimer et trouver leur place.
Amine Esseghir nous plonge dans la période la plus noire de l’Algérie postindépendance, quand l’arrêt du processus électoral libéra des forces noires qui ont dévasté le pays laissant à l’histoire une lourde mémoire fragmentée remplie d’interrogations appelant des réponses que le brouillard tarde à libérer.
Amine Esseghir a commencé le métier de journaliste en 1990 au journal Le soir d’Algérie, en 2005 il reçut le prix Euromed Heritage journalistic award (mention spéciale du jury) pour une longue enquête sur les textes du chant Chaabi, en 2012, il publia, Yaghmoracen, raconté par Ibn Khaldoun, une bande dessinée dont il a écrit le scénario avec les dessins de Mohamed Kechida.
Amine Esseghir réalisa deux documentaires, L’épopée de la bataille de Timimoun, en 2009, qui fait appel aux témoins algériens et Français de cette bataille pour le contrôle du Sahara durant la guerre d’Algérie, et, La Sagesse au service de la foi, un portait de Cheikh Abderrahmane El Djilali, un religieux érudit qui prônait la modération en Islam.
Amine Esseghir publia une étude sur les textes Chaabi dans la revue littéraire marocaine Nejma en 2018 et continua son métier de journaliste au Canada.
Revenir entier est un livre qui arrive après une trentaine d’années de maturité, pour déchirer les silences, lever des voiles, pour laisser apparaître des éclairages, des éclaircies, à travers des nuages, des orages, d’une époque ennemie de la vie.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes journaliste, vous venez de publier un livre qui bouscule l’esprit et déchire le cœur, Revenir entier, chez les éditions l’Harmattan, qui est Amine Esseghir ?
Amine Esseghir : Une question difficile pour commencer. Je dirais un individu ordinaire, journaliste par passion, peut-être aussi par vocation. Un projet d’écrivain sur le tard, Algérien de naissance, Québécois par choix et très probablement citoyen du monde.
Le Matin d’Algérie : Vous avez décidé de rompre le silence, trente ans après, vous sentez-vous libéré d’un poids ?
Amine Esseghir : Sincèrement, je ne pense pas avoir considéré le souvenir de la guerre anti-terroriste comme un poids. Du moins ce n’est devenu un poids qu’une fois que fut imposée la charte sur la réconciliation nationale par Bouteflika. Très rapidement j’ai vu le danger que peut constituer une loi qui force les Algériens au silence et à l’amnésie.
Le Matin d’Algérie : Vous avez bénéficié d’une bourse du Conseil des arts du Canada pour pouvoir avoir le temps d’écrire, vous faîtes une tournée en France pour présenter et dédicacer votre livre, comment est accueilli votre livre ?
Amine Esseghir : Oui une bourse pour écrire et une bourse du Conseil des arts et lettres du Québec pour pouvoir faire connaître le livre en France. Justement cela m’a permis de constater que les questions sont toujours lancinantes et les plaies toujours ouvertes. Déjà, la diffusion du livre au Québec, essentiellement à Montréal, m’avait convaincu de l’importance d’écrire et de parler de cette période sombre, ce qui est appelé officiellement la décennie noire ou la tragédie nationale. Mon voyage en France m’a convaincu qu’il est urgent de parler et d’écrire sur les dix ans de malheurs vécus par les algériens dans les années 1990.
Le Matin d’Algérie : Le titre de votre livre, Revenir entier, est incroyable, il accapare le regard, il résonne comme un coup de tonnerre, comment s’est fait le choix de ce titre ?
Amine Esseghir : En fait l’explication est à la fin du livre et je profite de l’occasion pour inciter les gens à lire le livre de comprendre le choix de ce titre.
Le Matin d’Algérie : Trente ans après, quel regard portez-vous sur l’Algérie d’aujourd’hui ?
Amine Esseghir : La seule chose dont je suis toujours convaincu, c’est que les raisons qui m’ont poussé à partir sont toujours valables. Une des plus importantes à mes yeux demeure cette loi du silence appelée Charte pour la paix et la réconciliation nationale.
Au-delà je vois ces jeunes, ces forces vives du pays, livrés à eux-mêmes poussés vers l’exil forcé prenant des risques inouïs pour quitter l’Algérie. Signes d’un échec total de toutes les politiques publiques. Sinon, je ne perçois l’Algérie qu’à travers les informations que je lis ou regarde. Quelques fois des amis toujours en Algérie me donnent leurs propres avis sur ce qui se passe. Dès lors il m’est difficile de donner un avis sans qu’il ne soit incomplet et très certainement subjectif.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Amine Esseghir : Je viens de terminer un roman de climat fiction dont les évènements se déroulent au 23e siècle à Montréal. Après Revenir entier, j’ai eu comme envie de m’éloigner encore plus de l’Algérie probablement.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Amine Esseghir : Il y a cette occasion manquée qui s’accroche comme une guigne à l’Algérie. Ce pays mérite un meilleur sort. Les Algériens méritent un pays où les libertés de réunion, d’activité politique, d’expression sont non seulement garanties, mais font partie des acquis irréversibles. La question de la mémoire s’est greffée aux revendications démocratiques et finalement représente encore une marche à gravir et pousse encore plus loin la possibilité pour les algériens de s’émanciper. Sinon on a beau s’éloigner de l’Algérie, ce pays ne vous quitte pas. Partout où on va, on porte ses souvenirs de bonheur et de malheurs. Comme disait cet étranger, Albert Camus, “de l’Algérie on ne guérit jamais”.
Entretien avec Brahim Saci
Mercredi 1 mai 2024
Lematindalgerie.com
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Marc-Olivier Dupin : « Je suis un artisan qui travaille avec passion »
Marc-Olivier Dupin est un chef d’orchestre, compositeur, d’une grande discrétion malgré une grande carrière qui n’a pas cessée de rayonner avec des compositions et des productions de haute volée.
Marc-Olivier Dupin est d’une famille de musiciens, c’est auprès de son père qu’il étudia le violon avant d’être admis au CNSMD (conservatoire national de musique et de danse de Paris) où il obtient les Prix, d’alto, d’écriture, d’orchestration, d’analyse et direction d’orchestre.
Marc-Olivier Dupin dirigea des institutions musicales prestigieuses, il fut directeur du CNSMD (1993-2000), directeur de l’Orchestre national d’Île-de-France (2002-2008), directeur de France Musique ainsi que la direction de la musique à Radio France jusqu’en février 2011 puis directeur du Pôle sup’93. Marc-Olivier Dupin fut conseiller de Jack Lang, ministre de l’Éducation nationale (2000-2002).
Il fut chargé de mission au CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée, 2011/2013 rapport sur la musique à l’image), délégué à la musique (2016/2017, DGCA (La Direction générale de la création artistique) Ministère de la Culture. Il est membre du Conseil d’administration d’Auteurs solidaires depuis 2017.
Marc-Olivier Dupin est Chevalier de l’Ordre national du Mérite en1995 et de la Légion d’Honneur en 2008.
Marc-Olivier Dupin fait partie de ces grands compositeurs qui traversent humblement le siècle en toute humilité malgré l’apport considérable apporté à la création artistique, il fait partie de ces penseurs qui font évoluer la musique et la composition musicale.
Marc-Olivier Dupin est cet infatigable génie de la musique qui se distingue et s’élève par la magie que dégagent ses créations musicales et par la diversité des répertoires approchés et investis, toujours dans un souci d’ouverture vers d’autres esthétiques, vers d’autres couleurs.
Parmi ses dernières réalisations, de nombreuses musiques de scène pour la metteure en scène Brigitte Jaques et des partitions pour les films documentaires de Jérôme Prieur. Plusieurs opéras pour l’Opéra-Comique : Robert le cochon et les Kidnappeurs (2014), Le Mystère de l’écureuil bleu (2016) sur des livrets du dramaturge et metteur en scène Ivan Grinberg, une adaptation de Puccini, Bohème, notre jeunesse. Pour l’Opéra de Paris, il a composé un ballet, les Enfants du Paradis (2008). Pour le ciné-concert, à la demande d’Arte, il a composé plusieurs partitions notamment pour le Monte Cristo, d’Henri Fescourt. Depuis de nombreuses années, il collabore avec Gallimard sur des livres-CD, tels que Le Petit Prince d’après Saint-Exupéry et Sfar (2019).
Marc-Olivier Dupin me fait penser à Jean-Sébastien Bach (1685-1750) qui a laissé une œuvre de plus de 1300 compositions, dans une richesse harmonique et mélodique qui nous laisse dans l’émerveillement, qui reste un exemple et une source d’inspiration pour toutes les époques.
Les créations de Marc-Olivier Dupin respirent la vie dont le souffle séduit profanes et mélomanes. De l’orchestre à l’image, l’élan poétique rapproche les rivages, le ciel se dégage, se dissipent les nuages, le soleil libéré irradie tout autour pour semer l’amour.
Le Matin d’Algérie : Vous avez un parcours musical qui pousse l’admiration, qui est Marc-Olivier Dupin ?
Marc-Olivier Dupin : Vos compliments sont totalement disproportionnés ! j’ai seulement le sentiment d’être un artisan qui travaille avec passion sur une grande diversité de projets.
Le Matin d’Algérie : Les années ne semblent pas avoir de prise sur vous, vous paraissez infatigable, qu’est-ce qui vous anime ?
Marc-Olivier Dupin : Ce qui m’anime est certainement de travailler sur de grands textes littéraires ou de beaux projets audiovisuels. Réaliser des projets dans lesquels se mêlent musique, texte et image, ou mouvement, reste une vraie passion pour moi.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les compositeurs qui vous influencent ?
Marc-Olivier Dupin : Il y en a beaucoup. Bien évidemment les grands classiques et baroques : Rameau, Purcell, Bach, Haydn, Mozart… Mais également les symphonistes du 19ème siècle : Wagner, Bruckner, Mahler, Strauss ou encore Fauré, Debussy, Ravel et plus proches de nous, Stravinsky, Bartók, Ligeti, Steeve Reich…
Le Matin d’Algérie : Vous êtes pour l’ouverture, nous ressentons cela en parcourant la diversité des répertoires dans vos créations, ce qui renouvelle le souffle des orchestres, quel est votre avis ?
Marc-Olivier Dupin : Il me semble qu’aujourd’hui, tout compositeur peut sortir de « sa boîte à outils » toute sortes de langages et de techniques, et également s’inspirer des musiques du monde. La palette est infinie !
Le Matin d’Algérie : Les conservatoires parisiens s’ouvrent depuis quelques années sur les musiques du monde et les musiques actuelles, qu’en pensez-vous ?
Marc-Olivier Dupin : C’est une très bonne chose, à condition de le faire avec la même curiosité, la même rigueur que pour des musiques de patrimoine écrit. Nous avons la chance de pouvoir connaitre toutes les cultures musicales de la planète. Il faut apprendre à les aimer et les respecter.
Le Matin d’Algérie : Platon disait « Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique », est-ce toujours vrai ?
Marc-Olivier Dupin : C’est plus difficile aujourd’hui à cause de la mondialisation et les multiples métissages, mais on peut toujours en trouver des traces…
Le Matin d’Algérie : Quel regard portez-vous sur l’état de l’enseignement artistique en France ?
Marc-Olivier Dupin : Le système français a beaucoup de points forts. J’y vois cependant deux grandes faiblesses : on ne fait pas assez chanter les enfants jeunes (notamment en chorale), la formation musicale (une version dévoyée du solfège à l’ancienne) dégoute les adolescents et les éloigne de la musique…
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Marc-Olivier Dupin : Toujours… mais ce sont encore des petits secrets…
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Marc-Olivier Dupin : L’Algérie est un grand pays, d’une grande richesse culturelle. Je forme le vœu que davantage de liens de part et d’autre de la Méditerranée puissent nous faire davantage partager nos patrimoines et notre créativité musicale
Entretien réalisé par Brahim Saci
Samedi 27 avril 2024
Le Matindalgerie.com
………………………………………………………………………………………………

Rencontre avec Habiba Benhayoune
Habiba Benhayoune vient de publier un roman poignant, bouleversant, Cœur berbère, chez les éditions Ardemment, il raconte un drame humain, celui d’une famille, de cette petite fille assistant sans défense aux coups portés à sa mère par son père. Ces mêmes coups qu’elle sentait retentir dans son propre corps frêle.
Il y a des romans qui nous font rire ou sourire, celui-ci nous déchire par la force et la justesse des mots choisis, tranchants comme une lame fraîchement aiguisée tirant le lecteur de son confort en le laissant en larmes, il aimerait s’interposer pour protéger et rendre le sourire à cette petite fille et sa mère.
Ce roman nous raconte une tragédie mais aussi un drame psychologique, celui de cette famille originaire du Rif, secouée par une misère sociale qui s’accompagne d’une violence sans nom.
Ce roman pose des questions cruciales, celles du déracinement et de l’exil qui s’impose, de l’ortie qui étouffe la rose, dans une société rifaine du silence, des non-dits, où les femmes sont invisibles, écrasées par le poids des traditions, dans un monde d’hommes, souffrent en silence.
Du Maroc à l’Algérie, jusqu’en France, l’exil pèse, laissant des braises dans les entrailles et des âmes qui brûlent comme un feu de paille que personne ne voit, on se consume en silence, seules les cendres trahissent le feu qu’on se démène à cacher.
Ce n’est qu’en dépassant le repli vers la culpabilité, dépassant, fracassant les tabous, qu’on entrevoit la liberté, pour se retrouver et se reconstruire.
Ce roman est un fleuve d’émotions qui interpelle notre cœur et notre esprit, il nous dit que même dans la nuit la plus sombre apparaît une lucarne d’où jaillit l’éclaircie qui rend tout possible, même le pardon impossible.
Le Matin d’Algérie : Vous venez de publier, Cœur berbère, chez les éditions Ardemment, un roman qui laisse des traces, qui transpire le vécu, qui est Habiba Benhayoune ?
Habiba Benhayoune : Cœur berbère est paru fin 2022 aux Éditions Ardemment à Paris. Habiba Benhayoune est une autrice, simple citoyenne française avec une double culture, qui toute sa vie s’est battue contre les aléas de la vie pour être et non paraitre, dans l’humilité et la discrétion. Habiba a traversé les mers houleuses, bravé des tempêtes pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui.
Le Matin d’Algérie : Vous étiez dernièrement au café littéraire parisien de l’Impondérable, invitée de l’écrivain Youcef, vous avez évoqué votre histoire familiale jalonnée de blessures, de souffrances, de silences, vous avez ému le public, le laissant au bord des larmes, comment peut-on se reconstruire après une jeunesse écorchée, volée ?
Habiba Benhayoune : Oui tout à fait et je salue le café littéraire de m’avoir accueillie ainsi que Youcef, que je félicite pour son initiative d’organiser ces rencontres littéraires qui permettent aux auteurs de s’exprimer. J’ai rencontré Youcef en février lors du salon du livre franco-berbère (CBF) et il m’a proposé de présenter mon livre au café littéraire.
L’histoire du roman n’est pas isolée. Les thèmes que j’y aborde de l’intérieur, à savoir la violence conjugale, le déracinement, l’exil, la souffrance que peuvent endurer des enfants dont les parents en font des covictimes est inhumaine. Cette violence est universelle, elle n’a ni visage, ni frontière. C’est ce que ce livre cherche à partager. Beaucoup de gens peuvent s’identifier à l’histoire de Yemma et de la famille du pêcheur, qu’ils se situent à n’importe quelle échelle sociale, leur histoire se ressemble. Le livre se veut porteur d’espoir et s’adresse à tout le monde, femmes, hommes, et concerne notamment les enfants en développement. Quel est le devenir de ces enfants qui vivent ces violences en spectateurs tétanisés, impuissants ! Ils mémorisent indéniablement des chocs pour le reste de leur vie car, les blessures du passé ne cicatrisent jamais totalement.
Le livre, non seulement, évoque la profondeur de la souffrance de la jeunesse d’Aouïcha, mais elle a commencé bien plus tôt, dès le berceau. Un enfant enregistre tout. Un enfant est une personne. Tout commence pour lui à ce moment-là. À partir de là, il peut devenir très sensible et voire même devenir fragile. Plus tard, certains s’en sortiront quand d’autres s’enliseront. La différence viendra des outils que chacun d’eux mettra en œuvre ou pas afin de sortir « presque » indemnes de cet héritage imposé, non choisi.
Cette écriture verbalise les violences, tapies souvent sous silence, pour les mettre en lumière.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes psychologue du travail, est-ce les déchirements de votre vécu qui vous a ouvert les portes de la psychologie ?
Habiba Benhayoune : il faut savoir que je suis devenue psychologue du travail sur le tard. Après un bac littéraire et un BTS de tourisme, j’ai exercé plusieurs métiers auparavant. Au départ, j’ai souhaité reprendre des études en cours du soir, conciliant vie professionnelle et familiale. À quarante ans j’intègre le Conservation Nationale des Arts et Métiers de Paris pour y préparer le diplôme de Psychologue du Travail en autodidacte.
Au départ, c’est l’expérience acquise au cours du parcours professionnel qui m’a conduite vers ce projet qui consistait à apprendre à comprendre les interactions en situations de travail. Qu’est-ce qui fait que les gens tombent malades au travail alors que pour moi, le travail est synonyme d’équilibre. J’ai mis sept ans au lieu de huit pour couronner ces longues années d’études. Ce sont ces études qui m’ont ouvert les yeux, m’ont fait comprendre ce que moi-même trouvais nébuleux. Cette prise de conscience m’a donné l’envie de me livrer. Un premier livre, l’Exil dans la vapeur » est paru en 2010 Aux Editions l’Harmattan. Un livre qui rend hommage au travail dit « invisible » et à l‘absence de reconnaissance.
J’ignore si mon vécu passé est la raison qui m’a donné l’idée de retourner aux études tout en travaillant, mais ce qui est certain, c’est que la rencontre avec des concepts de certains psychologues, entre autres (Freud, Vygotsky, Wallon, Piaget, etc.) résonnaient très fort chez moi. Ils m’ont permis de franchir des portes que je pensais closes à jamais. Je me sentais renaitre après chaque victoire. J’appris que le langage instrumentalise la pensée. Je me mets ensuite à griffonner tous les mots interdits que j’avais mémorisés depuis l’enfance et qui bouillonnaient dans ma tête. Ces mots interdits hérités que je m’entendais dire : « ne rien dire, ne rien faire, ce serait la honte ». Ces paroles que tout enfant enregistre n’est pas toujours efficace. Avec le temps et du recul, j’ai réussi à mettre des mots sur les maux qui me rongeaient en profondeur pour donner sens à une grande douleur refoulée depuis toujours, convertie en amnésie infantile.
L’objectif étant de réaliser mon indépendance, parvenir à me reconnaître dans une identité propre. Donc, oui ces études ont été une bénédiction pour moi. Mieux vaut tard que jamais.
Le Matin d’Algérie : Vous avez l’art de la narration, de la description, quels sont les écrivains qui vous influencent ?
Habiba Benhayoune : Ce livre s’est écrit dans ma tête tout le long de ma vie. Forcément, je me sens influencée par les écrivains, j’ai beaucoup lu étant jeune. Je lis un peu de tout. J’aime apprendre, tout peut m’interpeller, un livre, une affiche placardée dans les stations de métro, un tableau dans un musée, les voyages, les gens d’ailleurs avec leurs différences. Il ne faut pas oublier aussi que j’ai baigné dans une double culture dans le sud de la France et à Paris. Je passais mon temps à fréquenter les bibliothèques en dehors de l’école. Je ne partais pas en vacances. J’ai une écriture simple, accessible à tous et quand j’écris, je me demande si le lecteur comprendra, donc je me mets à sa place. J’affine, j’aime créer.
Rencontre avec le poète écrivain Amar Gacem
D’autre part, mon enfance passée sous silence dans mon pays natal, l’Algérie, dont les couleurs flamboyantes m’ont dotée de souvenirs inoubliables qui ne peuvent que raviver des mots et surtout une sensibilité emplie d’émotions. Ça va de soi. La nature environnante en en bord de mer là-bas parmi les pêcheurs, à Coralès, m’a bercée et encensée, semant une poésie irénique dans mon cœur. L’amour des choses, la saveur de la vie, la douceur de certains instants sont des éléments propices à l’écriture.
Plus tard, je découvrirai des auteurs et poètes classiques au collège et lycée. Ils me rendaient la liberté qui me manquait. Je devenais aérienne, me laissais entrainer dans une farandole poétique grâce à Ronsard, Baudelaire, Prévert, Gide.
Cependant ma route, semée d’embûches et d’écorchures indéniables, formait une ambivalence entre la vie familiale à la maison et l’école qui, paradoxalement m’offrait un espace propice à la rêverie. L’école de la République devenait ma deuxième famille. Les écrits de Victor Hugo résonnaient tellement chez moi. J’avais l’impression d’avoir vécu dans les Misérables. Je détestais les Thénardier de maltraiter Cosette. Tantôt gavroche car je me suis construite seule, tantôt Cosette quand il m’arrivait de n’avoir rien quand j’étais étudiante, seule au monde à Paris, mais la ténacité et l’espoir me poussaient à persévérer, me contentant de faire silence, de passer inaperçue. J’ai appris à me relever très vite de mes chutes. J’aime la poésie et je pense que je dois ce don précieux à ma mère qui m’a nourrie de contes et de chants amazighes.
Le Matin d’Algérie : Le poids des traditions cause encore bien des souffrances, l’Afrique du Nord peine à se démocratiser, la littérature peut aider à son émancipation, qu’en pensez-vous ?
Habiba Benhayoune : Les traditions ont été transmises de nos aïeux à nos parents qui nous les inculquent. Nous héritons de ce partage intacte, d’origine, qui ne s’adapte pas forcément au contexte moderne. Pourque ces traditions puissent continuer de se perpétuer, elles doivent s’adapter continuellement au parcours de chacun, les vivre autrement, les améliorer, ou rendre caduques certaines. Le monde avance en s’adaptant constamment. C’est alors que les traditions utilisées à bon escient, à petites doses, peuvent être bénéfiques et leur poids s’alléger. Il faut trier les choses pour alléger et convertir en positifs ce qui peut l’être. Une personne ne peut pas prendre à la lettre tout ce qui se dit tout comme elle ne peut pas non plus porter les valises seule au risque de s’effondrer ! Utiliser avec parcimonie et intelligence ce qui est positif et s’écarter du négatif. Agir en fonction de chacun et je sais pertinemment qu’on ne peut pas plaire à tout le monde. À chacun de saisir sa liberté d’action, sa destinée.
La littérature ne suffit pas à elle seule à prétendre être une solution. Elle s’adresse aux lettrés mais que faire des personnes si nombreuses encore à ne pas fréquenter l’école, nombre de filles aujourd’hui n’ont jamais mis les pieds dans une école. À la campagne, souvent elles sont mariées jeunes, on ne leur demande pas leur avis. Même si des progrès sont fournis à ce sujet, la route reste encore loin, longue, inaccessible à la gente féminine. On ne peut pas parler d’émancipation dans ce cas si l’éducation demeure inabordable.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Habiba Benhayoune : Oui, tout à fait un projet en cours, en gestation. Un autre à venir plus tard, j’ai besoin de temps. Je ne suis qu’à mon début et le dernier mot n’est jamais dit me concernant.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Habiba Benhayoune : Je vous remercie de me donner la parole. Je suis honorée que le Matin d’Algérie s’intéresse à mon livre dans lequel j’adresse un clin d’œil à mon pays natal. Je ne me sens plus seule désormais.
Je souhaite transmettre un message aux jeunes filles, aux jeunes femmes pour leur dire de ne pas rester dans l’ombre, de continuer à persévérer même si c’est dur, rien ne vaut la dignité, un combat de tous les jours, l’humilité, le respect de soi et des autres, et l’humanité dont j’ai moi-même été dotée par ma mère. La sagesse dans laquelle elle m’a élevée m’a sauvée. Aujourd’hui je continue mon chemin de résilience. La mémoire de certains souvenirs est toujours présente et me susurre à l’oreille « qu’on ne guérit pas de son enfance mais qu’on peut y survivre ».
Ce livre est un hommage à Yemma qui a beaucoup tremblé pour moi. Elle m’a encouragée à aller de l’avant. Une mère est universelle, une mère est irremplaçable. Elle donne la vie. Elle est le pilier de sa famille, elle porte et supporte, c’est elle qui continue de se battre, de porter le monde quand d’autres abandonnent. Cette femme dont la vie, mise à dure épreuve, est passée sous silence. Cette femme amazighe analphabète au foyer est avant tout Yemma. Elle m’a encouragée à persévérer pour devenir indépendante financièrement afin, je cite ses mots, « ne pas être une bourrique qui reçoit le bâton ».
Son intelligence pratique m’a construite, sa sagesse m’a fait grandir. Je suis fière d’avoir été sa fille. Le pardon peut être rendu possible mais pas les actes de violences.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Jeudi 18 avril 2024
lematindalgerie.com
…………………………………………………………………………………………………
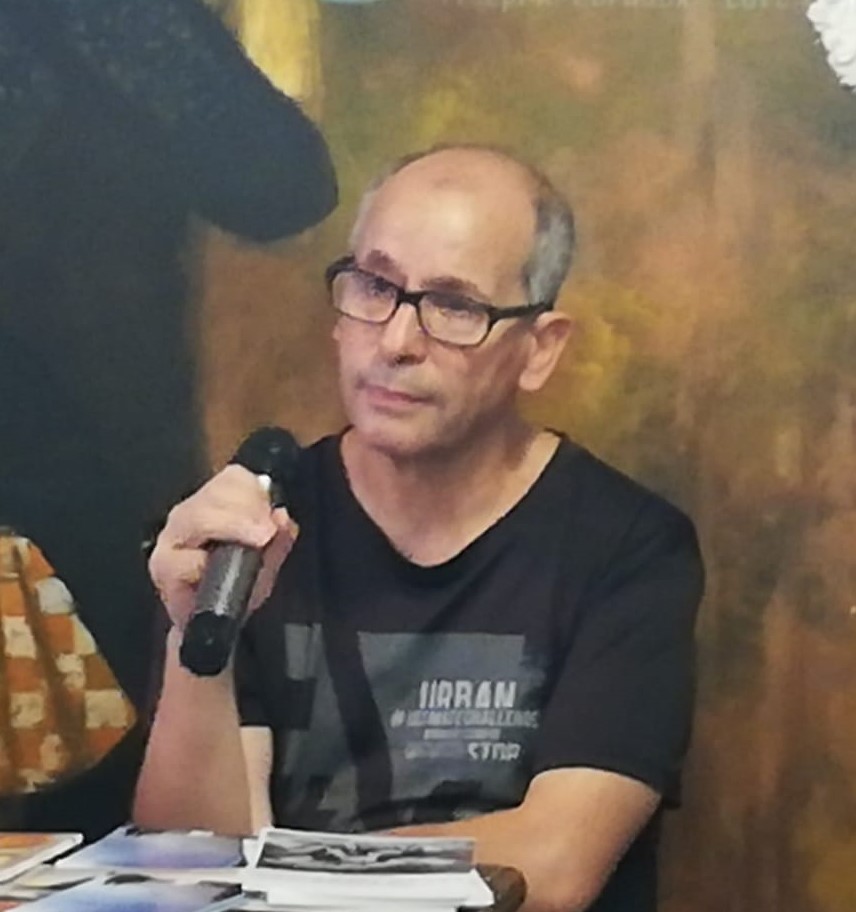
Rencontre avec le poète écrivain Amar Gacem
Amar Gacem est un auteur poète d’expression kabyle qui sait que rien ne peut remplacer la langue maternelle, il y a des choses, il y a des émotions, des pleurs qui passent mieux en kabyle que dans une langue empruntée. Cette idée rejoint celle de Jean El-Mouhoub Amrouche, « Je pense et j’écris en français mais je pleure en kabyle ».
L’écrivain Youcef Zirem l’a invité au café littéraire de l’Impondérable, nous avons pu constater la richesse des échanges, nous avons découvert un poète au grand cœur, qui maîtrise parfaitement la langue kabyle, nous avons pu apprécié l’élan poétique magnifié du poète kabyle.
Amar Gacem fait partie de cette nouvelle génération d’écrivains d’expression kabyle qui continuent à créer, à produire avec bien des peines, luttant contre vents et marées.
La littérature d’expression kabyle a pris de l’ampleur ces dernières années et le public s’y intéresse de plus en plus, apportant à la langue un nouveau souffle salvateur vers un avenir prometteur.
Amar Gacem vient de publier un nouveau recueil de poésie poignant dont le titre est évocateur, isuɣan n tsusmi, (les cris du silence), chez les éditions Tanekra.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes poète écrivain, la littérature vous passionne, qui est Amar Gacem ?
Amar Gacem : Ma passion pour la littérature et la poésie date de mon enfance. Lorsque j’étais encore très jeune, je souffrais d’une timidité excessive qui m’empêchait de m’exprimer facilement. J’avais pour unique réconfort la lecture et la composition de poèmes. La poésie est à mon sens une auto psychanalyse, en ce qui me concerne tout au moins.
Je suis né à Tizi Mellal, le village où le poète renommé Ahmed Lemseyyeh a vu le jour. Pendant 37 ans, j’ai vécu au pied de la montagne « Kouriet », en parfaite harmonie avec la nature, avant de venir m’établir en France en 2001. En Kabylie, j’ai exercé le métier d’enseignant dans des écoles primaires de différents villages durant une vingtaine d’année.
En plus de mon parcours professionnel, je me suis engagé activement au sein de l’association Slimane Azem à Agouni Gueghrane et j’ai travaillé avec le journal « Le Pays-Tamurt », puis avec la revue « Racines-Izuran », sous la supervision de Moh Si Belkacem et Salem Zenia. En 1994, avec quelques amis du village, j’ai pris part à la fondation de l’Association Ahmed Lemseyyeh, dont j’ai assuré la présidence jusqu’en 2001.
Une fois en France, j’ai d’abord exercé divers métiers, puis je me suis ensuite spécialisé dans l’accompagnement professionnel.
Tout au long de mon existence, la poésie est restée ma compagne constante, tel un ange veillant sur moi…. En Algérie, l’écriture ne m’a jamais quitté, que ce soit le jour ou la nuit. J’avais pour habitude d’écrire partout et en toute occasion, le matin comme le soir, à l’intérieur comme à l’extérieur, dans les transports en commun ou en pleine rue. Des poèmes jaillissaient dans ma tête, aussi imprévisibles qu’une averse soudaine. À mon arrivée en France, j’ai été abandonné par ma muse, ce qui m’a fait traverser une période de sécheresse poétique dépassant les dix ans.
En 2019, Julien Pescheur, le directeur des éditions Sefraber, a pris l’engagement de publier mon premier recueil de poèmes, intitulé « Izlan n tayri d tlelli ». (Chants d’amour et de liberté). C’est peut-être grâce à cela que j’ai réussi à sortir de ma longue torpeur poétique et que je me suis remis à écrire des vers.
En 2020 j’ai édité, à compte d’auteur, ma pièce de théâtre « Axxam iderwicen ». En 2021, j’ai fondé la petite maison d’édition « Tanekra » et j’ai également initié la revue poétique « Tamurt imedyazen » (la terre des poètes), grâce à l’aide précieuse de mes amis Oulaid Arkat, Hamid Ait Said et Hafsi Fazia. Depuis l’année 2020, je suis membre de l’Association Projet culturel amazigh monde (PCAM), fondée et présidée par le célèbre artiste Majid Soula.
Le Matin d’Algérie : Vous faites partie de cette nouvelle génération d’écrivains d’expression kabyle mais malgré vos efforts la littérature kabyle peine à s’imposer, à quoi est-ce dû à votre avis ?
Amar Gacem : Bien que le premier roman de l’histoire ait été écrit par un Amazigh, la littérature kabyle ou amazighe s’est principalement développée à travers la tradition orale. La domination étrangère ne lui a jamais accordé le temps de se développer. Aujourd’hui, la littérature kabyle et /ou amazighe, malgré les efforts de la nouvelle génération d’écrivains, peine à s’imposer pour diverses raisons :
1) Le manque de lectorat : les Kabyles et les Amazighs en général ne s’intéressent pas à la lecture. En ce qui concerne les rares individus qui apprécient la lecture, leur choix se porte souvent sur des livres rédigés en français, en arabe ou en anglais.
2) Le manque de promotion : La promotion de la littérature amazighe est très insuffisante pour ne pas dire inexistante. Pour atteindre un public plus étendu, il est indispensable que les auteurs amazighs bénéficient d’une plus grande visibilité grâce à des manifestations littéraires, des festivals, des médias et des plateformes numériques.
3) Le manque de soutien institutionnel : L’absence de soutien institutionnel, aussi bien au plan local qu’au niveau national et international, représente un obstacle au développement de la littérature amazighe. Afin de permettre aux écrivains de concevoir et de diffuser leurs œuvres, il est essentiel de leur offrir des subventions, des bourses et des installations adéquates.
En tous les cas, il est impératif de soutenir la littérature amazighe d’encourager l’usage de la langue tamazight et de fournir un encadrement institutionnel adéquat pour assurer son développement et sa consécration.
Le Matin d’Algérie : Votre poésie est à la fois limpide et écorchée, quels sont les auteurs et poètes qui vous influencent ?
Amar Gacem : Ma poésie est le fruit de l’assemblage d’émotions profondes et de réflexions mûrement réfléchies, et j’y puise mon inspiration en observant la société et le contexte dans lesquels je suis immergé. Voici certains poètes qui ont marqué ma vie : Ahmed lemseyyeh, Charles Baudelaire, Nizar Kabbani, Ben Mohamed et Lounis Ait Menguellet.
Le Matin d’Algérie : Vous venez de publier un nouveau recueil de poésie dont le titre, isuɣan n tsusmi, (Les cris du silence) interpelle le cœur et l’esprit, pouvez-vous nous en parler ?
Amar Gacem : Les cris du silence ont vu le jour dans la souffrance omniprésente qui a régné en Algérie avant et après octobre 1988. J’ai uniquement utilisé les mots pour dénoncer ou exprimer les souffrances que la plupart des Algériens ont vécues en secret. Le recueil compte 23 textes, composés et rédigés durant la période allant de 1983 à 1990.
Humilité et grandeur chez Lounis Aït Menguellet
Le Matin d’Algérie : Voyez-vous un avenir à la littérature d’expression kabyle ?
Amar Gacem : L’avenir de notre littérature et de notre culture dépendent de plusieurs facteurs déterminants :
1) L’Éducation et l’apprentissage : L’éducation revêt une importance capitale dans la conservation de la littérature et de la culture. Pour assurer le développement harmonieux des générations futures, il est crucial que les écoles, les universités et les institutions enseignent l’histoire, la langue et les arts. La langue amazighe doit être intégrée dans les systèmes éducatifs de tous les pays nord-africains. Sans oublier les institutions éducatives d’autres pays, parmi lesquels la France.
2) Le soutien institutionnel : Il incombe aux gouvernements, aux organismes culturels et aux mécènes de participer activement. Il convient d’offrir un soutien aux artistes, aux écrivains et aux créateurs dans le but de leur permettre de développer des créations signifiantes et percutantes.
3) La création et l’innovation : La culture ne peut pas rester figée dans le passé. La littérature et les arts doivent s’appuyer sur l’innovation et la créativité pour se développer et conserver leur importance.
En somme, l’avenir de notre littérature et de notre culture dépendra de notre engagement collectif à préserver, à innover et à transmettre ce patrimoine précieux.
Le Matin d’Algérie : La littérature, la poésie en particulier, peuvent aider à l’émergence d’une nouvelle conscience émancipatrice, qu’en pensez-vous ?
Amar Gacem : Sans aucun doute, la littérature et la poésie possèdent le pouvoir d’affranchir l’esprit, de stimuler la conscience et de provoquer l’envie de changement. La poésie offre la possibilité d’explorer des émotions intenses, des réflexions personnelles et des vécus uniques. Elle nous incite à méditer sur notre propre être et à mettre en doute les conventions établies.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Amar Gacem : Effectivement, quelques-uns de mes textes sont en attente de publication, à savoir deux recueils de poésie, une pièce de théâtre ainsi qu’un ouvrage consacré à l’œuvre et à la vie du poète Ahmed Lemseyyeh.
En ma qualité d’éditeur, je suis heureux de vous annoncer la prochaine publication du numéro 3 de la revue de poésie « Tamurt imedyazen » et d’un recueil de poèmes de Ghani Ath Hemmouche intitulé « Isefra mgal tatut » (Poèmes contre l’oubli).
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Amar Gacem : Je vais conclure avec cette belle citation de Mouloud Mammeri :
« Ceux qui, pour quitter la scène, attendent toujours d’avoir récité la dernière réplique à mon avis se trompent : il n’y a jamais de dernière réplique – ou alors chaque réplique est la dernière – on peut arrêter la noria à peu près à n’importe quel godet, le bal à n’importe quelle figure de la danse. Le nombre de jours qu’il me reste à vivre, Dieu seul le sait. Mais quelque soit le point de la course où le terme m’atteindra, je partirai avec la certitude chevillée que quelque soient les obstacles que l’histoire lui apportera, c’est dans le sens de sa libération que mon peuple – et avec lui les autres – ira. L’ignorance, les préjugés, l’inculture peuvent un instant entraver ce libre mouvement, mais il est sûr que le jour inévitablement viendra où l’on distinguera la vérité de ses faux semblants. Tout le reste est littérature ».
J’ajoute en kabyle : win i iḥemmlen tutlayt-is ad iɣeṛ idlisen-is
Entretien réalisé par Brahim Saci
lematindalgerie.com
Mardi 16 avril 2024
…………………………………………………………………………………………………………

Jean-Michel Wavelet raconte Camus : ombre et lumière
Le lecteur est accaparé dès les premières pages par la force de la narration, où l’élan poétique subjugue et ouvre la réflexion. Jean-Michel Wavelet possède la magie du conteur pour faire passer les idées et la magnanimité du philosophe qui s’interroge.
Ses années de recherche sur l’amélioration de l’école afin de pallier à l’échec scolaire, et ceux qui réussissent malgré leur condition sociologique offrant un champ d’étude extraordinaire, ont amené la maturité littéraire nécessaire.
Jean-Michel Wavelet s’est intéressé à ce fils de cordonnier devenu l’un des plus grands philosophes de son temps, Gaston Bachelard, que rien ne prédestinait à la philosophie, en publiant un livre poignant, Gaston Bachelard, l’inattendu – Les chemins d’une volonté, aux éditions L’Harmattan, qui inspira artistes, poètes, philosophes et savants.
Jean-Michel Wavelet s’est intéressé ensuite à ce fils d’analphabète et de pauvre, né à Dréan en Algérie, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1957, devenu l’un des plus grands écrivains de son temps et l’un des écrivains les plus lus dans le monde : Albert Camus. En publiant, Albert Camus – La Voix de la pauvreté, et Albert Camus enseignant empêché, pédagogue résistant, parus chez les éditions L’Harmattan.
Jean-Michel Wavelet éclaire les zones d’ombres et nous dévoile un Camus inattendu, dont l’œuvre porteuse de réflexions et d’interrogations ne cesse d’émerveiller mais aussi de bousculer.
Albert Camus est l’écrivain, philosophe, romancier et dramaturge, à l’origine de la philosophie de l’absurde, l’humaniste, l’homme d’esprit, mais aussi l’incompris.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes écrivain, conférencier, qui est Jean-Michel Wavelet ?
Michel Wavelet : J’ai commencé ma vie comme instituteur dès l’âge de 18 ans. Issu des quartiers sensibles des Hauts de France, j’avais la passion de faire réussir tous les élèves. Je n’ai jamais accepté l’injustice scolaire que l’école fabriquait souvent à son insu. J’ai tout mis en œuvre pour qu’il en soit autrement pour les plus modestes et les moins chanceux. J’observais mes élèves et notais après chaque journée de classe mes réflexions sur leurs difficultés et leurs progrès. Ces écrits me sont devenus très précieux parce qu’ils m’ont permis de découvrir ce que je ne voyais pas dans le vécu de ma classe. Au fil du temps et des études littéraires et philosophiques que j’ai effectuées en sus de mon métier, ces notes sont devenues des articles, puis des livres.
Entretemps, je suis devenu inspecteur primaire puis inspecteur d’académie. J’ai pu ainsi élargir mon champ de recherche et de réflexion. J’ai cherché alors à analyser le fonctionnement si peu démocratique de l’école et à suggérer des pistes d’amélioration. Et puis j’ai pensé qu’il fallait prendre le problème autrement. Plutôt que de passer au crible les difficultés des enfants défavorisés, peut-être était-il plus intéressant de porter attention aux enfants modestes qui ont, en dépit des pires obstacles, connu une réussite inattendue.
C’est ainsi que je me suis passionné pour les parcours mystérieux et atypiques de ces fils de pauvres devenus de manière totalement inattendue, écrivains ou philosophes célèbres. Ces trajectoires étaient de véritables énigmes que je cherche depuis lors à élucider.
Le Matin d’Algérie : De Gaston Bachelard à Albert Camus, vous avez publié un livre sur Gaston Bachelard et deux livres sur Albert Camus, ce n’est pas un hasard, qu’est-ce qui lie ces écrivains philosophes ?
Michel Wavelet : Le rapprochement entre Gaston Bachelard et Albert Camus n’avait jamais été fait jusqu’à présent. En première analyse tout semble les éloigner l’un de l’autre. Bachelard est épistémologue et s’intéresse au fonctionnement de l’imaginaire, de l’invention, de la découverte et de la création. Il ne participe guère à la vie de la cité et ne s’engage pas. Camus déploie ses talents de créateur doté d’une imagination et d’une sensibilité hors du commun.
Son champ est celui de l’art et de l’éthique. Et il n’hésite pas à s’engager dans la Résistance et pour la défense des libertés. L’un cherche à classer les formes d’imaginaire et les modes de connaissance, l’autre fait vivre les images et les idées. L’un est un homme de l’Est dont les racines familiales sont partiellement allemandes et l’autre est méditerranéen.
Et pourtant quelque chose d’essentiel les rapproche. Bachelard a lu Le Mythe de Sisyphe et cite Camus à plusieurs reprises. Jean Grenier, le professeur de philosophie et l’ami de Camus, est collègue de Suzanne Bachelard, la fille de Gaston, à l’université de Lille.
Et à cette occasion, il évoque auprès de Camus les recherches étonnantes de Bachelard sur les matières de nos rêveries. Mais surtout, tous deux sont issus de familles pauvres dont la culture est ouvrière et technique. Bachelard est fasciné par la cordonnerie et l’artisanat, Camus fréquente l’atelier de tonnellerie de l’oncle Etienne et se montre fort habile de ses mains. Tous deux pensent que le corps est façonné par le travail. Tous deux aiment le sport et ont joué au football. Tous deux ont fait du théâtre.
Tous deux voudraient éradiquer la misère et sont favorables au solidarisme. Tous deux sont philosophes, refusent la métaphysique abstraite et n’imaginent qu’une philosophie plurielle et concrète, une philosophie de la vie appuyée sur l’expérience. Tous deux sont profondément attachés à l’école et à la formation. Et puis bien sûr, ces fils de pauvres ont inversé le cours de leur destin social. Ils ont refusé le chemin qui leur était tracé à l’avance, la cordonnerie pour l’un, la tonnellerie pour l’autre. Contemporains l’un de l’autre, ils sont morts tous deux au début des années soixante et ont traversé la première moitié du XXe siècle.
Le Matin d’Algérie : Albert Camus reste une figure emblématique et controversée, il fut pourtant un journaliste engagé dans Alger républicain, et dans la revue Combat, qu’en pensez-vous ?
Michel Wavelet : Albert Camus est profondément humain et n’a jamais prétendu avoir atteint la perfection et être exempt de contradictions. Il a beaucoup douté de lui et de ses qualités d’écrivain, s’estimant même parfois moins talentueux que nombre de ses contemporains. Il considérait que Malraux méritait davantage le prix Nobel que lui, l’enfant du quartier populaire Belcourt. Il ne s’est jamais départi de ce sentiment d’imposture qui anime souvent les enfants de milieu modeste ayant franchi la frontière de leur classe d’origine.
Dans La Chute, il dépeint sans indulgence ses faiblesses. Et c’est sans doute cette honnêteté qui le rend si humain. C’est cette humanité qui nous fascine tant. Et c’est aussi elle qui interdit l’idolâtrie. On voudrait l’oublier parce qu’il refuse d’être un dieu vivant. Camus n’a jamais cru en l’absolu et aux lendemains qui chantent. Il a toujours vu l’envers sous l’endroit, le non sous le oui, la folie des hommes sous la séduction des idées. Il a toujours dénoncé les dangers de l’abstraction, la tentation totalitaire derrière la promesse de l’enchantement. Loin des raccourcis idéologiques et du simplisme ambiant, il assume la complexité de la vie humaine.
On lui envie ses combats mesurés, son extrême lucidité à l’égard de l’histoire. On lui envie la modernité de ses textes, l’actualité de ses récits. La lecture de La Peste nous a aidé à lutter contre le Covid, L’Étranger nous fait réfléchir sur la force des préjugés et les effets morbides d’un usage délétère des réseaux sociaux, Le Premier Homme pose le problème des sociétés bloquées par la reproduction sociale. La lucidité de Camus qui le conduit souvent à être incompris est insupportable aux yeux de ceux qui pensent avoir raison contre le réel lui-même.
Et pourtant Camus ne s’est jamais trompé. Dès 1935, il adhère au parti communiste algérien et lutte contre le colonialisme dont il dénoncera toujours les effets désastreux. En 1937, on l’exclut de ce même parti parce qu’avec ses amis arabes il persiste à défendre cette ligne anticolonialiste.
En 1938, il persiste et signe à pourfendre le colonialisme en dénonçant la misère qui en résulte en Kabylie et l’absence illégale de scolarisation de nombreux enfants arabes faute d’école, ce qui contrevient à l’obligation d’instruction des lois Ferry de 1882. En 1941, il entre en Résistance en enseignant aux enfants juifs, victimes de l’antisémitisme du régime de Vichy et cofonde en 1943 le mouvement Combat. Dans les années cinquante, il se bat contre la peine de mort et continue de dénoncer les inégalités entre la métropole et l’Algérie et la misère de la condition ouvrière. Il est aussi l’un des premiers à dénoncer le totalitarisme soviétique et franquiste. Il est aussi l’un des premiers à craindre la montée des extrémismes et du terrorisme.
Le Matin d’Algérie : Beaucoup reprochent à Albert Camus le peu de personnages algériens dans ses romans, quand il y en a ils sont insignifiants, comme si ses romans se déroulaient en métropole, et qu’il n’ait jamais avoué ouvertement son anticolonialisme, quel est votre avis ?
Michel Wavelet : On ne peut raisonnablement prétendre que Camus est colonialiste parce que les personnages algériens sont peu fréquents ou insignifiants dans ses romans. C’est un peu comme si l’on jugeait qu’un écrivain est misogyne parce que les femmes n’y sont pas suffisamment mises en lumière.
Dans Le Premier Homme d’ailleurs, Camus souligne sa joie d’être à l’école de la rue d’Aumérat au milieu de toutes les communautés, sources de richesses. Il joue, fait du sport, s’instruit avec ses copains arabes et dénonce leur quasi-disparition à l’entrée du lycée.
Mais Camus comprend très vite que, sous l’apparence d’un vivre-ensemble, une hiérarchie sociale existe entre colons pauvres et indigènes très pauvres. Ainsi, « des Arabes ou des Mauresques faméliques, parfois un vieux clochard espagnol », faisaient les poubelles et trouvaient « encore à prendre dans ce que des familles pauvres et économes dédaignaient assez pour le jeter (Le Premier Homme, OC, IV, p. 825). »
Pendant ce temps, les enfants arabes et français jouaient spontanément et ensemble au football. On note pareil compagnonnage entre l’Arabe et le père de Jacques dans Le Premier Homme. Le dialogue témoigne d’une certaine complicité, voire d’une ébauche de fraternité. Ils se parlent en connaisseur : « Tu connais les chevaux », dit l’Arabe. La réponse vint, brève, et sans que l’homme sourit : « Oui », dit-il » et l’Arabe de poursuivre pour rassurer « son compagnon » : « N’ayez pas peur. Ici, il n’y a pas de bandits (Ibid., p. 743-744).
Le sentiment d’inégalité face à l’école est également souligné. Ce ne sont pas tant les Arabes qui sont très vite écartés du système scolaire, ce sont les Arabes pauvres, de loin les plus nombreux. Ainsi Camus souligne qu’il avait bien « des camarades arabes à l’école communale », mais que « les lycéens arabes étaient l’exception » et qu’ils « étaient toujours des fils de notables fortunés (La femme adultère, in L’Exil et le Royaume, OC, IV, p. 12-13).
On comprend que la coexistence entre colons pauvres et Arabes, le plus souvent très pauvres, ne soit guère aisée. C’est une manière de gérer la misère que de diviser les pauvres entre eux et d’insuffler quelques sentiments xénophobes ou parfois même racistes. Albert Camus souligne à la fois la richesse des compétences des Algériens et les tensions qu’il perçoit entre les communautés dont le traitement n’est pas assez équitable.
Loin d’être relégués dans l’insignifiance, les Algériens sont souvent au cœur des préoccupations camusiennes. Dans L’Exil et le Royaume, l’une des nouvelles, L’Hôte, fait de l’Arabe le personnage central qui a dû voler de la nourriture pour nourrir sa famille. Et dans La Femme adultère, Janine admire les Arabes et les populations nomades au détriment de son triste commerçant français de mari. Elle n’est pas insensible au charme de l’Arabe aux gants qui paraît ne pas la voir et passe « autour d’elle dont les chevilles gonflaient ». Elle est même fascinée par les nomades qui vivent au milieu des dromadaires et des tentes noires : « elle ne pouvait penser qu’à eux, dont elle avait à peine connu l’existence jusqu’à ce jour (Lettre 535 du 15-12-1952 à Maria Casarès, op. cit., p. 892).
On retrouve la même fascination chez Camus qui avoue à Maria Casarès son intention de revoir « les tentes noires des nomades, pauvres et imposantes » qu’il aime, car il se sent « un peu de leur race, jamais fixé en un point de la terre, n’aimant pourtant que cette terre si pauvre et si nue (La Mort heureuse, OC, I, p. 1108).
Le nomadisme a son charme en ce qu’il repose sur le partage d’un certain dénuement qui forge le vivre-ensemble. Il dégage une fraternité et une solidarité qui fait tant défaut à la vie des pauvres des cités et à celle des plus aisés. Il rend encore plus insupportable la grande pauvreté qui secrète famine et misère au sein du peuple.
D’autres textes transmettent une image positive des Algériens. Dans La Mort heureuse, les Arabes étaient des acrobates « en maillot rouge » qui « tournaient et retournaient leur corps devant la mer où bondissait la lumière (La Mort heureuse, OC, I, p. 1108). Lorsque l’on sait que Camus valorisait le corps, on comprend l’admiration qu’il a pour ces gymnastes.
Même dans L’Étranger, plus controversé sur ce plan, l’Arabe est au cœur du récit puisqu’il est la victime pour laquelle se déroule le procès de Meursault qui d’ailleurs n’a pas non plus de prénom. Il faut donc lire intégralement Camus pour connaître sa véritable position sur ces questions.
Jamais au demeurant dans ses romans, il n’est question de justifier le colonialisme. Dans L’Étranger qui se déroule à Alger, il est fait état de dissensions entre des membres de la communauté arabe et française. Mais ces conflits ont quelque chose de fraternel et de passionnel sur fond de rivalité. Peut-être s’agit-il aussi d’une affaire de proxénétisme puisqu’on y apprend que l’un des Arabes est le frère de l’ancienne maîtresse de Raymond qui a une réputation de souteneur et qu’il y a un litige d’ordre sentimental.
Dans La Peste, l’action se déroule à Oran, dans une ville moins cosmopolite qu’Alger et que Camus n’affectionne pas particulièrement. C’est la communauté française et les autorités coloniales qui y sont dépeints sous un jour très défavorable.
Les Arabes ne sont guère présents, mais leur pauvreté et leur mauvais traitement inquiètent à tel point que le journaliste Raymond Rambert est chargé d’enquêter pour un grand journal parisien « sur les conditions de vie des Arabes (La Peste, OC, II, p. 41), dont l’état déplorable est dénoncé par le docteur Rieux.
Dans La Chute, Clamence, l’avocat français des pauvres est un anti-héros cynique et lâche.
Et puis bien sûr, la pauvreté produite par le colonialisme y est fortement dénoncée. La crainte de la famine dans les populations arabes laisse des traces littéraires. Dans L’Exil et le Royaume, Daru, l’instituteur des Hauts Plateaux est chargé de distribuer les sacs de blé aux victimes de la sécheresse. Mais « le malheur les avait tous atteints puisque tous étaient pauvres », et se transformaient en une « armée de fantômes haillonneux errant dans le soleil ». Les hommes, comme les bêtes, meurent « sans qu’on puisse toujours le savoir (Lettre 163 du 18 septembre 1951 à Jean Grenier, Correspondance Albert Camus-Jean Grenier (1932-1959), Gallimard, 1981, p. 180)
Il faut bien entendu lire aussi Les Chroniques algériennes et les onze articles sur La Misère en Kabylie pour comprendre combien Camus pouvait détester le colonialisme. Cette détestation commence dès 1935 avec son adhésion au parti communiste algérien sur ces bases anticoloniales. Il en est exclu en 1937 parce qu’il poursuit ce même combat.
Dans une lettre à Jean Grenier datée de 1951, Camus explique les raisons de son départ du parti : « Les affiches et la vente du journal, croyez-le n’y étaient pour rien. Pour un jeune sportif, c’était même plutôt drôle et du reste je le faisais, de mon propre gré, pour le théâtre et la maison de la culture, jamais pour le parti qui soignait ses intellectuels. Mais on m’avait chargé de recruter des militants arabes […]. Je l’ai fait et ces militants arabes sont devenus mes camarades […]. Le tournant de 36 est venu. Ces militants ont été poursuivis et emprisonnés, leur organisation dissoute, au nom d’une politique approuvée et encouragée par le P.C. Quelques-uns qui avaient échappé aux recherches sont venus me demander si je laisserais faire cette infamie sans rien dire. Cet après-midi est resté gravé en moi ; je me souviens encore que je tremblais alors qu’on me parlait ; j’avais honte ; j’ai fait ensuite ce qu’il fallait (Lettre 163 du 18 septembre 1951 à Jean Grenier, Correspondance Albert Camus-Jean Grenier (1932-1959), Gallimard, 1981, p. 180).
Dès 1939, Albert Camus attire l’attention sur l’appauvrissement des peuples d’Algérie et sur l’exploitation intolérable des vies humaines qui favoriseront l’état de guerre. Il préconise une véritable « politique sociale constructive (Dans le questionnaire Carl A. Viggiani, Camus confirme en effet l’hostilité du Gouvernement général à son égard. Celui-ci « intervenait auprès des entreprises privées (imprimeries) pour empêcher qu’on [l’] engage » (OC, IV, p. 647.), suite au reportage d’Alger-Républicain sur la misère en Kabylie.) On ne l’écoutera pas, mais on le lira. Le gouverneur général d’Algérie sera sourd à ses avertissements mais attentif aux propos subversifs du journaliste. La fiche de renseignement le concernant s’épaissira et lui vaudra quelques ennuis lors de son entrée aux États-Unis en 1946. Les autorités aveuglées par l’idéologie colonialiste et dominatrice lui reprochèrent d’avoir exhibé cette misère que personne ne voulait voir. Camus a eu raison trop tôt.
L’histoire confirmera malheureusement ses analyses quelque vingt ans plus tard. Camus persistera à sensibiliser la nation et ses dirigeants à la faveur d’articles publiés régulièrement dans d’autres journaux. Il continua en 1940 avec l’éphémère Soir-Républicain avant de s’engager pour Combat et la Résistance et de s’y illustrer de 1943 à 1947.
Il y dénoncera en 1945 la famine qui donne, en sus de la misère, un profond sentiment d’injustice puisque le Français a droit à trois fois plus de grains que l’Algérien alors que ce dernier a su se sacrifier pour leur patrie commune : « Un peuple qui ne marchande pas son sang dans les circonstances actuelles est fondé à penser qu’on ne doit pas lui marchander son pain ». Il en appellera à la solidarité car « quand des millions d’hommes souffrent de la faim, cela devient l’affaire de tous » Sa plume fera entendre avec force la voix des victimes de la misère et de la domination coloniale.
En 1958, il doit pourtant constater que rien n’a été fait et qu’une politique conservatrice qui opprime, appauvrit et asservit favorise le développement d’un nouvel impérialisme au même titre qu’un abandon du « peuple arabe à une plus grande misère ». Dans les deux cas, le processus conduit à la guerre, au terrorisme et à davantage de misère.
Albert Camus termina pourtant sa « carrière » de journaliste à L’Express en 1955 en plaidant pour une Algérie plus juste et pacifiée et en continuant de dénoncer le scandale de la pauvreté. Au cours des huit mois de coopération aux côtés des amis de Pierre Mendès-France, il n’oubliera pas ses habitudes de reporter critique et, dans trois des vingt-huit articles publiés, trouvera l’occasion de dénoncer encore la pauvreté et la misère en écho à son enquête en Kabylie.
On ne peut comprendre aussi sa position sur l’Algérie sans saisir le lien qu’il effectue entre colonialisme, nationalisme et injustice : « Je ne pense pas être prêt à transiger sur les questions qui provoquent ma colère : le nationalisme, le colonialisme, l’injustice sociale et l’absurdité de l’État moderne (Albert Camus parle avec Nicola Chiaromonte, Partisan review, octobre 1948, OC, II, p. 720).
Camus refuse toute frontière et tout mur entre les peuples. Il est pour un fédéralisme à l’échelle mondiale fondé sur l’entraide et la solidarité, une sorte de mondialisation à visage humain.
C’est pourquoi son refus d’une indépendance de l’Algérie n’est pas une acceptation du colonialisme, mais une hostilité à la mise en place de frontières nouvelles et d’un nationalisme hostile à toute coopération. Il ne veut pas non plus de l’Algérie française.
Il souhaite que la France et l’Algérie se rejoignent dans un Etat fédéral reposant sur l’égalité et la solidarité entre les peuples.
Le Matin d’Algérie : Les Algériens aiment beaucoup Albert Camus, il est l’un des leurs. Mais à Stockholm le 14 décembre 1957 à l’issue de la cérémonie de remise du prix Nobel de littérature, Albert Camus tient une conférence de presse quand un jeune algérien l’interpelle sur la situation sanglante en Algérie, Albert Camus répond « J’ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi le terrorisme qui s’exerce aveuglément dans les rues d’Alger. En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d’Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c’est cela la justice, je préfère ma mère ». Cette phrase maintes fois déformée résonne encore dans les esprits et alimente la part d’ombre, qu’en pensez-vous ?
Michel Wavelet : « Si c’est cela la justice, je préfère ma mère » peut être entendu de deux manières. C’est d’abord une réaction humaine aisément compréhensible. C’est un fils qui a peur pour la vie de sa mère qui a 75 ans et une santé fragile. Elle est prise dans une guerre qui menace son existence.
C’est aussi le fruit d’une réflexion. Qu’il s’agisse des Justes ou de L’Homme révolté, Camus considère qu’on ne peut construire la justice en commettant l’injustice à l’égard de victimes innocentes. Il exècre la violence et la terreur et estime qu’on ne peut bâtir une société équilibrée par la révolution. Une société solidaire exclut toute puissance dominatrice d’une classe par une autre.
Camus, comme Péguy, ne considère pas non plus la justice comme un concept abstrait. Elle doit se vivre et s’éprouver dans le quotidien et non être décrétée abstraitement. Elle doit se construire avec les hommes dans le dialogue démocratique et non par la soumission ou l’élimination de quelques-uns par quelques autres. Camus estime que la liberté est la valeur suprême. Un pays libre peut construire la justice, mais un pays totalitaire ne le peut même s’il impose la justice à tous par la force. La terreur ne conduit qu’à la terreur.
En aucun cas, Albert Camus ne préconise l’injustice, il indique simplement la voie la plus humaine pour y accéder. Comme il le dit lui-même dans son discours de Stockholm, Camus est du côté de ceux qui subissent l’histoire, des persécutés et des humiliés, des pauvres, des victimes des injustices et non des fauteurs d’injustice. Mais comme toujours, son raisonnement est mesuré, son jugement est fin et incompris. Il dit toute la complexité de l’action humaine qui échappe à tout manichéisme.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Michel Wavelet : Je travaille actuellement sur un petit ouvrage consacré à Camus et à sa découverte émerveillée du Vaucluse. Il s’intitule « Albert Camus, l’amoureux du Vaucluse ». Ce territoire sera sa patrie d’adoption dont la lumière et les paysages lui évoquent tant l’Algérie, si chère à son cœur. Ce livre comporte de nombreuses photos des lieux de villégiatures camusiennes.
Je continue également à travailler sur les enfants pauvres qui ont pu inverser le cours de leur destin. J’écris actuellement une biographie de Charles Péguy, fils de rempailleuse de chaises, (« Charles Péguy, le rempailleur de textes ») et j’ai un autre projet de livre sur l’école (« Réinventer l’école sous le regard des enfants pauvres », ce qui nous changera du regard des héritiers sur l’école).
Je continue également d’effectuer de nombreuses conférences sur les parcours de vie et de pensée de Bachelard et de Camus. Après Amiens, Nancy, Épinal et Châteauroux, je vais effectuer prochainement trois conférences dans le cadre de l’université d’Aix-Marseille. Ce mode de transmission est de l’ordre du partage que je considère comme essentiel. Je projette de me rendre à Alger pour y entretenir la mémoire de Camus.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Michel Wavelet : On n’a pas suffisamment mesuré l’importance que Camus accordait à l’éducation. Et pourtant Camus n’a eu de cesse de vouloir transmettre par ses essais, son théâtre et ses récits des valeurs d’humanité et de solidarité auxquelles il était profondément attaché. Et pourtant son ultime roman inachevé est un roman d’éducation. Et pourtant Camus s’est exprimé à plusieurs reprises sur sa conception de l’école en dénonçant notamment son inadaptation à la société du futur.
Il eut néanmoins le temps, dans ce roman d’éducation, de montrer que l’on ne fabrique pas une femme ou un homme dans la solitude, mais dans l’interdépendance et l’entraide, que l’on ne forge pas l’humanité sans intelligence collective, que l’on n’élève pas un être fin et sensible sans amour et que l’on n’arrache pas un être à la pauvreté sans le précieux concours d’une école chaleureuse, fraternelle et solidaire.
La question de sa mise à l’écart de l’enseignement en 1938 par une commission présidée par le gouverneur général d’Algérie est un sujet tabou et troublant sur lequel je reviens aussi en détail dans mon dernier livre Albert Camus, enseignant empêché, pédagogue résistant. Camus ne s’est jamais exprimé sur cet épisode douloureux. Mais son silence, comme souvent chez lui, fut éloquent et son refus de siéger au jury du prix littéraire d’Algérie tant que le gouverneur en serait l’instigateur signe sa défiance à l’égard des autorités coloniales.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Livres :
Albert Camus: Enseignant empêché, pédagogue résistant. Éditions L’Harmattan
Albert Camus : La voix de la pauvreté. Éditions L’Harmattan
Gaston Bachelard, l’inattendu : Les chemins d’une volonté. Éditions L’Harmattan
Pour réussir l’épreuve de français du concours de recrutement des professeurs des écoles. Éditions Delagrave
Libérons l’avenir de l’école. Éditions L’Harmattan
Une école pour chacun. Éditions L’Harmattan
Lematindalgerie.com
jeudi 11 avril 2024
……………………………………………………………………………….

« Bientôt les vivants », un roman poignant d’Amina Damerdji
L’écrivaine et chercheuse franco-algérienne Amina Damerdji, après son premier roman, Laissez-moi vous rejoindre, qui a eu un grand succès, vient de nous surprendre pour notre plus grand bonheur par la publication d’un deuxième roman lumineux au titre évocateur, Bientôt les vivants, toujours chez les éditions Gallimard. Il a été récompensé par le prix Transfuge du meilleur roman français 2024.
Il est des écrivains qui illuminent par le style et la force de la narration élevant au paroxysme l’élan littéraire et poétique, envoûtant l’imaginaire, laissant le lecteur entre les larmes et l’émerveillement, envahi par un flot d’émotions qui s’écoule page après page, malgré les drames et les déchirures, interpellant la conscience, l’esprit et le cœur humain, Amina Damerdji en fait partie.
Amina Damerdji a l’art d’écrire, son style s’affine et arrive à maturité, elle tisse sa toile et le génie littéraire fait le reste.
Dès les premières pages on se sent embarqué vers un voyage qui met tous les sens en alerte, le souffle coupé renaît puis s’accélère, s’essouffle et s’apaise, Amina Damerdji a le génie littéraire, qu’ont seulement les plus grands écrivains comme William Faulkner, Honoré de Balzac, Victor Hugo, Gabriel García Márquez, Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Mohamed Dib, Tahar Djaout pour son livre, les vigiles, sa dernière publication avant d’être assassiné, Youcef Zirem, particulièrement pour ses livres, la guerre des ombres, l’homme qui n’avait rien compris, et la porte de la mer.
Amina Damerdji articule ses personnages à la fois écorchés et attachants, immergés malgré eux dans ces années noires, de tant d’incompréhensions, d’incertitudes, qui laissent la pensée dans l’impasse.
Dans une Algérie plongée dans le chaos, dans une société algérienne en ébullition, en mutation, en perte de repères, livrée aux extrêmes, dans la barbarie, la détresse et le sang versé, la nature est là heureusement pour nous rappeler qu’après la tempête l’éclaircie est possible.
La Matin d’Algérie : Vous êtes écrivaine, chercheuse en lettres et sciences sociales, très en vogue, qui est Amina Damerdji ?
Amina Damerdji : Je suis née aux États-Unis puis j’ai grandi à Alger jusqu’à sept ans. Dans ma famille (algérienne et française) mais aussi à travers nos déménagements puis, plus tard mes voyages (j’ai vécu à Madrid et à La Havane), j’ai rencontré des gens très différents, qui pensaient, sentaient et voyaient le monde de façon singulièrement différentes, parfois même opposées. Je me suis construite dans cette pluralité.
La Matin d’Algérie : Vous venez de publier Bientôt les vivants, chez Gallimard, un livre poignant, déchirant, dont l’histoire se déroule dans les années les plus noires de l’Algérie post-indépendance, vous avez vécu cette période où la mort était l’ombre des vivants, comment peut-on survivre après cela ?
Amina Damerdji : C’est précisément ce que raconte le livre : malgré les massacres, malgré les pertes de proches, malgré la peur, les Algériens et les Algériennes faisaient plus que survivre : ils vivaient. Ils allaient au travail, avaient des histoires d’amour, des rêves, des déceptions, faisaient la fête etc. Quand on parle de la décennie noire, on parle des massacres, des paroxysmes de violence (et la violence était là, bien réelle) mais on ne parle jamais de ce qu’il y avait autour : cette incroyable capacité à continuer à vivre.
La Matin d’Algérie : Vous avez l’art du choix des titres, Laissez-moi vous rejoindre, pour votre premier roman, et, Bientôt les vivants, pour votre deuxième roman, des titres phares qui accaparent au premier regard la curiosité du lecteur, comment faites-vous ?
Amina Damerdji : Pour les deux romans, les titres sont venus à la fin. Pour Laissez-moi vous rejoindre, il s’agit des derniers mots de la narratrice. Bientôt les vivants, est quant à lui emprunté à Kateb Yacine, à la deuxième strophe de « Poussière de juillet » :
« Et même fusillés
Les hommes s’arrachent la terre
Et même fusillés
Ils tirent la terre à eux
Comme une couverture
Et bientôt les vivants n’auront plus où dormir »
Dans ce poème magnifique, Kateb Yacine parle du poids des morts d’une autre guerre, la guerre d’Indépendance : en isolant la première partie du vers, on va vers quelque chose de plus lumineux qui est, je l’espère, la trajectoire du roman.
Kateb Yacine et M’hamed Issiakhem : digressions sur deux livres
La Matin d’Algérie : Vous avez le génie littéraire, quels sont les auteurs qui vous influencent ?
Amina Damerdji : J’ai été influencée très tôt par des poètes. Arthur Rimbaud a été la première référence importante pour moi. Sa déconstruction du vers et surtout le fait que le geste d’écriture soit essentiellement chez lui un geste d’autonomie, de liberté m’a marquée dans mon adolescence. Il y a aussi eu le poète espagnol Federico García Lorca, assassiné au début de la guerre civile. Son rapport à la noirceur et à la lumière m’a fascinée. Chez les romanciers, Virginia Woolf pour sa manière de nous plonger dans le flot des pensées des personnages, Gabriel García Márquez pour son art de conter et son humour.
La Matin d’Algérie : Dans une Algérie qui se cherche, qui tend à se refermer de plus en plus sur elle-même, qui peine à se démocratiser, la littérature peut-elle aider à cette émancipation, à cette ouverture que le peuple attend comme une bouffée d’oxygène ?
Amina Damerdji : Le pouvoir du roman est précisément de briser les murs. En abordant le monde à travers la complexité et la richesse des personnages, en faisant un pas de côté par rapport à la langue quotidienne, en ouvrant sur l’imaginaire, la littérature permet de sortir des positions campées, des éléments de langage qui rétrécissent la pensée.
La Matin d’Algérie : L’écrivain veille et interpelle les consciences, pour les rendre meilleures, c’est un rôle qu’il endosse, qui s’impose, en ce sens, il y a beaucoup d’enseignements à tirer de votre livre, l’écrivain algérien Youcef Zirem dit qu’il n’y a pas de meilleur idéal que de se battre pour les droits humains, pour l’humanisme, pour le progrès, pour une vie digne pour toute l’humanité, qu’en pensez-vous ?
Amina Damerdji : Bientôt les vivants, n’est pas un roman militant. Il raconte un monde, celui de l’Algérie des années 1990, et pose une question existentielle qui dépasse le cadre de l’Algérie, une question que nous avons tous été amenés à nous poser : doit-on maintenir coûte que coûte les liens avec nos proches, notre famille, même quand ce lien nous abîme ?
La Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Amina Damerdji : Je commence à entrevoir le monde de mon troisième roman. L’Algérie n’en sera pas absente mais j’en parlerai quand je serai plus avancée dans l’écriture.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Livres :
Bientôt les vivants, roman, éditions Gallimard, 2021
Laissez-moi vous rejoindre, roman, éditions Gallimard, 2024
Poésie et dissidence à Cuba : Engagement et désengagement des écrivains, de la Havane à Madrid (1966-2002) éditions Casa Velazquez, 2022
Lematindalgerie.com
Lundi 8 avril 2024
……………………………………………………………………………………..
/image%2F1720502%2F20240416%2Fob_799b90_435982157-7733600866684088-25131940178.jpg)
Café l’Impondérable : Habiba Djahnine, une poésie entre ciel et terre
Habiba Djahnine était l’invitée de l’écrivain Youcef Zirem au café littéraire parisien de l’Impondérable, le 7 avril dernier.
Le livre de poésie, Traversée par les vents, publié chez les éditions Bruno Doucey, de Habiba Djahnine a été l’occasion de discuter de poésie, de féminisme, de cinéma, de décennie noire, de mysticisme… au café l’Impondérable de Youcef Zirem.
Habiba Djahnine est productrice, documentariste, réalisatrice de films, poétesse et écrivaine. Mais on ne peut parler de Habiba Djahnine sans évoquer sa sœur Nabila qui était une architecte engagée pour le droit des femmes, l’une des plus grandes féministes algériennes.
Nabila a créé l’Association de Défense des Droits des Femmes, Tiɣri n tameṭṭut (cri de femme), dont elle était présidente. Elle a lutté durant toute sa courte vie contre le Code de la famille reléguant les femmes au statut de mineures.
Nabila Djahnine a été assassinée par l’obscurantisme, par des fondamentalistes musulmans le 15 février 1995, rejoignant les milliers de victimes de cette période la plus noire de l’histoire de l’Algérie post-indépendance.
Habiba Djahnine est l’initiatrice de Béjaïa Doc, un atelier de création de films documentaires. Elle sillonna les routes d’Algérie dans le cadre de ces ateliers.
Son long métrage poignant, Lettre à ma sœur, consacré à sa sœur Nabila, a eu un grand impact sur le réveil des consciences et le sursaut identitaire.
Son recueil, Traversée par les vents, est une envolée mystique, une invitation au voyage, à la méditation, où le cœur interpelle l’esprit.
Le recueil s’ouvre sur une citation de Rumi (Djalâl ad-Dîn Rûmî), le grand poète mystique persan, l’un des plus hauts génies de la littérature spirituelle universelle.
« Je viens de cette âme qui est à l’origine
de toutes les âmes
Je suis de cette ville qui est la ville
de ceux qui sont sans ville
Le chemin de cette ville n’a pas de fin
Va, perds tout ce que tu as, c’est cela
qui est le tout. »
Cette citation donne le ton du recueil, une dimension mystique et spirituelle s’ouvre à nous et nous attire vers un beau voyage où aventuriers, chercheurs et initiés s’y retrouvent dans une voie qui transcende la réalité déchirant l’illusion vers la vérité.
« Tout nous assaille
Inquiétude et chaos
Tissent un sentiment
Peut-être une conviction
De n’appartenir qu’à la terre »
La terre nourricière qui donne vie et accueille la mort. La vie en sort toujours vainqueur.
Durant l’échange avec Youcef Zirem, une atmosphère apaisante nous enveloppa tous, les lectures de poèmes plongèrent la salle dans l’émerveillement, il faut dire que Youcef Zirem sait donner le ton, le rythme, le tout planant dans l’harmonie.
Habiba Djahnine cite les grands savants mystiques qui l’influencent, qui lui parlent, Rumi (Djalâl ad-Dîn Rûmî), Hallaj (Mansur al-Hallaj), Kheyam (Omar Khayam), des références qui émeuvent le public, éveillant les cœurs vers l’union et l’amour.
Les regards se croisent bienveillants, heureux du partage culturel comme une douce brise fraîche soufflant sur les âmes.
« Aâmi Salem
…..
J’ai bu du thé qu’il m’a offert et j’ai demandé
« As-tu prié … ? As-tu jeûné ? »
« Dieu m’a dispensé de tout
Ma soumission à Lui recouvre mes prières
Quant au jeûne il m’est quotidien »
Le sage, le mystique ou même l’Ermite savent voir au-delà des voiles, des cieux pleins d’étoiles, loin des certitudes, loin des servitudes, loin du superflu de note époque folle, ils se délectent de l’essentiel.
Le poète comme le peintre peint sa réalité, met des couleurs là où il n’y en a pas, ces couleurs sont les mots, ceux qu’il choisit et ceux qui s’imposent d’eux-mêmes.
« Les entrailles de la terre ont gémi
Désarroi destruction agonie
En lambeaux ils étaient
Mais ils se relèveront d’entre les morts
Ils reviendront maintes fois leur dire
Que la terre a assez bu de mensonges et de crimes
J’avais la conviction non la certitude d’un désert »
Habiba Djahnine a côtoyé les vents de la peur, de l’effroi, ceux qui accompagnent le sifflement de la faux de la faucheuse fauchant les âmes, elle peut maintenant accueillir ceux du déserts, ces vents qui sculptent les dunes et les mirages, son regard la portent au-delà des horizons, des vents mauvais aux vents meilleurs.
La rencontre littéraire s’est terminée aux frontières du désert, libre à chacun de continuer à marcher sur le sable fin ou de rebrousser chemin.
Brahim Saci
Livres de poésie :
Outre Mort – édition El Ghazali.
Fragments de la maison – édition Bruno Doucey.
Traversée par les vents – édition Bruno Doucey.
Les films :
Lettre à ma sœur
Autrement citoyens
Retour à la montagne
Avant de franchir la ligne d’horizon
Safia, une histoire de femme
La Kabylie des Babors
D’un Désert
Brahim SACI
DIASPORADZ
Le 10 avril 2024
…………………………………………………………………………………………………………….

Crédit photo : Jean-Marc Cherix
Rencontre avec Laure Mi Hyun Croset
Laure Mi Hyun Croset est une écrivaine qui émerveille le regard et l’intellect, une écriture forgée par l’expérience d’un vécu qui donne à chaque mot son poids et l’œil est captivé, le cœur est apprivoisé par ce style limpide mais ciselé où le souffle s’apaise, comme une césure qui offre une halte poétique aux dimensions spirituelles aux ailes mystiques.
Le lecteur averti trouvera la source où s’abreuver, l’aventurier trouvera des voyages inespérés, heureux donc celui qui sait regarder et lire derrière chaque ligne.
Laure Mi Hyun Croset a cette magie qu’ont seulement les grands auteurs, celui de retenir le lecteur par une écriture vraie sans concession, celui-ci se laisse accaparer au point de ne plus vouloir sortir tant il fait sienne l’histoire, et les sens sont en éveil pour ne rien rater pas même une respiration.
Laure Mi Hyun Croset a fait ses études à l’université de Genève en littérature française et en histoire de l’art, où elle a obtenu une licence, installée à Genève elle consacre son temps à l’écriture pour notre plus grand bonheur.
Laure Mi Hyun Croset ne cesse de nous surprendre agréablement par ses publications de qualité portant son génie littéraire au paroxysme des cimes, elle passe de la nouvelle au roman avec une facilité déconcertante, rétrécissant ainsi la frontière entre les deux genres, on s’y plonge, la brièveté et la densité se complètent, attendant avec suspense le dénouement.
Laure Mi Hyun Croset vient de publier, Made in Korea, un roman au titre évocateur paru aux Éditions BSN Press & Okama, c’est une histoire poignante, écorchée, sur le chemin d’une renaissance.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes une écrivaine au grand talent, qui ne cesse de faire parler d’elle, vous passez aisément de la nouvelle au roman, au conte, qui est Laure Mi Hyun Croset ?
Laure Mi Hyun Croset : Merci, cher Brahim Saci, pour vos mots magnifiques et perspicaces ! Derrière le journaliste, je perçois l’attention du poète. Il serait trop long de parler de ma personne, de ses passions et de ses contradictions, donc je vais plutôt vous dire deux mots sur l’écrivaine. Si je suis née en Corée et que je vis en suisse, ma vraie patrie est la langue française et je suis davantage une styliste qu’une conteuse. En effet, ce qui m’intéresse le plus, c’est le dispositif narratif, la structure, le point de vue sur les choses et le langage avec lequel je tente d’exprimer une partie de la complexité de notre monde.
Le Matin d’Algérie : La littérature semble faire partie de vous, quels sont les auteurs qui vous influencent ?
Laure Mi Hyun Croset : Vous avez totalement raison, je suis une plus grande lectrice que romancière. Si je suis une immense fan de La Bruyère, Flaubert ou Kundera, dont j’apprécie énormément l’ironie, j’aime aussi la littérature américaine contemporaine sombre et sauvage. Dès le moment où un auteur possède une acuité du regard et un style puissant pour l’exprimer, je suis emballée.
Le Matin d’Algérie : Made in Korea, interpelle le cœur et l’esprit, racontez-nous la genèse de ce roman ?
Laure Mi Hyun Croset : Comme j’avais écrit un roman très étrange et qu’il n’a pas encore trouvé preneur dans les grandes maisons d’édition françaises, j’ai décidé d’écrire un texte plus amène, un microroman plus optimiste, mon troisième pour la collection Uppercut qui associe sport et littérature. Ayant appris que j’avais un diabète génétique et étant adoptée, je me suis dit que ça serait amusant d’exploiter ces deux talons d’Achille dans un même roman et qu’il était temps de travailler sur mon pays d’origine. J’ai donc choisi le taekwondo et ai commencer à bûcher avec ardeur mon sujet.
Le Matin d’Algérie : Vous avez la magie de la narration, vous arrivez à aborder tous les sujets même les plus sensibles et graves sans jamais lasser le lecteur, comment faites-vous ?
Laure Mi Hyun Croset : Merci infiniment ! J’utilise l’ironie qui permet que, derrière chaque phrase, il y en ait une autre ou du moins un autre sens. Je recours aussi à l’ellipse qui fait travailler le lecteur. J’ai beaucoup de mal à exprimer tout simplement une chose et encore moins au premier degré. Je suis aussi très attentive au rythme de mon récit et j’élague énormément. Tout ce qui n’est pas strictement nécessaire doit disparaître ! J’écris assez vite, mais je relis très longtemps mes textes.
Le Matin d’Algérie : Il y a tout un élan poétique dans vos écrits, mais on sent un cri dans chaque mot, comme pour éveiller les consciences et les personnes endormies, pensez-vous que la littérature peut changer notre regard sur le monde ?
Laure Mi Hyun Croset : Vous avez une nouvelle fois tout à fait raison. J’essaye de bousculer mes lecteurs. Je les emmène dans une histoire jusqu’au moment où ils s’aperçoivent que mon personnage s’est trompé et qu’ils auraient dû moins s’identifier et garder une distance critique. J’ai envie que les gens se méfient de tout discours, qu’ils s’intéressent toujours à la source qui les émet. C’est en cela que ma littérature est engagée, moins par les thématiques que j’aborde, mais par cette vision de l’art qui doit réveiller les gens. Je pourrais le faire de façon plus douce mais la tonalité de mes ouvrages est acidulée, peut-être un peu moins dans le dernier. On n’échappe pas à soi-même ! Oui, la littérature peut, doit changer notre regard sur le monde, nous transformer, nous rendre plus perspicaces ou plus empathiques, sinon pourquoi en lire ?
Le Matin d’Algérie : “La littérature est le chant du cœur du peuple et le peuple est l’âme de la littérature” Disait Jiang Zilong, qu’en pensez-vous ?
Laure Mi Hyun Croset : Il me semble en effet que littérature permet de dire nos joies et nos souffrances. Oui, quand elle est subtile, elle parvient à exprimer notre condition d’être humain. Cette citation est très belle, et je l’étendrais à tous les arts.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Laure Mi Hyun Croset : J’en ai quantité dont des collaborations avec plusieurs artistes. J’aimerais aussi prendre le temps de relire mon précédent roman pour le soumettre sous une forme, pas forcément moins radicale mais peut-être plus aboutie, à une maison d’édition qui aimerait vraiment le défendre. J’ai également beaucoup de projets extraordinairement stimulants avec le prestigieux et fondamental Parlement des écrivaines francophones. Je suis aussi marraine ou ambassadrice de plusieurs festivals et associations dont j’aimerais honorer la confiance et porter la cause.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Laure Mi Hyun Croset : Merci infiniment pour votre fine et généreuse lecture de mon travail. Je vous souhaite un immense succès avec vos ouvrages. Le monde, surtout en ces temps sombres, a besoin de poésie à la fois pour comprendre et s’évader.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Publications :
– Made in Korea, roman, BSN Press & OKAMA, Suisse
– Pop-corn girl, microroman, BSN Press, Suisse
– Le beau monde, roman, Éditions Albin Michel, France
– S’escrimer à l’aimer, microroman, BSN Press, Suisse
– Après la pluie, le beau temps et autres contes, contes, Éditions Didier, France
– On ne dit pas « je » !, récit, BSN Press, Suisse
– Polaroïds, autofiction, Éditions Luce Wilquin, Belgique
– Les Velléitaires, recueil de nouvelles, Éditions Luce Wilquin, Belgique
Le 4 avril 2024
lematindalgerie.com
…………………………………………………………………………………………………….

Ben Mohamed, un poète clairvoyant
Le poète Ben Mohamed, de son vrai nom Benhamadouche Mohamed, fait partie de ces poètes à la verve franche et brillante. Il parle sans détours avec un charisme digne des poètes légendaires.
Nous avons pu le constater, invité de l’écrivain Youcef Zirem au café littéraire parisien de l’Impondérable, où le poète Ben Mohamed a su captiver le public en parlant de son parcours dans le champ culturel berbère et de son expérience riche et mouvementée à la Radio kabyle Chaîne 2.
On peut dire que Ben Mohamed a l’art de la rhétorique, alimentant son argumentation d’anecdotes laissant l’assistance dans l’émerveillement.
Il nous raconte qu’à huit ans, il assiste émerveillé avec son père à un récital de Slimane Azem dans un restaurant d’At Wacif. Il sortira de là avec un fascicule où des chansons de Slimane Azem étaient transcrites en caractères latins.
Le destin de poète de Ben Mohamed fut scellé ce jour-là. On a appris aussi que c’est grâce à Mohamed Hilmi qu’il fit sa première émission de radio.
L’affaire Sliman Azem
On ne pouvait évidemment pas évoquer la Chaîne 2 sans parler de la censure qui y a durement sévi et de Slimane Azem qui en a payé le prix fort, puisque celui-ci fut interdit d’antenne et jugé Persona non grata de 1967 jusqu’à l’ouverture politique de 1988.
Youcef Zirem n’a pas manqué de poser cette question cruciale à ce témoin de l’époque sur la censure touchant le légendaire Slimane Azem, l’un des plus grands poètes chanteurs du XXe siècle.
Ben Mohamed semblait s’attendre à cette question. Il nous rappelle ce que Kamel Hamadi ne cesse de dire, que l’interdiction n’était pas officielle, qu’une main malveillante a ajouté au stylo le nom de Slimane Azem sur une liste adressée par le ministère de l’information.
Nous étions en 1967 pendant la guerre des six jours, et cette liste concernaient les chanteurs français ayant apporté leur soutien à Israël.
Le directeur de la radio de l’époque n’a pas cherché à savoir qui avait ajouté le nom de Slimane Azem sur la liste, mais a inclus Slimane Azem dans l’interdiction, la loi du silence était tombée comme un couperet, personne n’osait en parler.
Une interdiction qui a brisé Slimane Azem que l’exil n’avait déjà pas épargné, personne n’a essayé d’éclairer les zones d’ombre, d’ailleurs même les écrivains et intellectuels de l’époque se sont tus.
Cette histoire d’ajout au stylo n’a évidemment convaincu personne. Puis Ben Mohamed nous raconte ses mésaventures avec la radio, on a censuré plusieurs fois ses émissions. Il est le premier à avoir invité Matoub Lounès, ce qui lui a coûté la suppression de son émission.
Puis Ben Mohamed nous raconte une autre anecdote concernant l’un des directeurs de la radio qui voulait donner une part importante au chant religieux, sous les conseils de bouffons de la radio espérant s’attirer ses faveurs.
Il fait venir le grand Mokrane Agawa spécialiste du genre, mais quand celui-ci arrive et entre dans le bureau tel un gentleman, à peine assis, que le directeur lui dit qu’il est ignorant, comme un âne, concernant le chant religieux.
Mokrane Agawa se lève brusquement et s’en va en lui laissant ces mots : « Je ne suis pas venu ici pour parler avec un âne. »
La salle est hilarante à ce moment-là, puis Ben Mohamed nous parle de ces projets d’écriture, 3 livres en perspective, dont l’un regroupera les poèmes chantés par les artistes puisque certains n’évoquent jamais l’auteur de leurs chansons.
Brahim Saci
3 avril 2024
Diasporadz
…………………………………………………………………………………………………

Rencontre avec le comédien chanteur Sadek Yousfi
Sadek Yousfi fait partie de cette belle jeunesse algérienne, kabyle, émergente, une nouvelle génération d’artistes doués et passionnés qui remplissent la scène artistique par des créations de qualité qui laissent le public dans l’émerveillement.
Loin d’être une fracture avec la tradition orale, cette nouvelle ère de la création jaillissante est complémentaire, elle élève et rehausse l’héritage culturel vers une ouverture salutaire sur le monde, tout en sauvegardant ses spécificités évidemment.
Sadek Yousfi est un homme cultivé aux talents multiples, s’il a la carrure des acteurs américains il n’a rien à leur envier tant il manie l’art de la comédie avec justesse et passion.
On peut dire que Sadek Yousfi crève l’écran et fait vibrer les scènes de théâtre par son jeu naturel et vrai malgré son jeune âge. Il joue aussi bien au théâtre, au cinéma, qu’à la télévision. Il est aussi écrivain et metteur en scène pour le théâtre.
Quand on le voit une fois on ne l’oublie pas tant son charisme est grand, ce qui s’ajoute à ces nombreux talents, que ce soit le chant, la composition ou la comédie, Sadek Yousfi se sent à l’aise, il est chez lui, l’art accapare tout son être, pour n’en faire qu’un avec lui.
L’art et la musique ont été ses passions depuis sa tendre enfance. Cet enfant d’Iferhounene en Kabylie fait plaisir à voir et à écouter, c’est à la maison de jeune d’Iferhounene qu’il a fait ses débuts au théâtre.
Sadek Yousfi est aussi auteur compositeur interprète, c’est une voix avec une musique qui sonne l’universel sans toutefois perdre ses repères d’où le génie de Sadek Yousfi, qui sait fort bien marier des sonorités nouvelles à des airs empreints des parfums d’Afrique, kabyles et berbères.
Sadek Yousfi poursuit actuellement des études théâtrales à l’université Paris-8.
Le Matin d’Algérie : Votre parcours est fascinant, du théâtre au cinéma, comédien metteur en scène, de la musique au chant, vous êtes auteur compositeur interprète, la passion des arts vous anime, qui est Sadek Yousfi ?
Sadek Yousfi : Pour commencer azul fell-awen, donc Sadek est un jeune passionné des arts vivants, depuis ma tendre enfance je rêvais d’être sous les feux de la rampe, je me sens si bien quand je suis sur scène, j’aime la connexion, le partage et l’échange qui se créent avec le public.
J’ai grandi à iferhounene, depuis mon enfance je suis passionné par l’art, surtout la musique, en 2008 j’ai découvert le théâtre à la maison de jeunes d’iferhounene, grâce à monsieur Houche Salah, il nous a fait une formation suivie de la réalisation d’une pièce de théâtre qui s’intitule, Ulac el herrga ulac, un spectacle qui a donné plus de trois cents représentations sur les chaînes nationales.
À l’époque, j’ai fait du théâtre dans l’association de la maison de jeunes nommée : Hamid ben Tayeb. En 2011 avec mon équipe on a créé la coopérative théâtrale, Macahu, avec laquelle on a produit une pléthore de spectacles avec beaucoup de metteurs en scènes, où j’ai joué en tant que comédien, tel que Lunja, yennayi jeddi, Tafat deg cqiq n tlam, Tislit n wenzar, Tadsa di twaghit…
En 2015, je suis nommé président de la coopérative théâtrale, Macahu, j’ai piloté cette coopérative en décrochant le grand prix de la meilleure pièce au festival national du théâtre amazigh en 2016, avec la pièce, Tadsa di twaghit.
En 2017, je tente ma première tentative de mise en scène sur le texte, Sin-nni, de Mohya, adapté de la pièce, Les Émigrés, de Slawomir Mrozek (écrivain, dramaturge franco-polonais), avec cette pièce on a décroché plusieurs prix, à l’instar de la meilleure pièce au festival national du théâtre jeunesse à Boumerdès.
En 2022, j’adapte et je mis en scène, Asdarfef, d’après, Les chaises, de Eugène Ionesco, avec lequel je décroche la meilleure mise en scène au festival du théâtre amazigh à Batna. J’ai joué à Tamenghest.
Avec la troupe de Azzouz Abdelkader, au théâtre régional de Tizi, j’ai joué dans deux productions, une en 2019 (Anag wis sebaa), et une autre en 2023 (Rosa hnini). Au cinéma j’ai joué dans plusieurs courts métrages en français comme : Celui qui brûle, Ne rien écrire sur mon épitaphe, en kabyle, J’ai joué un long métrage qui s’intitule : Azamul et un feuilleton ramadanesque qui s’intitule, Tayri d texidas. J’ai à chaque fois incarné le premier rôle.
Dans la musique, j’ai deux clips disponibles sur YouTube, Werggegi et Anida-ten, et je sors bientôt un nouveau titre. Sinon je suis actuellement étudiant en licence théâtre à l’université Paris 8 de Saint-Denis.
Le Matin d’Algérie : En Algérie, on a l’impression que tout est à faire, il y a si peu de productions, aussi bien théâtrales que cinématographiques, pourtant les talents ne manquent pas, mais le public ne montre que très peu d’intérêts aussi, que faut-il faire d’après vous ?
Sadek Yousfi : Il y a malheureusement un manque de formation et de culture théâtrales, les algériens savent très peu de choses sur le théâtre et le cinéma, on a pas eu un Shakespeare, un Molière, ou un Brecht, c’est pour dire qu’on a pas beaucoup de références, hormis quelques tentatives de Alloula (Abdelkader Alloula), Kaki (Abdelkader Ould Abderrahmane, dit Abderrahmane kaki), et Mohya (Abdallah Mohia) pour ne citer que ceux-là.
On se sent coupé du monde, on ne regarde pas ce qui se fait ailleurs, on s’est quelque peu refermés sur nous-mêmes, et l’on ne peut pas avancer sans s’ouvrir aux autres. C’est ce que Mohya (Abdallah Mohia) a compris en adaptant les grands auteurs universels comme, Am win yettrajun Rebbi, En attendant Godot, de Samuel Beckett, Aneggaru a d-yerr tawwurt, La Décision, de Bertolt Brecht, Llem-ik, Ddu d udar-ik, L’exception et la règle, de Bertolt Brecht, Tacbaylit, La Jarre, de Luigi Pirandello, Si Lehlu, Le Médecin malgré lui, de Molière, Si Pertuf, Tartuffe, de Molière Muhend U Caâban, Le Ressuscité, de Lu Xun.
Il y a des versions d’Antigone (une tragédie de Sophocle qui se déroule en 442 avant J.-C), de Roméo et Juliette (une tragédie de William Shakespeare publiée en 1597), de Médée (une tragédie grecque d’Euripide, produite en 431 avant J.-C), dans beaucoup de langues, alors pourquoi pas nous ? C’est dans ce sens qu’il faut aller, mettre les gens qu’il faut là où il faut et leur donner les moyens de travailler. Après, le public va suivre, c’est une évidence. C’est à l’artiste d’orienter le public non l’inverse.
Le Matin d’Algérie : La bonne santé des arts révèle le niveau de bonheur d’un pays, en quoi l’art peut-il aider au rayonnement d’un pays ?
Sadek Yousfi : Faut dire que le système en Algérie n’aide pas beaucoup l’artiste, toutes les salles sont monopolisées et étatiques, il n’y a pas de salles privées comme partout dans le monde où l’artiste pour se produire, il n’y a pas d’industrie musicale et cinématographiques qui entraîne un grand business du sponsoring des médias … etc.
L’artiste souffre en silence chez nous, déjà qu’il n’a même pas un statut digne pour le couvrir, ici en France ils ont l’intermittence, pas chez nous !
En plus de cela l’artiste est toujours pointé du doigt, quand il y a un deuil, c’est à lui d’annuler ses spectacles, quand il y a un problème c’est à lui de prendre position et le régler, c’est comme si l’artiste devait tout résoudre. Il doit parler du sport, de la politique de la météo… je pense qu’on demande trop de l’artiste.
Si on lui offre juste les conditions nécessaires pour produire son art et lui permettre de bien le diffuser, je pense que ce serait mieux pour tout le monde.
Le Matin d’Algérie : Vous passez d’un art à l’autre avec une facilité déconcertante, le théâtre, le cinéma, la composition musicale et le chant, comment réussissez-vous cette performance ?
Sadek Yousfi : Je pense que celui qui a une formation théâtrale peut facilement passer d’un art à l’autre. Le théâtre est un art tellement complet qu’il est comme une passerelle qui s’ouvre vers toutes les autres expressions artistiques.
Le théâtre est le père des arts, pour être un bon comédien de nos jours il faut non seulement savoir jouer ou incarner des rôles mais en plus chanter, danser, et avoir une bonne expression corporelle.
Au théâtre, on travaille la diction, la voix, l’imaginaire, le corps, ces exercices là on les retrouve aussi dans le cinéma et le chant …. J’insiste sur la formation, quelle soit physique ou intellectuelle.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un chanteur talentueux, mais on vous voit peu sur scène, est-ce parce que vous faites du cinéma une priorité ?
Sadek Yousfi : Tous les kabyles sont des chanteurs de nos jours (rire), il y a beaucoup de concerts, et il y a même un grand public pour ça, mais en ce qui me concerne j’ai fait du théâtre une priorité, j’aspire à un théâtre universel en kabyle. Avec la chanson on arrive à remplir les plus grandes salles parisiennes comme le Zénith, je rêve qu’on puisse faire la même chose pour le théâtre et le cinéma kabyle.
Nous avons malheureusement l’impression qu’il n’y a que la chanson dans notre culture, d’ailleurs le grand public ne connait pratiquement que les chanteurs. Les auteurs, les réalisateurs, les metteurs en scènes restent méconnus. Il reste donc beaucoup à faire.
Le Matin d’Algérie : Quels sont ceux qui vous influencent dans le théâtre, le cinéma et la musique ?
Sadek Yousfi : L’art en général et les artistes universels m’influencent, je suis sensible aux œuvres intemporelles. Charlie Chaplin au cinéma était extraordinaire, sans dire un mot, il a fait rire le monde entier, la seule expression de son visage suffisait, de l‘Amérique à l’Afrique, à l’Europe à l’Asie, la seule évocation de son nom fait rire. Parce qu’il s’adresse au cœur humain, Charlie Chaplin a su toucher le monde entier.
Concernant le théâtre, je dirais le théâtre de Vsevolod Meyerhold (Karl Kasimir Theodor Meierhold dit Vsevolod Emilievitch Meyerhold un dramaturge et metteur en scène russe), Car c’est un théâtre qui se base sur l’expression corporelle, pas sur le parler, et le corps est compris par le monde entier, on a soif de la même façon, on manifeste partout la douleur de la même façon.
Pour ce qui est de la musique, j’aime la musique dite moderne et les fusion musicales…
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Sadek Yousfi : Je sors bientôt ma nouvelle chanson avec un clip filmé comme au cinéma, comme j’aime le faire dans tous mes clips, j’essaie de raconter une histoire qui ne raconte pas tout à fait le texte de la chanson mais une histoire qui marche en parallèle avec le texte de la chanson, donc proposer au public deux œuvres dans une seule.
Dans le théâtre, j’ai finalisé l’écriture d’un monodrame féminin, que je souhaite mettre en scène très bientôt.
Pour ce qui est du cinéma, j’ai des propositions ici en France mais rien n’est encore décidé. On verra d’ici là.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Sadek Yousfi : Pour conclure, j’appelle les jeunes artistes à s’instruire, à encourager la formation, parce que le don à lui seul ne suffit pas, si tu manques d’intellect tu vas vite disparaître, j’appelle les autorités concernées à ouvrir les portes des théâtres, à encourager encore plus cet art, et j’espère qu’un jour on aura des œuvres à l’image de Vava inuva ou de Nedjma de Kateb yacine qui feront parler d’elles dans le monde.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Chaîne YouTube :
2 avril 2024
lematindalgerie.com
…………………………………………………………………………………
L’incontournable café littéraire parisien de l’écrivain Youcef Zirem

Le café littéraire parisien de l’Impondérable, de l’écrivain Youcef Zirem, qui se déroule chaque dimanche à 18h, au 320, rue des Pyrénées, dans le XXe arrondissement de Paris, est un espace littéraire unique en son genre, ouvert et à la portée de tous.
Il peut se vanter d’être le seul café littéraire hebdomadaire de cette capitale des arts et des lumières. Nombreux sont ceux qui sont passés par là depuis 2017, et l’on se bouscule pour y être invité, tant Youcef Zirem a le don de mettre à l’aise l’invité dans des échanges courtois et éclairés.
Tous les dimanches l’art et la littérature se côtoient et prennent un verre dans ce lieu devenu quasi mythique, où les tenants actuels du lieu, Mourad et Sofiane, vous accueillent avec le sourire bienveillant.
L’écrivain poète journaliste Youcef Zirem a le génie de pouvoir tenir une programmation depuis 2017, ce qui est une sacrée performance, mais l’écrivain humaniste est aimé de tous, artistes et auteurs s’y retrouvent avec joie, ils savent que Youcef Zirem les mettra généreusement en lumière.
Paris compte cinq cafés littéraires historiques, « Les Deux Magots » à Saint-Germains-des-Prés, que fréquentaient jadis Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, un lieu de rendez-vous d’artistes et d’intellectuels, Guillaume Apollinaire, Elsa Triolet, Louis Aragon, André Gide, Picasso et d’autres.
« Le Procope » dans le VIe arrondissement de Paris, La fontaine, Racine, Diderot, d’Alembert, Beaumarchais, Voltaire, Balzac, Nerval, Hugo, George Sand, Musset et Verlaine s’y sont attablés. Aujourd’hui Amélie Nothomb, Éric-Emmanuel Schmitt fréquentent ce lieu.
« Le Café de la Paix », place de l’opéra dans le IXe arrondissement, fréquenté par de nombreux intellectuels, écrivains, Maupassant, Victor Hugo, Émile Zola, Oscar Wilde, Paul Valéry, André Gide, Marcel Proust.
« Le Café de Flore » dans le VIe arrondissement, fréquenté par Guillaume Apollinaire, Picasso, Boris Vian, Serge Reggiani, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Ionesco.
« La Closerie des Lilas » dans le VIe arrondissement, Bazille, Renoir, Monet, Sisley, Pissarro, Émile Zola, Paul Cézanne, Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Edmond de Goncourt, Paul Verlaine, Paul Fort, Lénine Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry. Amedeo Modigliani, Germaine Tailleferre, Paul Fort, André Breton, Louis Aragon, Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre, André Gide, Paul Éluard, Oscar Wilde, Samuel Beckett, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Henry Miller, ont fréquenté cet endroit.
Le café littéraire parisien de l’Impondérable est un exemple pour le vivre ensemble et l’ouverture culturelle. C’est un lieu convivial, où les échanges se font dans la curiosité, l’amitié, et la bonne humeur. Les poètes, les écrivains, les artistes en général, sont toujours les bienvenus.
Les artistes, les écrivains, les intellectuels de tous bords viennent parler de leurs publications. L’écrivain Youcef Zirem anime toujours les débats avec brio.
Après une présentation et un échange entre l’invité et Youcef Zirem, la parole est donnée au public. Chacun est libre d’intervenir et de poser la question qu’il veut, même celui qui vient de rentrer, qui n’a rien suivi, tout le monde l’écoute avec bienveillance et l’invité lui répond, tout se passe dans le respect du vivre ensemble.
Ce café littéraire situé dans un quartier populaire joue aussi un rôle éducatif. Les rencontres sont toujours chaleureuses et conviviales. Les gens restent souvent très tard et en profitent pour échanger autour d’un verre entre eux et avec l’invité.
Le café littéraire parisien de l’Impondérable de l’écrivain Youcef Zirem reste le rendez-vous incontournable de tous les dimanches à 18h. L’écrivain Youcef Zirem continue d’assurer la programmation, parfois même avec peines et sueurs, mais pour cet amoureux des arts et des lettres le partage culturel est comme un don de soi, il sait combien le livre et les arts peuvent améliorer le monde et il nous le rappelle souvent en disant « le meilleur est toujours possible ».
Brahim Saci
26 mars 2024
DIASPORADZ
………………………………………………………..
Rencontre avec Lyazid Benhami

Lyazid Benhami est cet homme généreux et discret assoiffé de savoir et de culture. Après l’obtention du bac, il a entamé des études en gestion et en management à l’université Paris 1 Sorbonne.
Pour des raisons familiales, il a dû interrompre pour des raisons personnelles, familiales et militantisme politique au sein du FFS, pensant y revenir mais en vain, car d’autres latitudes l’attendaient. Un vaste champ d’études et de réflexions s’ouvrait alors et s’offrait à lui.
Lyazid Benhami est cet homme infatigable au service des autres, vice-président de l’Association des Amitiés franco-chinoises de Paris, il a participé à différents évènements :
Organisation de plusieurs expositions d’artistes chinois en France, initiation de l’exposition en novembre 2019 de l’Arc de Triomphe à Shanghai, organisation de divers évènements culturels et économiques sur place en Chine, dont un voyage d’étude sur le patrimoine culturel et architectural de la province du Shanxi en Chine en juin 2013, ayant abouti à un rapport de propositions de coopérations.
Il est aussi vice-président du Comité de Mobilisation de la Journée mondiale de la culture Africaine (Journée reconnue par l’UNESCO en novembre 2019), président de l’Association franco-berbère de Villejuif : Organisation de la première célébration du Nouvel An Berbère dans la ville de Villejuif en janvier 2020, membre fondateur du premier Festival-Carnaval du Nouvel An Berbère à Paris, organisé en 2022 avec plusieurs partenaires publics et privés.
Lyazid Benhami a également coordonné la revue Géostratégiques N°58 ; « L’Algérie, 60 ans après l’indépendance ». Elle a été publiée par l’Académie de Géopolitique de Paris à l’occasion du soixantième anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie. Notre invité a été aussi Coordinateur et initiateur du Centenaire de la naissance de Krim Belkacem. Il travaille dans le champ culturel en France, dans les monuments historiques parisiens. Lyazid Benhami est donc passionné d’histoire, et on a pu le constater au café littéraire parisien de l’Impondérable, invité de l’écrivain Youcef Zirem, autour de son livre, Tahar Ibtatene, dit Tintin: Héros de la Résistance (1940-1945) et de la guerre d’Algérie (1954-962), paru chez les éditions L’Harmattan. Lyazid Benhami nous a tracé le portait de cet homme emblématique, qui a marqué la deuxième guerre mondiale par son rôle joué dans la Résistance française et son apport à la Révolution algérienne.
Le Matin d’Algérie : Vous paraissez infatigable, quand on voit tout ce que vous faites, mais c’est la culture qui vous anime, qui est Lyazid Benhami ?
Lyazid Benhami : Un citoyen qui estime que la société civile a toute sa place dans les débats et l’action publics. À travers la culture, j’essaie à ma juste mesure de promouvoir les dialogues en convoquant l’histoire, les arts, et de tenter de construire des espaces dans lesquels la réflexion et le sens critique prévalent sur la pensée unique et aux dictats ambiants.
Par ailleurs, je me suis éloigné du militantisme politique au sein du FFS très tôt, dès 1991. C’était peut-être parce que j’y suis entré très précocement, dès 1984, pendant la période de clandestinité du parti.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes kabyle mais vous œuvrez beaucoup pour la culture chinoise, d’où vient cet engouement pour la Chine ?
Lyazid Benhami : Je me suis intéressé très tôt à la culture chinoise, dès mon adolescence. C’est une culture passionnante, enrichissante, et je vais vous surprendre, elle est certainement très proche de la nôtre. Le sens de l’honneur, de la valeur pour la parole donnée, l’usage des métaphores dans le langage et les arts, sont autant d’attraits en communs. Je suis dans les amitiés avec la Chine depuis une quarantaine d’années, et au sein du bureau exécutif de l’Association des Amitiés franco-chinoises de Paris depuis 12 ans.
Nous avons beaucoup à apprendre de ce grand pays, doté d’une civilisation vieille de cinq mille ans. Enfin, qui peut ignorer aujourd’hui la puissance retrouvée de la Chine ?
Le Matin d’Algérie : On le voit bien, l’histoire vous passionne, vous venez de publier, Tahar Ibtatene, dit Tintin: Héros de la Résistance (1940-1945) et de la guerre d’Algérie (1954-962), paru chez les éditions L’Harmattan, où vous dressez un portrait, un parcours, à la fois déchirant et fascinant de votre oncle Tahar Ibtatene, cette grande figure de la Résistance à l’occupation allemande et de son implication dans la Révolution algérienne, pouvez-vous nous en parler ?
Lyazid Benhami : Il est difficile de résumer le parcours de Tahar Ibtatene en trois lignes. Arrivé en France très tôt en 1924, à l’âge de 15 ans. Il passa le reste de son existence en France. En 1940, il rejoint les services secrets du général de Gaulle. Il intègre en tant qu’agent secret le BCRA (Le Bureau Central de Renseignements et d’Action de la France libre) en octobre 1943, l’ancêtre de la DST (Direction de la surveillance du territoire).
En 1954, il se mettra à la disposition de la Révolution algérienne, au sein de la Fédération de France du FLN (Front de libération Nationale). Il avait 45 ans et était de surcroît un ancien officier des services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale au sein de la Résistance française.
Il fut un artisan convaincu et pragmatique d’une véritable indépendance de l’Algérie. Ce fut un homme averti et de grande expérience.
Le Matin d’Algérie : Racontez-nous la genèse de ce livre ?
Lyazid Benhami : La genèse de ce livre, Tahar Ibtatene, dit Tintin: Héros de la Résistance (1940-1945) et de la guerre d’Algérie (1954-962), tient à ce que j’ai été le destinataire des archives personnelles de mon oncle Tahar Ibtatene. Du fait de leur importance historique, j’ai souhaité les partager avec le lecteur français et algérien, tout en rendant un hommage appuyé à ce grand héros de la Résistance française et de la Révolution Algérienne. J’ai dû aussi approfondir et peaufiner mes recherches dans les livres d’histoires, au Service Historique de la Défense, ainsi qu’au sein d’autres institutions.
Le Matin d’Algérie : Tahar ibtatene a joué un rôle crucial dans la Résistance française et dans la Révolution algérienne, vous éclairez un pan de l’histoire resté longtemps dans l’ombre, pourquoi à votre avis ?
Lyazid Benhami : Le parcours singulier de Tahar Ibtatène a côtoyé la grande Histoire, celle de la Résistance française en sa qualité d’officier des Services secrets français, puis celle pendant la guerre d’Algérie en sa qualité de militant pour l’indépendance algérienne au sein du FLN. Il a combattu le nazisme puis le colonialisme.
Ses états de service en tant qu’agent permanent, puis chargé de mission au sein de l’état-major des Services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que ses actions en faveur de ses frères FLN durant la Révolution algérienne, témoignent de sa bravoure et de son attachement aux principes de la liberté et de l’humanisme.
Les affaires secrètes sont par définition discrètes, imperméables, confidentielles. Elles demandent davantage de temps pour les analyser et les comprendre. Dans la Résistance, les missions de Tahar Ibtatène ont toutes revêtues les sceaux « confidentiel » et « très secret », les archives le prouvent. Pendant la guerre d’Algérie, les membres du FLN ne le connaissaient pas, tout était hermétique. Les cellules étaient au plus composées de trois membres chacune.
Parler de ce personnage atypique peut surprendre ; il eut très peu d’officiers Résistants qui eurent également un rôle au sein du FLN pendant la guerre d’Algérie. Je pense qu’à ce niveau de contributions et d’engagements, Tahar Ibtatène fut le seul. À charge maintenant aux historiens de continuer le travail commencé. Les archives publiques et privées sont là et sont nombreuses.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Lyazid Benhami : Les projets en cours sont ceux liés à mes différents engagements au sein des associations dont je suis membre actif, donc beaucoup !
Entretien réalisé par Brahim Saci
Livre : Tahar Ibtatene, dit Tintin: Héros de la Résistance (1940-1945) et de la guerre d’Algérie (1954-962), édition L’harmattan
jeudi 28 mars 2024
lematindalgerie.com
…………………………………………………………..
Rencontre avec le chanteur Tarik Aït Menguellet

Tarik Aït Menguellet fait partie de cette belle relève qui éclaire la scène artistique algérienne et plus particulièrement la chanson kabyle. S’il se rapproche du timbre vocal de son père Lounis Aït Menguellet, Tarik Aït Menguellet apporte un nouveau souffle, comme une brise rafraîchissante qui remplit l’atmosphère d’espoir, qui laisse entrevoir de beaux jours et un avenir prospère pour la chanson la chanson kabyle.
Dans la famille Aït Menguellet, l’art se transmet avec bonheur, le père Lounis Aït Menguellet. Outre donc Tarik, il y a Djaffar qui aide son père musicalement depuis plusieurs années mais qui a aussi ses propres compositions musicales et Hayat qui a fait les Beaux-Arts. Nous pouvons dire que l’art chez les Aït Menguellet est une histoire de famille.
Tarik Aït Menguellet se distingue par son originalité, un charisme, un élan musical et poétique qui s’affirme et s’impose de lui-même par la force du verbe et la beauté des compositions.
Le Matin d’Algérie : Vous faites partie de cette belle et jeune génération de chanteurs kabyles qui fait plaisir à voir, mais qui est Tarik Aït Menguellet ?
Tarik Aït Menguellet : Je ne sais pas si je suis si jeune que ça ; disons que je suis jeune dans le domaine de la chanson puisque je me suis mis assez tard à l’écriture et la composition. En effet, la génération qui est en pleine éclosion fait plaisir à voir. Et l’adage dit justement qu’aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années.
De plus en plus, on voit des talents émerger, non pas qu’il y en ait plus qu’avant je pense, mais aujourd’hui, grâce à l’internet et aux réseaux sociaux, il est plus facile de présenter au public son potentiel. Imaginez : il y a quelques années, il fallait passer par la radio, la télévision, les journaux. Et cela n’était pas accessible à tous. Il fallait être au bon endroit et au bon moment, avoir certaines relations etc., mais tout cela a été balayé par un revers de la main numérique des réseaux sociaux et autres plateformes de streaming. C’est cela qui a permis, à mon sens, cette émergence de talents… et parfois d’absurdités malheureusement.
Le Matin d’Algérie : Vous avez du talent, mais vous êtes si discret, pourquoi si peu d’apparitions ?
Tarik Aït Menguellet : Merci pour le compliment. Vous connaissez le dicton : « Chassez le naturel, il revient au galop. » Si je suis discret, c’est à cause de ma nature. Un autre dicton dit également : « pour vivre heureux, vivons cachés ». Je crois que je vais m’arrêter là pour les citations et les proverbes !
Cela dit, je n’ai jamais considéré qu’écrire des chansons était synonyme de visibilité ou de représentation publique. J’écris des chansons à la manière d’un écrivain qui, une fois son livre terminé, le livre au public. Je dois également avouer que lorsque j’ai composé mes premières chansons, je voulais que d’autres les chantent.
Concernant la visibilité, il faut également intéresser les producteurs de spectacles qui misent sur des chanteurs pouvant remplir des salles. Il faut avoir beaucoup d’audience, abandonner un morceau de sa liberté pour appartenir aux autres, et un tantinet de célébrité. Une bonne dose de followers ne fait pas de mal non plus, ainsi que le nombre de vues détermine aux yeux des gens la valeur d’une œuvre. Tout cela fait que je suis un mauvais cheval pour cette course débridée.
Le Matin d’Algérie : Même si vous avez un timbre vocal qui se rapproche de votre père, vous avez votre propre style, quels sont les chanteurs kabyles qui vous influencent ?
Tarik Aït Menguellet : Concernant le timbre de voix, je pense que c’est purement génétique, ce qui ne m’empêche pas d’en être très fier. Contrairement à ce que pourraient croire la plupart des gens, je n’ai pas toujours baigné excessivement et exclusivement dans l’univers musical de mon père. Il est loin d’être un nombriliste ou un égocentriste et lorsqu’il nous passait de la musique, c’étaient d’autres artistes qui étaient à l’honneur, qu’ils soient algériens, orientaux ou occidentaux.
Je pense qu’être influencé se fait naturellement, ce n’est pas un acte conscient. On prend un peu de tout, ça travaille dans le cerveau et ça ressort sous une forme ou une autre. Et chaque artiste nous influence à sa manière, sans pour autant les cantonner dans tel ou tel rôle ; mon père et Slimane Azem pour l’importance des textes ; Cherif Kheddam et Idir musicalement ; Taleb Rabah pour avoir su si bien chanter les tracas de la vie ordinaire ; N’na Cherifa pour le rythme des mots ; Fahem pour avoir chanté des thèmes que d’autres n’ont jamais effleuré ou même osé etc. Je vais m’arrêter là sinon je ne pourrais plus m’arrêter de parler. Il y en a tellement ! Des plus anciens aux tout nouveaux.
Le Matin d’Algérie : Votre père a su conquérir le cœur de la majorité des Kabyles par un travail de qualité, il n’est pas facile de passer derrière lui et d’imposer son propre travail, votre frère Djaffar travaille beaucoup avec votre père mais vous, vous vous démarquez, vous semblez prendre votre propre envol, du coup vous êtes plus libre, qu’en pensez-vous ?
Tarik Aït Menguellet : Il est vrai que Djaffar est très présent dans le paysage artistique de mon père, en tant que musicien et arrangeur, et ça n’est pas toujours simple pour un artiste avec autant de talent que de devoir subir tout le temps des comparaisons souvent aberrantes. Ce qui ne l’a pas empêché d’exceller dans le domaine et d’avoir ajouté sa pierre à l’édifice de la chanson algérienne et de la musique universelle.
Il est vrai que j’ai le champ plus libre mais le nom me suit et généralement, la première question que me posent les gens, est de savoir si c’est mon père qui écrit les paroles de mes chansons, et si c’est mon frère qui en fait les musiques. Étant auteur et compositeur de mes œuvres, je réponds que non. Cependant, la suspicion quitte rarement leurs yeux. Mais, bon, j’imagine qu’il y a des fardeaux plus lourds à porter.
Le Matin d’Algérie : Pensez-vous que l’art et la chanson en particulier peuvent contribuer à l’émancipation de l’Algérie ?
Tarik Aït Menguellet : Certainement oui. L’art chez nous a toujours été une sorte d’exutoire, pour le créateur qui se délivre de ses tourments, et pour le public qui trouve un écho aux siens. Vous avez utilisé un mot très important : l’émancipation. Nous sommes les prisonniers de plusieurs entraves qui nous empêchent d’avancer, les femmes comme les hommes, même si les femmes en souffrent plus. Aujourd’hui, il faut s’affranchir de ces liens, qu’ils soient liés à la tradition, à la religion, à l’histoire. Il faut garder le bon grain et se débarrasser de l’ivraie. Toute notre vie est faite d’interdictions, de lois, d’embrigadement, de dogmes, de censures, de proscriptions, qui sont autant d’inhibiteurs de la créativité et d’obstacles à l’émergence du bon sens.
Et l’art peut nous sortir de ce marasme. Il suffit, par exemple, de voir le nombre de femmes et de jeunes filles qui s’affirment aujourd’hui dans le domaine de la chanson, alors qu’il y a à peine quelques décennies, il était indécent de chanter même pour un homme.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Tarik Aït Menguellet : Les projets à venir sont comme l’espoir qui, chacun le sait, nous aide à vivre. Et des projets, j’en ai plein les placards, les armoires, les tiroirs, mais souvent en gestation, voire en mal de finition. J’essaie de trouver le temps d’en finaliser le plus grand nombre, notamment des chansons, peut-être un album, pour cette année, et l’édition d’un nouveau roman et d’un recueil de chroniques en phase de relecture.
Avec ma femme, qui est également auteure compositrice, on a des projets de livres et d’albums pour enfant, d’ailleurs nous en avons réalisé un qui sera bientôt mis sur les plateformes de streaming.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Tarik Aït Menguellet : Un dernier mot peut être serait d’affirmer mon soutien pour tous les calomniés sans fondement, les emprisonnés sans raison, pour ceux qui sont privés de leur famille et proches, pour les victimes de conflits et de barbarie où qu’ils soient, pour les gens qu’on empêche de s’exprimer ou simplement de vivre normalement.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Livre :
Le Petit Prodige, Kindle Édition
Chaîne YouTube :
youtube.com/channel/UCZbs24tA4Pe_q3l5PL8Q7Tw
mardi 26 mars 2024
lematindalgerie.com
………………………………………………………………………………….

Ahmed Amzal (chanteur) : je laisse ma musique parler à ma place
Ahmed Amzal est le reflet d’une âme passionnée, c’est un chanteur de grand talent, très discret, qui chante depuis de longues années. Ahmed Amzal est de la Kabylie profonde, de Djebla d’Aït Ksila, un village qui domine majestueusement la mer, l’un des plus beaux villages kabyles soigneusement préservée.
L’artiste émerveille par ses créations musicales de qualité, il a une voix qui apaise, qui force le respect, car elle vient du cœur, elle émeut, elle envoûte ; elle captive chargée d’émotion, c’est le ciel touchant la mer, c’est la montagne fière, c’est aussi la fascination et l’élévation spirituelle du désert.
Même s’il se fait rare sur scène, il continue discrètement à composer dans un effort sans cesse passionné soucieux de la qualité et du bon travail. Sans crier gare, ce chanteur originaire du célèbre village de Djebla éblouit l’oreille par un chant harmonieux qui fend les airs comme par magie pour laisser une empreinte poétique élevée, pour que nul n’oublie.
Le Matin d’Algérie : Vous chantez depuis de longues années, qui est Ahmed Amzal ?
Ahmed Amzal : Je suis un artiste d’expression kabyle passionné de musique, né et élevé dans le magnifique village de Djebla d’Aït Ksila, en Kabylie maritime. Mon nom d’artiste, « Amzal », est tout simplement un clin d’œil à ma région natale de l’Aarche Imzalen.
J’ai commencé à composer et à chanter dès mon adolescence. Les débuts de carrière des artistes tels que Amar Ikhenoussen et Hamid Ouagrani, mes compagnons de l’époque, m’ont beaucoup inspiré, mais la condition de chanteur était très mal vue par le contexte social de cette période. En outre, comme beaucoup d’artistes, je devais trouver un équilibre entre ma passion pour la musique et les responsabilités de la vie quotidienne.
Cependant, c’est lors de mon exil que j’ai réellement renoué avec ma passion pour la musique, où j’ai rencontré et côtoyé de nombreux artistes talentueux, qui m’ont encouragé à poursuivre mes aspirations musicales, à l’image du regretté Mouhoub Ali, paix à son âme, originaire du village Taguelmimt d’Ait Ksila. La chanson est devenue pour moi une échappatoire, un exutoire, face aux difficultés de l’exil, un moyen d’exprimer mes émotions, mes expériences et mes réflexions sur l’amour, la société et bien d’autres sujets.
Je suis un fervent défenseur de l’authenticité et de la sincérité dans la musique, et je m’efforce toujours de partager des histoires vraies et des émotions profondes avec mon public.
Ma musique est l’expression profonde de mes sentiments, de mes expériences et de mes valeurs, et j’espère qu’elle continuera à toucher les cœurs et les esprits de ceux qui m’écoutent.
Le Matin d’Algérie : Vous avez beaucoup de talent, pourtant vous êtes si discret, à quoi est-ce dû ?
Ahmed Amzal : En ce qui concerne ma discrétion, je pense que cela découle de ma personnalité et de ma vision artistique. Pour moi, la musique est avant tout une forme d’expression authentique et personnelle, plutôt qu’un moyen de recherche de la renommée ou de la célébrité.
Je préfère laisser ma musique parler pour moi-même. De plus, je suis profondément attaché à ma vie privée et à ma famille, ce qui peut également contribuer à ma réserve en tant qu’artiste. En fin de compte, je crois que la qualité et la sincérité de mes compositions artistiques parleront d’elles-mêmes, et je préfère me concentrer sur la création de belles œuvres plutôt que sur la recherche d’une certaine forme de gloire.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les chanteurs kabyles qui vous influencent ?
Ahmed Amzal : Des artistes légendaires tels que Slimane Azem, Cherif Kheddam et El Hasnaoui, ont profondément influencé ma musique et mon approche artistique. Leurs chansons ont nourri mon inspiration et ont contribué à façonner mon identité musicale. Slimane Azem est l’une des figures les plus emblématiques de la musique kabyle. Ses chansons engagées et poétiques, souvent inspirées par les thèmes de l’exil, de l’amour et de la nostalgie, ont eu un impact profond sur moi. Son style unique et sa capacité à capter l’essence de notre identité à travers sa musique m’ont inspiré à chercher ma propre voie artistique.
Le Matin d’Algérie : Quel regard portez-vous sur la scène artistique algérienne, particulièrement kabyle d’aujourd’hui ?
Ahmed Amzal : La scène artistique kabyle d’aujourd’hui est dynamique et diversifiée, avec de nombreux artistes émergents apportant de nouvelles perspectives et des sonorités innovantes à la chanson kabyle. Cependant, malgré ces avancées, il reste des défis à relever, notamment en ce qui concerne la promotion et la diffusion de la musique kabyle au-delà des frontières régionales.
Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans cette évolution, offrant aux artistes de nouvelles plateformes pour partager leur musique et interagir avec leur public à l’échelle mondiale. Mais cette montée en puissance des réseaux sociaux a également contribué à une ruée vers la chanson commerciale, parfois influencée par d’autres genres, caractérisés par un langage moins raffiné et des compositions moins soignées. Cette tendance, peut diluer les valeurs et les traditions culturelles profondément ancrées dans la chanson Kabyle.
Je pense qu’il est donc important que nos artistes maintiennent un équilibre entre l’innovation et la préservation de leur héritage culturel, en veillant à ce que leurs créations reflètent toujours nos valeurs et nos traditions.
En naviguant habilement entre les nouvelles possibilités offertes par les réseaux sociaux et les défis posés par la commercialisation, nos artistes peuvent continuer à jouer un rôle central dans la préservation et la promotion de la chanson kabyle, tout en s’adaptant aux réalités de notre époque numérique.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Ahmed Amzal : Actuellement, je suis concentré sur la création de nouvelles compositions. J’aspire évidemment à continuer d’explorer les thèmes qui me sont chers, tels que l’amour, l’exil, la société …, à travers ma chanson. En parallèle, je suis ouvert à de nouvelles collaborations avec d’autres artistes talentueux, à l’instar du poète-parolier Hamid Ait Said que je salue au passage, car je crois en l’enrichissement mutuel que peuvent apporter ces échanges créatifs.
J’espère pouvoir me produire sur scène dès que les conditions le permettront. En somme, je reste passionné et engagé dans mon travail artistique, et je suis très enthousiaste à l’idée de partager de nouvelles créations avec mes fans dans un avenir proche.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Ahmed Amzal : Je voudrais simplement exprimer ma gratitude envers tous ceux qui m’ont soutenu, aidé et encouragé au fil des ans, ainsi que pour cette opportunité de partager un peu de moi avec votre lectorat. La musique est une force puissante qui unit les gens et transcende les frontières, et je suis honoré si j’ose dire par ma très modeste contribution à cet héritage en tant qu’artiste.
Je reste déterminé à continuer à créer, à partager et à célébrer la richesse de notre culture à travers mes chansons. Merci à tous pour votre soutien et votre amour.
Entretien réalisé par Brahim Saci
PS : Je remercie le journaliste Hamid Banoune pour son aide précieuse.
samedi 23 mars 2024
lematindalgerie.com
……………………………………………………………………………….
Stéphanie Guilhou : « Sans lecteurs, la littérature devient stérile »

Stéphanie Guilhou est cette poétesse au grand cœur, au visage souriant, n’est-ce pas le meilleur des partages ? Le sourire, comme pour braver le temps qui passe. Stéphanie Guilhou porte la poésie dans son regard d’où émanent et jaillissent des espoirs, ceux d’un lendemain meilleur, ceux d’un présent apprivoisé sans les regrets.
Après des études littéraires et l’histoire de l’Art, Stéphanie Guilhou décide de publier. L’écriture a en fait toujours été là comme une fidèle amie pour elle, et c’est seulement là qu’elle se dévoile comme une étoile naissante dont la lumière irradie enfin au-delà des horizons.
Les poèmes de Stéphanie Guilhou sont parfois comme des tableaux, l’œil averti y entrevoit la voie menant vers soi et là-bas, des images et des couleurs s’entremêlent afin de porter l’émotion et les sensations au paroxysme du possible dans un élan quasi-mystique au-delà des limites crées, au-delà de l’éther comme une prière qui assainit l’air pour un souffle renouvelé, rafraîchi.
Stéphanie Guilhou vient de publier un beau recueil de poésie « Au fil du temps » chez, Lys bleu éditions, une écriture arrivée à maturité, des années ont coulées laissant des traces, des couleurs, mais aussi des blessures et des cicatrices, d’où un élan poétique magnifiant le beau même en bousculant le logos pour élever l’expression poétique de l’apparent au caché toujours pour en extraire la profondeur et la beauté vers une renaissance exaltée.
Le Matin d’Algérie : Vous avez fait des études littéraire et l’histoire de l’art, vous venez de publier un beau recueil de poésie « Au fil du temps », qui est Stéphanie Guilhou ?
Stéphanie Guilhou : Comme les chats j’ai eu 7 vies, vivant chacune d’elle avec passion et parfois des moments plus longs et difficiles. C’est cette alternance de rythmes, de matière, de temporalité qui m’a donné à la fois l’élan, la créativité et l’espoir.
Suite à un baccalauréat littéraire, j’ai commencé mes études supérieures par un cursus en Histoire de l’Art et Archéologie. Chaque cours était un voyage, chaque livre une découverte. Cela a été des années très stimulantes. J’ai aussi pu participer à des chantiers de fouilles en Charente-Maritime. Un aqueduc romain, plein de galeries, de rivières souterraines, de pierres centenaires qui nous dévoilaient au fur et à mesure des fouilles leurs mystères.
Ce sont des années baignées par l’esthétisme, le beau, le romantisme, parfois le tragique aussi. Cette sensibilité et la culture développées au contact de ces œuvres font maintenant partie de moi, comme un photographe fait corps avec son appareil, l’œil s’ajuste aux tableaux, aux sculptures, aux bâtiments et cela laisse une empreinte même pour les petites choses du quotidien.
Mes projets ont ensuite évolué vers d’autres aventures, j’ai ensuite travaillé en ONG (Organisation non gouvernementale) auprès de personnes passionnées et d’une humanité très humble et très grande. Cela chamboule tout ce que vous aviez appris jusqu’à présent et transforme la notion du temps consacré, et de l’engagement. En 2010 je suis partie sur le terrain au Liban pour travailler dans un dispensaire auprès de personnes atteintes de handicap. Cela restera à ce jour ma plus belle expérience. Un temps dans ma vie où chaque instant avait un sens et où pourtant était présent ce sentiment de ne pas faire assez, de pouvoir se dépasser chaque jour un peu plus, et d’être pourtant humain, de pouvoir tant donner et pourtant d’être parfois si démuni.
Si cette expérience était à refaire je la referais sans hésiter !
Un troisième temps est ensuite arrivé celui de la vie en entreprise, le dynamisme des projets, les premières rencontres artistiques professionnelles. Dans le cadre de mon travail nous organisions des concours de chant : un concours européen de karaoké et un concours mondial de chant dont la finale en 2018 s’est déroulée à Paris. J’ai découvert à ce moment l’environnement musical, les tournées de sélections, la magie du show, toute une culture que je connaissais à travers ma chère radio. Ce bain de musique a été pour moi un élément moteur en termes d’écriture et de rencontres. Sans cette étape je n’aurai jamais osé me lancer dans de nombreux projets.
Aujourd’hui vient le temps de l’écriture diffusée, et je continue à travailler au sein de projets associatifs.
Le Matin d’Algérie : « Au fil du temps » est un titre évocateur qui interpelle la réflexion, pouvez-vous nous en parler ?
Stéphanie Guilhou : “Au fil du temps” est mon premier livre, il a donc une signification toute particulière pour moi. Il a été écrit au fil de l’eau, au fil des années, au fil de mes expériences, au fil des rencontres… C’est un mélange de vécu, de témoignages, d’histoires, d’idées qui étaient là dans ma tête et qui ont été au fur et à mesure transposées sous formes de vers.
Au début c’était des textes, des poésies, des chansons que j’écrivais en rentrant des tournées des concours de chants. Je les partageais avec mes proches et mon entourage artistique. Peu à peu le contenu s’est densifié et la trame s’est brodée avec patience.
Un jour où j’étais entre deux jobs m’est venu l’idée de me lancer enfin, de le publier. Je ne savais pas trop où j’allais et j’ai été agréablement surprise par les retours positifs que j’ai eus. J’ai consacré le temps que j’avais de disponible à ce moment-là, à le bichonner pour sa parution et c’est ainsi que ce premier livre est né. Je suis très heureuse de pouvoir diffuser ces textes à un public plus large, ils ont longtemps été cocoonés et il est temps pour eux de vivre leurs vies et d’être appropriés par d’autres !
Cette influence musicale qui a été à l’origine en termes d’inspiration de leur construction, et de leur rythme continue de se diffuser. Certains poèmes sont transposables en chanson et ont trouvé leur place sur le piano d’amateurs qui s’en servent pour leurs compositions.
L’idée que ce que j’ai écrit en noir et blanc puisse trouver une nouvelle dimension en blanches et noires en version plus aérienne me réjouis. J’aime cette idée de transformation, d’évolution, d’adaptation. Une nouvelle vie qui prend forme pour ces textes, quelque chose qui m’étonne à nouveau sur leurs constructions.
Le Matin d’Algérie : Pour Charles Baudelaire, le temps est l’ennemi, celui qui détruit, le poète constate impuissant ses ravages, qu’en pensez-vous ?
Stéphanie Guilhou : On ne peut pas échapper au temps, il court infiniment, même si on décide de faire une pause dans sa vie le temps lui continue de courir.
Cependant je ne pense pas qu’il soit un ennemi, certes nous grandissons puis nous vieillissons mais il nous apporte aussi maturité, confiance, la solidité des liens avec ceux que nous aimons.
Quand nous disons de quelqu’un “ Je le connais depuis 20 ans” le temps est alors un fidèle ami. Il est à la fois invisible et marqueur, imperceptible et indélébile, il est ce que nous en faisons mais comme la nature il aura toujours le dernier mot !
Le Matin d’Algérie : Votre poésie est limpide, à portée de tous, et pourtant elle est d’une profondeur inouïe, comment faites-vous ?
Stéphanie Guilhou : C’est cette inspiration musicale qui lui apporte ce rythme et cette construction. Les chansons sont construites pour être diffusées, pour s’adapter à leurs publics. Quand j’écris, j’écris d’abord pour moi mais avec l’idée que cela puisse aussi se transmettre, comme un dialogue. Sans lecteurs, la littérature devient stérile et comme tout art c’est avant tout une histoire de rencontres, quelque chose qui nous a touché et qui pourra par ricochets toucher quelqu’un d’autre.
Il y a beaucoup de poèmes construits sur des témoignages aussi il y a de ma part une volonté de leur rester fidèle. Fidèle à leur histoire, à leur simplicité, à leur authenticité.
J’écris depuis toujours, lycéenne et étudiante j’aimais beaucoup participer à l’écriture d’articles et à des concours d’écriture : Théâtre, court métrage, poésie… Je pense que cela a aussi influencé mon style et ma façon d’aborder ma plume.
J’essaie toujours de faire en sorte que dans les textes que j’écris qu’il y ait quelque chose qui puisse accompagner le lecteur. Quelque chose que j’ai appris et que j’ai envie de transmettre, quelque chose que l’on m’a raconté et que j’ai trouvé d’une grande beauté. Il y a un cheminement qui continue et qui par les échanges que j’ai avec mes lecteurs s’enrichit et m’inspire.
Le Matin d’Algérie : La poésie et l’art en général peuvent sauver le monde, pour un retour salvateur vers le cœur, vers le bonheur, qu’en pense la poétesse Stéphanie Guilhou ?
Stéphanie Guilhou : Absolument, l’encre noir devient couleur en se transformant en calligraphie. Les mots ont une nuance, comme une gamme chromatique, comme une partition de musique. Je travaille avec des dictionnaires et des dictionnaires des rimes. Pour chaque mot il y a une palette, un relief, une puissance.
C’est un moyen de quitter les abysses et d’élever nos plus profondes pensées. Que ce soit par l’écriture, la peinture, le cinéma, la musique etc… l’art nous permet de toucher des choses au plus profond de nous, de transcender des douleurs, de catharsiser des blessures.
L’art c’est aussi de la légèreté, ce qui nous permet de nous évader, de s’imprégner d’un lieu, de personnes, de cultures.
Nous sommes entourés d’art, et de poésie. La poésie se trouve sur la façade d’un immeuble, dans le vent qui balaie les feuilles d’automne, dans les chansons, à chaque printemps, dans la solitude de l’hiver, dans le spleen du métro un lundi matin, dans un échange de regards…
C’est un moyen de mettre en vers notre quotidien du plus banal canard dans le café aux moments les plus extraordinaires qui illuminent nos vies.
C’est aussi une histoire de transmission de vécu, d’impressions d’émotions. C’est ce qui fait notre humanité et que nous devons laisser en patrimoine chacun à son échelle et avec le savoir-faire de son art.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les poètes qui vous influencent ?
Stéphanie Guilhou : J’aime beaucoup Victor Hugo, j’aime son romantisme et la façon dont ses poèmes peuvent être poignants. Au cours de mes études littéraires j’ai eu la chance d’étudier les grands classiques de la littérature française : Baudelaire, Musset, Apollinaire, Rimbaud… ça a été une chance et une éducation aux belles lettres.
Je garde une tendresse particulière pour Prévert qui a marqué mon enfance, et pour son poème Barbara.
Il y a dans la musique aussi beaucoup de poésie et j’ai été fortement influencé par les mots d’Aznavour. Chaque mot à sa place, sa puissance et sa justesse.
J’aime aussi beaucoup la modernité et la tendresse des paroles de Jean-Louis Aubert ainsi que l’élégance et la chaleur de la musique d’Anna Chedid dite NACH, petite fille d’Andrée Chedid.
Le Matin d’Algérie : Avez des projets en cours ou à venir ?
Stéphanie Guilhou : J’ai un nouveau recueil de poèmes consacré au Liban qui est en cours d’écriture. Cela tient une place dans mon cœur depuis longtemps, il y a cette envie de le partager. Il sera illustré et cette fois-ci plus construit comme des tableaux.
Je continue à écrire des poèmes et des chansons, qui sont là bien sagement dans un cahier le temps que des projets arrivent à maturité.
Après j’ai le projet d’écriture d’un livre biographique sur une artiste, et toujours des idées de nouvelles de romans, d’articles qui foisonnent et qui j’espère un jour verront le jour !
Entretien réalisé par Brahim Saci
lematindalgerie.com
Le 19 mars 2024
…………………………………………………………………………………….
Rencontre avec le grand compositeur Philippe Hersant

Philippe Hersant est ce compositeur de génie à l’humilité stupéfiante comme le sont les plus grands. Cet homme généreux et souriant force le respect et l’admiration. Il a marqué la musique classique d’une empreinte quasi-mystique tant la lumière qui émane de ses compositions invite le cœur et l’esprit vers une élévation touchant les étoiles.
Philippe Hersant est licencié en lettres modernes de l’Université Paris-Nanterre, il a en parallèle un parcours musical remarquable. Il a fait ses études musicales au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où il suit les classes d’harmonie de Georges Hugon, de contrepoint d’Alain Weber et de composition d’André Jolivet.
Philippe Hersant a aussi enseigné la musicologie à l’université Paris-Sorbonne, il a côtoyé les plus grands noms du monde de la musique classique, largement reconnu. Il s’est vu décerner les plus hautes distinctions, Il est Commandeur des Arts et Lettres.
Son catalogue est riche de près de deux cents œuvres, musique instrumentale soliste, musique de chambre, orchestre, chœur. Il est l’auteur de trois opéras : Le Château des Carpathes, commandé par le Festival de Montpellier et de Radio France, Le Moine noir, commandé par l’Opéra de Leipzig et Les Éclairs, sur un livret de Jean Echenoz, commandé par l’Opéra-Comique.
Il a également écrit une musique de ballet pour l’Opéra de Paris, Wuthering Heights, sur une chorégraphie Kader Belarbi, des Vêpres de la Vierge, commandées par Notre-Dame de Paris pour le 850ème anniversaire de la cathédrale et un opéra choral, Tristia, commandé par Teodor Currentzis et l’Opéra de Perm en Russie.
Philipe Hersant a également écrit un grand nombre de musiques de scène et de musiques de film. Il est ce composteur patient et persévérant qui traverse les ans déchirant l’air, le souffle sans cesse renouvelé, avec une jeunesse défiant le temps avec des créations qui émerveillent le profane et le mélomane tant l’émotion est élevée à son paroxysme.
Excusez du peu, Philippe Hersant est comme cette source où mène la Grande Ourse, où s’abreuve l’âme et le cœur.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un compositeur reconnu, vos créations sont un jaillissement de lumière, qui est Philippe Hersant ?
Philippe Hersant : Je ne pense pas que ma production ait toujours été lumineuse ! Elle s’est nettement éclaircie au fil du temps. Mes œuvres ont longtemps été le reflet d’un parcours chaotique, semé de doutes, parfois même à la limite du renoncement. À cinq ans, j’étais sûr de vouloir être compositeur. C’était une véritable vocation. Mais à l’adolescence, l’incertitude s’est installée durablement… J’avais 30 ans lorsque j’ai écrit ce que je considère comme mon opus 1. J’ai renié tout ce que j’ai écrit auparavant. Il m’a donc fallu des années pour me trouver, pour m’accepter. La route fut longue, tortueuse et escarpée…
Le Matin d’Algérie : Les arts en général et la musique en particulier sont comme cette fontaine de jouvence, les ans, le temps n’ont pas d’emprise sur le génie créateur, vous paraissez infatigable, comment faites-vous ?
Philippe Hersant : Depuis une vingtaine d’années, le rythme de ma production s’est beaucoup accéléré. C’est parce que, progressivement, le fait d’écrire de la musique est devenu pour moi naturel, régulier, presque quotidien. Je ne remets plus jamais cela en question et n’imagine pas ma vie sans cette activité.
Je ne dirais pas que le temps n’a plus d’emprise sur moi, mais je pense que cette certitude adoucit le cours du temps et j’en suis heureux.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les compositeurs qui vous influencent ?
Philippe Hersant : Ils sont extrêmement nombreux ! Je n’ai pas coupé le lien avec la musique du passé : celle-ci, bien au contraire, me nourrit. Lorsque j’avais vingt ans, j’adoptais, par suivisme, une attitude avant-gardiste (« Du passé faisons table rase » !) Cette attitude n’était pas profondément ressentie, elle ne me correspondait pas et m’a mené dans une impasse. Mes compositions maintenant font souvent référence au passé, parfois même à un passé très ancien (musiques médiévales, renaissantes, baroques…) Je suis également influencé par les musiques populaires de toutes origines. Je me sens relié à toutes les musiques du monde qui m’ont précédé et qui me touchent. Je ne sens nullement le besoin d’innover à tout prix.
Un compositeur me fascine particulièrement, c’est Gustav Mahler, car ses œuvres englobent tout, le sublime et le trivial, le savant et le populaire, le sacré et le profane. Ses symphonies sont des œuvres-mondes.
Le Matin d’Algérie : La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée, disait Platon, qu’en pensez-vous ?
Philippe Hersant : J’ai souvent lu cette phrase et j’ai longuement cherché (sans succès) à savoir de quel dialogue de Platon elle provenait.
En fait, je crois qu’elle est un résumé un peu sommaire de ce que le philosophe dit dans le Timée : « Quand on cultive avec intelligence le commerce des Muses, l’harmonie, dont les mouvements sont semblables à ceux de notre âme, ne paraît pas destinée à servir, comme elle le fait maintenant, à de frivoles plaisirs ; les Muses nous l’ont donnée pour nous aider à régler sur elle et soumettre à ses lois les mouvements désordonnés de notre âme, comme elles nous ont donné le rythme pour réformer les manières dépourvues de mesure et de grâce de la plupart des hommes ».
En somme, la musique, si elle est pure, peut influencer l’âme humaine et la rendre bonne. Belle idée !
Le Matin d’Algérie : Nous vivons une époque écorchée, déréglée, la musique peut-elle aider à retrouver les repères perdus qui équilibrent la balance ?
Philippe Hersant : Toute forme d’art peut aider, je pense, à compenser les laideurs et les dérèglements du monde. Dans L’Idiot de Dostoïevski, le prince Mychkine dit cette phrase fameuse : « La beauté sauvera le monde ». Comment s’en passer ?
Le Matin d’Algérie : Les conservatoires sont la vitrine d’un pays, et leur santé est un indicateur du niveau culturel et du bonheur, qu’en pensez-vous ?
Philippe Hersant : Oui, ils sont essentiels, bien sûr ! L’apprentissage d’un instrument et – peut-être plus encore – la pratique collective, au sein d’un orchestre ou d’un chœur, est un formidable outil de socialisation. Cela apprend à écouter l’autre, à vivre ensemble, à s’ouvrir vers le monde.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Philippe Hersant : De nombreux projets ! Des œuvres chorales, un concerto pour violon et, pour dans quatre ans, un opéra.
Entretien réalisé par Brahim Saci.
philippehersant.fr
Le 17 mars 2024
lematindalgerie.com
…………………………………………………………………………………………….
Cyril Mokaiesh : « La musique et la poésie guident ma vie »
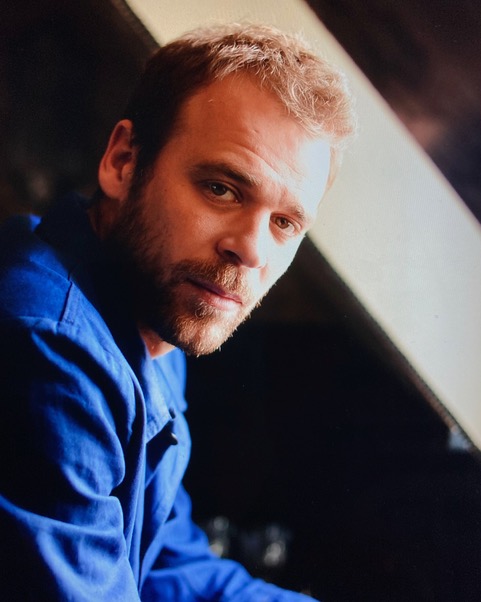
Crédit photo : Dominique Gau
Cyril Mokaiesh est l’un des auteurs compositeurs chanteurs français à texte le plus en vogue, il est une bouffée d’oxygène dans le paysage artistique parisien. Sa poésie, ses chants sonnent vrais, on ne peut s’empêcher en l’écoutant d’avoir une pensée pour Jacques Brel, Léo Ferré, Georges Brassens, Serge Reggiani, et de se replonger dans cette époque glorieuse de la chanson française, où la chanson à texte s’était imposée par la qualité, la force des poèmes, de la musique et le charisme de ces chanteurs qui ne trichaient pas, qui étaient fidèles à leurs écrits.
Cyril Mokaiesh est cet artiste authentique animé par la passion des arts, de la poésie, de la musique et le chant. Il a été un grand joueur de tennis, un sport qu’il pratiqua avec art. Il fut à 18 ans champion de France de tennis junior.
Cyril Mokaiesh s’investit entièrement dans tout ce qu’il fait, il continue à émerveiller son public par des compositions de qualité, en l’écoutant on se dit que la chanson française a encore de beaux jours devant elle.
Le Matin d’Algérie : Vous avez été champion de France de tennis, vous êtes auteur compositeur chanteur, on peut dire que la passion vous anime, qui est Cyril Mokaiesh ?
Cyril Mokaiesh : J’ai 38 ans, je suis père de famille et en effet la musique, l’écriture, l’interprétation guident ma vie. La création d’une chanson, un album est à chaque fois une manière de me prouver que mon existence a un but, c’est vital.
Le Matin d’Algérie : Dans cette époque écorchée ou le matérialisme sauvage est dévastateur, la chanson à texte est quelque peu boudée, c’est l’ère de la « fast fashion », la priorité est donnée à la facilité, la médiocrité au détriment de la qualité, l’univers de la chanson française s’appauvrit, qu’en pensez-vous ?
Cyril Mokaiesh : Parfois j’ai l’impression que l’époque n’est pas sensible à la beauté, à l’exigence, que la chanson n’est pas considérée à sa juste valeur et que tout se vaut à l’ère des réseaux : une recette de cuisine, un combat de MMA, un You tubeur ou un artiste finalement quelle différence ? On juge sur le nombre de followers qui primera sur le contenu. Tout le monde a quelque chose à dire ou à vendre, ce qui laisse peu de place pour la nuance et la subtilité. J’essaie d’être indifférent à tout ce spectacle et à redoubler de concentration dans ce qui m’anime.
Le Matin d’Algérie : Quelles sont vos influences dans la poésie et la musique ?
Cyril Mokaiesh : Je ne saurais plus dire quelles sont mes influences aujourd’hui car après quinze ans de métier les goûts et les envies changent mais s’il ne devait en rester que deux je dirais Léo Ferré et Paul Éluard pour leur engagement romantique auquel je suis resté fidèle.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Cyril Mokaiesh : Je joue un spectacle sur la vie et l’œuvre de Georges Moustaki. Un concert – théâtre où je me glisse dans sa peau, je chante et raconte sa vie de poète citoyen du monde. Et je prépare un nouvel album de mes propres compositions.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Site vidéos de Cyril Mokaiesh
youtube.com/@CyrilMokaiesh/videos
lematindalgerie.com
vendredi 15 mars 2024
…………………………………………………………………………………………………………
Rencontre avec l’écrivain Madjid Boumekla

Madjid Boumekla est cet infatigable militant pour les causes justes, il a fait des études en Algérie à l’Institut de planification et des statiques de Ben Aknoun puis à l’Université Paris-Sorbonne où il obtient un DESS (Diplôme d’Études supérieurs spécialisées) en économie des ressources humaines, il a entamé un doctorat qu’il a arrêté pour devenir chef d’entreprise jusqu’à sa retraite.
Il vient de publier deux livres sur l’Académie Berbère, Académie berbère – Genèse et question identitaire, et, Académie berbère – Genèse et question identitaire : témoignages et entretiens, Agraw imaziɣen, cette association emblématique, l’élan précurseur pour la reconnaissance de l’identité berbère, dont les membres fondateurs sont Mohand Arab Bessaoud, Abdelkader Rahmani, Mohand Said Hanouz, Naroun Amar, Khelifati Med Amokrane, et Taos Amrouche et bien d’autres personnes de renom.
Invité par l’écrivain Youcef Zirem au café littéraire parisien de l’Impondérable, Madjid Boumekla a expliqué comment cette formidable association malgré les difficultés, les pressions de l’Algérie, de la France de l’époque et les nombreuses tentatives de l’amicale des algériens en France pour saboter et avorter son travail, a malgré tout aidé à l’éveil des consciences bien avant l’apparition du concept d’identité comme l’a expliqué le chercheur, l’ethnopsychiatre Hamid Salmi.
Madjid Boumekla évoque la genèse, l’évolution et l’impact de l’Académie berbère sur l’imaginaire berbère.
Le Matin d’Algérie : Vous avez dit au café littéraire que vous n’étiez qu’un bistrotier qui écrit, mais vous êtes aussi universitaire, alors qui est Madjid Boumekla ?
Madjid Boumekla : il est vrai que j’ai fait des études d’économie que j’ai arrêtées après mon obtention du DESS à la Sorbonne. Ce n’était pas l’envie de continuer qui me manquait, mais plutôt les moyens financiers. Je suis arrivé à Paris avec un pantalon, une chemise, quelques sous-vêtements de rechange dans un petit sac, et également la somme de 350,00 frs de change que l’État algérien permettait, dans la poche.
Ma situation précaire m’a obligé à trouver du travail dans la restauration et j’ai continué parallèlement mes études. Une telle situation est supportable seulement pendant un court laps de temps, ce qui m’a poussé à interrompre mes études. Dans un premier temps, c’était temporaire. Je pensais reprendre mon cursus universitaire une fois que j’aurais amassé un petit pécule. Hélas, ou pas, les choses se sont passées autrement. J’ai continué à travailler pour finir définitivement dans le commerce jusqu’à ma retraite.
Une fois dans le commerce, je me suis légèrement éloigné du travail intellectuel, bien que mes connaissances en économie m’aient partiellement aidé dans mes activités de chef d’entreprise dans la restauration.
Porté sur le combat culturel, j’ai réussi tout de même à joindre l’utile à l’agréable en utilisant mon espace commercial pour des activités culturelles en plus de celles liées à la gastronomie. Cela m’a permis d’utiliser mon restaurant de tremplin pour sortir Yennayer de son espace privé et lui donner sa place dans l’espace public en organisant régulièrement son dîner depuis 1985, première année de l’achat de mon restaurant. J’ai également utilisé mon commerce pour d’autres rassemblements militants. Il a servi de lieu pour le lancement de la dynamique des associations de villages kabyles en France et de lieu de réunions politiques lorsque j’étais militant du FFS.
Cette situation, avec un pied dans le commerce et un autre dans le monde politico-culturel, m’a permis d’écrire des articles, un peu plus tard, avant d’investir l’univers du livre.
Le Matin d’Algérie : Pourquoi avez-vous décidé d’écrire ces deux livres sur l’Académie Berbère ?
Madjid Boumekla : la publication de ces deux livres sur l’Académie berbère est venue après quatre autres, mes livres sont disponibles sur Amazon.
Pour répondre à la question, je dois remonter à ma période d’adolescence. En tant que lycéen en Kabylie, avec certains de mes amis, nous recevions le bulletin de l’Académie berbère, Itij de l’OFB (organisation des forces berbères ) et la revue de l’association Afus deg fus, que nous faisions circuler autour de nous. Cela m’a valu six mois de prison ferme, deux ans avec sursis, une amende pécuniaire et une interdiction d’avoir un passeport pendant longtemps. Tout ceci m’a sensibilisé un peu plus au combat identitaire amazigh, car mes débuts de prise de conscience de l’amazighité remontent à mon enfance, avec un père militant aux côtés de Laïmèche Ali à Tizi-Rached. Ensuite, la chanson engagée, avec tous les groupes de chanteurs kabyles qui ont fait florès à l’époque, a contribué à mon éveil identitaire.
Suite à ma deuxième opération chirurgicale du dos, j’ai arrêté de travailler pour incapacité physique, pour ensuite partir à la retraite. Et là, après ma militance sur le terrain, je me suis entièrement consacré à celle de l’écrit. Les sujets qui me sont venus à l’esprit étaient ceux liés à ma propre vie. Voilà, comment j’ai écrit et publié les deux livres sur l’Académie berbère. À ces raisons s’ajoute celle de rendre hommage à cette association qui avait bravé tous les dangers pour contribuer à faire avancer le combat culturel et identitaire des Amazighs.
Le Matin d’Algérie : Quand on parle de l’Académie berbère, on pense à Mohand Arab Bessaoud, est-ce ses livres ou sa forte personnalité qui ont masqué les autres membres fondateurs ?
Madjid Boumekla : j’oserai dire les deux en mettant tout de même un bémol. Le passé de combattant au sein de l’ALN (armée de libération nationale), celui dans les rangs du FFS (Front des forces socialistes ) dans sa guerre contre le duo machiavélique Ben Bella – Boumediene qui s’apprêtait à prendre le pouvoir après l’indépendance du pays, en cassant le processus constituant qui se mettait en place, son statut d’ancien instituteur et d’écrivain, a probablement joué dans le lancement de l’Académie. Le bémol est qu’il n’est pas le seul à avoir un passé aussi convaincant. Il y avait tous les autres y compris des chercheurs émérites sur la berbérité, qui ont apporté leurs cautions à la naissance de l’Académie. J’ai cité toutes ces personnes dans le premier volume.
Le Matin d’Algérie : Qu’est-ce qui a empêché l’Académie berbère d’évoluer vers une véritable académie ?
Madjid Boumekla : Ma réponse va recouper en partie la précédente. À ses début, l’Académie a regroupé beaucoup de personnes « intellectuelles ». Je mets le terme intellectuel entre guillemets car ces personnes étaient plutôt des universitaires, des politiques, des artistes et d’étudiants en plus de quelques travailleurs manuels.
À l’origine l’Académie portait le nom ABERC (Association berbère d’échanges et de recherches culturels ). Effectivement, le but recherché était celui d’une académie qui va s’atteler à la recherche et la publication. Sa destinée a été tout autre. Pourquoi ? Je vois deux grandes raisons. La première était politique. Le coup d’État orchestré par Boumediene en 1965 a verrouillé tout l’espace politique et l’opposition s’est retrouvée à l’étranger, singulièrement en France. Le climat au sein du mouvement militant était prédominé par l’esprit politique. Ceci me permet d’évoquer la deuxième raison. Cet esprit a traversé l’Académie dès sa naissance. Deux tendances se sont affrontées, celle culturaliste et celle politico-culturaliste. In fine, la deuxième tendance, autour de Mohand Arab Bessaoud, l’a emporté après l’immobilisme de l’association pendant environ un an et demi. En 1969, un changement structurel est intervenu. Hormis Abdelkader Rahmani, président de l’ABERC, qui avait quitté l’association, la majorité des membres fondateurs était restée. Certains la quitteront progressivement. Ceux qui sont restés se sont occupés des activités de l’association que j’ai traitées en profondeur dans mes deux livres. C’était cette tendance que j’ai qualifiée de politico-culturaliste qui a pu donner une dynamique à l’Académie berbère.
Le Matin d’Algérie : Pourquoi les autres cofondateurs n’ont-ils pas écrit d’après-vous ?
Madjid Boumekla : Les véritables raisons ne pourraient être apportées que par certains des intéressés eux-mêmes, malheureusement décédés. Dans ma réponse, je ne peux qu’approcher la question
Je dirai que la peur joue en partie un rôle. Les pouvoirs successifs en place en Algérie depuis l’indépendance n’ont pas hésité à recourir à des politiques de répression et d’oppression. Qui pourrait oublier les assassinats des opposants perpétrés par la sinistre sécurité militaire à l’époque de Boumediene ? L’oppression a instauré l’autocensure dans les esprits.
Je vois également deux raisons. La première est liée à la structure interne de l’Académie et la seconde à notre culture orale. Pour ce qui est de la première, à l’exception des cofondateurs « intellectuels », le reste des adhérents qui ont participé à la fondation de l’Académie étaient des ouvriers qui n’avaient pas nécessairement les capacités d’écrire. Quant à la seconde raison, notre culture est restée longtemps dominée par l’oralité et l’écrit peinait à y trouver sa place, surtout en l’absence de lecteurs. Ce phénomène s’accentue avec l’avènement de la culture des réseaux sociaux, qui accorde une plus grande importance à l’audiovisuel, favorisant ainsi notre tradition orale.
Le Matin d’Algérie : L’académie berbère est gravée dans la mémoire collective des berbères, particulièrement des kabyles, quelles conclusions peut-on en tirer aujourd’hui ?
Madjid Boumekla : Malgré ses moyens matériels limités et les pressions qu’elle a reçues de la part des pouvoirs politiques en place dans les pays de l’ex-tamazgha, l’Académie berbère a fortement contribué à l’éveil identitaire des peuples amazighs. Il est vrai que son travail a eu un impact beaucoup plus important sur les Kabyles que les autres amazighs. La raison en est qu’elle était constituée en majorité de Kabyles, et donc le premier travail de sensibilisation s’est principalement concentré en Kabylie, notamment à travers son fameux bulletin « Imazighene ». Néanmoins, le combat avant-gardiste mené par les kabyles a pu entrainer les autres berbères dans la lutte. Actuellement, la berbérité se manifeste partout où les berbères existent. Peu nombreux étaient ceux qui ont cru à cet éveil des peuples amazighs. Les militants de l’Académie y étaient du nombre. Ils ont pu mener des petites actions ayant un impact grandiose.
Quelques repères historiques prouvent l’impact des actions de l’Académie sur le mouvement berbère. Lors de la manifestation de la fête des cerises de Larba Nat Iraten, en 1974, et de la finale de football de la coupe d’Algérie, en 1977, remportée par la JSK (jeunesse sportive de Kabylie ) dans les tribunes du stade et dans les rues d’Alger, les personnes présentes ont scandé Imazighen, l’un des slogans phares de l’Académie. Lors du gala d’Idir en 1977 à la Coupole d’Alger, une lettre écrite en tifinagh a été projetée sur un écran géant placé sur le bord de la scène a suscité l’euphorie général au sein des spectateurs. Pendant la même époque, des tags en tifinagh ont été apposés sur des plaques d’indication routières et sur des routes en Kabylie. Qui a vulgarisé le tifinagh après l’avoir actualisé ? C’était bien l’Académie. Elle a également créé le drapeau que tous les amazighs arborent, le système d’énumération, le calendrier, etc. Tout est bien détaillé dans mes deux livres.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Madjid Boumekla : comme je l’ai dit précédemment j’écris sur des sujets liés à mon vécu. Je suis donc en train de collecter des informations sur la dynamique des associations de villages kabyles en France. Si tout se passe bien j’essaierai d’en publier un livre.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Madjid Boumekla : Toi aussi, Brahim, tu excelles dans l’écriture poétique. Je te souhaite bon courage. Il faut écrire, écrire, … comme notre ami commun Youcef Zirem n’arrête pas de le dire.
Merci pour le journal Le Matin d’Algérie qui m’a offert la possibilité de m’exprimer. Je lui souhaite longue vie.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Livres publiés :
– Académie berbère : genèse et question identitaire, independently published
– Académie berbère- Genèse et question identitaire : témoignages et entretien, Independently published
– Yennayer amager n tefsut… rituels fondamentaux dans la tradition kabylo-amaziɣ, Independently published
– Couscous artisanal, mode de préparation et recettes, de Madjid Boumékla et Malika Boumekla, Independently published
– La crise berbériste de 1949 ou le sursaut de la berbérité, Independently published
Berbérités: Entre amalgame et manip, Spinelle éditions
mardi 12 mars 2024
lematindalgerie.com
………………………………………………………………………………………

Rencontre avec la chanteuse Lycia Nabeth
Lycia Nabeth est une chanteuse talentueuse, à la voix envoutante qui ne cesse de monter comme une étoile dans le ciel de la chanson kabyle de ces dernières années.
Lycia Nabeth est une voix qui rafraîchit le cœur et l’esprit, elle s’écoule pure comme l’eau des sources du Djurdjura ou de l’Akfadou. L’art est une histoire familiale chez les Nabeth, son père et sa mère chantent, la passion des arts s’est transmise. Son père Kader Nabeth a marqué la chanson kabyle par la beauté de ses compositions et ses chants.
De l’université au chant, Lycia Nabeth est une bouffée d’oxygène dans la chanson kabyle, de sa belle voix jaillissent tant d’espoirs.
Le Matin d’Algérie : De l’université au chant, qui est Lycia Nabeth ?
Lycia Nabeth : Azul, alors il est toujours difficile de parler de soi (rire), ce que diraient les gens qui me connaissent bien … c’est que Lycia Nabeth est une chanteuse qui chante son identité, sa société kabyle, ses valeurs qui lui ont été transmises par ses parents et qui l’encouragent et la soutiennent dans cette voie. Elle a fait son apparition avec la chanson « Riyid Iles-iw », qui a été chaleureusement accueillie par le public en 2009, puis s’est consacrée à ses études et sa vie de famille.
Elle est revenue en 2021 avec un album de huit titres et qui a rencontré un franc succès notamment avec la chanson « Amxix-iw ». Cet album a également bénéficié du soutien de mes parents et d’autres contributions sur le plan artistique. C’est un album qui a été salué par la critique comme apportant de nouvelles sonorités et du renouveau, c’est ce que j’essaie de faire en m’inspirant des sonorités d’autres cultures et styles.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes une étoile montante dans la chanson kabyle, le talent, la voix, l’esprit kabyle, tout est là, comment faites-vous ?
Lycia Nabeth : J’ai eu la chance d’avoir comme école mes parents et j’ai toujours aimé chanter en étant accompagnée par le jeu de guitare de mon père que je trouve exceptionnel.
Mes parents m’ont toujours transmis aussi leur amour de la culture et de la question identitaire sur laquelle je suis très sensible, j’estime qu’il est dans notre devoir collectif de transmettre à nos enfants la culture, l’héritage que nous avons reçu de nos aïeuls.
Et le fait de chanter en kabyle est aussi une forme de contribution à la préservation et le rayonnement de notre culture qui a besoin du soutien de tous. Il y a toujours une magie entre le public kabyle et les artistes, je suis le fruit de cette société, je fais aussi partie de ce public et je chante une histoire qui est la sienne, qui est la nôtre et quand les paroles, la musique sont bien accueillies par le public, il s’opère une symbiose entre l’artiste et son public et c’est grâce à ce public que nous rayonnons et j’espère contribuer à son rayonnement aussi.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur votre père Kader Nabeth qui a marqué le chant kabyle par ses compositions de qualité.
Lycia Nabeth : Mon père a toujours été un exemple à suivre pour moi. On a toujours eu une grande complicité depuis ma tendre enfance. Il a toujours veillé à mon bien-être et à me soutenir dans la voie que j’ai choisie, à tous les niveaux.
Quant à ses compositions, je trouve que ses mélodies dérivent « descendent » de la montagne du Djurdjura et sont authentiques en plus de ça, toutes ses chansons sont différentes les unes des autres.
Le Matin d’Algérie : Vos chansons s’écoulent, enchantent et émerveillent l’oreille et le cœur, vous aimez le bon travail, quelles sont vos influences artistiques ?
Lycia Nabeth : J’ai grandi en écoutant les chansons de mon père bien évidemment, et celles de son ami d’enfance Brahim Izri dont j’ai adopté le style naturellement. J’écoutais tous les détails sans jamais me lasser. Il y a eu évidemment Idir que j’ai eu la chance de côtoyer et dont j’ai partagé la scène, notamment à Bercy, ça été des moments inoubliables et des influences qui ont forgé mon style et qui m’ont beaucoup inspirée. J’écoute énormément la musique kabyle en général, qu’elle soit ancienne ou moderne.
Je suis fan et j’essaie de contribuer avec d’autres artistes autant que possible en partageant des scènes et des chansons. On est comme une famille et on partage cette envie de faire avancer notre culture, la chanson kabyle, et aussi de la transmettre aux générations futures… comme disait Slimane Azem « nedjayawend ma t kemlem amzun ur nemouth ara ».
Durant mon enfance, j’ai beaucoup écouté aussi des musiques étrangères comme Christina Aguilera, Britney Spears, Lara Fabian, Daniel Lévi et plein d’autres artistes ou groupes comme Scorpions qui m’ont aussi apporté quelques influences.
Le Matin d’Algérie : La chanson kabyle a été longtemps dominée par les hommes, mais on voit par bonheur apparaître de nombreuses chanteuses, musiciennes compositrices, dont vous faites partie, qui font un travail de qualité, qu’en pensez-vous ?
Lycia Nabeth : Le domaine artistique est souvent difficile d’accès pour une femme « surtout dans des sociétés à forte tradition comme la mienne » comme disait Idir. J’ai eu la chance d’être accompagnée par mes parents, et surtout soutenue. Chanter pour une femme reste un véritable défi ; il faut résister au « qu’en-dira-t-on ». Il n’est pas permis aux femmes d’exprimer librement leurs émotions en public dans nos sociétés, la relation homme – femme est déjà complexe dans toutes les sociétés et chez nous, ça l’est encore plus.
Il y a toujours une tendance à reproduire en milieu professionnel des schémas familiaux fortement imprégnés par une tradition patriarcale, et il est vraiment difficile pour une femme d’être vue comme une artiste, ou simplement comme une collègue de travail.
Même s’il y a eu beaucoup de progrès, et il faut le reconnaître, le chemin à parcourir reste encore long dans certains milieux. Il est encore difficile dans certaines familles d’envoyer leurs filles dans une école de musique, prendre des cours particuliers; tout d’abord il y a la distance, il y a trop peu d’école de musique chez nous, et si vous ajoutez les barrières sociétales, tous les ingrédients sont réunis pour que les filles n’apprennent jamais les activités artistiques.
Le fait de chanter en tant que femme est aussi une forme de soutien et d’encouragement pour toutes les femmes à réaliser leurs projets professionnels, personnels et à ne pas se résigner et surtout à lutter contre toutes les formes d’injustice que les femmes continuent de subir aujourd’hui.
Le fait de voir des jeunes filles talentueuses nous donne beaucoup d’espoir ; tout d’abord beaucoup d’espoir pour notre culture, il y a une relève qui se dessine et ça donne chaud au cœur de voir autant de talents ; et beaucoup d’espoir aussi pour nos sociétés puisqu’on voit des familles, des pères, des mères, des frères, des maris aussi soutenir ces jeunes chanteuses qui vont aussi tracer le chemin pour d’autres femmes talentueuses qui n’osent pas prendre l’initiative d’exprimer leur art.
Il faut aussi rendre hommage à tous ces messieurs qui soutiennent leurs sœurs, leurs filles, leurs épouses dans la voie artistique et qui montrent aussi le chemin pour toute la société. Mon espoir est de voir aussi des femmes réalisatrices de clips et dans les studios d’enregistrement.
Le Matin d’Algérie : La chanson kabyle foisonne de talents mais elle manque de visibilité, l’ouverture démocratique tarde à venir, l’avenir s’annonce assez sombre malgré quelques éclaircies çà et là, d’où vous vient cet optimisme véhiculé dans vos chansons ?
Lycia Nabeth : Je me suis beaucoup questionnée aussi sur l’optimisme que j’ai et que j’ai envie de transmettre notamment au moment d’écrire les textes. Je pense que ça vient de tout l’amour que j’ai reçu de la part de mes parents et des meilleures années de ma vie que j’ai vécu au village (At Lahcène – At Yenni) en me sentant libre et à l’aise dans l’insouciance et la sécurité. Ça vient aussi de mon père qui a toujours donné une image d’homme positif et exemplaire. Ma mère quant à elle, elle a fait de moi une personne toujours prête à avancer dans ses projets bien que les conditions soient difficiles.
Je suis très souvent touchée par ce que je vois dans la société et je veux apporter de l’espoir ne serait-ce qu’avec mes chansons et le son de ma voix.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en perspective ?
Lycia Nabeth : J’ai du nouveau qui va sortir bientôt. Je travaille sur un nouvel album et quelques clips qui vont sortir prochainement, avant de les partager sur scène avec le public très chaleureux. Quand je ressens l’accueil du public et je vois aussi un public de jeunes, ça me donne beaucoup d’espoir pour notre culture et les jeunes talents qui arrivent. Nous avons une grande culture millénaire qui vient de très loin et qui a été sauvegardée ; nous avons le devoir de la faire grandir encore plus et de la transmettre à nos enfants pour qu’elle demeure …
Entretien réalisé par Brahim Saci
Le 09 février 2024
Le Matin d’Algérie
Lematindalgerie.com
………………………………………………………

Rencontre avec le poète écrivain Reski
Rezki Rekaï dit Reski est un poète écrivain discret, jovial, toujours souriant, c’est un poète rempli d’humanisme, dont les écrits émerveillent, interrogent et réchauffent le cœur.
Originaire du village Igariden, Maâtkas, la poésie a toujours fait partie de lui, mais ce fils de commerçant a fait des études en économie et gestion d’entreprise à l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, il a continué ses études en France où il a obtenu en 2008 un Diplômé de troisième cycle en Audit et contrôle de gestion à l’INSEEC Paris.
Passionné de littérature et de poésie, ses premières lectures sont les livres d’Albert Camus et de Mouloud Feraoun.
Reski a vécu une dizaine d’années en Belgique où il a participé à plusieurs salons du livre, il a eu son premier prix de poésie Oxfam Liège, en octobre 2022. Il vient de publier un beau livre de poèmes et réflexions, Des mots Une beauté Un sens, chez thebookedition.
L’écrivain poète journaliste Youcef Zirem l’a invité à son café littéraire de l’Impondérable au 320 rue des Pyrénées dans le XXème arrondissement de Paris, ce fut une belle rencontre, on a pu constater avec bonheur que Reski est fidèle à ce qu’il écrit.
Le Matin d’Algérie : Vous avez fait des études en économie de gestion, en Audit et contrôle de gestion, et pourtant c’est la littérature qui vous anime et vous passionne, qui est Reski ?
Reski : Je dirai entre parenthèses qu’en économie et gestion, il y a une spécialisation en ressources humaines, donc on ne peut pas dissocier la chose purement économique de l’humain. Je vais terminer en disant que l’entreprise a besoin de l’humain comme l’humain a besoin de l’entreprise.
C’est qui Reski ?
Il est “le fruit “ d’une vie en communauté dont les relations humaines sont très importantes et une vie en occident où l’individualisme est presque roi.
Cela a forgé sa pensée que j’essayerai de résumer en quelques points :
La vie est une chance à saisir.
Si on remet l’humain au centre du monde, ce dernier se portera mieux.
La modernité ne doit pas effacer la tradition mais plutôt l’accompagner.
L’homme n’est pas né méchant ou gentil mais il fait des choix.
La planète terre est assez riche pour nourrir tous ses enfants sans exception.
Le monde est riche par la diversité de ses identités.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les auteurs qui vous fascinent ?
Reski : Il n’y a pas un auteur qui me fascine plus qu’un autre, j’ai aimé les livres de Feraoun car ce sont les premiers que l’ai lus, en plus qu’ils abordaient des sujets propres à ma société.
J’ai bien aimé le roman les chercheurs d’os de Tahar Djaout. Après je peux aimer du Camus comme du Balzac ou du Zola.
Je peux acheter un livre pour son titre sans connaitre forcément l’auteur mais je peux aussi acheter un livre car je trouve sa couverture belle…
J’ajouterai, si j’ai une fascination, elle est pour la chanson kabyle, pour ces poèmes et pour une certaine philosophie dans ses textes.
Le Matin d’Algérie : D’où vient cette passion pour les livres ?
Reski : Franchement je ne sais pas. Une chose est sûre, un livre est cet objet que je trouve si fascinant (si on peut considérer un livre comme un objet). À première vue, il n’est qu’une couverture, mais c’est celle-ci qui invite le lecteur à découvrir ce qui fait le fond du livre. Ce fond peut raconter une histoire, il peut faire rêver, il peut faire voyager, il peut faire aimer et faire douter en même temps …
Je pense que le plus important est que derrière chaque livre, il y a une âme avec une grande sensibilité … Et écrire, c’est laisser le cœur s’exprimer en mots.
Le Matin d’Algérie : Nous vivons une époque tourmentée, particulièrement en Algérie où la démocratisation tarde à venir, la poésie peut aider à apporter un peu de soleil dans la grisaille régnante, qu’en pensez-vous ?
Reski : Je vous livre cette citation : les nobles batailles se gagnent par l’art, et j’ajouterai : elles se gagneront par l’art. Effectivement la poésie comme les autres arts peuvent contribuer.
Mais avant tout, une question s’impose : quelle démocratie pour quelle société ?
Je pense que La démocratie est d’abord une culture, donc à chaque société de penser son système qui permet le vivre ensemble, et ce malgré les différences des opinions et des sensibilités.
Après, prenant le cas des assemblées des villages kabyles, je pense que c’est un exemple parfait de ce qu’on appelle aujourd’hui la démocratie participative. Donc peut être là une source d’inspiration et une idée à généraliser au niveau régional et pourquoi pas national.
Et d’ailleurs, je souligne qu’aujourd’hui, même les démocraties occidentales doutent et elles se cherchent un nouveau souffle. Je finirai par dire : que rien n’est acquis et rien n’est perdu, donc c’est aussi valable pour le cas de l’Algérie.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Reski : Si je retrouve un peu plus d’inspiration et surtout de l’énergie, je publierai un nouveau recueil de poèmes et de réflexions.
Entretien réalisé par Brahim SACI
Livres publiés :
La rose des ténèbres, une nouvelle, thebookedition.
Éviter au monde un lendemain qui déchante, un essai, thebookedition.
Des mots Une beauté Un sens, poésies, thebookedition
Le 06 février 2024
Le Matin d’Algérie
Lematindalgerie.com
……………………….

Crédit photo: Kriss Logan
Isabelle Georges, le talent à l’état pur
Isabelle Georges est une chanteuse qui émerveille et éblouit par ses multiples talents, le chant, la danse et la comédie. Cette artiste discrète brille comme un soleil depuis plusieurs années, la voir bouger sur scène, c’est le charme et le talent dans un élan poétique quasi magique débordant d’émotion.
Les yeux grands ouverts, l’oreille attentive pour ne rien rater, nous sommes transportés vers les cimes du bonheur, c’est une bouffée d’oxygène qui libère les mots pour panser les maux.
Isabelle Georges est habitée par l’art depuis sa tendre enfance, une passion sans doute transmise par sa mère qui a étudié le chant au conservatoire. Elle ne cesse d’évoluer, de visiter, d’interpréter différents répertoires de la chanson française, de la comédie musicale américaine en passant par le jazz, elle donne sa propre couleur et une vitalité remarquable, d’où sa grande originalité qui laisse à chaque fois le public comblé.
Isabelle Georges s’est produite dans des salles prestigieuses en France et à travers le monde, comme le Théâtre des Champs Élysées, la Philharmonie de Paris, le Musikverein de Vienne, le Concertgebouw d’Amsterdam, le Bal Blomet, le Festival d’Édimbourg ou encore celui de Radio France Occitanie Montpellier.
Isabelle Georges est cet univers musical enchanté où se mêle l’expression heureuse des arts multiples, c’est un souffle sans cesse renouvelé de tant de beauté.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes une artiste incroyable, vous chantez, vous dansez, vous êtes aussi d’une grande discrétion, qui est Isabelle Georges ?
Isabelle Georges : Oh Là là ! Isabelle Georges est, tout d’abord, une femme reconnaissante, parce qu’elle a la chance de vivre sa passion, en joyeuse compagnie !
Une femme qui aime malaxer la matière, aller au bout de ses rêves, entre émerveillement, doutes, crises d’angoisse ou de fou-rire, prises de risques, flou, tâtonnements, fulgurances… Bille en tête ! Guidée par une constante : apprendre, apprendre, apprendre ! Curieuse de tout ! Assoiffée de musique, de délicatesse et de poésie… La boussole sur joie !
Le Matin d’Algérie : Vous rayonnez sur les plus grandes scènes depuis plusieurs années, vous paraissez infatigable, comment faites-vous ?
Isabelle Georges : Quand on a la chance d’imaginer des projets et de pouvoir les réaliser, entourée de gens passionnés et passionnants, dans des lieux magnifiques, on a une énergie hors du commun.
Le Matin d’Algérie : Vous excellez dans tout ce que vous faites, la passion vous anime, quelles sont vos influences ?
Isabelle Georges : Mes influences sont très variées. Entre le jazz et la poésie chantée qu’écoutait mon papa, le chant sacré que pratiquait maman en rêvant de comédie musicale, la musique de film, de ballet ou de scène qu’écrivait ma grand-mère… Et puis, il y a ma sœur, mes nièces, les artistes, les gens que j’ai le bonheur de rencontrer sur mon chemin.
Mais aussi les photos de Louis Stettner, la poésie de Raymond Devos, la peinture de Chagall, les mots de Stefan Zweig, les films This must be The place, West Side Story, Swing Kids… La musique de Leonard Bernstein, Claude Debussy, Judy Garland, le courage d’Emma Thompson, l’écriture et les interprétations de Jacques Brel, la classe d’Harry Belafonte, l’inventivité d’Ella Fitzgerald, Billy Holiday, Freddy Mercury, Sammy Davis, Elvis Presley, Michael Jackson, Prince, Fred Astaire ou Gene Kelly… Le concerto d’Aranjuez, l’humour de Mel Brooks… Mais il y en a tant d’autres…
Le Matin d’Algérie : Un mot sur Frederik Steenbrink, pianiste, chanteur, qui vous accompagne sur scène
Isabelle Georges : Nous nous sommes rencontrés à Liège, en Belgique, sur la comédie musicale Titanic. C’était un moment charnière dans ma vie, j’avais enchaîné plusieurs premiers rôles de comédie musicale et je voulais aller vers quelque chose de plus personnel. C’est Frederik qui m’a donné l’idée de mon tout premier spectacle, Une Étoile et moi, à Judy Garland. Ce spectacle m’a ouvert les portes de la créativité ! Impossible de les refermer depuis ! Avec Frederik, nous avons confectionné un peu plus de 10 spectacles et ça continue. Il possède une force de travail extraordinaire, une voix et une musicalité, hors du commun et j’ai une immense confiance en son œil aiguisé et atypique.
Le Matin d’Algérie : Dans cette époque tourmentée où tout s’accélère dans la légèreté et la destruction des valeurs, vos performances sur scène, votre maitrise, votre savoir-faire donnent un nouveau souffle au music-hall, qu’en pensez-vous ?
Isabelle Georges : Je pense à Oncle Sadegh, cet Iranien de 70 ans, qui danse et chante en pleine rue, devant son étal de poissons, pour réclamer la liberté et le bonheur”.
Je pense que la musique, la danse, les spectacles vivants, les arts quels qu’ils soient, sont les plus belles ressources à la disposition de tous les hommes pour se rencontrer, se découvrir, apprendre, stimuler leur conscience, leur joie, transcender leurs différences, reprendre courage… Si mes spectacles/chansons ouvrent le champ des possibles pour, ne serait-ce qu’une personne, c’est une fête !
Je ne résiste pas à partager cette citation de Leonard Bernstein :
« Ce sera notre réponse à la violence : faire de la musique plus intensément, plus belle, avec plus de cœur que jamais auparavant. »
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Isabelle Georges : Frederik Steenbrink et moi venons d’enregistrer la toute première version musicale de la nouvelle de Stefan Zweig, 24h de la vie d’une femme, avec le magnifique Trio Zadig. L’album et le spectacle sortiront à l’automne 2024.
Nos différents spectacles, dont Oh Là Là, sont sur la route, en tournée.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot
Isabelle Georges : Un immense merci, cher Brahim pour cet entretien. Vive la musique et la poésie ! Un jour j’irai en Algérie.
Entretien réalisé par Brahim Saci
isabellegeorges.com
Le 01 février 2024
Le Matin d’Algérie
Lematindalgerie.com
………………………………………………………………………..

Rencontre avec l’universitaire et romancière Clotilde Brunetti-Pons
Clotilde Brunetti-Pons est universitaire, docteur en droit, professeur émérite de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), juriste romancière, auteur de nombreux articles et ouvrages juridiques. Clotilde Brunetti-Pons est officier dans l’Ordre des Palmes académiques. Enseignant-chercheur rattachée au CEJESCO- Centre d’études juridiques sur l’efficacité des systèmes continentaux – de l’URCA; consultante en droit de la famille et de la protection de l’enfance.
Clotilde Brunetti-Pons est aussi présidente de l’Association de l’Ordre des Membres des Palmes académiques (AMOPA) section de Paris VII.
Clotilde Brunetti-Pons est une femme lumineuse, toujours souriante, c’est une vie vouée à l’art et à la transmission du savoir, comme un phare salutaire par temps couvert.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes une universitaire brillante, votre présence illumine, qui est Clotilde Brunetti-Pons ?
Clotilde Brunetti-Pons : Que vous répondre ? Celle que vous interrogez est d’abord une mère de famille nombreuse et une épouse épanouie. Je ne serais pas la même sans ma famille.
Avec une vie déjà bien remplie, il m’a fallu trouver de l’énergie pour exercer une activité professionnelle très dense. Cela s’est fait sans y penser, sans calculer, mais parfois au détriment de ma santé.
L’enseignement m’a beaucoup apporté. J’ai eu l’impression d’être faite pour cela : être à l’écoute, transmettre. Ce furent de belles années, mais les trajets Paris-Reims m’ont fatiguée. Après 38 ans d’activité professionnelle, j’ai arrêté l’enseignement pour me consacrer entièrement à la recherche et à l’écriture.
Le Matin d’Algérie : Comment passe-t-on de professeur d’université au roman ?
Clotilde Brunetti-Pons : Enfant puis adolescente, je dévorais trois romans par jour. Grâce à cette passion, j’ai pu m’évader du quotidien, voyager dans de nombreux pays, fréquenter des milieux différents, croiser des personnages variés et souvent très différents de moi, ce qui était instructif. Écrire s’est imposé à mon esprit comme une continuité de la lecture. J’ai commencé à composer des poèmes à l’âge de 16 ans. Mes études de droit ont interrompu cette première période de création tout en m’apportant de la rigueur et sans nuire au goût d’écrire, loin de là.
Mes premiers articles juridiques ont vu le jour avant la fin de mon cursus universitaire, puis une thèse de doctorat, achevée à 28 ans, et des publications en droit des obligations. Parallèlement à mes études, j’étais chargée de mission à la protection judiciaire de la jeunesse, et d’abord au centre d’éducation surveillée de Vaucresson. Particulièrement sensible à la question de l’éducation des jeunes et de leur réinsertion familiale, une spécialisation en droit de la famille et de la protection de l’enfance s’est rapidement imposée.
Après 30 ans d’activité professionnelle sur ces thématiques, j’ai construit des récits autour de jeunes dont je souhaitais parler. Au départ, ces textes étaient exclusivement destinés à ma fille de 15 ans qui me réclamait la suite, chapitre après chapitre, puis à mes garçons. L’idée de les publier ne m’avait pas effleurée. Et puis un jour, la fille de bons amis, Élise, a lu l’un de mes manuscrits qui traînait sur une table. Elle l’a dévoré, me l’a rendu en larmes. Son émotion m’a convaincue qu’il fallait le publier. En 2015, je me suis lancée.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes présidente de l’Association de l’Ordre des Membres des Palmes académiques (AMOPA) section de Paris VII, cette formidable association contribue et participe au rayonnement de la culture à travers le monde, parlez-nous de cette association ?
Clotilde Brunetti-Pons : L’AMOPA est une belle association tournée vers les autres, spécialement la jeunesse. Elle publie une revue de qualité, soutient les élèves par des bourses, organise de nombreuses activités culturelles et aussi, notamment, des concours entre établissements (nouvelles, poèmes, expression écrite, histoire, géographie, …). Les lauréats sont mis en valeur et reçoivent de beaux prix.
L’AMOPA est divisée en 110 sections. Elle regroupe non seulement des personnes décorées dans l’Ordre des Palmes académiques, mais aussi des sympathisants. Quand la présidence de mon Université m’a décerné le grade de chevalier, en 2013, je ne connaissais pas encore cette association. C’est l’ancienne présidente de la section Paris VII, Denise Roudier, qui m’a envoyé une lettre m’invitant à soutenir l’AMOPA en adhérant, ce que j’ai fait. En 2018, la section m’a élue présidente et, depuis lors, nous (le bureau de l’AMOPA Paris 7) avons organisé de belles activités et des concours. Un magnifique recueil de nouvelles et poèmes rédigés par nos lauréats a vu le jour en 2021. Mettre en lumière la beauté de notre jeunesse est une grande joie.
Le Matin d’Algérie : L’AMOPA est comme un phare dans ce monde tourmenté, elle a un programme riche et varié, le prochain congrès international de l’AMOPA se déroulera à Tours du 31 mai au 2 juin 2024, mais le 4ème Salon du livre amopalien de Paris aura lieu le 13 mars 2024 à la Mairie du VIIème arrondissement, parlez-nous de ce salon du livre ?
Clotilde Brunetti-Pons : La première édition du salon du livre amopalien de Paris eut lieu en 2020. Cet événement est tout à fait original. Il s’agit de mettre en valeur les publications d’auteurs amopaliens (membres de l’AMOPA) et des réalisations de nos jeunes en rapprochant, par des activités communes, les chefs d’établissements du secteur, les familles, les professeurs, les membres de l’AMOPA et tous les amis du livre. L’entrée est libre.
La quatrième édition du salon du livre amopalien est planifiée le mercredi 13 mars 2024, à la mairie du 7ème arrondissement de Paris, de 14 heures à 19 heures.
De très beaux livres y seront présentés par leurs auteurs. Madame Michèle Dujany, Présidente de l’AMOPA, sera présente.
Au cours de l’après-midi, les visiteurs pourront assister à des conférences passionnantes sur des thèmes variés : La tuberculose d’hier à aujourd’hui, Julien Gracq, L’esprit français de Madame de la Fayette à Jean d’Ormesson.
Des élèves viendront présenter leurs travaux et projets.
Pendant le salon, seront déclamés des textes littéraires et des poèmes rédigés par les lauréats des concours de l’AMOPA 2019-2023.
S’ensuivra à 18 heures une cérémonie de remise des prix aux lauréats 2024 de la section Paris VII. Un cocktail viendra clore l’événement à partir de 19 heures.
Le Matin d’Algérie : « L’art sauvera le monde » disait Fiodor Dostoïevski, qu’en pensez-vous ?
Clotilde Brunetti-Pons : Dostoïevski est l’un de mes écrivains préférés. Cette citation souligne ce que l’auteur a cherché à révéler dans ses œuvres : une certaine transcendance est nécessaire pour éviter un comportement mauvais (le parricide dans Les frères Karamazov) ou le fait d’être possédé par des actes antérieurs criminels. Il faudrait donc que l’art s’inscrive au-delà du perceptible et des possibilités de l’intelligible. C’est d’ailleurs ce qui procure une émotion. En permettant à l’homme de percevoir qu’il n’est pas tout, l’art peut sauver le monde.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Clotilde Brunetti-Pons : Oui. J’aimerais organiser une exposition de sculpture d’un ancien membre de l’AMOPA décédé, à l’automne. S’agissant des projets en cours, je dirige actuellement une recherche de belle envergure, avec 25 spécialistes, sur L’efficacité de la protection de l’enfance en France et à l’échelle européenne. Les contributions seront publiées dans un ouvrage et nous exposerons nos conclusions lors d’un colloque le 17 janvier 2025. Ou encore, un recueil des productions de nos lauréats 2022-2024 est en préparation.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Clotilde Brunetti-Pons : Merci pour cet entretien. Le succès des concours de l’AMOPA et des cérémonies de remise des prix montre que la jeunesse d’aujourd’hui a besoin d’être encouragée, soutenue et inspirée. Il s’agit là d’une belle mission.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Romans publiés :
Les Sirènes de L’ombre, éditions Amalthée 2023
Les non-dits de l’éveil, éditions Amalthée 2020
La flûte de pan, éditions Amalthée 2018 (actuellement en phase de réédition 2024)
L’oiseau d’or, éditions Amalthée 2015
Le 27 janvier 2024
Le Matin d’Algérie
Lematindalgerie.com
___________________

Rencontre avec Khiredin Kati du groupe Amzik
Khiredin Kati est universitaire, musicien virtuose, chanteur. Sa technique du jeu du mandole est impressionnante. Il émerveille les yeux, il enchante l’oreille qui reste attentive pour saisir la fluidité du jeu et toutes les sonorités. Khiredin ne fait qu’un avec son mandole, une symbiose quasi magique qui fait le bonheur des passionnés et autres mélomanes.
Khiredin Kati dit Didine Kati faisait déjà parler de lui avant la création du groupe AMZIK. Didine Kati surprend par sa simplicité, toujours souriant, attachant, quand il prend son instrument les modes chaâbi défilent avec une facilité déconcertante, on a l’impression que ces préludes savants sont imprégnés dans ses doigts. Ces modes chaâbi s’exécutent avec une dextérité rare. Sa maîtrise du chaâbi et sa connaissance de la musque kabyle l’amènent vers d’autres influences musicales, comme le jazz.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes universitaire, musicien, chanteur, qui est Didine Kati ?
Didine Kati : Bonjour, et merci de m’accueillir. Je suis effectivement un universitaire diplômé en musicologie. En tant que musicien et chanteur, je m’efforce de fusionner les différentes facettes de ma vie pour créer une harmonie entre ma carrière académique et ma passion pour la musique. Je suis également arrangeur et la composition musicale me fascine et me porte dans mes projets.
Le Matin d’Algérie : On l’a compris, la musique est pour vous plus qu’une passion, elle fait partie de vous, on a l’impression qu’elle a toujours été là, qu’est-ce qui rend possible cette symbiose ?
Didine Kati : La musique a toujours été une partie intégrante de ma vie, symbole de l’éducation et de la transmission me permettant de m’exprimer d’une manière unique avec pour socle primordial la connexion profonde avec mon public. Ma pratique assidue et ma curiosité pour différentes influences musicales enrichissent continuellement mon expression artistique, voici le tableau de cette symbiose.
Le Matin d’Algérie : Quelles sont vos influences musicales ?
Didine Kati : Mes influences musicales sont diverses et riches. Bien sûr, mes racines sont kabyles et, avec la musique chaâbi, elles sont mes premières sources d’inspiration. Cependant, mon appétence à aller vers l’autre m’a conduit à explorer de multiples horizons musicaux, notamment le jazz, qui a profondément marqué mon style et mon histoire artistique. Cette diversité d’influences se reflète dans ma musique au sein de mes groupes AMZIK et AZAWAN.
Le Matin d’Algérie : Un proverbe africain dit, lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens. Le groupe AMZIK est un peu cette union entre les origines, le passé, le présent et le futur, il y a comme une intemporalité dans votre musique, parlez-nous de la genèse de « AMZIK » ?
Didine Kati : AMZIK est effectivement le fruit de cette exploration des racines et de la fusion des traditions avec la modernité : le lien continue entre les générations. Nous avons voulu créer une musique qui transcende le temps, en incorporant des éléments du passé tout en embrassant avec beaucoup de finesse et d’amour les défis du présent. La genèse d’AMZIK réside dans cette quête d’intemporalité, de voyage musical qui unit les générations et les cultures.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur Nonor et Karim Belkadi qui vous accompagnent
Didine Kati : Mes compagnons de route au sein d’AMZIK, Nonor et Karim, sont des artistes exceptionnels, chacun apportant sa propre touche unique à notre musique. Nonor par ses textes et sa poésie pointilleuse, Karim par la hauteur et la puissance de sa voix. Leur talent et leur dévouement sont essentiels à la création de notre son distinctif. C’est un honneur de partager cette aventure musicale avec des musiciens aussi talentueux et passionnés qu’eux.
Le Matin d’Algérie : Comment voyez-vous la chanson kabyle d’aujourd’hui ?
Didine Kati : Quelques jeunes artistes émergents font preuve d’une créativité remarquable ! C’est une période excitante pour la musique kabyle, qui est en pleine innovation.
Le Matin d’Algérie : L’Algérie peine à se démocratiser, la musique peut aider à cette émancipation, qu’en pensez-vous ?
Didine Kati : La musique a le pouvoir de transcender les barrières et de créer des ponts entre les individus. Elle peut jouer un rôle crucial dans l’émancipation, à l’image du jazz qui a été un facteur important de l’histoire sociale des États-Unis, non seulement comme art formel, mais pour avoir favorisé l’essor social des Afro-Américains.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
Didine Kati : Absolument, nous sommes actuellement en train de finaliser notre nouvel EP, un projet qui représente une étape importante pour AMZIK. D’ailleurs, l’un des nouveaux titres « Yennad w-ul » vient de sortir et son clip est maintenant disponible. Cette nouvelle production explore des territoires musicaux inédits tout en restant fidèle à notre identité. Nous sommes impatients de partager les autres créations de ce nouvel EP avec nos fans et de les emmener dans un voyage musical captivant.
Aussi, je suis ravi d’annoncer que nous avons également prévu une série de cartes blanches au Point Fort d’Aubervilliers. Ces événements seront l’occasion de célébrer la diversité musicale et de créer des rencontres artistiques atypiques. Nous sommes reconnaissants de pouvoir contribuer à la scène musicale locale et de créer des moments uniques de partage avec le public.
En résumé, entre la sortie imminente de notre EP, les concerts et les soirées carte blanche au Point Fort d’Aubervilliers, les prochains mois s’annoncent riches en découvertes et en émotions musicales. Nous avons hâte de partager ces moments avec notre public fidèle et de rencontrer de nouveaux amateurs de musique. Restez à l’écoute pour plus de détails et de surprises à venir !
Entretien réalisé par Brahim Saci
mardi 23 janvier 2024
Le Matin d’Algérie
Lematindalgerie.com
……………………………………………………………………………………………………
.JPG)
Crédit photo : Yves Nivot
Rencontre avec le compositeur et chef d’orchestre Christian Rivet
Christian Rivet, guitariste, luthiste, compositeur et chef d’orchestre, passionné de poésie, a étudié la guitare, la direction d’orchestre, la composition et la musique de chambre au Conservatoire régional de Metz puis au prestigieux Conservatoire supérieur de Paris auprès d’Alexandre Lagoya où il obtient les premiers prix de guitare et musique de chambre.
Sa rencontre avec d’éminentes personnalités du monde de la musique ont été déterminantes, le luthiste Hopkinson Smith, le guitariste Alvaro Pierri, les flûtistes Michel Debost et Aurèle Nicolet, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Peter Eötvös, Pascal Dusapin, parallèlement il enseigne la guitare et la musique de chambre.
Ces dernières années Chrisitian Rivet se consacre principalement à la composition.
Figurent à son catalogue, Quelque part dans l’inachevé pour flûte et orchestre (création Emmanuel Pahud, Orchestre des Pays de Savoie dir. Nicolas Chalvin), Étoile double pour violoncelle, contrebasse et ensemble (Ensemble inter-contemporain dir. Matthias Pintscher), Cinq secondes d’Arc (Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. Elena Schwartz), Courant d’étoiles pour le trio Wanderer, Au Dos du Ciel pour alto solo (Gérard Caussé), le concerto de piano Brisé d’arêtes et bord du vent (Célimène Daudet), Une Nuit de plein jour, pour le quatuor Hagen.
Il donne des récitals de luth Renaissance, de guitare électrique en Europe, des concerts. Christian Rivet a réuni les compositeurs Robert de Visée (guitare baroque) et André Jolivet (guitare moderne) sur un disque édité par Zig-Zag Territoires qui a été récompensé par la presse spécialisée (10 de Classica-Répertoire).
Son enregistrement « 24 Ways upon the Bells » (John Dowland, Benjamin Britten, John Playford et Les Beatles) édité par Naïve a été nommé meilleur enregistrement de l’année par le journal « Le Monde ». Il a enregistré également au côté de Sarah Aristidou, de Daniel Barenboïm et d’Emmanuel Pahud un CD paru chez Alpha Classics. Mais il n’a pas fait que ça !
Christian Rivet donne également des récitals de luth Renaissance, de guitare en Europe, des concerts aux États-Unis, au Japon avec des interprètes de renom, tels que le flûtiste Emmanuel Pahud (Ils ont enregistré « Around the World » chez Warner Classics, récompensé par la critique) et le quatuor Hagen. Sa musique est publiée chez Durand / Universal Classical Music.
La carrière musicale de Christian Rivet ne cesse de rayonner en France et à l’étranger, il a généreusement accepté de répondre à nos questions.
Le Matin d’Algérie : Votre parcours est impressionnant, qui est Christian Rivet ?
Christian Rivet : Une personne comme tout un chacun qui aime la vie, son épouse, ses filles… sa famille et ses amis… ses partenaires musicaux, ses élèves… Une personne à l’écoute du monde qui l’entoure…
Le Matin d’Algérie : Vous êtes passionné de poésie, quel rôle joue-t-elle dans vos créations musicales ?
Christian Rivet : La lecture d’un texte poétique est un vecteur qui me permet un voyage à l’intérieur de soi… Comme si je basculais dans une autre dimension…Cela aiguise ma perception du monde et me donne des pistes en ce qui concerne la texture instrumentale, les couleurs…comme une « invitation au voyage » …
Le Matin d’Algérie : En tant que luthiste, quel lien voyez-vous entre la musique baroque et la musique dite moderne ?
Christian Rivet : La recherche de l’inconnu : nous n’avons aucune trace audio sur ce qui a été, la manière d’interpréter, de concevoir, de réaliser (quelques indications mais… bien insuffisantes) …Idem en ce qui concerne ce qui sera …ce qui n’est pas encore couché sur le papier…
On se transforme en inspecteur qui a la charge d’une enquête… Il faut effectuer des choix et c’est palpitant…
Le Matin d’Algérie : Les conservatoires parisiens s’ouvrent sur la musique du monde et les musiques actuelles, qu’en pensez-vous ?
Christian Rivet : Cela aurait dû être ainsi depuis la création de ces écoles… Les musiques du monde sont très proches de ce qui fait notre quotidien, notre vie… Elles sont implantées dans notre chair
Le Matin d’Algérie : Vous êtes maintenant mondialement connu, quel regard portez-vous sur le monde de la musique classique d’aujourd’hui ?
Christian Rivet : Il faut continuer à défendre les véritables valeurs musicales : défendre le texte avant tout… et faire très attention au monde de l’image qui dénature et fausse l’écoute…
Le Matin d’Algérie : Quel conseil donneriez-vous à un jeune compositeur fraîchement diplômé qui souhaite percer dans la musique classique en France ?
Christian Rivet : Travailler sans concession, sans relâche… ne pas chercher à « réussir » mais dessiner ce qui vit à l’intérieur de soi sans oublier de rencontrer les personnages extraordinaires, les lieux fantastiques qui nous entourent…
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?
L’écriture d’un opéra…
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être…
Christian Rivet : Justement… les premiers mots, écrire parallèlement avec les mots… Musique et littérature ainsi associées de manière indissoluble.
Entretien réalisé par Brahim Saci
dimanche 21 janvier 2024
Le Matin d’Algérie
Lematindalgerie.com
_________________________________________________

Koceila Kezzar, un talent qui illumine
Koceila Kezzar, artiste jusqu’au bout des doigts. Koceila Kezzar est chanteur, musicien, universitaire, il fait partie de cette génération montante qui tend à s’imposer par le talent, et le savoir musical sur une scène artistique habituée à être constamment occupée par les soixantenaires et septuagénaires, cette jeune génération dont fait partie le talentueux Koceila Kezzar arrive comme une bouffée d’oxygène de tous les espoirs.
Koceila Kezzar a étudié la technique vocale, la musique, le solfège, en commençant par le piano, puis la guitare. Son jeu de la guitare s’affine et ne cesse d’évoluer, de s’améliorer pour donner des sonorités d’une grande pureté, les notes semblent s’exécuter comme par magie tant la passion est grande.
Koceila Kezzar est d’une famille d’artistes, son père est le chanteur auteur compositeur Mohand Ouali Kezzar, un artiste discret qui a marqué la chanson kabyle par ses compositions de qualité, il est hélas parti trop tôt, que sa belle âme repose en paix. Mohand Ouali Kezzar a transmis la passion des arts, l’amour de la musique à son fils. Ameziane Kezzar l’oncle de Koceila est aussi écrivain, poète, qui a écrit pour Idir paix à son âme et Cheikh Sidi Bémol. On peut dire que l’art rayonne dans cette famille. La chanson kabyle a de beaux jours devant elle.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes chanteur, musicien, universitaire qui est Koceila Kezzar ?
Koceila Kezzar : Exact, j’interprète des chansons laissées par mon défunt père mais je compose aussi de temps à autre. Je me suis beaucoup perfectionné dans la pratique de la guitare et le chant.
Le Matin d’Algérie : Votre père Mohand Ouali Kezzar vous a transmis cette passion pour la musique, pour devenir une vocation, pouvez-vous nous en parler ?
La transmission était sans doute naturelle. Je m’intéressais beaucoup à ce qu’il faisait. Je lui ai demandé de m’apprendre ses chansons et des choses un peu plus avancées par la suite. J’ai trouvé dans cet apprentissage non seulement le plaisir de partager des moments avec mon père, mais aussi la joie que pouvait me procurer une passion.
Le Matin d’Algérie : Vous faites partie d’une nouvelle génération de chanteurs kabyles qui fait plaisir à voir, c’est comme une éclaircie dans un temps couvert, qu’en pensez-vous ?Je crois que le manque de création et d’originalité chez nous les jeunes a causé ce temps couvert. Le public veut toujours du nouveau, ce qui est logique. On se lasse très facilement de l’habitude, donc on attend toujours de la part de l’artiste quelque chose qui est propre à lui. Faire partie de ceux qui éclaircissent ce temps est un honneur pour moi.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur votre père, Mohand Ouali Kezzar, auteur compositeur interprète virtuose, qui a laissé une œuvre musicale.
L’art, le savoir, la culture et la musique, cette dernière a été un très bon compagnon pour mon père depuis son jeune âge. Il l’a beaucoup étudiée même. Il était toujours prêt pour apprendre quelque chose de nouveau. Il ne faisait jamais les choses au hasard et a toujours voulu exposer la beauté de l’art. Il était travailleur et n’a jamais choisi la facilité (un perfectionniste peut être). Il m’a laissé beaucoup de cadeaux immatériels : l’éducation, la musique, l’art, la culture, la manière de penser correctement, ce qui est juste et ce qui est faux. Il a toujours été là pour moi et a fait le maximum pour faire de moi la meilleure version que je puisse être. Il m’a appris ce qu’était la joie de vivre et la nécessité de la protéger. On était inséparables, on riait beaucoup ensemble, on chantait, on apprenait beaucoup de choses (des documentaires, des films …). Chaque jour, j’écoute ses chansons avec un pur plaisir. Je pense aussi à son sérieux. Tout était agréable avec lui, même les choses que je n’aimais pas faire auparavant étaient des moments de joie et d’éclats de rire avec lui. Tout le bien que mon père m’a apporté et tous les sacrifices qu’il a fait pour nous m’ont marqué à vie. Que le bon Dieu lui accorde toute sa miséricorde.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?J’ai un single en préparation, il sortira cette année, prochainement je l’espère. Pour la suite, je continue à créer, à composer
.Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être…J’espère être à la hauteur des attentes des gens, apporter de la joie, positivité et consolation à travers l’art. Merci beaucoup à vous de m’avoir donné cette occasion pour m’exprimer.
Entretien réalisé par Brahim Saci
lundi 8 janvier 2024
Le Matin d’Algérie
Lematindalgerie.com
___________________________________________________________

Moussa Lebkiri ou la magie des mots
Moussa Lebkiri, l’enfant des Aït Chebana, cette belle Kabylie profonde, est un comédien, humoriste, conteur, écrivain, metteur en scène. Un artiste accompli. Pour Moussa Lebkiri l’art est une éthique. Une manière de vivre. Il a d’ailleurs fait de l’art sa raison d’être, il n’a pas cessé durant de longues années de sillonner les routes en véritable saltimbanque en participant à des festivals en France et à l’étranger sans jamais se fatiguer, toujours en s’émerveillant et en émerveillant, en ayant à l’esprit la transmission, avec toujours cette volonté de vouloir former et lancer la nouvelle génération.
Moussa Lebkiri crée en 2011 le Café Bavard au café de Paris, une scène ouverte à la découverte de nouveaux talents, le succès est grandissant depuis.
Le Matin d’Algérie : Vous avez fêté le dimanche 5 novembre vos 40 ans de carrière au café littéraire parisien de l’Impondérable, invité de l’écrivain Youcef Zirem où vous avez émerveillé le public, pouvez-vous nous parler de cette belle rencontre ?
Moussa Lebkiri : Officiellement j’ai fêté mes 40 ans de carrière en 2016. J’ai un public qui me suit fidèlement dans mes spectacles, tout comme à mes Café Bavard et dernièrement au Café Littéraire de l’Impondérable. Dans ce genre de lieu populaire, ou souvent le bruit des verres trinquent avec le public, c’est une gageure que de s’y produire, il faut avoir assez de métier pour capter l’attention de l’auditoire. Pour ma part le challenge a été relevé. Je viens de cette école de l’inconfort où il faut savoir recréer à chaque fois la magie du verbe. Je me complais à dire que ma formation théâtrale, je la dois à la plus grande école, celle de la rue dont le public jusqu’à aujourd’hui reste mon réfèrent professeur.
Le Matin d’Algérie : Vous paraissez infatigable, qu’est-ce qui vous insuffle cette force ?
Moussa Lebkiri : Infatigable ? oui mon carburant, je le puise dans l’ART et tant que je peux faire le plein, je roule. Mon engouement pour l’art est comparable au jardinier qui cultive son jardin, au cuisinier qui mijote ses plats… tout ce qui est création transcende une banalité en une chose sublimée. Le théâtre pour moi est générateur d’énergie, c’est mon jogging. Faire rire et émouvoir le public est ma récompense, ravi de le surprendre au détour d’un mot d’une grimace dans mon jeu…
Le Matin d’Algérie : Quels sont les humoristes et conteurs qui vous parlent ?
Moussa Lebkiri : en premier, Moi ! Chaque matin je me parle et je tente de me faire rire, je n’y arrive pas tout le temps. L’humoriste qui par excellence me parle est Devos, maître des mots et de l’absurde, ses mots rugissent comme dans un cirque, ils les domptent à sa guise. Il y a Desproges à l’humour acide, corrosif, décapant, le verbe cinglant mais aussi une plume qui sait prendre quelques envolées joliment poétiques. Et puis, il y a l’ami Fellag, un authentique clown qui sort tout droit de la commedia dell’arte. Par le rire, il a su panser les blessures d’un peuple algérien qui a beaucoup souffert et hélas qui souffre encore. Il nous est arrivé de partager la même scène avec un bonheur que je crois réciproque.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur la danseuse Saliha Bachiri qui vous accompagne depuis de longues années.
Moussa Lebkiri : Un mot, il en faudrait bien plus pour parler de l’artiste Saliha Bachiri. Ça été pour moi une vraie rencontre lors de son spectacle « L’une devenant la mémoire de l’autre », un spectacle de danse kabylo-contemporain où la danse kabyle et la danse contemporaine se cherchent pour se confondre, se défaire et s’intégrer l’une à l’autre. J’ai été séduit par l’artiste. Saliha, on peut le dire, a mis la barre haute pour donner au public quelque chose de nouveau sortant des sentiers battus et débattus. Par ailleurs, elle danse également la vraie danse kabyle dite « authentique » sans tomber dans un folklorisme qui l’appauvrit, la limitant aujourd’hui à un seul mouvement récurent, un « bug » sur la vibration des hanches. Le clip de la chanteuse Lycia où Saliha danse en témoigne, elle a également chorégraphié et dansé pour Rachid Taha, le chanteur Zedek, le groupe Djurdjura… et bien sûr dans certains de mes spectacles, sans compter ses nombreuses créations, ses cours où de nombreuses danseuses se sont formées chez elle. Ses pièces chorégraphiques sont de petits bijoux parlant à notre âme, à notre culture berbère sans aucun complexe.
Le Matin d’Algérie : Votre double culture française algérienne a-t-elle été un atout ou un handicap dans votre carrière en France ?
Moussa Lebkiri : Un réel atout, il m’a fallu ce cocktail délicieux, cette potion culturelle magique qui m’a permis de puiser à ces deux sources en tant que kabyle ancré dans cette douce France. Je me complais d’ailleurs à dire en raccourci, je trempe ma plume dans ma Kabylie pour écrire mon ici. Jouer sur les deux tableaux, c’est merveilleux d’avoir « un ici » et un « là-bas » pour faire jongler son art. Bien que tout n’est pas été rose pour moi, les débuts étaient très difficiles professionnellement. Il faut se faire un nom au-delà de son propre nom, car celui d’origine n’est pas harmonieux à certaines oreilles du pays d’accueil. Qu’on se rappelle la prime au retour dans les années 70, et qui a inspiré le réalisateur Mahmoud Zemouri avec son film « prend 10 000 balles et casse-toi » où j’ai joué le rôle de Djelloul.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes toujours dans la transmission, vous essayez toujours de lancer la relève, pensez-vous avoir atteint votre objectif ?
Moussa Lebkiri : J’essaie de transmettre ce que l’on m’a transmis, donner ce que l’on m’a donné, un juste retour. La passation est essentielle quand on hérite de l’expérience des anciens, ce fut le cas notamment pour le métier d’« amachaou », celui de conteur. L’artiste laisse une trace de son passage, dans une mémoire qui à son tour nourrira les générations à venir qui n’auront plus qu’à se servir pour y trouver leurs inspirations. La formation est un rouage de transmission, j’ai aimé former et j’aime encore donner des cours de théâtre et de contes pour réveiller l’artiste qui sommeille dans tout un chacun. Je serais plutôt un éveilleur qu’un donneur de leçon.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur le Café Bavard
Moussa Lebkiri : Lors de mes tournées, j’ai toujours aimé faire découvrir un artiste avant mes spectacles, le Café Bavard n’en ait qu’une continuité. C’est une scène découverte d’artistes professionnels et amateurs de tous bords (Chanson, théâtre, opéra, conte, humour, danse…). Le Café Bavard existe depuis 2011 et fait parti des bonnes sorties parisiennes sélectionnées par Télérama. Il a séduit quelques médias tel que M6 qui pourrait un jour titrer : « Le Café Bavard a d’incroyables talents ». Ce que le public aime chez moi, c’est mon côté « monsieur presque loyale », ma transparence à dire ce que je pense des artistes mais toujours avec élégance, humour sans froisser quiconque.
Le Matin d’Algérie : L’humour, la comédie, le théâtre dissipent le gris, nous rapprochent, nous rappellent notre humanité, et facilite le vivre ensemble, qu’en pensez-vous ?
Lebkiri Moussa : Un artiste est un être subversif, il est un éveilleur, il interpelle sans cesse, il est le chahuteur de nos pensées souvent arrêtées et obtuses. Il donne du beau, du ciel bleu à ceux qui ouvrent leurs yeux et leurs cœurs.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot, avez-vous des projets en cours ?
Lebkiri Moussa : La vie est mon projet avec de belles rencontres et j’espère que le public aura toujours comme projet celui de m’applaudir encore et encore. La poésie me porte et me donne le souffle de déclamer toutes les lumières des possibles.
Entretien réalisé par Brahim Saci
vendredi 5 janvier 2024
Le Matin d’Algérie
Lematindalgerie.com
_______________________________________________
.jpg)
Rencontre avec l’écrivain chanteur Akli Drouaz
Akli Drouaz fait partie de ces universitaires rares, dont le parcours fascine, écrivain auteur compositeur chanteur, une vie riche d’errances multiples. De la Kabylie à la France, à l’Allemagne, c’est un voyageur attentif, qui s’enrichit aux contact d’autres cultures sans jamais se perdre. Akli Drouaz est un intellectuel authentique, un poète vrai. On ne se lasse pas de l’écouter chanter ou tout simplement parler, on a l’impression d’être au village, il a cette humilité des villageois kabyles. Sa vie, en France ou en Allemagne, ne l’a pas éloigné de la source du village, s’il est parti c’est pour revenir.
Le Matin d’Algérie : Vous avez un parcours impressionnant, universitaire, écrivain, auteur compositeur interprète, qui est Akli Drouaz ?
Je crois savoir qui je suis, le fils de mon enfance (Ibn Khaldoun). Je suis pétri de l’histoire de mon pays, celle récente et l’autre plus profonde et complexe. Tu me pousses à user du « Je » et bien je le ferai. Ce n’est guère de m’étaler encore moins de m’épancher, mais ta sollicitude me touche et répondre à des questions d’un journal tel que Le Matin d’Algérie, m’y oblige. En réalité, je suis le fruit pourri de cette histoire algérienne aux confluents d’évènements, si dures, si violents. Dans ma jeunesse, je me définissais comme Amazigh et impliquant une forme de résistance nécessaire et douloureuse, plus tard, je me suis reconnu dans quelque chose d’immuable, je me suis souvent déclaré « Algérien à plein temps », quand on me posait des questions personnelles de type : que faites-vous dans la vie ? … je rétorquais : « Je suis Algérien à plein temps et cela n’est pas un métier de tout repos ».Mais choisissons-nous vraiment qui nous sommes ? Je n’en sais trop rien. Je suis né et j’ai grandi dans une contrée aux multiples souffrances, la Kabylie plus précisément dans la région de Ouaguenoun que j’ai quittée depuis mes huit ans pour n’y revenir que plus tard, quasiment un demi-siècle après. Les guerres successives ont marqué notre mémoire collective, notamment avec l’empire ottoman et plus tard avec le colonialisme français. La traversée de ma région Ouaguenoun et mon village limitrophe d’Avizar était un vrai coupe-gorge pour les troupes ottomanes, il faut dire que nous avions aussi connu des massacres et des pertes terribles, je suis donc tout cela ; à la fois attaché aux racines de mon pays, mais aussi une espèce de sujet hybride traversé par les influences des terres traversées. Très jeune, j’ai vécu en Grande Bretagne, en Allemagne incluant Berlin durant la guerre froide et ensuite en France, j’ai eu la chance d’assister à la chute du mur de Berlin… tu vois que ta question n’est pas simple. Pour le reste, j’avoue devoir contrarier une partie de ton portrait, je ne suis pas universitaire (Bien que j’en ai chauffé des bancs), je réfute le terme d’intellectuel, c’est une charge trop lourde. Venant de toi, je l’accepte ou plus tôt je le prends comme une gratitude, mais encore une fois c’est une charge bien trop lourde pour moi. J’ai un profond respect pour les personnes qui cherchent et qui trouvent ou qui continuent à chercher, mais je m’éloigne de la cacophonie kabyle ambiante ou les cracheurs de feu tiennent les podiums et le crachoir. Je respecte et admire ceux qui produisent, travaillent créent, je laisse ma part de colère se poser loin de l’invective. Certains parlent pour ne rien dire et cela ne m’inspire guère.
Le Matin d’Algérie : Comment passe-t-on de la musique, du chant, au roman ?
Je suis tenté de dire chaque chose en son temps ; dans les années 1970 et 1980 la musique était un moyen d’expression à la portée de toute une jeunesse en quête de liberté. La quête identitaire et l’expression de sentiments et d’opinions notamment politiques, ont servi de viatique pour la chanson, la musique n’étant que le récipient, le contenant. Les évènements de 1980 ayant libéré la parole, je crus pour ma part que la chanson ne suffisait plus, par ailleurs et je l’admets, bien que doté de quelques qualités, je n’avais ni la force ni le talent nécessaire, j’étais souvent en colère, ce qui m’éloignait des autres. J’ai produit des groupes dont je tairais les noms mais ils se reconnaitront. Je crois que le milieu à l’époque en tout cas manquait de sérieux et de professionnalisme, les producteurs vendaient des K7 comme ils vendraient des tomates en été…Le passage de l’un à l’autre bien que difficile était évident, dans la chanson, j’ai pensé plus sérieusement que quand on n’a plus rien à dire, il n’était pas nécessaire de le faire savoir. Mais si ça te dit on fait un cd (sourire).
Le Matin d’Algérie : Vous avez beaucoup de talents comme beaucoup d’artistes de votre génération, qu’est-ce qui vous a empêché de faire une plus grande carrière ?
Notre culture étant absente des vrais podiums et réduite à une simple et vulgaire marchandise, je n’ai pas souhaité participer à cette gabegie. Le Matin d’Algérie : Quel regard portez-vous sur la chanson kabyle d’aujourd’hui ? La chanson kabyle connait un véritable essor. Hommes et femmes des jeunes avec des talents extraordinaires apportent un nouveau souffle, ils n’ont pas l’écoute et l’espace nécessaires à leur expression, mais je trouve que cette jeune génération est formidable.
Le Matin d’Algérie : Vous avez réussi l’exploit de revenir vivre au village, comment voyez-vous l’avenir de la littérature algérienne dans un pays qui peine à se démocratiser ?
J’ose croire que la littérature résistera à la déliquescence généralisée. De tous temps ce type d’expression salvateur a survécu à toutes les crevasses de l’histoire du pays ; l’Allemagne en particuliers a connu un essor incroyable à la fin de la guerre ; les œuvres de Böll, Grass et bien d’autres ont fleuri sur les cendres de la terreur, chez nous Feraoun, Yacine, Mammeri, Dib et plus tard Djaout et Mimouni ont donné dans la douleur et les affres de conflits terribles et chacun en son temps a donné le meilleur de la littérature de chez nous ; ne dit-on pas que la culture est tout ce qui reste après que tout soit détruit ?Oui, je crois que des générations contreront les funestes desseins d’un système en voie de décomposition.Quant à ma petite personne, je crois que chaque être humain devrait avoir le droit de vivre là où il le désire, notre terre de naissance serait bien entendu l’endroit idéal. Tout n’est pas tout rose, loin s’en faut, mais j’aime mon pays et je suis heureux d’y vivre, bien que l’état dans lequel se trouvent, mon village et mon pays, soit tristement déplorable, dagi ara yemmet kaci, hna imout kaci.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Le 29 décembre 2023
Livres publiés :
Cacahuète, Apopsix éditions
Rêves d’exil, Apopsix éditions
Errances, identités flouées, Achab éditions
Le Matin d’Algérie
Lematindalgerie.com
………………………………………………………………………………….

Rencontre avec l’écrivain et danseur, Abdelkader Habilès
De la danse classique à l’écriture, Abdelkader Habilès a publié un roman en deux parties « L’envoyé de Bonaparte », une saga qui jongle entre l’histoire et la fiction et un livre de contes « Le chevalier du Hodna et Anzar le Dieu de la pluie ».
Dans son roman la fiction se mêle à la passion dans une volonté de saisir des pans de l’histoire commune de l’Algérie et la France.
C’est une écriture limpide, qui fascine, qui nous emporte vers l’Afrique du Nord, l’Algérie, qui étanche la soif identitaire de l’auteur, Abdelkader Habilès vogue vers ses origines algériennes berbères, pour un rapprochement entre les deux rives.
Le Matin d’Algérie : Avant de parler de vos publications, qui est, Abdelkader Habilès ?
Abdelkader Habilès : Il est difficile de me définir, car je suis boulimique. Je pense être moderne, amical, sensible à la beauté, mais aussi dur avec moi-même. Avec ce travail littéraire, il est finalement ressorti que le fil rouge de ma vie était le romantisme. J’ai en moi un amour absolu pour le ballet romantique et mes parents m’ont donné le nom d’une grande figure de l’indépendantisme algérien, mais aussi du romantisme, l’émir Abd-el-Kader. Le général Duvivier qui a combattu Abd-el-Kader disait de lui qu’il aurait pu être un héros d’un ouvrage de Lord Byron. Je suis un romantique moderne, un vêtement me résume le burnous, il est l’habit de prestige des amazighs et la cape du danseur classique.
Le Matin d’Algérie : On sent votre fascination pour les orientalistes et l’Émir Abdelkader, qui est un personnage assez controversé, dont Napoléon III voulait faire le roi des arabes, occultant la dimension berbère, qu’en pensez-vous ?
Abdelkader Habilès : Effectivement, je suis passionné par l’orientalisme qui pour moi précède le romantisme français. Cette école de peinture suit le principe de la vérité idéalisée, mon travail littéraire suit aussi ce chemin. J’aime le beau et j’emploie toute mon énergie pour écrire de belles histoires. Le choix des modèles, des chevaux et des paysages par les maîtres pour leurs tableaux sont pour moi des sources d’inspiration pour mes histoires.
Je vais commencer par la question arabe. Le monde berbère comprend de nombreux peuples ayant une culture commune (arts, systèmes sociaux, artisanats), de plus, ces peuples vivent sur des territoires différents : sec ou arrosé ; plaine ou montagne.
Ces peuples vivent dans le tamazgha depuis le néolithique, la période glaciaire a donné à certains une pigmentation plus claire, d’autres sont restés basanés.
Le mode de vie des Berbères du Sud du Tell a évolué avec la désertification progressive de l’Afrique du Nord, ces gens qui sont souvent d’origine Zénète pratique la longue transhumance. Ils ont adopté un mode de vie qui ressemble à ceux des Bédouins.
Les Phéniciens ont inventé l’alphabet, ils l’ont transmis à tous les peuples. Pour l’Afrique du Nord, ils ont apporté en plus le commerce à grande échelle et une langue franche pour parler à tous les Berbères : le Punique. Avec cet apport, l’Afrique du Nord est devenue la plus grande puissance commerciale et militaire du monde, avec comme capitale Carthage et les royaumes alliés. De ce glorieux passé, est restée une langue sémitique, le maghrébi.
Lorsque les premiers missionnaires musulmans sont arrivés dans le tamazgha, ils ont considéré certains autochtones comme leur semblable, car ils leur ressemblaient et parlaient une langue proche de l’arabe. Ils voulaient surtout englober dans le monde musulman de nouveaux peuples.
L’émir Abdelkader était très érudit, il se considérait comme arabe, mais pour un monde spirituel. Avant de parler du royaume arabe, afin de connaître l’état d’esprit de l’émir, il faut rappeler qu’il avait mis en place un système politique en Algérie. Son état était basé sur l’alliance des Khalifats, ou duchés, qui compose l’Algérie. Chaque duché conservait son particularisme avec leur organisation propre. Son état avait été mis en place en 1836, mais ne comprenait pas toute l’Algérie. Lors de la Paix de Tafna, il avait proposé de le mettre en place sur tout le territoire de l’ancienne régence. Il aurait été constitué de huit Khalifats, un des huit aurait été celui de la Medjana qui correspond à l’ancienne petite Kabylie et au Hodna.
Quand napoléon III, lui a proposé de devenir roi. Il n’a pas accepté, car il avait décidé de ne se consacrer qu’à étudier, voyager et enseigner.
Ce royaume arabe n’existait pas, c’était le projet utopique de Napoléon III pour le Proche-Orient qui voyait s’effondrer l’empire turc. L’émir s’est installé à Damas et en tant qu’ami de la France et de l’Angleterre, sur place, il a contribué à l’émergence d’un projet politique réel avec la création des états modernes du Proche-Orient : la Syrie, le Liban, l’Irak et l’Egypte dans une autre mesure.
Pour moi, les mots berbères et arabes ne s’opposent pas. Il y a la civilisation amazighe et cette culture apparaît aussi dans l’univers arabe. Les Amazighs ont une longue et riche histoire, si cela nous emmène vers le haut et le beau, ils peuvent en prêter des morceaux.
Le Matin d’Algérie : De la danse à l’écriture, un parcours original, surprenant d’autant plus qu’il n’est pas courant qu’un garçon de surcroît issu de l’immigration fasse de la danse classique, pouvez-vous nous en parler ?
Abdelkader Habilès : Effectivement, j’ai un parcours singulier. Mais je ne suis pas unique, il y a des grands danseurs d’origine algérienne, par exemple l’ancienne star de l’Opéra de Paris, Kader Belarbi.
Maintenant, il faut voir les gens issus de l’immigration algérienne comme des Français à part entière. Par exemple, certains Français d’origine algérienne aiment tout autant Aznavour qu’un autre Français, même d’origine arménienne. Pour un Parisien comme moi, la danse classique tient une place essentielle. Il faut rappeler à vos lecteurs que la danse classique a été inventé par le roi soleil. Et la danse peut rapidement devenir une évidence, à 17 ans, lorsque vous assistez à une représentation de Roméo et Juliette avec comme interprète Patrick Dupont et Monique Loudières. L’intensité de la frénésie du public de l’opéra lors de la représentation était immense.
Quant à l’écriture, j’ai pris ma plume pour rendre hommage à tous ces Nord-Africains venus travailler en France, ils sont captivants, je les aime. Ils sont une source d’inspiration, car ils ont du cœur, leurs regards brillent de mille feux. Ils peuvent être, beaux ou laids, généreux ou avares, fidèles ou fourbes, sensés ou crédules, érudits ou ignorants. Il y a peu de livres, même des fictions qui parlent d’eux.
Le Matin d’Algérie : L’envoyé de Bonaparte, votre roman en deux parties, parlez-nous de la genèse de ce roman ?
Abdelkader Habilès : Tout a commencé par mon désir de connaître l’histoire de la région de mes parents et plus largement de l’Afrique du Nord. Il faut rappeler à vos lecteurs que je suis moi-même un passionné d’histoire notamment le 19e siècle et la révolution française. Les gens qui m’entouraient ne connaissaient pas l’histoire de l’Algérie comme nous. Français nous connaissons l’histoire de France. Ma curiosité m’a poussé à acheter des livres, il y en a de nombreux sur l’histoire de l’Afrique du Nord. Ensuite, lors de repas de famille, j’ai partagé les informations que j’avais découvertes avec mes parents mes frères, mes sœurs, mes cousins.
Ils étaient vivement intéressés et souhaitaient en savoir plus, ils me demandaient d’écrire tout ça, car cela avait beaucoup d’importance. Alors, je me suis posé la question d’écrire quelque chose, n’étant pas historien, mais par contre ayant des capacités pour inventer des histoires, j’ai décidé d’écrire un roman d’aventures historique. Passionné par les histoires fantastiques, les romans d’aventures, les films de cape et d’épée, j’ai eu l’idée de transposer le thème du roman d’aventures historique sur l’histoire des Nord-Africains. Je souhaitais quelque chose d’assez global donc ce roman passe par différentes époques qui sont les périodes clé de l’histoire des Nord-Africains.
Écrire un premier livre est une démarche solitaire, car avant de pouvoir déclarer qu’on a écrit quelque chose, il faut que le projet soit pratiquement abouti. Et après dix ans de travail, j’ai pu publier ce roman en deux parties.
Le Matin d’Algérie : L’envoyé de Bonaparte, pourquoi ce titre ?
Abdelkader Habilès : Pour deux raisons, Bonaparte est pour moi la personne qui a le plus marqué l’histoire mondiale, car il a apporté les idéaux de la révolution française aux peuples d’Europe et du monde. Grâce à lui, la méritocratie a été adoptée par la majorité des pays modernes.
Plus personnellement, il a soulevé le voile qui couvrait la civilisation égyptienne et aussi, mais cela est moins connu, sur celle d’Al Andalous. Il a révélé au monde occidental le génie de la culture Nord-africaine.
L’envoyé est le nom d’un des personnages principaux de mon roman dans la tradition orale nord-africaine, l’envoyé est le Moqadem qui porte le message du cheikh, détenteur de l’esprit, dans ce cas de l’esprit de la révolution française.
Le Matin d’Algérie : Le chevalier du Hodna et Anzar le Dieu de la pluie, votre livre de contes est captivant, vous en avez fait un beau conte chorégraphique où vous dansez, la conteuse Chahrazade vous accompagne sur scène, parlez-nous de cette rencontre avec Chahrazade ?
Abdelkader Habilès : Charazade est une artiste accomplie, puisqu’en plus d’être comédienne, elle est aussi chanteuse dans différents répertoires notamment le jazz. Nous nous connaissons depuis très longtemps puisque c’est ma cousine. J’ai toujours voulu faire un projet artistique avec elle, l’occasion s’est présenté avec le conte chorégraphique le chevalier du Honda. Elle a développé plusieurs projets et n’est pas toujours disponible. Ce spectacle est aussi interprété par une autre comédienne Janine.
Janine est une comédienne très talentueuse que j’ai eu la chance de voir sur scène. Je lui ai proposé le rôle qu’elle a immédiatement accepté, elle a créé un personnage sur scène qui lui appartient. Elle joue le rôle d’une conteuse ambulante berbère qui va de village en village raconter des histoires, dans ce livre, elle raconte l’histoire du chevalier du Hodna.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en perspective ?
Abdelkader Habilès : Je continue à développer le spectacle, Le chevalier du Hodna et j’ai de nombreux contacts qui devraient aboutir normalement à des représentations à Aix-en-Provence, Marseille, Rennes et Paris. Je vais participer à des salons littéraires, ou j’ai l’énorme plaisir de parler de mes livres avec le public. Je serai les samedi 10 et dimanche 11 février à la mairie du 5e arrondissement, pour le Forum du livre franco-berbère de Paris.
Entretien réalisé par Brahim Saci
youtu.be/jGCd50bwipI?si=buFbw3Uxqv9Wwr-x
Mercredi 20 décembre 2023Le Matin d’Algérie
Lematindalgerie.com
…………………………………………………………………………………………
.jpg)
Rencontre avec Blaise Rosnay du Club des Poètes
Le Club des poètes est cette taverne quasi mythique située au 30, rue de Bourgogne dans le septième arrondissement de Paris, où l’on peut dîner tout en célébrant la poésie.
Lieu de rencontre des poètes et amis de la Muse, où chacun peut déclamer des vers ou simplement écouter autour d’un verre, c’est un havre de paix, d’échange, de spectacle, dédié à la poésie.
Des poèmes de toutes les époques, de tous les pays, connus ou pas connus sont déclamés chaque soir par des jeunes et moins jeunes, devant un public émerveillé.
Cette belle histoire commence en 1961, quand le poète Jean-Pierre Rosnay, ancien résistant, épris de liberté, le père de Blaise Rosnay l’actuel propriétaire, décide d’ouvrir ce restaurant avec sa femme Marcelle, la sœur de Georges Moustaki, Mahmoud Darwich, Raymond Queneau, Louis Aragon, Pablo Neruda, et d’autres, sont passés par là.
En 1978, il organise avec Léopold Sédar Senghor, le premier Festival international de poésie de Paris, qui accueille des poètes du monde entier.
Des JAR au Club des Poètes, Jean-Pierre Rosnay fonde après la guerre le mouvement poétique les JAR (Jeunes Auteurs Réunis) auquel se joignent, son beau-frère Georges Moustaki, Guy Bedos et Georges Brassens.
Le poème, Liberté Égalité Fraternité de Victor Hugo, fit scandale en pleine guerre d’Algérie, il fut censuré, les interviews de Louis Aragon et Pablo Neruda disparaissent aussi, son émission fut interdite.
Jean-Pierre Rosnay anime des émissions de poésie à la radio et la télévision jusqu’en 1983, et tient la rubrique poésie de l’hebdomadaire, Les nouvelles littéraires, journal littéraire créé en 1922. Jean-Pierre Rosnay fut un esprit libre jusqu’à sa disparition en 2009. Son fils Blaise reprend le Club des Poètes.
Le Matin d’Algérie : À la mort de votre père, le poète Jean-Pierre Rosnay, vous reprenez le Club des Poètes, qui est Blaise Rosnay ?
Blaise Rosnay : Alors, en fait, je participe à la vie du Club des Poètes depuis ma prime enfance. J’ai couru entre les chaises de ce lieu quand j’avais 5 ou 6 ans. J’ai appris les lettres et les mots en écoutant les poèmes de tous les temps et de tous les pays. Je dis des poèmes depuis que j’ai 7 ou 8 ans. J’ai accompagné l’action poétique de mes parents tout au long de ma vie, même si j’ai fait aussi des études d’ingénieur. Mais l’univers poétique est si vivant, si libre, si attachant, qu’il m’était impossible de m’en séparer pour me consacrer à une carrière d’ingénieur, alors je suis vite revenu « au bercail » et je me suis occupé de différents aspects du Club auprès de mes parents, comme par exemple, l’édition de notre revue, l’organisation de spectacles, etc.
Le Matin d’Algérie : Le Club des Poètes est un lieu qui célèbre la poésie au quotidien, qui fascine jeunes et moins jeunes, quel est le secret de cette réussite et longévité ?
Blaise Rosnay : Le secret, c’est que la poésie touche les cœurs tout simplement, qu’elle nous élève et nous rassemble dans notre aspiration commune pour la bonté, commune à tous les êtres humains. La politique sépare, la religion sépare, la compétition professionnelle sépare. La poésie rassemble et réunit les personnes humaines de tous les horizons qui, l’espace de l’écoute d’un poème, de sa lecture ou de son écriture, n’ont plus de doute. Nous faisons tous partie de la même famille humaine,
une famille qui ne peut se nourrir que de pain, mais a besoin de beauté, d’intelligence, de sensibilité, d’émotions simples et vraies, et c’est cela qu’offre la poésie.
Le Matin d’Algérie : Votre père est le poète libre par excellence, qu’en pensez-vous ?
Blaise Rosnay : Je pense que c’est tout à fait vrai. Mon père a passé son adolescence dans les combats de la Résistance pour rejeter les tenants d’une idéologie mortifère, raciste, barbare et il a offert les plus belles années de sa jeune vie pour ce combat. Après la guerre, le gouvernement français a voulu l’intégrer à l’armée française, car il voyait d’un mauvais œil ces jeunes gens sans uniforme qui avaient durant la guerre accompli le travail que l’armée régulière avait largement abandonné, en luttant avec ferveur pour la libération du territoire français. Mais mon père a refusé l’uniforme.
Je tiens à dire aussi, puisque je m’adresse à un grand journal algérien, que mon père, qui avait beaucoup de sympathie pour Kateb Yacine et Mohammed Dib, a pris position immédiatement pour l’indépendance de l’Algérie, ce qui ne lui a pas valu, d’ailleurs, en France, que des amitiés.
Je me souviens qu’il m’avait raconté avoir été, lors d’une soirée du Club des Poètes, provoqué et agressé par des partisans belliqueux de l’Algérie Française, contre lesquels il avait même été obligé de se battre physiquement. Ce qui n’empêchait d’ailleurs pas mon père d’avoir des amis « pieds-noirs » comme par exemple le chanteur Jean-Claude Leguem et le comédien Philippe Téton, qui tous deux avaient gardé un grand amour et une grande nostalgie pour votre pays.
Par ailleurs, mon père a toujours été libre de toutes les appartenances. Par exemple, un peu comme Victor Hugo, mon père était, je crois, tourné vers Dieu, mais complètement indifférent au pouvoir de toutes les autorités religieuses.
Il ne considérait pas non plus les personnes en fonction de leur statut social et ses amis pouvaient appartenir à n’importe quel milieu. Et même vis-à-vis du monde littéraire, il s’est toujours montré très indépendant, refusant de jouer le jeu des relations et des accommodements, si souvent nécessaires dans ce milieu comme dans d’autres pour se frayer un chemin. Cela explique pourquoi, à mon grand dam, les éditions Gallimard n’ont pas réédité ses œuvres depuis 50 ans, ce que je trouve dommage et injuste, compte tenu de la beauté de son œuvre et de tout ce qu’il a fait pour la France, pour la fraternité entre les peuples et pour la Poésie.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur votre mère Marcelle, « la Muse », dont la présence illumine les lieux.
Blaise Rosnay : Ma mère est une personne merveilleuse qui a été le soutien continuel et inconditionnel de mon père dans toutes ses poétiques aventures. Elle est née à Alexandrie, est venue faire un petit tour à Paris à la fin de ses études, et n’est plus jamais revenue, car entre-temps, elle était tombée amoureuse de mon poète de père. Mon grand-père dirigeait « La Cité du Livre » à Alexandrie qui en était à l’époque la plus grande librairie, lieu de rassemblement des poètes et écrivains du monde entier quand ils passaient par l’Egypte. Ma mère a vécu toute son enfance
parmi les livres et bien sûr, après sa rencontre avec mon père, la poésie est devenue toute sa vie, et toutes les folies que mon père a voulu faire au nom de la poésie, cette petite fille sage d’une bonne famille d’Alexandrie, les a faites avec lui. Elle connaît des dizaines de poèmes par cœur, et c’est elle seule qui savait apaiser mon père dans les tumultes des combats de la vie.
Le Matin d’Algérie : Dans un monde déchiré par le matérialisme sauvage, le poète a-t-il encore sa place ?
Blaise Rosnay : Plus que jamais, bien sûr. Elle est plus que jamais nécessaire. Urgente même, pour paraphraser le titre d’une revue de poésie que vient de lancer mon fils Timothée (20 ans) « Urgence Poésie ! ». L’animal humain a besoin de spiritualité, c’est ce qui fait, d’ailleurs, qu’il n’est pas tout à fait un animal comme les autres. La poésie nourrit cette faim, mais alors que les religions dogmatisent, enferment, contraignent, le poète est le chantre de la liberté, une liberté aimante.
Le Matin d’Algérie : La poésie peut-elle changer notre regard sur le monde ?
Blaise Rosnay : Je dirais que pour moi, ce qui est essentiel, c’est que la poésie change le regard sur les autres, ou plutôt protège le regard aimant qui nous est naturel dans l’enfance, mais que la vie matérialiste dont vous parliez finit par user.
Je vous livre quelques mots que j’ai écrits à l’occasion de mon récent anniversaire :
« J’ai été ce petit enfant qui courait sous les poutres du Club des Poètes et apprenait les mots dans les poèmes, et apprenait les hommes et les femmes en les écoutant dire des poèmes ou en les regardant les écouter. Regardez comme les gens sont beaux quand ils écoutent un poème. On n’en guérit pas. À ce rythme-là, on finit même par les aimer. Je devrais dire : on commence même par ça.
Puis, on s’étonne : on se demande à quoi peut bien servir la guerre, comment et pourquoi on peut en arriver là.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot
Blaise Rosnay : Vive la Poésie !
Entretien réalisé par Brahim Saci
poesie.net
Lundi 18 décembre 2023
Le Matindalgerie.com
………………………………………………………………………………

Rencontre avec le chanteur percussionniste Messaoud Kheniche alias META
Messaoud Kheniche alias META est un auteur compositeur chanteur percussionniste en vogue depuis maintenant quelques années. Sa musique oscille entre le jazz, la pop, parfois même comme une senteur rafraîchissante de blues, des mélodies élevées, comme une quête quasi-spirituelle, comme une brise venant d’Afrique traversant le désert par les dunes de sable chaud et survolant la mer, dans des sonorités époustouflantes de lumière.
L’album, Incurve life, est d’une grande maturité musicale et poétique, c’est un Jazz empreint de diverses couleurs.
Le Matin d’Algérie : Vos créations bousculent et émerveillent, qui est Messaoud Kheniche ?
Messaoud Kheniche : Formé comme batteur au centre musicale et créatif de Nancy, il s’installe dans la capitale du jazz européen en 1996 à l’appel de François & Louis Moutin (jazzman de renom). Dès lors, on le retrouve sur l’album Init du trio André Ceccarelli/N’Guyen Lê/Bob Berg, puis au sein de Bad Elephant, avec Daniel Casimir, Louis Moutin, Linley Marthe et Michael Felberbaum. Depuis 1996, le chanteur-percussionniste s’est illustré dans de multiples contextes, sans gommer sa singularité. La liste est longue de ses participations dont il a toujours su tirer parti pour peaufiner sa propre vision des choses. « La leçon du plaisir… », résume celui qui s’affirme aussi en leader.
Il publie quatre disques sous son seul surnom : Secret History en 2003 et Epigram en 2008. Il reconduit la même équipe pour son troisième album, The Sweetness of a Safron Wind en 2012, dont le titre fait écho à ses origines « africaines ». « Incurve Life » (choc jazzmagazine et artiste sacem en 2020, la récompense suprême qui distingue les disques à écouter ). Son dernier disque « Cross Road » sortit en 2022.
Meta a collaboré avec entre autres : Avishai Cohen, Thomas Enhco, Paul Lay, Pierre de Bethmann, Stéphane Galland, André Ceccarelli, François & Louis Moutin, Ari Hoenig, Lee Konitz, Fiona Monbet, David El Malek, Nguyen Lê, Bob Berg, Samy Thiebault, Sophie Alour, Jasser Haj Youssef, Stéphane Guillaume, Eric Le Lann… Il publie quatre disques sous son nom.
Le Matin d’Algérie : Il y a le jazz mais en vous écoutant on sent d’autres influences, qu’en pensez-vous ?
Messaoud Kheniche : En effet, je suis d’origine Algérienne. Ma famille vit à Constantine et comme tout enfant d’immigré, ma culture d’origine est diffuse mais très forte. Cela a construit l’originalité et la singularité de mon travail.
Le Matin d’Algérie : Parlez-nous de la genèse de l’album, Incurve Life ?
Messaoud Kheniche : Composé en réaction au chaos de ce monde, Incurve Life invoque la force de l’art et sonde la part démiurgique de l’humanité. Le passage du temps, le changement, l’évolution sans limite et l’espoir d’une renaissance.
Le Matin d’Algérie : Incurve Life, pourquoi ce titre ?
Messaoud Kheniche : « Une vie en courbes », car la vie n’est pas faite de lignes droites, elle est faite de courbes qui parfois, nous font même tourner en rond. Au-delà de nos certitudes, cette vie en courbe dessine un parcours aléatoire et infini.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur Meta et les musiciens qui vous accompagnent
Messaoud Kheniche : Il y a Pierre-François Dufour – batterie, violoncelle, à 11 ans il se produit déjà dans de nombreux festivals européens puis, l’année suivante, donne ses premiers concerts de soliste et chambriste. Parallèlement, il continue sa carrière de batteur de jazz sur scène auprès de Bernard Lubat et Michel Portal. En 2000, il intègre le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans la classe de Philippe Muller. Ses talents d’improvisateur et de rythmicien sont repérés très tôt par beaucoup d’artistes dans le milieu du jazz, notamment Archie Schepp, Richard Bona, Louis Winsberg, Paco Sery et tant d’autres.
À 18 ans, Yutaka Sado l’invite comme violoncelle solo à l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine. Il jouera également le concerto pour violoncelle d’Edward Elgar et différents concerts de musique de chambre avec les solistes de l’orchestre. Au cours de la même période, il rencontre Mstislav Rostropovitch qui lui promet un grand avenir. Sa carrière de batteur de jazz s’ouvre alors vers la musique du monde, notamment la musique de l’île de la Réunion et Madagascar.
On le retrouve au violoncelle auprès de Jean-Pierre Marielle et Agathe Natanson dans la pièce Les Mots et La Chose de Jean-Claude Carrière, d’abord au Théâtre de l’Œuvre à Paris et en tournée dans toute la France et en Europe francophone.
Sa collaboration avec Jean-Pierre Marielle continue dans La correspondance de Groucho Marx, mise en scène par Patrice Leconte. Cette fois-ci, Pierre-François est à la batterie et est directeur musical au Théâtre de l’Atelier à Paris puis lors de la tournée qui se finira par le festival Juste pour rire de Montréal.
En 2012, il crée l’ensemble Archipel, dont il est toujours directeur musical.
Sur scène il collabore avec Diana Krall, Melody Gardot et enregistre les albums de Christophe, Salvatore Adamo et Autour de Nina avec l’arrangeur et réalisateur Clément Ducol.
Il participe à la création de nombreux albums et partage la scène avec des artistes tels que Maxim Vengerov, Hans Zimmer, Nemanja Radulovic, Quincy Jones, Jean- Luc Ponty, Stefano di Battista, Vanessa Paradis, Bojan Z, Camille, Sylvain Luc, Charles Aznavour, David Binney, Yael Naim, Hugh Coltman, Vincent Delerm, Yvan Cassar, Meddy Gerville, Eric Seva, Zaz, Spleen, Maxime Le Forestier, Marc Bertoumieux, Camélia Jordana, Sandra Nkaké, Gregory Porter, Sophie Hunger, Keziah Jones, Olivia Merilahti, Ben L’oncle Soul, Marc Lavoine, Roberto Alagna, Régis Gizavo, Warren Ellis, Mory Kanté, Giovanni Mirabassi…
Il y a Simon Tailleu – contrebasse, l’intimité d’un trio piano – basse – voix, un hommage à Stan Getz accompagné par un orchestre de cordes, ou encore un groupe rassemblant les plus grandes sommités du jazz Français à Marciac : la discographie en sideman de Simon Tailleu sur des labels aussi importants que Verve, Act Music et Laborie parle d’elle-même. Accompagnateur indispensable d’Émile Parisien, Paul Lay ou encore Youn Sun Nah, le contrebassiste apporte à tout projet sa musicalité sans faille, sa sagesse de producteur, et son expérience de jeune vétéran. Il a notamment partagé la scène avec Wynton Marsalis, Marcus Gilmore, Ambrose Akinmusire, Michel Portal ou encore Didier Lockwood.
Tout juste arrivé de Martigues, il remporte le prix de groupe, le second prix de soliste et le prix de compositeur au Concours National de la Défense, avant d’intégrer la classe de jazz du Conservatoire National Supérieur de la Ville de Paris. Sa présence auprès des musiciens les plus établis ne l’empêche pas d’apporter une contribution précieuse aux projets de jeunes talents, et il est aujourd’hui membre de Mélusine et House of Echoes, deux groupes lauréats du dispositif Jazz Migration. Simon est par ailleurs un vidéaste de talent ayant réalisé des captations de concerts et des clips pour des groupes comme Watershed ou The Thiefs.
Puis, il y a Leonardo Montana – piano, d’origine brésilienne, naît à La Paz en 1977 d’un père colombien et d’une mère anglaise. Il grandit entre Bahia (Brésil) et la Guadeloupe (Antilles françaises), où, adolescent, il débute le piano en autodidacte. En 1996, il commence à se produire, on a pu l’entendre, entre autres, aux côtes Felipe Cabrera, Raul de Souza , Anne Paceo, Celine Bonacina ,Bill Mchenry , Geraldine Laurent,Michael Pipoquinha, Pedro Martins, Plume, Claude Tchamitchian , Irving Acao , Gueorgui Kornazov , Dave Liebman, Mokhtar Samba ,Anne Paceo Yokai ,Bruno Schorp , Naissam Jalal, Chico Freeman, Arnaud Dolmen,Christophe Panzani,Line Kruse, Sandro Zerafa dans de nombreux festivals et clubs du monde entier .
Son amour pour la voix l’amène également à travailler avec de nombreux vocalistes tels que Omara Portuondo, Agathe Iracema , Meta, Marianne Solivan , Deborah Brown, Charlotte Wassy, Anne Sila, Cynthia Saint-Ville, Sofia Ribeiro, Chloé Cailleton, Viviane de Farias,Cynthia Abraham , Marcia Maria, Fredrika Stahl, Catia Werneck ,Charlotte Wassy ,Maria de Medeiros…
Sa palette artistique s’est élargie à la composition de musique de scène, avec sa participation à la création de deux opéras, écrits par le librettiste Bernard Turle, lors du Festival d’été du Wem (Var) : « Variations provençales » (quintet de jazz, chœur et solistes) et « Randonnée Dérandonnée » (2 pianos, violoncelle, alto, chœur et solistes).
En juin 2023 il est » Invité Fil Rouge » d’un festival autour du piano à Fort de France , Martinique, « Piano Kon Sa Ka Ekri ». En préparation, deux enregistrements sous son nom en 2024, dont un en piano solo.
Le Matin d’Algérie : Messaoud Kheniche, qu’est-ce qui l’inspire ?
Messaoud Kheniche : un désir de musiques en mouvement, une envie de ne pas s’en tenir à un registre ou à une formule consacrée. C’est toute la force de ces huit compositions que d’échapper à la pesante loi des catégories. Les chemins buissonniers et sinueux, toutes les différences, les sentiments partagés, mitigés, par cet artiste qui vibre à chacun des maux qu’il décrit. Il y est aussi question de l’amour, vécu comme une renaissance (Emma Things), ou encore de la force de l’art, face à la beauté picturale de Francis Bacon (Layer Of Fog) …
Au-delà des mots, la musique parle d’elle-même. Libre elle aussi de se mouvoir sur toutes les gammes de la palette des sensations : du jazz, certes, mais avec une sensibilité « pop », un rien de sensualité dans chaque chorus. Ici, l’enjeu n’est pas d’épater la galerie par des triples croches, mais de jouer juste, de toucher la corde sensible. Lyrique, onirique, la musique de ce chanteur à l’aura quasi métaphysique réconcilie le corps et l’esprit, ce fameux Body and Soul qui demeure le meilleur étiage d’un jazz prêt au voyage, libéré des contraintes formelles. C’est toute la force du message de Meta, une spiritualité portée par un attelage tout autant en suspension, au diapason de ses intentions : un quintette majuscule (avec ses fidèles complices – le pianiste Pierre de Bethmann, le guitariste Michael Felberbaum et le batteur Karl Jannuska – mais aussi de nouveaux compères, le saxophoniste Stéphane Guillaume et le contrebassiste Simon Tailleu) auquel s’ajoute un quatuor à cordes. Somme toute, loin d’appesantir le propos, cet équipage s’avère des plus légers, parfaitement en accord avec cette ode nomade qui vise à repousser les limites et enjamber les frontières, pour au final établir un pont inédit entre le jazz, le classique et la pop.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les grands noms de la musique qui vous parlent ?
Messaoud Kheniche : Oum Kelthoum, Fairouz, Sting, Beatles, Léo Ferré…
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en perspective ?
Messaoud Kheniche : Les prochains concert Parisiens auront lieu : le 29 mars au jazz club le « Baiser Salé » (Paris 1) Le 4 mai au jazz club « Le son de la Terre » (Paris 5). Le 30 mai au jazz club le « Sunset/Sunside » Paris 1)
Entretien réalisé par Brahim Saci
samedi 9 décembre 2023
Le Matin d’Algérie
Lematindalgerie.com
youtube.com/watch?v=wunvF_0qUZk
………………………………………………………………………………

Rencontre avec le cinéaste Ferhat Mouhali
L’acteur, réalisateur, documentariste, scénariste Ferhat Mouhali, a réalisé avec son épouse Carole Filiu-Mouhali un beau long métrage documentaire « Ne nous racontez plus d’histoires ! » sur la guerre d’Algérie.
« Ne nous racontez plus d’histoires ! », est un film documentaire, étonnant, courageux et bouleversant de Carole Filiu-Mouhali et Ferhat Mouhali sur la guerre d’Algérie, un regard apaisant, apaisé, sur une histoire écorchée, c’est aussi un nouveau regard plein d’amour pour un rapprochement entre les deux rives pour un avenir meilleur. Il a fallu sept-ans à ce couple de réalisateurs Marseillais Filiu-Mouhali et Ferhat Mouhali pour finir ce film, Ne nous racontez plus d’histoires.
Ce sont deux regards de chacune des deux rives qui se rejoignent en un, qui déchirent des brouillards pour que le soleil puisse briller, dans une quête de vérité et d’espoirs.
Le Matin d’Algérie : Avant de parler de votre film, « Ne nous racontez plus d’histoires ! », qui est Ferhat Mouhali ?
Ferhat Mouhali : Avant de faire du cinéma, j’ai fait des études en économie à l’université de Béjaïa, c’est là que j’ai milité au sein de l’association nationale de jeunes RAJ (Rassemblement Action Jeunesse). Avec les autres membres de l’association, nous faisions du théâtre engagé sur les thématiques des droits humains. Puis j’ai découvert le cinéma documentaire avec les ateliers de Bejaia Doc organisés par la cinéaste Habiba Djahnine durant lesquels j’ai réalisé mon premier court-métrage documentaire “Heureusement que le temps passe”. Il a obtenu le prix du jury au festival national du film amazigh en Algérie et le coup de cœur du public du festival français Point Doc. J’ai réalisé ensuite “Des vies sous silence”, lors de l’université d’été de la Fémis (École nationale supérieure des métiers de l’image et du son) en 2012 à Paris. En 2020, j’ai réalisé mon premier long métrage documentaire « Ne nous racontez plus d’histoires ! ». En tant que comédien, je joue en ce moment dans des séries et longs-métrages français et étrangers.
Le Matin d’Algérie : Parlez-nous de cette collaboration avec Carole Filiu-Mouhali ?
Ferhat Mouhali : Carole est journaliste et elle était en train de réaliser un webdocumentaire sur les femmes algériennes (FATEA) quand nous nous sommes rencontrés. Nous avons travaillé ensemble sur ce projet qui a été diffusé sur TV5 Monde en 2012. Puis quand j’ai réalisé “Des vies sous silence”, elle s’est rendue compte elle aussi qu’elle manquait de connaissances sur la guerre d’Algérie alors qu’elle est fille de pieds-noirs. Nous avons décidé de travailler ensemble à nouveau et de croiser nos regards sur notre passé dans “Ne nous racontez plus d’histoires !”.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur la genèse de ce film ?
Ferhat Mouhali : Quand j’ai fait ma formation à la Fémis en 2012, c’était le cinquantième anniversaire de l’indépendance algérienne et j’ai souhaité réaliser un court-métrage sur ce sujet. Carole a travaillé à mes côtés et après de longues discussions, nous avons réalisé que nous avons reçu chacun une histoire officielle de cette guerre.
Tout au long de la réalisation du film, nous avons découvert des histoires et des souffrances légitimes, isolées, séparées, comme si chaque personne avait souffert plus que les autres. Notre objectif : les réunir et essayer d’avancer, ensemble.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les obstacles rencontrés ?
Ferhat Mouhali : Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Au début de la réalisation, nous avons reçu des financements de différentes institutions de cinéma mais malheureusement, notre producteur de l’époque a fait faillite. Les financements dédiés au film ont disparu et nous avons dû racheter nos droits d’auteur. Le tournage a eu lieu à ce moment-là, en 2015, dans ces conditions déjà difficiles.
Pour être clairs, ce ne sont pas les personnes que nous avons interviewées qui étaient réticentes, mais plutôt les institutions. En Algérie, nous avons demandé l’autorisation de tourner dans une école : nous voulions filmer un cours d’histoire, en parallèle de ce que nous avions filmé en France. Mais jusqu’à ce jour, nous n’avons toujours pas reçu de réponse à notre demande !
À Alger, nous étions discrets quand nous filmions car nous n’avions pas d’autorisation. Quand nous voyagions, chaque passage à la frontière était compliqué, je devais passer plusieurs heures dans les bureaux de la police des frontières pour des « examens de situations » et la police a confisqué définitivement notre matériel lors d’une entrée sur le territoire. À chaque séjour, nous recevions des convocations de la police et nous devions nous rendre au commissariat local pour répondre à leurs questions.
Nous avons ensuite réalisé une collecte sur internet pour financer le montage et nous avons rencontré notre producteur actuel. Si en France, nous n’avons eu aucun problème pour tourner, c’est la diffusion qui s’est avérée compliquée. Les chaînes et institutions de financement contactées trouvaient notre idée « intéressante » mais « trop sensible » et ne voulaient pas prendre le risque de traiter ce sujet. Elles ne s’intéressaient pas aux témoignages recueillis et au regard croisé que nous portions mais voulaient que nous abordions principalement ce que l’Algérie a fait de son indépendance.
Le Matin d’Algérie : Votre film, « Ne nous racontez plus d’histoires ! », est bouleversant, pourquoi ce titre ?
Ferhat Mouhali : Ce qui nous a frappé quand on a commencé à travailler sur ce film, c’est que tous les deux, moi, Algérien ayant grandi et vécu en Algérie, membre d’une famille du FLN, et Carole, fille de pied-noir, baignée dans ce récit depuis son enfance, nous ne connaissions finalement pas grand-chose de cette guerre. Les connaissances que nous en avions étaient totalement disparates alors que chacun avait sa propre vision d’un seul et même événement. En dehors de nos propres récits familiaux et de ce que nous avions reçu à l’école – beaucoup pour moi, pas grand-chose pour Carole – nombreux étaient les trous et les absences. Pour elle, c’était la violence, la cruauté de cette guerre qui avaient souvent été occultées. Pour moi, c’étaient des personnages historiques, des massacres entre Algériens qui avaient été effacés.
L’idée de « Ne nous racontez plus d’histoires » est partie de là, de cette envie de comprendre les raisons pour lesquelles un Algérien et une Française pour qui finalement tout devait être clair, ne connaissaient pas grand-chose à leur passé commun. Tous deux, nous avions le sentiment de nous trouver face à une sorte de mensonge collectif et volontaire et nous avions envie d’en comprendre l’origine. En quelque sorte, nous étions déçus de l’histoire « officielle » et nous avions envie de reconstruire par nous-mêmes cette mémoire.
Ces deux histoires officielles – l’une mythifiée, glorifiée et l’autre du silence et nostalgique du paradis perdu – ces deux versions ne nous arrangeaient pas et nous voulions faire entendre une voix différente de celles que nous avions entendues jusqu’à présent. Nous avons interrogé des témoins mais aussi des lieux qui ont vécu cette guerre. A travers notre caméra, les lieux sont devenus eux-mêmes des outils de révélation de la mémoire. “Ne nous racontez plus d’histoires !”, c’est un film pour apprendre de notre passé et mieux comprendre notre présent.
Le Matin d’Algérie : Pensez-vous que votre film documentaire, « Ne nous racontez plus d’histoires ! », a atteint son objectif ?
Ferhat Mouhali : Notre film est porté par nos histoires personnelles. Nous y présentons des membres de notre famille, et des images de notre passé. Nous y présentons nos questions, nos doutes, nos espoirs. Nous avons voulu inviter le spectateur avec nous, qu’il sente qu’il nous accompagne. Dans l’art, l’œuvre n’est jamais achevée. Malgré toutes les entraves que nous avons rencontrées, nous sommes très satisfaits de la vie que le film mène. Il a été sélectionné dans plusieurs festivals nationaux et internationaux, nous avons reçu trois prix et surtout le film continue à être projeté. Nous sommes également heureux que notre film soit utilisé comme support pour évoquer la guerre d’Algérie dans des collèges, lycées et universités français. Nous accompagnons notre film pour provoquer des débats dans les salles de cinéma, auprès de tous les publics, que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes.
Notre objectif avec ce film, c’est d’ouvrir le débat sur cette période des deux côtés de la méditerranée, de nommer les horreurs commises sans prêcher la haine ou émettre un jugement. Mais plutôt de raconter des faits réels et historiques pour essayer d’avancer ensemble vers une vérité plus apaisée.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous d’autres projets ?
Ferhat Mouhali : Actuellement je suis en développement de mon prochain film de fiction, sur les déplacements des personnes dans le temps et dans l’espace, une thématique qui me tient à cœur depuis longtemps et qui concerne beaucoup de pays en ce moment. Dans ma famille, mon arrière-grand-père, dont l’avis importait peu, a été envoyé en France pour participer à la première guerre mondiale. Gazé par les Allemands, il a été réformé par l’armée française et il est rentré malade en Algérie où il est décédé quelques temps après. Quelques années plus tard, mon grand-père partira lui aussi pour la France où il passera la moitié de sa vie dans des usines. Descendant d’immigré, je vis aujourd’hui à mon tour sur cette terre.
Entretien réalisé par Brahim Saci
vraivrai-films.fr/catalogue/ne_nous_racontez_plus_d_histoires_?fbclid=IwAR3hp8u5jonAn0D3Fox3XcYkZLeRxeXb4OSP5nHHFJ_cmlIPSnBlyws3rHE
mercredi 6 décembre 2023
Le Matin d’Algérie
Lematindalgerie.com
__________________________________________________
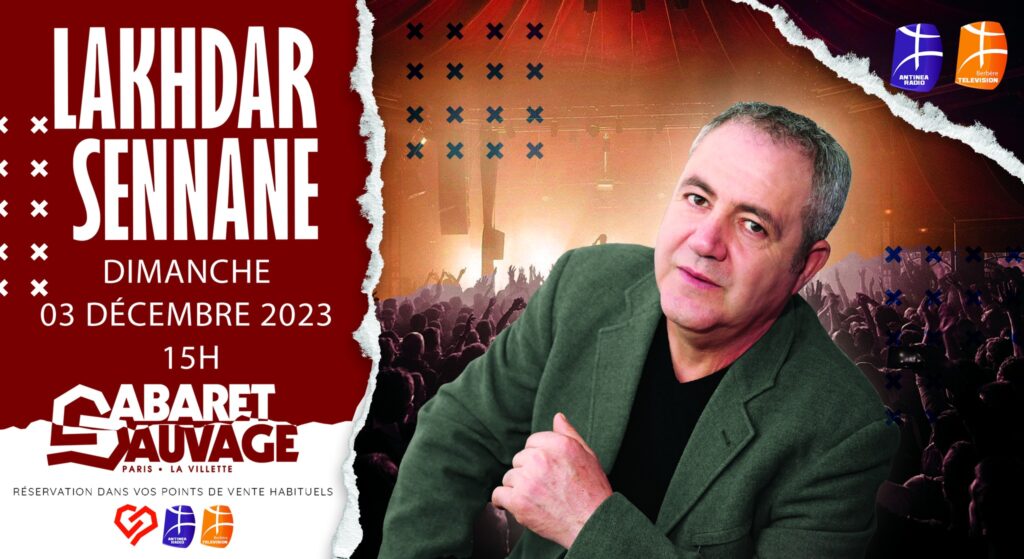
Lakhdar Sennane au Cabaret Sauvage
Lakhdar Sennane est cet artiste discret, un chanteur kabyle, auteur compositeur qui ne cesse de monter, tellement son talent est grand. Ces compositions sont de toute beauté, portées avec justesse par une voix douce et puissante qui remplit l’air d’émotions.
Il se produit au Cabaret Sauvage le 3 décembre à 15h, pour notre plus grand bonheur, pour célébrer ces 30 ans de carrière.
Lakhdar Sennane est un chanteur brillant, altruiste, qui fait parler de lui depuis de longues années, par ses productions de qualité, qui touchent et interpellent l’esprit, le cœur se réchauffe, l’oreille est attentive pour tout capter, comme pour ne rien laisser s’échapper, tant l’émotion qui se dégage par sa voix et la mélodie est grande, envoutante.
Lakhadar Sennane chante l’amour avec ses joies et ses peines, la vie avec ses hauts et ses bas, mais aussi l’exil. Si ses rythmes sont souvent dansants ils ne font pas oublier la profondeur des paroles, la force du poème chanté laisse son empreinte dans l’air, comme un baume rafraichissant exhalant un parfum sur les mots guérissant les maux.
En écoutant ses airs, ses compositions, nous sommes transportés comme par magie vers l’Algérie, la Kabylie, vers les cimes du Djurdjura, de l’Akfadou et de Yemma Gouraya, on sent cette brise caressant la terre, traversant le ciel et la mer, remplie de senteurs du bonheur.
Ces chansons sont comme une bouffée d’air salvatrice, qui nous remplit de joie, c’est ce qu’on ressent par exemple en écoutant, Adrar-iw, Ma montagne, c’est un voyage quasi spirituel à travers la Kabylie, ses montagnes et ses valeurs ancestrales, millénaires.
La chanson kabyle revient avec force ces dernières années pour remplir les salles parisiennes, c’est très encourageant.
À ceux qui s’interrogent sur l’avenir de la chanson kabyle et qui s’inquiètent quant à sa relève, lorsqu’on voit le talentueux Lakhdar Sennane, on se dit que la chanson Kabyle a encore de beaux jours devant elle.
Brahim Saci
Vendredi 1 décembre 2023
Le Matin d’Algérie
Lematindalgerie.com
………………………………………………………………………………….

Élisabeth Tamaris, une vie vouée à l’art dramatique
Élisabeth Tamaris a consacré de longues années à l’enseignement de l’art dramatique au conservatoire municipal Camille Saint-Saëns du 8e arrondissement de Paris, de 2000 à 2008, elle n’a jamais cessé de transmettre le savoir théâtral, dans le but de former les nouvelles générations. Elle a aussi suscité l’admiration de ses élèves par sa façon d’enseigner et par sa façon d’être, par son sourire et sa générosité. Une carrière d’une richesse immense, (une carrière d’une grande diversité) de la télévision à la radio, du cinéma au théâtre et des mises en scènes de génie (des mises en scènes étonnantes).
Élisabeth Tamaris se distingue une nouvelle fois par la mise en scène de, « Ourika », de Claire de Duras, dans ce beau (petit) Théâtre Darius Milhaud, 80 Allée Darius Milhaud, 75019 Paris, à deux pas de la Villette, du 10 octobre au 19 décembre 2023 tous les mardis à 19h et les dimanches 15, 22, 29 octobre, 3, 10 et 17 décembre à 18h, (il reste encore trois dates en décembre le 3, 10 et 17 à 18h).
Le Matin d’Algérie : Vous avez une carrière incroyable, qui est Élisabeth Tamaris ?
Élisabeth Tamaris : Juste quelqu’un qui a toujours aimé les œuvres et l’art sous toutes ses formes, s’est consacrée particulièrement à l’exercice de l’interprétation théâtrale, et a ressenti le besoin de transmettre son expérience et son admiration pour les grands poètes de l’art dramatique, dont parlait si bien des gens comme Maria Casarès ou Laurent Terzieff.
Le Matin d’Algérie : Vous paraissez infatigable, malgré le poids des années, quelle est votre secret ?
Élisabeth Tamaris : Infatigable, ce n’est pas toujours vrai, mais la poursuite d’une activité que l’on aime et qui vous apporte autant est la meilleure des armes, tant qu’on peut matériellement l’exercer. Comme disait l’écrivain Jean Paulhan : « J’aimerais vivre jusqu’à ma mort ». Et bien sûr, c’est un immense privilège.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur l’association Mélane qui présente la pièce « Ourika » de Claire de Duras, comment s’est passée la rencontre avec la comédienne Marie Plateau ?
Élisabeth Tamaris : J’ai rencontré Marie Plateau en jouant avec elle dans plusieurs spectacles de la Compagnie de l’Elan (dans les années 85) et nous avons réciproquement suivi nos parcours depuis. Elle a créé l’Association Mélane, qui a produit plusieurs spectacles liés à la diversité, puis je lui ai « soufflé » l’idée de faire quelque chose à partir du roman de Claire de Duras qui me tenait à cœur depuis longtemps, et dont finalement j’ai fait la mise en scène.
Le Matin d’Algérie : Le message véhiculé par « Ourika » est plus que jamais d’actualité, bien qu’écrit au 19ème siècle, qu’en pensez-vous ?
Élisabeth TAMARIS : En travaillant sur le texte, c’est ce qui nous a particulièrement étonnées. Et cela nous a conduit à faire évoluer le spectacle en mettant sous le regard du spectateur une comédienne métisse d’aujourd’hui qui en travaillant le texte, se laisse happer par l’histoire et le personnage d’autrefois, tellement elle y retrouve son expérience contemporaine des souffrances qu’impliquent toutes les formes de discrimination.
Le Matin d’Algérie : Pensez-vous que les arts, l’Art dramatique en particulier, peuvent changer notre regard sur monde ?
Elisabeth Tamaris : Le changer, je ne sais pas… L’éclairer, l’enrichir, le nuancer, c’est ce que nous espérons.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur Claire de Duras qui nous a laissés il y a deux siècles, « Ourika », ce texte en avance sur son temps, d’une clairvoyance inouïe.
Élisabeth Tamaris : Claire de Duras était une aristocrate cultivée, tenant, déjà sous l’Empire puis surtout pendant toute la période de la Restauration un brillant salon où se croisaient les gens les plus éminents de l’époque, politiques, artistes, savants, hommes de lettres, comme Madame de Stael, Benjamin Constant, etc… et tout particulièrement Chateaubriand, pour lequel elle a eu une amitié indéfectible. Très marquée comme toute sa génération, par les drames de la Révolution qu’elle a traversés dans sa jeunesse, elle avait une nature hypersensible et lorsqu’elle s’est retirée pour écrire, son premier sujet a été l’histoire réelle qu’elle connaissait de cette jeune enfant sénégalaise, élevée dans la famille de Beauvau, qui était morte (de chagrin ?) à 16 ans, bien qu’élevée et aimée comme une enfant de la maison. Toute la force du roman est liée à la façon dont Claire de Duras s’est projetée dans la conscience de cette jeune femme noire pour lui donner la parole, pour la première fois sans doute dans la littérature occidentale.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les grands noms du théâtre qui vous parlent ?
Élisabeth Tamaris : J’en ai déjà cité deux, je pourrais dire Peter Brook, Jean Vilar, il y en aurait tant d’autres, tous ceux qui ont fait l’histoire du théâtre si vivante au XXème siècle, la liste serait trop longue… Pour le XXIème siècle, j’aurais envie de citer d’anciens élèves qui font un si beau parcours dans la mise en scène et l’interprétation (Igor, Olivier, Louise, Valentine… et les autres !)
Le Matin d’Algérie : J’ai parlé avec beaucoup de vos anciens élèves, ils sont unanimes quant à votre belle façon de transmettre le savoir théâtral, toujours en privilégiant le côté humain, il y a de la magie dans tout ce que vous faites, avez-vous d’autres projets en vue ?
Élisabeth Tamaris : D’autres projets, avec Marie Plateau et l’Association Mélane, liés à la Lecture à Voix Haute, discipline qui nous passionne en ce moment et pour laquelle nous animons des ateliers qui vont se développer prochainement.
Pour le reste, on verra ce qui se présentera, je veux surtout vous remercier ainsi que mes anciens élèves, pour la gentillesse de leurs témoignages !
Entretien réalisé par Brahim Saci
vendredi 24 novembre 2023
……………………………………………………………………………………………………….

Rencontre avec l’écrivain Jean Calembert
Jean Calembert vient de nous surprendre avec la publication d’un livre passionnant, un roman, Le Mal-Aimé, chez Bitbook.be. Jean Calembert a un parcours des plus atypiques, docteur en droit, expert en marketing, il a parcouru le monde avant sa plongée et une immersion passionnée dans la littérature à l’âge de 77 ans.
Le Mal-Aimé interroge et interpelle, voguant entre le réel et la fiction, il ne laisse pas le lecteur indifférent. Page après page nous sommes captivés par la fluidité et la profondeur de la narration.
Le Matin d’Algérie : Vous avez un parcours atypique, qui est Jean Calembert ?
Jean Calembert : Je suis né à Liège le 4 août 1942 et j’ai eu, après mes études de droit, un parcours de « guru » marketing assez chaotique dans de grandes multinationales. D’abord avant de créer ma propre société, une PME, en 1988. On était deux au début, on a fini à plus de vingt employés, et on est devenu un des acteurs principaux au niveau mondial dans une niche, le domaine des études de marché qualitative dans le monde agricole.
En parallèle, j’ai toujours mené une vie artistique assez intense, avec un fort investissement dans la photo et dans la peinture. Comme j’étais un pion important dans les multinationales et le patron de ma PME, j’ai pu prendre entre mes longs voyages à l’étranger – à Pâques, durant l’été et pendant les fêtes de fin d’année – de nombreuses périodes de repos, le plus souvent dans mon petit paradis de Laborel en Drôme provençale où j’ai fait construire une petite maison en 1988-1989.
Le Matin d’Algérie : D’où vous vient cette passion pour l’écriture ?
Jean Calembert : Depuis mes 15 ou 16 ans, j’ai toujours beaucoup lu grâce à un génial professeur de français : Rimbaud, Apollinaire, Mauriac, Malraux, Camus (surtout…), Radiguet, Nimier, Faulkner entre autres et surtout Nabokov (Lolita). A 18 ans, mon père (géologue) m’a envoyé aux USA pour me persuader d’abandonner mon idée de faire le droit. J’y ai découvert Joyce, Miller (Henri), Kerouac, John Fante et bien d’autres. Et depuis, je n’ai jamais arrêté de lire, surtout des auteurs américains (Nathaniel West, Baldwin, Auster, Harrison), mon idole dans ses premiers livres (Murakami) mais j’aime moins les derniers, Houellebecq et un fantastique écrivain belge, Jean-Philippe Toussaint.
J’ai toujours beaucoup écrit mais plus en anglais qu’en français, des milliers de rapports pour mon boulot, pour des gens qui parlaient mal l’anglais, n’aimait pas lire et étaient avant tout des vendeurs ou des commerciaux. Les rapports étaient rédigés en PowerPoint, un logiciel où les graphiques avaient la priorité sur le texte. Il était donc essentiel d’utiliser des mots simples, des phrases courtes, des « histoires » avec un fil rouge clair faciles à mémoriser. Je crois que cette expérience a été déterminante dans ma façon d’écrire.
À 77 ans (en Belgique, on est jeune de 7 à 77 ans selon le journal de Tintin), le jour de mon anniversaire, j’ai eu une illumination et j’ai décidé de me lancer dans mon premier roman, « Joe Hartfield, l’homme qui voulait tuer Donald Trump », malgré le titre un hymne à l’amitié … et au jazz. J’y ai pris un énorme plaisir … et mes lecteurs aussi. J’étais devenu un écrivain malgré moi ! Et c’est aussitôt devenu une passion. Je viens d’écrire Le Mal-Aimé et j’ai depuis quels jours un nouveau roman en jachère.
Le Matin d’Algérie : Pourquoi ce livre ?
Jean Calembert : Je voulais continuer à écrire. Murakami dans son livre « Profession écrivain » dit que c’est facile d’écrire un bon livre mais qu’un écrivain se construit dans la durée. Malgré la malédiction attribuée au second roman, je me suis lancé ce défi et je crois l’avoir réussi ! Le Mal-Aimé est très différent du premier roman. C’est un livre plus court, plus construit, une chronique familiale aux forts accents chabroliens. Les lecteurs qui ont acheté, Joe Hartfield, ont presque tous adoré, Le Mal-Aimé, et vice-versa. J’ai maintenant un noyau dur de fans qui attendent mon troisième roman !
Le Matin d’Algérie : Le titre, Le Mal-Aimé, nous interpelle, on ne peut s’empêcher de penser à la chanson du mal aimé de Guillaume Apollinaire, à cet impossible amour, qu’en pensez-vous ?
Jean Calembert : En fait, le poème d’Apollinaire n’a pas eu d’influence sur moi, je le connaissais mais je l’avais oublié. J’avais d’abord intitulé le livre Les Mal-Aimés, juste comme ça, parce que cela me semblait être applicable à tous les personnages principaux. Puis j’ai changé en Le Mal-Aimé car je trouvais que cela répondait à ma volonté de rendre hommage à mon père, une personne extraordinaire mais que j’avais injustement mal aimé… Et j’ai donc choisi ce titre sans penser à Claude François (ouf !!!). Ce n’est que plus tard que je me suis souvenu de la chanson d’Apollinaire, un de mes poètes préférés avec René Char et Blaise Cendrars.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les auteurs qui vous parlent ?
Jean Calembert : J’en ai parlé plus haut. J’y ajouterai André Hardellet, Lawrence Ferlenghetti, Richard Brautigan et des auteurs moins connus comme Georges Fourest, Jean-Bernard Pouy et Samira Sedira. Et quand j’aime un auteur, j’achète presque tous ses livres !
Le Matin d’Algérie : Pensez-vous que la littérature soit salvatrice dans le monde tourmenté d’aujourd’hui ?
Jean Calembert : Je crains que non. La littérature de qualité est pour moi et une minorité de gens, bien ou mal pensants, un « médicament ». Comme le théâtre, la peinture, la sculpture, la chanson engagée, le rap de qualité, le cinéma. Pour d’autres, c’est la TV, les chaines d’informations continues, l’alcool, la drogue, TikTok, le foot.
Mais qui se soucie de la littérature dans l’immense majorité des personnes, désespérées, abruties par la société de consommation, les « fake news », leur « struggle for life » ?
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot
Jean Calembert : Non deux. Lire délivre !
Entretien réalisé par Brahim Saci
mercredi 22 novembre 2023
………………………………………………………………………………………………………………………………………
/image%2F1720502%2F20231123%2Fob_8193b4_12698503-1146028918743610-477462155376.jpg)
Rencontre avec le thérapeute et ethnopsychiatre Hamid Salmi
Hamid Salmi est thérapeute, formateur en ethnopsychiatrie, psychologue, chercheur en ethnopsychiatrie, il fut formé à l’école de Georges Devereux, il fut aussi chargé de cours à l’Université Paris VIII. C’est un thérapeute de renom, il est l’un des rares spécialiste dans le domaine de l’ethnopsychiatrie. Une discipline plus que jamais d’actualité dans une époque écorchée où l’individualisme et l’indifférence touchent les plus faibles, notamment les populations de diverses origines, issues de l’immigration, là où la psychologie et la psychiatrie se trouvent dans l’impasse, l’ethnopsychiatrie apporte des réponses.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes universitaire avec un parcours étonnant, qui est Hamid Salmi ?
Hamid Salmi : Je suis né en Algérie pendant la guerre de libération. À l’âge de cinq ans, J’ai quitté la Kabylie avec une cousine pour rejoindre mon père qui était commerçant en Oranie, à Hammam-Bou-Hadjar. Bien plus tard, en 1973, à l’âge de 23 ans, je suis parti en France, après avoir obtenu une licence en psychologie à l’université d’Oran. Chacun de ces lieux et chacune de ces périodes a laissé en moi des empreintes indélébiles.
La Kabylie, c’était le monde villageois avec ses champs, sa rivière, ses sources, toutes ses traditions agraires, ses initiations culturelles, ses poétesses, ses guérisseurs. Mais tout cet ordre ancien était effracté et bouleversé par la colonisation. Il y avait les maquisards qui nous rendaient visite la nuit et les militaires qui venaient le jour. J’ai gardé en mémoire beaucoup d’images, de scènes et de paroles. J’ai pu élaborer, bien plus tard, des blessures psychiques enfouies provoquées par la guerre. De ce fait, je me suis intéressé dans mes recherches aux traumatismes transgénérationnels générés par des génocides ou des massacres à grande échelle un peu partout dans le monde.
Ma période en Oranie est marquée par le monde multiculturel de l’époque. Je parlais à mon père en kabyle, j’entendais la derja, la langue espagnole, le français, les autres parlers amazighs du Rif ou du Sous… Le magasin de mon père constituait une interface entre le monde du dedans et celui du dehors. J’étais immergé dans tous les échanges en arabe dialectal avec ses proverbes, ses métaphores…ll y avait aussi la radio qui égrenait continuellement ses chants rythmés ou nostalgiques chaâbi, kabyle, égyptien, au rythme saccadé cette machine à coudre de mon père.
Je faisais d’ailleurs mes devoirs sur la table de cette machine à coudre où je tissais, moi aussi, mes premières phrases en français et plus tard en arabe classique. Ce riche monde de la culture orale et écrite m’a préparé à mon futur travail de médiateur entre la raison graphique et les systèmes de pensée populaires. J’étais, en quelque sorte, poussé à créer un espace métissé pour articuler les logiques institutionnelles modernes aux logiques culturelles traditionnelles portées par les migrants.
Ma troisième période en France est marquée, dès ses débuts, par la rencontre dans les hôpitaux et les services sociaux, avec mes compatriotes ouvriers nord-africains confrontés à l’épreuve de l’exil et aux conflits intergénérationnels avec leurs propres enfants nés en France. Les deux précédentes séquences de ma vie m’ont donné une bonne partie des outils cliniques et culturels pour les comprendre, les aider et les soigner.
Le Matin d’Algérie : Votre rencontre avec Georges d’Évreux et Tobie Nathan a-t-elle été déterminante ?
Hamid Salmi : À l’université d’Oran, un coopérant, professeur de psychologie sociale, connaissant ma passion pour l’anthropologie et la clinique m’a appris l’existence d’une discipline appelée Ethnopsychiatrie dont le fondateur est Georges Devereux. J’ai aussitôt contacté ce dernier et lui ai envoyé mon mémoire qui portait sur les techniques de guérisons traditionnelles, appréhendées d’un point de vue psychanalytique et ethnologique. Il m’a répondu favorablement et m’a fixé un rendez-vous dans la région parisienne pour un entretien original. Ainsi, j’ai pu être admis à poursuivre mes recherches avec lui dans le cadre de cette discipline qu’est l’Ethnopsychiatrie. Dans son séminaire, j’ai pu rencontrer son ancien élève Tobie Nathan. Quelques années plus tard en 1985, j’ai rejoint Tobie Nathan qui a créé la première consultation d’ethnopsychiatrie à l’hôpital Avicenne à Bobigny. C’est dans ce cadre que mon être en multiples fragments de vie s’est unifié. C’est via cette longue expérience clinique groupale que mes divers savoirs, accumulés dans différentes disciplines, sont devenus tangibles, actifs et efficients.
J’ai eu la chance de recevoir l’enseignement complexe du fondateur Georges Devereux et la pratique effective de l’ethnopsychiatrie transmise par mon ami et maître en clinique Tobie Nathan.
Le Matin d’Algérie : Votre culture d’origine berbère kabyle vous a-t-elle aidé dans vos recherches en ethnopsychiatrie ?
Hamid Salmi : Tout à fait, le fait d’être né dans un village kabyle avec sa riche culture orale et ses anciennes traditions m’a permis par exemple, de mieux comprendre les différents groupes et ethnies de l’Afrique sub-saharienne. Je me suis intéressé aux divers dispositifs traditionnels de concertation et de médiation comme l’assemblée villageoise (agraw), l’arbre à palabre… Pour comprendre les patients, il est important de connaitre, d’expliciter et d’utiliser les systèmes de pensée populaires qui sont nichés au cœur des contes, des mythes et des légendes de différents peuples.
Le Matin d’Algérie : Là où la psychologie moderne et la psychiatrie en particulier patinent, l’ethnopsychiatrie ouvre des voies, qu’en pensez-vous ?
Hamid Salmi : On peut le dire, l’ethnopsychiatrie, se situant entre différentes disciplines, est une recherche ouverte et une clinique créative. Elle fait rebondir les multiples concepts et élimine ceux qui ne sont pas ou plus opérants et efficients dans la clinique des migrants et des autochtones. Cette discipline tient compte de tous les segments d’une culture tels que les systèmes linguistiques, initiatiques, culinaires, ceux de l’alliance, de la parenté et de la filiation…C’est à la fois une thérapie groupale et familiale. Elle respecte et met en lumière également la nature et la singularité irréductible de la personne.
Les symptômes et les désordres psychologiques sont codés par la culture d’origine du patient. Il faut comprendre scientifiquement ce que signifient, par exemple, la notion de mauvais œil, possession, envoûtement… sans les réduire à des diagnostics structurels construits par la psychiatrie et la psychologie classique. Mais, nous travaillons, à la fois, pour créer des ponts entre les disciplines scientifiques et pour maintenir et encourager les complémentarités entre les différents praticiens qui entourent les patients.
Le Matin d’Algérie : Dans un monde qui a tendance à se refermer de plus en plus, l’ethnopsychiatrie a plus que jamais sa place, êtes-vous souvent sollicité par les acteurs sociaux et les médecins ?
Hamid Salmi : En effet, je suis sollicité par de nombreuses institutions sanitaires, éducatives, judiciaires, culturelles, religieuses. J’ai traversé depuis plus d’une trentaine d’années toutes ces institutions pour donner des conférences, former des professionnels, intervenir auprès de patients difficiles, superviser des équipes, créer des consultations, des groupes de parole dans des quartiers difficiles, des centres sociaux, des collèges, des prisons…C’est un travail passionnant, gratifiant et les résultats dépassent souvent mes espérances. J’aurai tant aimé transmettre le fruit de toute cette expérience aux professionnels en Algérie.
Le Matin d’Algérie : L’ethnopsychiatrie est une discipline assez récente, a-t-elle atteint ses objectifs ?
Hamid Salmi : Je peux dire que l’ethnopsychiatrie a atteint ses objectifs du point de vue de la recherche, de la complexité et de l’efficience de ses concepts. Elle s’est assez répandue en France et dans quelques pays occidentaux francophones. J’ai également enseigné cette discipline en Italie et au Canada. Mais, il reste toujours tant à faire sur le terrain clinique, éducatif et social.
Entretien réalisé par Brahim Saci
vendredi 17 novembre 2023
Ethnopsychiatrie : Cultures et thérapies, entretien
Catherine Pont-Humbert, Hamid Salmi, Édition Vuibert
…………………………………………………………………………………………….

« Nancy-Kabylie », un livre poignant de Dorothée-Myriam Kellou
Dorothée-Myriam Kellou vient de nous émerveiller par la publication d’un livre poignant, « Nancy-Kabylie », paru chez les Éditions Grasset. Ce livre époustouflant de beauté, de vérité, arrive comme un éclair dans le paysage littéraire parisien.
Nancy-Kabylie, un livre bouleversant. Il bouscule, il écorche, il interpelle le cœur et l’esprit, accapare le lecteur dès les premières pages pour ne plus le lâcher et celui-ci se laisse emporter par chaque ligne, par chaque page, par les souvenirs attachants mais souvent rudes d’une époque, d’une injustice passée sous silence, qui l’enveloppent et l’interrogent.
Dorothée-Myriam Kellou est animée par une quête perpétuelle quasi-spirituelle, de vérité, tentant d’apporter à chaque fois dans chaque création un éclairage nouveau. Rencontre.
Le Matin d’Algérie : Vous venez de publier un fabuleux livre Nancy-Kabylie, chez les Éditions Grasset, mais avant de parler de votre livre, qui est Dorothée-Myriam Kellou ?
Dorothée-Myriam Kellou : C’est une très bonne question. Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Car la quête est aussi collective. J’essaie d’y répondre dans mon livre en prenant ces détours par la France, l’Égypte, la Palestine, les États-Unis et l’Algérie. Mon père, Malek, qui a longtemps été silencieux sur son histoire m’a raconté dernièrement un mythe berbère sur l’identité. Nous sommes un miroir brisé. Toute notre vie durant, nous allons chercher les morceaux de ce miroir dispersés pour retrouver notre image. Grâce à ce livre, j’ai retrouvé de nombreux morceaux, mais il m’en reste beaucoup d’autres à trouver.
Le Matin d’Algérie : Vos créations sont toujours une quête de vérité, briser les silences à tout prix, d’où vous vient cette soif de liberté ?
Dorothée-Myriam Kellou : Peut-être me vient-elle de mes parents, qui tous deux ont eu soif de liberté très jeunes ? Mon père Malek a quitté son village, son pays pour embrasser le rêve du cinéma et se marier avec ma mère, Catherine, née dans une famille de la grande bourgeoisie, milieu qu’elle a souhaité quitter à son tour pour faire l’expérience du monde, du voyage et de la liberté.
Le Matin d’Algérie : Parlons de votre livre, il semble être le plus personnel, Nancy Kabylie, pourquoi le choix de ce titre ?
Dorothée-Myriam Kellou : J’ai aimé l’idée du tiret dans Nancy-Kabylie. J’ai longtemps cherché mon histoire algérienne. J’ai grandi à Nancy, voyagé et vécu en Égypte et en Palestine, étudié l’histoire et la langue arabe en France et aux États-Unis. Quand je suis arrivée à Mansourah, dans le village de mon père, dans le Sud de la Kabylie, ma famille me parlait en kabyle. J’ai alors pris conscience que le premier voyage que je cherchais à faire était Nancy-Kabylie, pour retrouver la langue, la mémoire, l’histoire du village kabyle où a grandi mon père.
Le Matin d’Algérie : Parlez-nous de la genèse de ce livre ?
Dorothée-Myriam Kellou : J’ai réalisé un podcast pour France culture, qui s’appelle l’Algérie des camps. Il s’agit d’une enquête de deux heures en huit épisodes qui interroge les conséquences du déracinement en masse qu’a subi la population algérienne pendant la guerre d’indépendance. À l’issue de la diffusion de ce podcast, j’ai reçu un mail de Pauline Perrignon, éditrice chez Grasset. Elle m’a demandé si j’avais le désir d’écrire. Elle avait senti en moi « une voix d’auteure », m’a-t-elle dit. J’avais déjà écrit une cinquantaine de pages sur la base de notes que j’avais prises lors de la réalisation de mon film À Mansourah tu nous as séparés (2019), où mon père était le fil rouge de l’histoire. J’ai alors osé poursuivre ce voyage intérieur et écrire ce livre de manière très intime.
Le Matin d’Algérie : Vous connaissez le poids du silence, en quoi votre livre est-il un travail de mémoire ?
Dorothée-Myriam Kellou : Je dis que c’est un travail de mémoire librement réimaginé. Je me suis laissée une liberté pour réécrire ma quête à partir de mes souvenirs de ce « grand voyage initiatique », comme l’appelle mon père. Grâce à ce travail de mémoire, commencé avec le film, À Mansourah tu nous as séparés, poursuivi avec le podcast, l’Algérie des camps, et le livre Nancy-Kabylie, j’ai été capable de chercher du côté de l’oubli l’histoire de mon père, de son peuple et de faire exister des paroles silenciées. Ce silence m’était insupportable. J’avais besoin que mon père me raconte, que les siens me disent ce qu’ils avaient vécu, dans l’intime, au plus profond d’eux-mêmes, pour comprendre leurs blessures, celles dont nous avons héritées en silence.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur votre père Malek
Dorothée-Myriam Kellou : Mon père s’appelle Abdelmalek Kellou. Cela m’étonnait toujours enfant de voir son prénom écrit différemment par l’administration française, tantôt Abdelmalek, tantôt Malek. Pour moi, il était papa Malek. J’étais très admirative de lui et le reste. Il a franchi terres et mer pour réaliser son rêve de faire du cinéma, pour s’exprimer librement, de manière créative. Enfant, j’aimais qu’il me fasse découvrir de beaux films d’auteurs au cinéma et qu’il me parle de ses projets de films. Plusieurs n’ont jamais abouti. L’un d’eux (Lettres à mes filles) a donné naissance à mon film, À Mansourah tu nous as séparés. Aujourd’hui, il termine un nouveau projet de film qui retrace l’histoire de son fantôme : le sergent Blandan, une statue coloniale qui se trouvait sur la route de son village à Alger, à Boufarik, et a été rapatriée et érigée sur la place publique à Nancy, où lui, l’exilé s’est installé et où nous avons grandi, ma sœur Malya et moi.
Le Matin d’Algérie : Votre double culture française algérienne vous a-t-elle aidée ou freinée dans votre carrière artistique ?
Dorothée-Myriam Kellou : Je pense que ce double ancrage est à la fois frein et élan. Cette part algérienne est toujours difficile à vivre en France. Les injonctions à la discrétion voire à l’effacement sont encore nombreuses. Mais c’est aussi une source d’inspiration et de création intarissable. Notre histoire, à nous descendants de colonisés, nous place en marge. Le défi est de ne plus faire de notre histoire une note de bas de page. Il faut œuvrer pour la remettre au centre, avec dignité et créativité. Nous sommes de plus en plus nombreux à le relever.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en perspective ?
Dorothée-Myriam Kellou : Je travaille sur un projet artistique avec le musée des beaux-arts de Nancy pour imaginer un contre-regard sur cette statue du Sergent Blandan, héros de la conquête coloniale, qui faisait si peur à mon père, enfant.
Le Matin d’Algérie : Maintenant il vous reste à apprendre le kabyle, qu’en pensez-vous ?
Dorothée-Myriam Kellou : Oh, j’aimerais tant ! Mais où ? Nous manquons d’espaces et de lieux pour l’apprendre en France. Quand je vais dans un café kabyle à Paris, je leur demande toujours de m’apprendre un mot. Je collectionne les mots. Peut-être que dans un an, j’en aurai déjà 365 ?
Entretien réalisé par Brahim Saci
mercredi 15 novembre 2023
« Nancy-Kabylie », Dorothée-Myriam Kellou, Grasset, octobre 2023
……………………………………………………………………………………………………

Rencontre avec l’actrice réalisatrice Catherine Belkhodja
Catherine Belkhodja est une artiste franco-algérienne au parcours atypique : auteure, plasticienne, reporter, performeuse, poétesse ou script doctor, on la connaît comme actrice réalisatrice, mais elle est aussi licenciée en philosophie, urbanisme, et architecte DPLG.
Après un passage à l’Education nationale, elle se spécialise en architecture bioclimatique, travaille comme urbaniste au schéma directeur de l’éclairage, poursuit ses recherches en philosophie jusqu’à l’obtention d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en esthétique. Sa soif des arts ne s’arrête pas là. Après des études de théâtre au Conservatoire d’Alger, elle étudie au Conservatoire supérieur d’art dramatique de Paris, et commence une immersion fulgurante dans le monde de la télévision et du cinéma.
Le Matin d’Algérie : Vous avez un parcours fascinant. qui est finalement Catherine Belkhodja ?
Catherine Belkhodja : Fascinant, je ne sais pas. Atypique surtout, car je suis avant tout curieuse de découvrir le monde et d’expérimenter différentes approches créatives. J’aime rencontrer de belles personnes qui me font partager leur regard sur le monde et leur univers.
C’est pourquoi je consacre une partie de ma vie au questionnement : – questionnement philosophique mais aussi questionnement plus global envers les êtres qui m’entourent, leur culture, leur façon de vivre quotidienne ou leur créativité, le plus beau cadeau qu’on puisse me faire c’est de m’ouvrir des frontières en me faisant partager de nouvelles connaissances.
Nous avons tous le devoir de transmettre nos savoirs et d’apprécier ce que les autres ont la générosité de nous transmettre. J’ai eu le privilège de pouvoir suivre les études qui m’intéressaient mais les savoirs ne se limitent pas aux études officielles ou académiques. On peut apprendre de tous les êtres qui nous entourent, y compris de personnes qui n’ont jamais suivi d’études. J’apprécie particulièrement les autodidactes qui ont tracé leur propre parcours en s’inventant les outils pour le faire. C’est d’ailleurs le cas de mon cher père qui m’a beaucoup appris. Il nous a toujours incités à progresser, à aller de l’avant, en dépassant nos limites. De lui j’ai gardé le goût d’aller toujours plus loin, au-delà de ma zone de confort.
Le Matin d’Algérie : Quelle pourrait être votre devise ?
Catherine Belkhodja : Ma devise serait d’inventer chaque jour sa vie. J’ai pratiqué de nombreux métiers qui m’ont tous comblée… jusqu’à ce que j’en fasse le tour. Au début, il est évident que je devais surtout assurer mes moyens d’existence et celle de ma famille. Mais c’est toujours intéressant de s’adapter au Réel tout en se projetant vers un futur plus conforme à nos désirs. Il ne faut jamais renoncer à nos rêves d ‘enfance. Je n’ai jamais songé spécifiquement à « faire une carrière » mais plutôt à réaliser différents projets, aussi variés soient-ils, en fonction de mes centres d’intérêt, en créant un terrain favorable pour m’y préparer et en me forgeant les moyens de les réussir. Je n’ai jamais fini d’apprendre et j’aime penser que le futur me réserve encore bien des surprises. Naturellement, plus on avance, et plus les projets deviennent des défis qui nécessitent davantage de moyens, de ténacité ou de patience.
Par ailleurs, il m’a toujours paru important de réserver une partie de mon temps à la création d’un monde meilleur en s’impliquant dans des actions concrètes pour faire avancer des questions qui me tiennent à cœur comme la cause des femmes, l’écologie, la promotion des cultures, la situation des seniors, le droit des peuples …Chaque avancée est précieuse et mérite d’être tentée.
Je suis fière et heureuse d’avoir pu collaborer à la lutte contre le gaspillage alimentaire et la distribution aux associations, l’amélioration des EHPAD, l’observatoire de la diversité, la promotion des femmes, des énergies douces, d’artistes divers ou la défense de l’environnement.
L’art occupe cependant la majeure partie de ma vie. Il m’est absolument indispensable, même si les supports utilisés varient souvent : peinture, sculpture, installations multi- médias ou performances alternent avec le théâtre (actrice, adaptatrice, auteure ou mises en scène), le cinéma, la télévision (conception, animation, journaliste ou réalisatrice) ou l’écriture (poésie, haikus, nouvelles, scénarios). Cette forme d’art protéiforme peut désorienter parfois mais dans la mesure où je ne cherche pas des prouesses techniques, ces recherches ne sont pas incompatibles et se nourrissent mutuellement. J’ai grand plaisir aussi à organiser des évènements culturels (expositions, concours ou spectacles), pour moi, chaque journée est différente.
Cette nuit par exemple, j’ai conçu et réalisé la structure d’une sculpture en grillage métallique et matériaux de récupération divers (cartons, tissus, charriots, papiers et manche à balai) pour une exposition collective sur le thème de la différence inaugurée le 1 décembre. Mains griffées en coupant le grillage avec quelques restes de colle à effacer avant un casting. Le matin, les dernières corrections d’un article pour une publication dans une revue à laquelle je collabore. Dans la foulée, réponse à une interview sur Chris Marker avec qui j’ai travaillé une trentaine d’années.
J’organise en effet un festival Chris-Marker au cinéma Le Méliès de Montreuil avec l’équipe de programmation. Une séance de travail pour élaborer l’animation d’une conférence à l’Université du Caire ou la programmation d’une résidence artistique à Louxor. Au passage, noter quelques haikus sur le thème du scarabée ou travailler le fond d’une toile en devenir. Pause relax pour relire une pièce surréaliste de Jayne Mansour dont je dois assurer la mise en scène au printemps 2024, pour l’anniversaire des 100 ans du surréalisme à la Maison André Breton. Contacter un photographe au Sénégal pour une exposition sur les masques de lions ou la conception d’un nouveau magazine.
La journée se poursuit ainsi sur des chapeaux de roue, incluant films, livres ou pièces de théâtre à chroniquer. Depuis que mes enfants sont autonomes, et après le décès de mes parents dont je me suis beaucoup occupée en fin de vie, je peux me donner davantage à mes propres recherches ou activités. J’aime aussi être surprise avec des propositions de collaboration diverses pour des textes, des mises en scène, des conférences ou des expositions.
Le Matin d’Algérie : Depuis votre enfance à Alger, vous êtes habitée par les arts, l’art dramatique en particulier, pouvez- vous nous en parler ?
Catherine Belkhodja : Mes premiers cours datent effectivement de mon adolescence, au Conservatoire d’Alger où j’étudiais le violon, le solfège et la diction. C’est aussi à Alger que j’ai fait mes premiers pas au théâtre.
Je me souviens d’une toute petite apparition dans « Mon corps, ta voix et ta pensée » (dans un petit théâtre situé derrière « Les Galeries algériennes ») qui était passée aux actualités à la télévision algérienne et m’avait valu les taquineries de mes camarades de lycée. J’avais adoré aussi participer aux pièces présentées au lycée. Plus tard, on m’avait proposé de rejoindre la troupe de Kateb Yacine pour « Mohammed prends ta valise » mais mon père s’y était opposé.
Lorsque j’ai eu ensuite l’opportunité d’interpréter un petit rôle d’institutrice dans un film de Lallem, j’avoue que j’ai désobéi et me suis rendue sur le tournage. Si je me souviens bien, j’avais été repérée au club d’équitation de Blida pour une scène à cheval et voulais saisir cette chance. Par la suite, une partie de l’équipe avait quitté le tournage et j’ai eu l’opportunité de remplacer au pied levé la script girl, l’occasion pour moi découvrir les rudiments d’un tournage. J’avais participé aussi à la création de décors en réalisant plusieurs affiches de films lorsque j’étais étudiante aux Beaux-arts d’Alger.
Après mon bac, j’ai eu l’autorisation de poursuivre mes études à paris. Là, j’ai rejoint aussitôt une petite troupe de théâtre d’avant-garde, avant de prendre de nouveau des cours au conservatoire du cinquième arrondissement, puis du Conservatoire national Supérieur. Malheureusement je ratais certains des cours car je devais aussi gagner ma vie. Mon agent Myriam Bru avait décroché mes premiers rôles. Mes premiers cachets m’ont permis de quitter l’Education Nationale et de publier mes premiers articles, avant de rejoindre l’agence Gamma TV au début comme journaliste, puis présentatrice d’émissions TV avant de rejoindre la réalisation de sujets sociétaux. Par la suite j’ai proposé des concepts, animé des émissions TV, réalisé mes premiers courts métrages et décroché un sept d’or pour l’émission Taxi, avant de me tourner vers le cinéma.
Le Matin d’Algérie : Vos enfants font tous du cinéma, Léonor, Kolia, Jowan, Maïwenn et Isild font une carrière impressionnante. Pouvons-nous dire que vous leur avez transmis le gène de la création ?
Catherine Belkhodja : Disons que je leur ai surtout transmis l’amour du cinéma mais ils n’ont pas tous souhaité en faire une carrière.
Léonor, qui a étudié la musique à mi-temps au Conservatoire de Paris est devenue auteure-compositrice et suit une brillante carrière en sociologie de la littérature. Elle a enseigné dans plusieurs universités, a créé une école de français en République dominicaine, tout en étant chercheuse, script doctor et journaliste.
Kolia, avec des débuts très prometteurs comme acteur (deux rôles principaux primés et excellentes critiques) a préféré s’orienter vers des activités humanitaires et la médiation culturelle. Jowan, a préféré poursuivre comme chef opérateur et documentariste. Lui aussi adore son métier et est capable de résister à des conditions climatiques redoutables pour réaliser ses films. Son premier documentaire a été sélectionné au film du Réel et acheté par ARTE.
Seules Isild et Maiwenn ont souhaité poursuivre comme actrices, mais sont devenues également auteures et réalisatrices. Contrairement à ce qu’on a pu lire dans certains journaux, je n’ai pas spécialement cherché à « pousser » mes enfants dans ces métiers mais comme ils vivaient avec moi, ils ont constaté le plaisir dans mon travail et participaient à certains projets.
Mes filles ont sans doute aussi pu comprendre les difficultés du métier et les luttes pour parvenir à faire les films que l’on porte en soi. Ces expériences ont sans doute été bénéfiques pour elles car elles ont pu résister aux obstacles et aller jusqu’au bout de leurs projets. Pourtant, ce n’était pas facile pour elles car elles étaient jeunes et ne sortaient pas d’une école de cinéma. Néanmoins leur forte personnalité leur a permis de vaincre les résistances et de s’imposer dans un métier où les femmes ont plus de difficultés à trouver des financements. Elles n’ont pas hésité d’ailleurs à devenir elles-mêmes productrices de leurs propres films avant d’acquérir la confiance des producteurs, grâce à leur succès. Ce sont de vraies battantes qui ne renoncent jamais. Je n’ai sans doute pas été une mère modèle mais je suis fière d’avoir transmis l’amour du travail bien fait et le courage de tenir bon même quand les obstacles nous découragent.
Ce n’est pas si facile de concilier travail et maternité. Il faut privilégier les priorités. On fait forcément des erreurs mais pour moi, ce qui importe le plus c’est d’aider nos enfants à trouver leur voie en leur permettant d’être autonome avec un métier qu’ils aiment et qui les rend heureux.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur votre père, Kaddour Belkhodja qui nous a quittés à l’âge de 90 ans.
Catherine Belkhodja : Je n’ai pas la mémoire des dates. Papa était un vrai patriarche. Terriblement autoritaire mais très attentif et impliqué dans notre éducation. Il venait d’une famille aisée mais avait perdu son père très jeune. Comme de nombreux émigrés, il a rejoint la France pour gagner sa vie. Il a toujours été un exemple pour moi : Hyperactif, il arrivait à concilier son travail, ses activités militantes, et avait une constante soif d’apprendre et d’étudier. Il n’avait que son certificat d’études en arrivant en France mais tout en travaillant dur et en suivant des cours le soir, a fini par décrocher deux doctorats …Un vrai autodidacte qui en plus s’impliquait beaucoup dans la vie familiale. Il a toujours partagé avec ma mère les tâches du foyer : un vrai féministe avant l’heure, ce qui était plutôt rare à son époque et avec l’éducation reçue. Par contre, il était très autoritaire et pouvait nous terroriser parfois. Comme nous étions trois filles, il a toujours considéré que nous devions poursuivre des études.
Mais il était beaucoup moins généreux pour les autorisations de sortie !
Il a été un grand spécialiste de l’émigration algérienne et a réuni des documents précieux qui feront sans doute l’objet d’une future publication. Il a écrit aussi un livre plus personnel qui sera publié prochainement. C’était aussi un conteur né, et un vrai médium doué de facultés télépathiques qu’il m’a aussi transmises. Ma mère aussi était une femme exceptionnelle d’une grande personnalité. Mon père l’adorait et la respectait infiniment.
Le Matin d’Algérie : Vous avez à votre actif dix-sept longs métrages, douze courts métrages, neuf téléfilms, cinq pièces de théâtre. Quels sont vos souvenirs ou projets au théâtre ou de cinéma ?
Catherine Belkhodja : Je regarde rarement le passé et suis plutôt tournée vers l’avenir. D’ailleurs je n’ai pas de copies et égare souvent mes propres textes. Je suis heureuse de les redécouvrir quand ils ont été publiés. Dans le cinéma, mes prestations sont encore très modestes, même si mon rôle dans Level Five de Chris Marker a été très salué par la critique et m’a ouvert les portes … du dictionnaire du cinéma. (rires)
Pour le théâtre, je retiens surtout mes dernières créations : l’adaptation et la mise en scène de « Splendides exilées », une pièce d’Arezki Metref dont j’interprétais le premier rôle en compagnie de Myriam Mézières, Alexandra Steward et Noëlle Châtelet. Cette pièce avait d’ailleurs été présentée aussi en Algérie au festival Raconte-Arts et sélectionnée au festival international de théâtre de Bejaïa. Par la suite, j’ai écrit et mis en scène deux autres pièces : « Heureux comme un roi » avec Denis Lavant présentée au Théâtre de la Halle aux cuirs à Paris-la Villette, et « Escalade nocturne » au théâtre 104, à Paris également.
Ces deux pièces font partie d’une trilogie sur l’émigration. Le troisième volet « Macadam » est en cours d’écriture. Ces pièces ont été mises en scène au moment du Covid, ce qui a malheureusement stoppé les tournées prévues. Je garde un beau souvenir également de l’adaptation au théâtre du «Dépays» de Chris Marker avec Etienne Sandrin, présentée à Avignon et à Paris, au Collège des Bernardins. Cette pièce fera d’ailleurs bientôt l’objet d’une reprise à Paris et d’une tournée au Japon.
Le Matin d’Algérie : Vous avez beaucoup écrit dans la presse, dans des revues, des magazines. Vous avez cofondé le périodique Le Marco Polo magazine, fondé la maison d’édition Karedas dont vous êtes la directrice artistique, créé le grand concours International de haïku Marco-Polo, vous avez fondé également l’association culturelle Belleville Galaxie. Vous êtes une artiste infatigable, avez-vous des projets en cours ?
Catherine Belkhodja : J’ai toujours plusieurs projets en cours. Certains sont plus longs à mettre en place mais je n’y renonce pas pour autant. Ma prochaine pièce de théâtre «Macadam» bouclera ma trilogie sur l’émigration mais nécessite des partenariats avec des coproducteurs. Elle sera plus longue à mettre en place que les deux précédentes, qui nécessitaient peu de moyens. Une autre pièce, surréaliste, écrite par Jayne Mansour sera présentée à la Maison André Breton (La rose impossible) pour l’anniversaire du Surréalisme.
En cours de finalisation, un projet avec Philippe Bouret, poète, auteur et psychanalyste qui m’a présenté des photos d’installation d’objets quotidiens, que j’accompagne de haikus. Les premiers haishas ont fait l’objet d’une publication chez MARSA. J’ai également un recueil de nouvelles en gestation pour l’automne sans doute. Certaines parues dans les revues ou maisons d’édition comme Brèves, Marsa, Liroli, TK21, Le Lithaire ou la Belle inutile.
Le Matin d’Algérie : Votre double culture Française algérienne, a-t-elle été d’un grand apport ou un frein dans votre carrière d’actrice réalisatrice ?
Catherine Belkhodja : En termes de culture, c’est une vraie richesse. Pour l’action sur le terrain, cela peut être un handicap. Trop française en Algérie, trop algérienne en France. Le nom de mon père, que j’ai voulu conserver en refusant de prendre un pseudo, a plutôt été un frein : Le fameux plafond de verre, inutile de faire un dessin.
La culture de mon père, je la découvre davantage maintenant car durant mon enfance, il était très occupé et à l’adolescence, j’étais pensionnaire. J’ai appris l’arabe à l’école car maman ne le parlait pas. J’ai pu passer mon bac algérien mais avais malgré tout beaucoup de lacunes en arabe. Néanmoins, j’ai pu jouer deux fois en arabe lors d’un tournage à Venise et un autre à Berlin. Mon agent de l’époque m’avait classée dans les « actrices étrangères » et ne m’envoyait pas sur les castings en français. Inversement, après le conservatoire, on ne me proposait plus de rôle en arabe. En matière de réalisation, c’est épuisant de travailler sans le soutien d’une production.
En Algérie, la coproduction de la télévision algérienne s’est avérée fictive. Le seul soutien dont j’avais pu disposer était un car de l’office du tourisme pour mon équipe. Je leur en suis très reconnaissante. Les autres soutiens promis n’ont jamais été effectifs.
Seule la télévision française avait respecté les contrats (FR3, ARTE et Canal +). J’avais ensuite fondé une maison de production mais la gestion s’est avérée chronophage. Je me suis tournée alors vers des projets plus rapides à mettre en place. J’ai un scénario de long métrage qui me tient à cœur mais ne m’y consacrerai que lorsque je pourrai m’appuyer sur une maison de production solide. C’est trop compliqué de devoir tout gérer en même temps. Il vaut mieux former une belle équipe, fiable, pour de tels projets.
Je me suis lancée souvent dans des projets sans moyens. Maintenant je préfère prendre le temps de bâtir un vrai partenariat, pour ce projet plus ambitieux. En attendant, les idées ne manquent pas !
Entretien réalisé par Brahim Saci
lundi 13 novembre 2023
Le Matin d’Algérie.
Lematindalgerie.com
………………………………………………………………………….

Rencontre avec l’écrivain Jean-Claude Michot
Jean-Claude Michot est un écrivain romancier très prolifique, il a publié plus de quinze romans et la plupart des histoires de ses romans se déroulent à Lyon, cette ville où il a exercé le métier de chauffeur de taxis pendant vingt ans, après avoir côtoyé tant de gens, il est à même de mieux comprendre l’âme humaine dans sa part mystérieuse et sa complexité.
L’écriture dont le style et la force n’ont pas cessé de s’élever pour donner le meilleur dans l’ombre et la lumière, comme ferait un peintre jouant avec les couleurs, mais Jean-Claude Michot jouant avec les mots. Cette écriture qui n’a pas cessé de s’affiner, elle s’est imposée pour le plus grand bonheur des lecteurs. Les romans de Jean-Claude Michot captivent, désorientent, entre suspense et intrigues, le tout si bien tissé pour nous tenir en haleine.
Le Matin d’Algérie : Benoît Cohen pour écrire son roman Yellow cab, Taxis jaune, a décidé de devenir chauffeur de taxi pendant plusieurs mois à Manhattan comme son héroïne, afin de mieux restituer la réalité dans la fiction, mais vous, vous avez été chauffeur de taxi pendant 20 ans, vous avez écouté des milliers de gens, l’écriture coule chez vous comme un fleuve, comment est née cette soif d’écrire ?
Jean-Claude Michot : Paradoxalement, ce n’est pas mon ancien métier qui m’a donné l’envie d’écrire, mais c’est un cri du cœur. Mon père ayant été abandonné par sa mère, institutrice, qui n’a pas voulu l’élever car il n’était pas désiré, en a beaucoup souffert. J’ai voulu décrire la vie de ma grand-mère, sans pour autant la dénigrer et par ce livre : « 1927. Marthe, institutrice et fille mère », j’ai rendu hommage à mon père et tenté de raconter ce qu’a pu vivre ma grand-mère.
Après ce livre, j’ai désiré transmettre mon ressenti sur mon voyage par la route de Lyon jusqu’en Inde en 1978. Puis, mon troisième livre fut : « Jean le taxi », fruit de mon expérience, mais aussi fiction mâtinée d’intrigues.
Ensuite, je n’ai eu de cesse de continuer cette aventure littéraire et le besoin d’écrire est devenu de plus en plus impérieux, au fil des ans,
Le Matin d’Algérie : Maintenant les romans se succèdent, auriez-vous écrit si vous aviez fait un autre métier ?
Jean-Claude Michot : Il faut savoir que je n’écris que depuis l’âge de 60 ans ; il est vrai que durant ces longues années de taxi, j’ai eu le temps, en étant en attente de clients, de lire pas mal de livres, ce qui m’a sans doute aidé à écrire.
Le Matin d’Algérie : comment vous vient l’inspiration ?
Jean-Claude Michot : Bonne question ! Le plus dur est de trouver un sujet. Ensuite l’inspiration me vient tout en écrivant, assez naturellement, je dois dire. Peut-être suis-je inspiré par tout un fatras de réminiscences des nombreux films que j’ai visionnés. Mais, cela est une spéculation. En revanche, il m’est arrivé de rester bloqué plusieurs jours, en attente d’une idée pour pouvoir poursuivre mon roman.
L’habitude aussi m’aide énormément et écrire est devenu un peu comme un réflexe.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les auteurs qui vous inspirent ?Jean-Claude Michot : Il n’y en a pas beaucoup. Je dirais : Emile Zola, Hermann Hesse dont j’ai lu presque tous les livres et David Goodis, un des maîtres américains du roman noir.
Le Matin d’Algérie : Votre écriture n’a pas cessé de s’affiner, qu’en pensez-vous ?
Jean-Claude Michot : Vous avez raison. N’ayant pas fait d’études supérieures en lettres, ayant toutefois une base de quatre années de latin, il m’a été assez difficile d’avoir un bon style dès le début de cette aventure. Je dois dire que je suis assez méticuleux et rigoriste et j’essaie de ne pas m’endormir sous mes lauriers. Je ne fais quasiment jamais relire mes livres pour l’orthographe, deux ou trois fois, j’ai fait appel à une collègue pour vérifier la logique de l’histoire et la syntaxe.
Maintenant, je pense qu’avec la force de l’habitude et la rigueur que je m’impose, il est normal que mon écriture se soit affinée. Je suis peut-être comme le bon vin, je m’améliore en vieillissant !!
Le Matin d’Algérie : La littérature peut-elle aider à changer notre vision du monde ?
Jean-Claude Michot : Absolument ! Mais il dépend des auteurs que l’on lit. « Germinal » d’Emile Zola que j’ai lu étant tout jeune m’a effectivement chamboulé et, par la suite, j’ai continué à découvrir des livres abordant le sujet qui me tenait à cœur. Oui, les livres nous aident à acquérir une vision élargie des phénomènes du monde. Après c’est aussi une question de sensibilité. Tout le monde ne ressent pas le même livre d’une façon identique. Problèmes de vibrations, certainement. Mais le terreau est important.
Entretien réalisé par Brahim Saci
jeudi 2 octobre 2023
Le Matin d’Algérie
Lematindalgerie.com
……………………………………………………………………………..

Le discret poète Abdelouahab Mouheb n’est plus
Abdelouahab Mouheb ce poète de génie discret qui a écrit pour Slimane Azem et Idir s’est éteint le 24 octobre 2023 à l’âge de 75 ans, chez lui à Villejuif (région parisienne), vers 20h d’un arrêt cardiaque dans son sommeil.
Abdelouhab Mouheb est originaire du village Tifrit Naït Oumalek dans la commune d’Idjeur en Kabylie, au pied de l’Akfadou, dans la mémoire collective des villageois Abdelouahab Mouheb est presque un mythe, une légende, il est l’héritier des poètes antiques, le poète, le fabuliste, il est celui qui a écrit pour l’immense Slimane Azem. C’est dire l’immensité également de ce poète.
À Paris, Abdelouhab était aussi Aby pour les uns ou Albert pour d’autres. Il était un poète hors du commun qui avait une maîtrise parfaite de la langue kabyle, son amour pour la poésie et les contes anciens était immense. Il maniait aussi la langue française à la perfection, féru de littérature, de poésie, il pouvait aisément passer du kabyle au français, ses traductions poétiques et ses poèmes en kabyle sont d’une dimension esthétique élevée.
Il avait accepté il y a quelque temps de répondre à mes questions mais nous n’avons jamais réussi à nous revoir. A chaque fois il y avait un fâcheux contretemps. Cet entretien ne se fera jamais, il avait pourtant tant de choses à raconter sur sa rencontre avec Slimane Azem, sur sa collaboration avec Idir et sur son parcours artistique personnel.
En 1974, grâce à un ami bijoutier Salah Cheref, issu du même village, qui avait une bijouterie avec sa femme française à Belleville, il rencontre Slimane Azem à Paris, dans son café situé Boulevard de la Chapelle, une collaboration s’ensuit avec Slimane Azem qui était émerveillé par ce jeune poète.
Abdelouhab Mouheb remet à Slimane Azem cinq poèmes qu’il chantera. Slimane Azem lui donne cinq cents francs, ce qui était une belle somme pour l’époque avec la promesse de le déclarer à la SACEM, ce qui ne se fera malheureusement jamais malgré l’insistance d’Abdelouhab. Une semaine après cet échange Abdelouhab revient au café voir Slimane Azem, celui-ci lui dit que la chanson, Muḥ yetabaɛ Muḥ, est sous presse, Abdelouhab s’enquiert de la promesse de le déclarer à la SACEM, Slimane Azem lui promet une nouvelle fois qu’ils iraient ensemble, ce qui n’arrivera jamais, même après l’entremise du frère d’Abdelhouhab qui écrit à Slimane Azem à Moissac, l’intervention est restée lettre morte.
Abdelouhab n’a plus jamais, à notre connaissance cherché après Slimane Azem. Nous aurions aimé que cette collaboration perdure vue la beauté de ces poèmes avec la composition et l’interprétation de génie de Slimane Azem.
– Awin i k-id yeran a Simoh Oumhend
– Yusa-yid lefker– Muḥ yetabaɛ Muḥ
– Le poème l’hirondelle, l’adaptation en français de la chanson, Ay afrux ifilelles
– Tamɣeṛt d umcic
En 1981 Abdelouhab Mouheb est à radio berbère. Il participe à des émissions poétiques, où il a côtoyé Abdallah Mohia, c’est la rencontre de deux poètes, avec qui il a gardé une grande amitié, ils avaient une admiration réciproque.
Abdelouhab Mouheb a côtoyé Idir pendant de longues années, ils ont été très proches, il était le parolier de sept chansons de l’album, Le petit village, Taɣribt-iw, avec la chorale Tiddukla de l’ACB de Paris (l’association de culture berbère), en 1985.
– Taddart-iw (Le Petit Village)
– Aman yeddren (L’Eau vive)
– Aԑeqqa n yired (Le Grain de blé)
– Amɣar (Le Vieux)
– Taɣribt-iw (Sources)
– Itran, tiziri (Au clair de la lune)
– Tiziri yulin (Les Trois Petites Fées)
Des années plus tard, il écrit les paroles de la chanson, Ageggig, de l’album, les chasseurs de lumières, « Iseggaden n tafat », le titre de l’album est tiré du poème, Ageggig.
La collaboration avec Idir s’est hélas terminée après cet album. Abdelouhab Mouheb considérait qu’Idir ne reconnaissait pas sa vraie valeur, il ne l’a jamais cité ni en public ni dans les médias.
Tel est le destin du poète de génie resté dans l’ombre malgré sa collaboration avec les plus grands, Abdelouhab Mouheb s’en est allé comme il a vécu en toute discrétion, sans prévenir. Il m’avait confié son désir de publier un livre, hélas il est parti avant sa réalisation, que sa belle âme repose en paix.
Je vous laisse apprécier la beauté de cette chanson chantée par Idir, écrite par Abdelouhab Mouheb.
Brahim Saci
jeudi 26 octobre 2023
Le Matin d’Algérie
Lematindalgerie.com
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Mack Nat-Frawsen : « Quand l’inspiration est là, il faut la saisir pour écrire »

Mack Nat-Frawsen est universitaire, consultant en informatique de gestion, c’est un poète écrivain prolifique. Il n’est pas seulement poète mais il est aussi romancier. C’est un intellectuel d’une discrétion rare, qui a fait le choix d’écrire sous le pseudonyme de Mack Nat-Frawsen.
Publier des recueils de poésies et des romans peut paraître paradoxal mais dans le cas de Mack Nat-Frawsen il n’en est rien, car les deux découlent d’une même source poétique créatrice et passer du recueil au roman, loin d’être un dépaysement, est un enrichissement littéraire élevé.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un auteur prolifique, qui est Mack Nat-Frawsen ?
Mack Nat-Frawsen : Quand l’inspiration est là, il faut la saisir pour écrire et peindre des mots sur cette page blanche à portée de main.
Je suis natif de la région des At Frawsen, plus précisément de Mekla. Cette belle région montagneuse, au pied du Djurdjura petite sœur du Kilimandjaro.
En septembre 1993, j’ai quitté la Kabylie pour poursuivre mes études universitaires en France. Après un DEUG A (sciences et structure de la matière), j’ai fait un cursus de deuxième cycle d’ingénieur en génie des systèmes industriels. A la sortie de la fac, j’ai intégré le domaine de l’informatique de gestion où j’exerce en tant que consultant et chef de projets. Un métier qui m’a permis de découvrir la France entière.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un poète, écrivain discret, vous écrivez sous le pseudonyme de Mack Nat-Frawsen, ceci ne risque-t-il pas de desservir votre popularité ?
Mack Nat-Frawsen : Sourire… À dire vrai, je n’aime pas trop que l’on me dise que c’est un pseudonyme, car il n’en est pas du tout. Je l’ai choisi pour rendre hommage à ma région natale. Si une quelconque lumière devait briller sur ma personne, alors je préfère la partager avec cette belle région qui m’a vu naître.
Le Matin d’Algérie : Votre écriture est d’une dextérité poétique rare, comment réussissez-vous cet exploit ?
Mack Nat-Frawsen : Pour être franc, je l’ignore complètement. Pour moi, ce n’est pas un exploit. Je ne fais que lier les mots et accorder les temps. Mais la lecture aide sans doute, car elle est cet océan qui nous inonde de voyages et de rêves.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un auteur singulier, vous passez aisément de la poésie au roman, quels sont les écrivains et les poètes qui vous parlent ?
Mack Nat-Frawsen : Le roman, pour moi, n’est qu’une autre face de la poésie avec un autre orchestre polyphonique. Passer de la poésie au roman serait cet entracte qui permet de passer de la face A à la face B d’une mélodie permettant de peindre des tableaux avec des mots arborant les couleurs de nos états d’âme du moment.
Quant aux écrivains et poètes qui me parlent, ils sont nombreux, mais je citerai feu Christian Bobin qui m’a beaucoup marqué par la force magique et graphique de son verbe, Mouloud Feraoun qui m’a permis de prononcer mes premiers mots dans la langue de Molière, Mohammed Dib, Tahar Djaout, Rachid Mimouni, Ernest Hemingway, Jean Sénac, Jack London, Fernando Pessoa, Pablo Neruda. La liste est longue, mais je n’oublierai pas de citer certains de mes amis écrivains et poètes comme Farid Abache, Youssef Zirem, Améziane Aizaf, Azeddine Lateb et notre serviteur Brahim Saci.
Le Matin d’Algérie : Vous avez beaucoup publié, qu’est-ce qui vous inspire ?
Mack Nat-Frawsen : J’ai publié, à ce jour, dix recueils de poésie et deux romans. Tout peut m’inspirer, mais cela dépend du moment et du lieu. La lecture d’une phrase, dans un roman par exemple, peut faire l’objet d’un flash qui va m’inspirer quelques vers d’un poème. Un voyageur (homme ou femme) sur un quai de gare peut m’inspirer un paragraphe ou quelques pages d’un roman. J’écris souvent pendant mes voyages en train ou en avion.
Le Matin d’Algérie : Que pensez-vous de la littérature algérienne actuelle ?
Mack Nat-Frawsen : La littérature algérienne a connu une belle évolution ces vingt dernières années. J’ai rencontré beaucoup de jeunes écrivains et poètes, dans les différents salons du livre organisés en Kabylie, ainsi que via les réseaux sociaux. À chaque fois que je me rends en Algérie, je reviens avec presque une dizaine de nouveaux livres écrits par cette jeunesse qui n’a pas à rougir devant toutes littératures du monde. Nos jeunes continuent de maintenir cette belle flamme de création littéraire, léguée par nos anciens auteurs et anges tutélaires tels que Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Mohammed Dib, Kateb Yacine, Tahar Djaout, Assia Djebar et tant bien d’autres.
Interview réalisée par Brahim Saci
Ouvrages édités sur Amazon :
Romans
Le voyage avec Élise
Lettres aux absences
Recueils de poésie
Le bleu du littoral
Le vers de la mélodie
La rivière espérance
Les beaux rêves demain
Vers au vent
Agris n unebdu – Les flocons de l’été
Le souffle du zéphyr
Mots éparpillés
Eclats de vers poétiques
Le quai aux fleurs câlines.
Interview réalisée par Brahim Saci
Samedi 7 octobre 2023
Lematindalgerie.com
………………………………………………………………………………………………………….
Rachid Boutoudj : « Rien ne peut désancrer la littérature algérienne d’expression française »
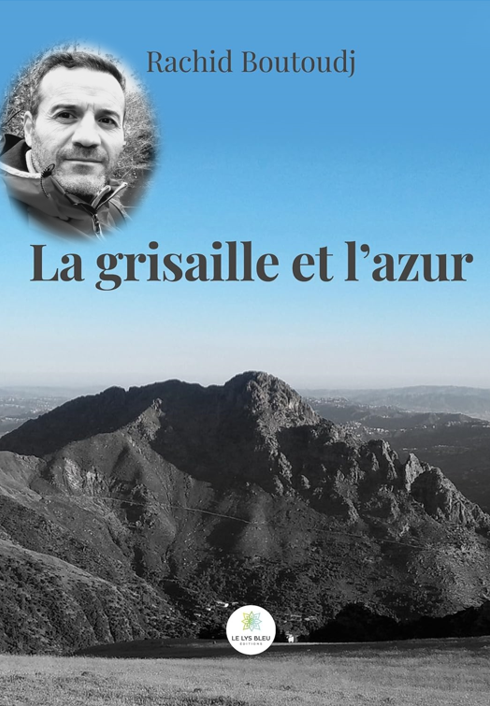
Rachid Boutoudj est titulaire d’un doctorat en électronique à l’Université des Sciences et technologies de Lille, il vient par bonheur de publier chez, Le lys bleu, un beau recueil de poésie intitulé « La grisaille et l’azur » avec une préface de José Alfredo Vasquez Rodriguez.
« La grisaille et l’azur » est un titre qui interpelle en laissant entrevoir le beau voyage poétique entre l’ombre et la lumière, le tout écrit dans une langue française, ciselée, épurée, page après page jaillissent des élans poétiques insoupçonnés émerveillant le cœur et les yeux. Rencontre.
Le Matin d’Algérie : Vous venez de publier un beau livre de poésie, « La grisaille et l’azur », pouvez-vous nous parler de la genèse de ce livre ?
Rachid Boutoudj : Je savais que je devais écrire depuis le premier jour où j’ai foulé le sol de la France avec ma fraiche majorité en bandoulière.
En arrivant en France, j’ai élu domicile dans un foyer d’immigrés, ouvriers de nuit dans les filatures de l’Armentiérois, dans le nord.
Après l’ébranlement émotionnel lié à ces diverses fulgurances de la modernité qui émerveillent un montagnard qui venait de quitter la quiétude séculaire de son hameau, j’ai fait face pour la première fois de ma vie aux affres du déracinement et aux langueurs extrêmes de la nostalgie. J’ai aussi observé ces braves hommes asservis par la furie des manufactures. C’est dans ce contexte que j’ai alors commencé à griffonner des petits textes dans un petit calepin tout en lisant abondamment.
Après mes études universitaires, lors d’un séjour pour raison professionnelle dans l’est de la France, une région où l’hiver est bien plus rude qu’ailleurs, étreint par une profonde mélancolie, j’ai écrit le premier poème qui augure ce recueil et ce dernier m’a été inspiré par l’âpreté de la destinée de ma mère. Ensuite la muse a eu la lumineuse idée de venir me caresser joyeusement de ses petites ailes frissonnantes pour m’insuffler l’ensemble de ce livre.
Le Matin d’Algérie : Un mot sur José Alfredo Vasquez Rodriguez qui a préfacé votre livre, parlez-nous de cette rencontre ?
Rachid Boutoudj : Alfredo est un ami précieux. Nous nous sommes rencontrés sur un terrain de football. C’est un Espagnol originaire de l’Andalousie. Il est professeur dans le nord de la France. L’histoire et la littérature dans sa globalité sont des domaines qui le passionnent. Il a été mon premier lecteur. Au gré de nos rencontres il n’a jamais cessé de m’encourager à faire connaître du grand public mes poèmes. C’est ainsi qu’un jour j’ai suivi ses conseils. Pour lui témoigner ma gratitude j’ai spontanément songé à lui pour écrire la préface de ce recueil, mission qu’il a naturellement acceptée tout en disant que désormais notre amitié connaitra une certaine postérité. Je souhaite à chacun d’avoir un ami aussi loyal aussi bienveillant qu’Alfredo.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes installé dans le nord de la France depuis de longues années, peut-on dire que le nord vous a adopté ?
Rachid Boutoudj : Je suis arrivé dans le nord en 1991 et j’y vis toujours. L’hospitalité du nord n’est pas une légende. Des artistes, des chanteurs, des écrivains et simplement des anonymes ont fait l’éloge du nord. Les habitants de cette région sont d’une profonde générosité. Il y a certaines valeurs qui se transmettent de génération en génération et dans le nord celles-ci s’inscrivent naturellement dans un serment intangible. L’histoire de cette région a gravi dans le marbre la grandeur de l’âme et l’humanisme.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes un scientifique, pourtant la littérature vous passionne, quels sont les auteurs qui vous ont influencé ?
Rachid Boutoudj : J’ai eu un parcours scientifique dans le domaine des électrons, des ondes et de la matière mais la littérature a toujours occupé une place privilégiée dans ma vie. Toute lecture qu’on a savourée ou qui nous a ému déteint sur notre vie d’une façon ou d’une autre. Comme bon nombre de mes semblables j’ai été saisi par la portée des écrits de Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, Kateb Yacine et Rachid Mimouni. Les mots de ces écrivains phares résonnent encore dans ma tête.
En dehors de la littérature algérienne, les écrivains que j’affectionne sont fort nombreux mais s’il faut n’en citer que quelques uns je dirais : Albert Camus, Emile Zola, Victor Hugo, Fiodor Dostoïevski, Jean Giono, Franz Kafka, Marcel Proust, Fernando Pessoa…et j’ajouterai Marcel Pagnol dont la gaieté inextinguible me rappelle invariablement un pan de mon enfance.
Le Matin d’Algérie : Quel regard portez-vous sur la littérature algérienne d’aujourd’hui ?
Rachid Boutoudj : La littérature algérienne d’aujourd’hui est plus vivace et plus vigoureuse qu’on le pense. Le flambeau légué par les devanciers est toujours vif et ardent. J’ose croire qu’il le demeurera encore car on constate l’émergence d’un vivier d’écrivain très talentueux de surcroît. Il suffit de constater que les salons du livre fleurissent un peu partout en Algérie notamment en Kabylie.
Cet été lors d’un passage à Tigzirt je me suis engouffré dans une librairie du centre ville. Si le lieu regorgeait de classiques de la littérature algérienne ou occidentale, il m’était donné à découvrir des écrivains locaux dont la plume est à la fois belle et pertinente. J’ai quitté le lieu en emportant les livres de Yelis N-Tarihant, Leila Bennini, Rachid Hammoudi, Lounes Ghezali et Ali Mouzaoui. Je n’ai pas été déçu par la lecture de leurs ouvrages respectifs.
Pour conclure je dois dire que rien ne peut désancrer la création littéraire algérienne, d’expression française, du fertile limon d’où elle puise sa sève. Il y a eu de prodigieuses productions littéraires par le passé, il y en a de sublimes aujourd’hui et il y en aura de remarquables demain.
Interview réalisée par Brahim Saci
mercredi 4 octobre 2023
Lematindalgerie.com
………………………………………………………………………………………
Kacem Madani : « Dans ma jeunesse j’avais cru en l’Algérie »

samedi 30 septembre 2023
Avant de prendre sa retraite, Kacem Madani, de son vrai nom Belkacem Meziane, était professeur des universités en physique. Il a enseigné à l’Université des sciences et technologies d’Alger et en France, à l’École nationale supérieure des sciences appliquées et de technologies (ENSSAT), Lannion, dans les Côtes d’Armor, ainsi qu’à l’Université d’Artois, Lens, dans le Nord-Pas-de-Calais.
Depuis une quinzaine d’années, il écrit des chroniques dans le journal en ligne Le Matin d’Algérie. Des analyses ciselées, de haute volée. Toujours sous le pseudonyme Kacem Madani, il a publié quelques ouvrages dans lesquels il fait part de sa grande indignation face aux tribulations politiques de nos décideurs. Il a généreusement accepté de répondre à nos questions.
Le Matin d’Algérie : vous avez un parcours atypique ! Qui est Kacem Madani ?
Kacem Madani : C’est toujours difficile de parler de soi, surtout quand votre vie s’étale sur des décennies et que vous bénéficiez d’une retraite quasi-dorée alors que de nombreux concitoyens pâtissent d’une justice aux ordres au pays et que d’autres croupissent encore dans les geôles pour un oui ou pour un non qui déplaisent aux maîtres du moment.
Mon parcours n’est pas si atypique que cela. Il ressemble à celui de nombreux Kabyles qui ont eu la chance d’avoir fait des études supérieures et d’avoir vécu à Alger, du temps où notre capitale brillait de mille et une splendeurs, de mille et un espoirs. Ces temps n’ont malheureusement engendré que désillusions ! Dans ma jeunesse j’avais cru en l’Algérie. À tel point qu’au contraire de nombreux camarades, après des études aux USA, je suis rentré au pays, décidé à tous les sacrifices pour un avenir meilleur. Malheureusement, les combines en haut lieu ont réussi à nous décourager.
Au lendemain de la légalisation du FIS par nos décideurs, l’idée de prendre la poudre d’escampette commençait à germer dans ma tête. Se sacrifier pour le meilleur, oui ! mais participer à la construction du pire, non ! J’ai donc quitté le pays au début des années 1990 pour construire une nouvelle carrière en France. Une carrière qui, après des années de travail acharné, m’a mené jusqu’à une titularisation en tant que professeur des universités en optique et physique des lasers.
Le Matin d’Algérie : vous vous appelez Belkacem Meziane, pourquoi avoir choisi d’écrire sous le pseudonyme de Kacem Madani ?
Kacem Madani : C’est simple, ce pseudo, qui a fini par me coller à la peau, je l’ai choisi et adopté pour séparer mes interventions en tant que chroniqueur sur Le Matin d’Algérie de ma profession de physicien. D’ailleurs, je suis venu au monde de la chronique grâce à Mohamed Benchicou. Quand Aâmmi Moh avait lancé la version en ligne de son journal, j’intervenais en tant que commentateur lambda. Parfois, quand mes exposés se faisaient consistants, Mohamed les insérait dans ses colonnes. C’est donc par le plus heureux des hasards que je suis venu à l’écriture. Je ne serai jamais assez reconnaissant à Aâmmi Moh et Hamid Arab pour m’avoir laissé une certaine liberté de ton dans mes nombreux coups de gueule.
Le Matin d’Algérie : quel regard portez-vous sur l’Algérie d’aujourd’hui ?
Kacem Madani : J’aurais bien voulu être optimiste, mais comment l’être quand on voit toute cette médiocrité chronique qui sévit de la base au sommet de la pyramide du pouvoir ? Pour ne rien vous cacher, je regrette l’ère Bouteflika. Malgré quelques dérives, le petit vieux avait beau s’accrocher au koursi, il avait laissé un tant soit peu de lest à la liberté d’expression.
Ce qui m’horripile le plus, c’est le massacre de l’éducation. L’arabisation bornée et irréfléchie a coulé notre système éducatif. Non satisfaits de ce carnage pédagogique, voilà que nos autocrates veulent introduire l’anglais dès l’école primaire ! ? En tant qu’anglophone, je devrais applaudir telle initiative, mais soyons sérieux, où est le personnel enseignant capable de remplacer le français par l’anglais ? On reprend les mêmes stratagèmes de poudre aux yeux et on refait délibérément les mêmes erreurs, au vu et au su de tous ceux qui sont tourmentés par l’avenir de ce pays et qu’on a laissés sur la touche pour les raisons que l’on connaît.
Tout le reste est à l’image de cet exemple. De la poudre aux yeux dans tous les domaines et à tous les niveaux. En fait, le pouvoir a, de tous temps, voulu nous faire croire qu’il possédait toutes sortes de baguettes magiques pour redresser la barre d’un navire à la dérive depuis des décennies. Tant que le pétrole coule à flots, ils ne lâcheront pas le morceau. Et rien ne dit qu’ils le lâcheront une fois les sources taries. Pour subsister, ils sont capables d’imposer une taxe sur l’oxygène que le peuple respire (clin d’œil à notre ami Youssef Zirem).
Le Matin d’Algérie : dans un monde déchiré où les valeurs s’effondrent, que peut apporter l’écrivain ?
Kacem Madani : L’écrivain est un lanceur d’alerte. Malheureusement, sa portée est limitée. Ne serait-ce que du fait que les nouvelles générations ne lisent plus, et que le langage sms tend à supplanter toutes les langues vivantes de la planète. Cet effondrement des valeurs est d’ailleurs intimement lié à ces joujoux de technologies qui envahissent le quotidien de tous les humains sur Terre. Quand je pense qu’on commence à peine à interdire les téléphones portables dans les classes, il y a de quoi se poser des questions par rapport à la vitesse de réaction des responsables concernés et des pédagogues affirmés. Je crois pouvoir dire que je suis l’un des premiers à avoir alerté sur les dangers de ces nouvelles technologies bien avant le smartphone ! Mais que peut bien changer une alerte noyée dans un océan de suivisme des plus ahurissants ?
Interview réalisée par Brahim Saci
Références :
Belkacem Meziane, « From nonlinear dynamics to trigonometry’s magic », Cambridge scholars, 2022.
Kacem Madani, « Autopsie d’une Algérie jamais en paix », eds Constellations, 2023.
Kacem Madani, « Mémoire(s) en dents de scie », eds Maïa, 2022.
Kacem Madani, « Aït Menguellet, chants d’honneur », eds Hedna, 2021.
Kacem Madani, « Indignation(s) chronique(s) », eds Vérone, 2017.
samedi 30 septembre 2023
Lematindalgerie.com
………………………………………………………………….
Rencontre avec la psychanalyste Sandra Cardot
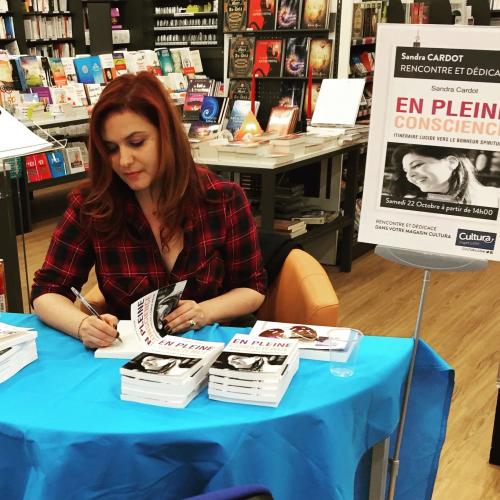
Sandra Cardot est psychanalyste, thérapeute, art-thérapeute, à Bourg-en-Bresse. Elle a publié, « Ferme tes yeux Jessica », « Empathie et Compassion », « En pleine conscience », ses livres sont une plongée dans l’univers du psychisme humain, pour le comprendre et le guérir. Dans un monde où le mal-être devient un mal grandissant, la psychologie et la psychanalyse apportent des réponses. Sandra Cardot a généreusement accepté de répondre à nos questions.
Le Matin d’Algérie : Qui est Sandra Cardot ?
Sandra Cardot : Je suis psychanalyste, autrice et artiste.
Le Matin d’Algérie : Comment êtes-vous venue à l’écriture et à la publication ?
Sandra Cardot : Mon parcours est totalement atypique puisque j’ai d’abord fait les beaux-arts de Grenoble avec un passage d’une année au fine-art de Sheffield pour ensuite embrayer en psycho au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris ; achever une psychanalyse qui aura duré 10 ans et obtenir un diplôme d’art-thérapeute à l’hôpital psychiatrique de Sainte-Anne Paris.
C’est en 2012, après le décès de mon père que tout a commencé dans l’écriture. Je rêvais la nuit et il fallait que j’écrive le jour ! Mon premier livre Ferme tes yeux Jessica, est un roman Fantasy pour pré-adolescents qui traite de la mort, de la thérapie et du phénomène de télékinésie. C’est après la parution de ce livre que je me suis faite remarquer auprès d’Yves Michalon (feu mon éditeur) qui m’a proposé d’écrire mes expériences en développement personnel.
À la suite est paru, En pleine conscience itinéraire lucide vers le bonheur spirituel, et Empathie et Compassion comment développer nos super-pouvoirs.
Le Matin d’Algérie : André Malraux a dit « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. » qu’en pensez-vous ?
Sandra Cardot : Les paroles de Malraux à ce sujet résonnent comme un espoir prophétique et visionnaire basé sur la certitude qu’il y aura toujours une part de spiritualité dans un siècle.
Personnellement, je pense que l’humanité manque encore beaucoup de pure spiritualité, la spiritualité ne se constitue pas de religions, de sectes et de pensées égoïstes écrites par l’humain. La spiritualité est conscience et énergie cosmique, c’est pour moi de la pure spiritualité.
Nous ne sommes pas encore à cette ère où l’être humain fait confiance indubitablement à sa conscience et à son pouvoir de rétablir de l’harmonie.
Le Matin d’Algérie : En vous lisant on sent notamment l’influence de Carl Gustav Jung, cette grande figure de la psychologie, pouvez-vous nous en parlez ?
Sandra Cardot : Jung était un psychanalyste de génie ! J’ai une profonde admiration pour son parcours qui a été à la fois rigoureux quand il travaillait avec Freud et novateur presque rebelle lorsqu’il instaura la spiritualité dans psychanalyse.
L’installation des synchronicités dans les thérapies ont été salvatrices pour un nombre incalculable de personnes en difficulté psychique.
Jung a su montrer au monde entier, avec la participation de scientifiques en mécanique quantique dont le physicien Wolfgang Pauli, que la psychologie analytique ou dite complexe ne se résume pas qu’à une topique, ou une exploration des rêves. Elle est étroitement liée aux énergies cosmiques et l’histoire personnelle du patient.
Le Matin d’Algérie : Dans un monde plus que jamais tourmenté, en perpétuelle mutation, la psychologie est-elle salvatrice ?
Sandra Cardot : La réponse est un grand OUI ! La psychologie est une recherche intelligente, fondamentale, sans aucune critique de soi-même. Sans elle nous manquons de confiance en soi et de développement personnel. Nous ruminons le passé et laissons la porte ouverte aux pensées négatives. La psychologie requiert d’être sincère et véritable. Elle demande beaucoup de courage mais in-fine elle nous apporte la résilience, cette force mentale pour affronter l’adversité.
Entretien réalisé par Brahim Saci
lundi 18 septembre 2023
Lematindalgerie.com
Sandra Cardot – Psychanalyste et thérapeute à Bourg-en-Bresse
………………………………………………..
Rencontre avec Frédéric Lemaître, rédacteur en chef du magazine Persona

©Renaud Monfourny
Le magazine Persona, (de l’autre côté du miroir, les artistes dévoilent leur face cachée) ce sont des rencontres, des entretiens avec des artistes de tous horizons, cette revue est une bouffée d’oxygène dans le monde littéraire et artistique. Frédéric Lemaître le rédacteur en chef de Persona, a généreusement accepté de répondre à nos questions.
Le Matin d’Algérie : J’aimerais que vous me parliez de la genèse de Persona, ce magazine, comment est née cette belle idée ?
Frédéric Lemaître : Après avoir travaillé pendant 25 ans pour des magazines musicaux en faisant des chroniques de disque et déjà quelques interviews d’artistes, j’ai voulu voler de mes propres ailes et proposer non seulement de parler de musique, mais aussi de tout ce qui m’intéresse en art : littérature, photographie, arts graphiques, peinture, philosophie… Étant graphiste, Ma compagne, Isabelle Dalle, m’a alors proposé de m’accompagner dans cette belle aventure. Si ce que l’on voit de la revue est remarquable, c’est bien grâce à elle.
Le Matin d’Algérie : Il faut de la passion pour créer une revue, en quoi votre magazine diffère des autres ?
Frédéric Lemaître : Il faut non seulement beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de détermination. La mienne était de créer une revue intemporelle, que l’on puisse y revenir sans cesse et avoir plaisir à la garder dans sa bibliothèque. C’est pourquoi nous avons voulu un tirage sur un beau papier, avec une couverture épaisse et imprimée en « soft touch » qui donne dès le toucher, une grande douceur à l’ensemble. Je dirais également que la revue diffère des autres dans le sens où elle aime aller voir ce qui se cache derrière le miroir, derrière l’âme de l’artiste et ainsi proposer des entretiens libres et profonds. Pour cela nous avons choisi de prendre le temps de ce partage et c’est pourquoi c’est une revue trimestrielle.
Le Matin d’Algérie : Persona, ne contient pas de publicités, est-ce pour préserver votre indépendance ?
Frédéric Lemaître : Dès le départ je souhaitais ne pas avoir de pages publicitaires côtoyant la parole des artistes ou leur travail, pour éviter de polluer, à la fois nos yeux, et notre pensée. En préservant ainsi notre indépendance nous restons maître de tout ce que nous voulons publier, sans n’avoir de comptes à rendre à personne, sinon à PERSONA !
Le Matin d’Algérie : Votre magazine Persona est ouvert sur le monde des arts avec une dextérité rare, comment réussissez-vous cet exploit ?
Frédéric Lemaître : Nous savons tous que l’art se nourrit de l’amour de l’art et que je suis probablement gourmand de tout ce que je vois depuis l’enfance. Il n’y a donc pas d’exploit, mais juste un rendu de cet amour passionné pour tout ce qui nous fait vibrer.
Le Matin d’Algérie : Pensez-vous que Persona a atteint ses objectifs ?
Frédéric Lemaître : Si l’objectif de PERSONA était d’avoir un joli succès d’estime auprès de ses lecteurs mais aussi auprès des artistes publiés, alors c’est réussi. Mais si l’objectif est d’atteindre le plus grand nombre de personnes et de réaliser de belles et nobles ventes en adéquation avec l’énergie que nous y mettons, alors on en est loin car la revue reste tout de même assez confidentielle. La distribution n’est pas chose aisée.
Le Matin d’Algérie : Quel regard portez-vous sur l’univers de la publication et de la distribution en général ?
Frédéric Lemaître : Il y a évidemment probablement trop de publications, il suffit juste de regarder chaque rentrée littéraire et ses centaines de livres pour comprendre qu’il n’y a pas de place pour tout le monde dans les médias. D’ailleurs, bien malheureusement, les médias ne parlent toujours que de la même poignée d’auteurs, années après années, c’en est abjecte et injuste. Une revue comme PERSONA tente bien évidemment de mettre en lumière des visages inconnus, des plumes rares, mais nous sommes maintenant tellement sollicités, qu’il est évidemment impossible de parler de tout le monde.
La distribution est un vrai métier et c’est probablement de ce côté-ci que nous avons besoin d’une grande aide. On sait aussi que beaucoup de magazines mentent sur les chiffres des ventes et que la plupart des tirages présentés en kiosques finissent à la poubelle. Hélas !
Le Matin d’Algérie : Quel conseil pouvez-vous donner à de jeunes créateurs qui veulent se lancer dans l’édition ?
Frédéric Lemaître : Je ne peux répondre que bien modestement à cette question. Il faut avant tout de la passion, écouter son cœur, se lancer un défi, et pour le reste espérer que notre petite étoile illumine un coin du ciel de cette vaste voie lactée qu’est le monde de l’édition.
Entretien réalisé par Brahim Saci
mardi 12 septembre 2023
Lematindalgerie.com
Magazine Persona : www.personaedition.com
___________________________
Yasmine Madaoui parle de son recueil de poésie « Stylo et Pinceau »
/image%2F1720502%2F20230909%2Fob_5e3fbf_yasmine-madaoui.jpg)
Yasmine Madaoui vient de nous offrir un bouquet de fleurs en publiant un beau recueil de poésie illustré par de magnifiques aquarelles de Hassiba Mokraoui. En parcourant les pages de ce lumineux recueil, nous sommes saisis et envahis par la profusion de couleurs dans un élan poétique sans cesse renouvelé qui n’échappe ni au regard ni au cœur dans un jaillissement d’émotions considérable.
Yasmine Madaoui a accepté de répondre à nos questions avec la grande générosité qui la caractérise.
Le Matin d’Algérie : Yasmine Madaoui, vous êtes médecin et vous venez de publier un recueil de poésie « Stylo et Pinceau », pouvez-vous nous parler de cette relation entre la poésie et la médecine ?
Yasmine Madaoui : Je vous retournerais bien la question en vous demandant si vous pourriez faire une quelconque action sans que votre esprit ne se soit chargé auparavant de l’anticiper : le corps d’une personne et son esprit ne font qu’un.
Georges Canguilhem écrivait que « l’acte médicochirurgical n’est pas qu’un acte scientifique, car l’homme malade n’est pas seulement un problème physiologique à résoudre, il est surtout une détresse à secourir ».
Il me semble qu’on pourrait retrouver la création artistique (langage, peinture, sculpture) au croisement du somatique et du psychique.
Je vais aller plus loin dans ma réflexion en me permettant d’établir un lien entre la psychothérapie et la poésie. Le corps se fait soigner par un médecin, l’esprit se fait soigner par un psychiatre et, entre les deux, le poète trouverait sa place.
Dans son livre « Le Délire et les rêves dans la Gradiva de Jensen, Paris, Gallimard, 1986 », Freud rend hommage aux poètes : « Ils sont de précieux alliés et il faut placer bien haut leur témoignage ».
Je vous confie qu’à la fin de mes études médicales à la faculté de médecine d’Alger en 85, il était question que je passe le concours pour pouvoir me classer et effectuer mon résidanat, je vous donne dans le mile, en psychiatrie !
J’avais effectué mon internat à L’hôpital psychiatrique Frantz-Fanon de Blida, j’ai été impressionnée et tout de suite séduite par l’approche non médicamenteuse (l’ergothérapie, la musicothérapie et le sport) qu’a introduite le Dr Frantz Fanon dès son arrivée en 1953.
Hélas, j’ai préféré rentrer chez moi, mon éloignement du cocon familial était trop lourd à gérer et quelques années en plus à passer au loin me semblaient impossibles.
Pour en revenir au lien entre la médecine et la poésie on pourrait voir la chose sous deux angles :
Le poète serait un « malade » qui aurait la conscience de soi de la poésie et qui considèrerait sa poésie comme sa « thérapeutique », avec un bénéfice psychique personnel qu’il retire de l’écriture de son poème.
Ou encore, la poésie serait une « thérapeutique » pour le poète mais pour le lecteur aussi. Les mots, écrit Freud en 1890, « sont l’outil essentiel du traitement psychique ». Le poète, par ses mots, peut soigner les âmes tourmentées comme par magie. Et oui, de la magie avec des mots qui sont souvent déliés de la phrase, qui ont une sensibilité particulière et qui fond références bien souvent à des maux.
Le poète possèderait l’art de combiner les mots, les sonorités, les rythmes pour évoquer des images, suggérer des sensations, des émotions pour se soigner et soigner les autres.
Le Matin d’Algérie : Vos poèmes sont illustrés par des belles aquarelles, c’est une belle rencontre, le stylo et le pinceau forment une sorte de symbiose, comment avez-vous réussi cet exploit ?
Yasmine Madaoui : Le stylo murmure des mots, la harpe murmure des mélodies, deux mondes qui se rejoignent dans « une ivresse poétique ». Imaginez l’œuvre poétique de Omar Khayyâm dans les « Rubaiyat» ou encore « Les Paradis artificiels » de Baudelaire, récités avec le murmure d’une harpe en musique de fond, c’est sublime. Le poète devient chanteur !
Le stylo dessine des mots, le pinceau dessine des apparences, deux univers artistiques qui se rencontrent. Imaginez qu’un poème, avec un contour graphique sur une page, forme un dessin qui illustre les vers ou encore qu’une belle aquarelle s’offre au regard d’un poète, c’est magnifique : Le poète devient peintre !
Une aquarelle est un feu d’artifice poétique,
Et les émotions, sur nos lèvres, un cantique.
Les pinceaux, les stylos, en nous, s’emmêlent
En un recueil aux couleurs de l’arc-en-ciel.
Le Matin d’Algérie : Vos origines algériennes kabyles, votre double culture, nourrissent-elles cette maturité poétique ?
Yasmine Madaoui : Il est vrai que ma double origine, berbère et française, m’a fait côtoyer deux mondes différents et vivre dans chacun d’entre eux comme s’il était le seul mais m’a aussi doté de deux sensibilités différentes qu’il a fallu mixer quelque fois l’une au détriment de l’autre.
La culture et les traditions berbères et celles françaises sont loin d’avoir des passerelles qui les lient entre elles même si une histoire commune est née du fait de la colonisation. Quelque fois, je me dis que je suis le fruit de cette histoire commune avec tout ce qu’elle charrie avec elle de bon et de mauvais.
Apprendre à composer avec les deux en même temps a créé des déchirures et des plaies que j’ai recousues en enlaçant le fil de la chemise de la combative Jeanne d’Arc la pucelle et celui de Taqendurt de la reine guerrière Dihya.
Je tiens à préciser que je suis loin d’avoir atteint une maturité poétique. Je ne fais qu’apprendre à taquiner les mots :
Ma pensée dessine les contours de la feuille,
Laissant la rosée perlée y griffonner mes confessions,
Pour finalement ne plus prêter à mon recueil,
Que des vestiges de notes condamnées à la disparition.
La nymphe se révélera, alors, dans ma romance en deuil.
Le Matin d’Algérie : Est-ce que le regard du médecin a une influence sur le regard de poète ?
Yasmine Madaoui : Sûrement. La poétesse en moi, si je puis me permettre de me donner cette qualité et le médecin que je suis devenue de par mes études, ne font qu’une et même personne : Moi, avec ma sensibilité et mon amour pour les autres, ma colère quelque fois et mon soucis d’égalité avec la gente masculine.
Je ne me qualifierais pas de féministe mais de femme libre et déterminée à conserver mon indépendance. D’autant, que pour le médecin que je suis, la fameuse différence vient tout simplement du chromosome Y. Les hommes présentent un chromosome Y et un chromosome X, alors que les femmes ont deux chromosomes X. Cela change-t-il grand-chose ? Juste à donner à chaque sexe des forces qui lui sont propres pour vivre et en aucun cas donner des limites.
Le médecin connait le corps de la femme qui se trouve être aussi le mien et ne comprend pas cet irrésistible souhait de nos sociétés patriarcales et traditionnelles de le soumettre.
Je suppose que cela fait de moi une poétesse engagée dans le combat des femmes d’autant plus que la plupart des traditions religieuses sont castratrices pour les femmes. Elles se servent des différences physiques pour imposer leur hégémonie sur la gente féminine. Elles évoquent la responsabilité d’Eve et le péché originel, la ruse et la “tromperie féminine”, l’impureté de son corps capable de mettre au monde les enfants y compris de l’autre sexe.
La poésie est le vecteur qui s’est imposé à moi pour véhiculer ce sentiment d’injustice profonde.
Le vent ligote les épis de ses cheveux,
Comme des lianes pour museler
Sur sa bouche, le cri de sa rage étouffée.
Pour gronder, il lui reste, ses grands yeux,
Deux émeraudes, brillants des plus précieux.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les poètes qui vous influencent ?
Yasmine Madaoui : Cette question me met mal à l’aise car, quand les mots se bousculent, ce sont plutôt les événements, la vie de personnes, ma propre vie, les histoires de la mythologie et les contes d’enfant qui m’inspirent.
Mais je veux vous parler d’un petit recueil de poésie qui m’accompagne depuis 1980, date à laquelle je l’ai acheté à la foire d’Alger alors qu’il venait juste d’être édité à la SNED.
J’aime ce livre. Il a vieilli à mes côtés. Ses pages se sont jaunies sous la patine de l’âge, 43 ans ! J’ai personnalisé chaque poème par des croquis esquissés qui reflètent mon ressenti à leur lecture.
Je veux nommer « Cristal du rêve » de Rachid Zerrouki, Né en 1948, décédé en 2002, a fait ses études supérieurs à la faculté de médecine d’Alger.
« Je découvre Dieu en rompant la tige d’une fleur.
Je le perds en cherchant une demeure. »
Comme pour mon petit recueil, Les émotions qui s’en exhalent sont labiles. Elles apparaissent et puis s’en vont comme un cadeau éphémère qui laisse un goût d’inachevé. Il ne reste plus qu’à le relire de nouveau et comme un arbre non greffé, la saveur de son fruit sera à chaque fois renouvelée.
Le Matin d’Algérie : Peut-on dire qu’écrire est une sorte de délivrance pour vous ?
Yasmine Madaoui : Délivrance ? Un bien grand mot qui me fait rebondir à votre question première. La poésie serait donc une « thérapeutique » pour le poète. D’après Freud, les mots seraient l’outil essentiel du traitement psychique. Et donc, par des mots magiques le poète soignerait son âme tourmentée ?
Rachid Zerrouki répondrait: « Poète, nourri d’amertume autant que d’orgueil, j’ai pourtant suivi mon dur chemin jusqu’aux bords privés de mots !… »
Moi, je vous réponds :
«Au gré du lys d’étang, mes vers flottent en procession ;
Les jardins d’eau, lui prêtent sa fleur solitaire
Pour écrire en strophes ma virginale passion,
Et mon amour que les palabres des grenouilles grégaires
Finissent par noyer dans le reflux de mes obsessions. »

Entretien réalisé par Brahim Saci
samedi 9 septembre 2023
Lematindalgerie.com
_______________________________
Le journaliste Belkacem Messaoudi s’est éteint à Alger
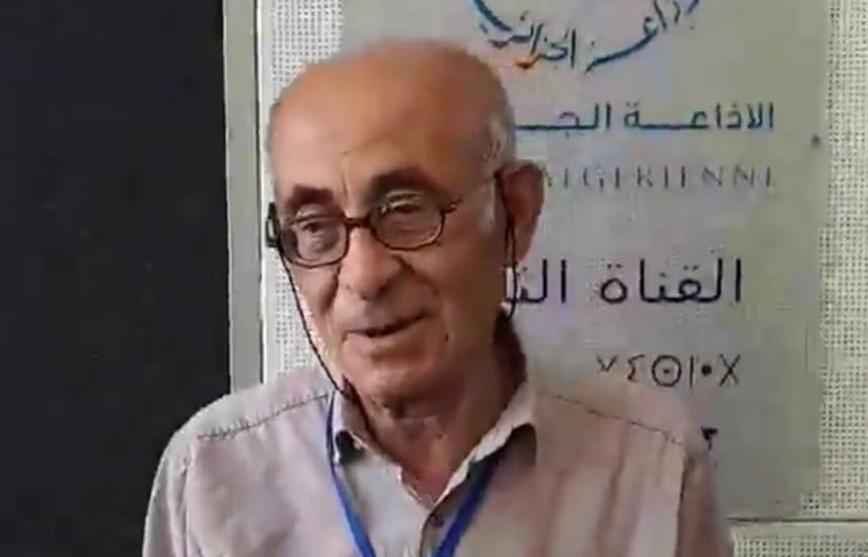
Le journaliste Belkacem Messaoudi, dit Da Belkacem, s’est éteint, le 12 août 2023 à Alger, à l’hôpital Mustapha Bacha, à l’âge de 81 ans. Paix à son âme.
Grand poète, auteur-compositeur inscrit à l’ONDA depuis 1976, auteur de plusieurs textes chantés par des chanteurs connus tels que Boualem Chaker, Mouloud Habib, et d’autres. Journaliste, animateur, producteur d’émissions culturelles de génie à la radio chaîne kabyle depuis 1963.
Belkacem Messaoudi est l’un des premiers journalistes de la radio chaîne kabyle, juste après l’indépendance, il fait un bref passage à la télévision, il fut l’un des premiers présentateurs du journal télévisé de l’Algérie indépendante mais c’est la radio qu’il préfère.
Il a été journaliste-producteur-animateur d’émissions radiophoniques jusqu’à sa retraite, nul n’oublie sa célèbre émission « Nouba g iɣṛiben » en collaboration avec Abdelkader Abdeladim, qui avait un succès considérable. Elle reste gravée dans la mémoire de cette époque et au-delà.
« Papa c’est la chaîne 2, il était plus présent à la chaîne 2 qu’avec nous, il a sacrifié sa vie pour la chaîne 2 et tamazight », témoigne son fils à Berbère télévision.
La Radio kabyle fut créée en 1948 par la France coloniale. Elle garda son nom jusqu’en 1975, puis elle devient la chaîne 2 diffusant ses programmes en cinq langues amazighes, principalement en kabyle, mais aussi en chenoui, chaoui, mozabite et targui.
Orphelin de père et de mère, Belkacem Messaoudi rejoint Alger à la fin des années 1950 vers l’âge de 15 ans où il poursuit des études secondaires puis entre à l’Ecole des beaux-arts.
C’est en fréquentant l’émission des amateurs de Cheikh Noureddine que s’ouvre pour lui les portes de la Radio pour un avenir radiophonique radieux d’une richesse culturelle immense, pour la belle carrière que nous lui connaissons.
Belkacem Messaoudi se retrouve aux côtés des grands noms de la radio, Si L’hocine Ouarab, normalien et compagnon d’études de Mouloud Feraoun, Si Mohamed Lamrani, proviseur de lycée, Larbi Bessai rédacteur en chef, Abdelkader Abdeladim, Ahmed Mahiou ancien professeur de maths, ne pas confondre avec l’ancien doyen de la Faculté de droit d’Alger, Boukhalfa Bacha, voir son livre « Cfawat n radio n teqbaylit ou l’apport immense de la chaîne 2 », préfacé par Saïd Sadi, édité en 2019 chez les Editions Frantz-Fanon.
Belkacem Messaoudi rejoint ainsi ceux qui ont marqué la chaîne radio kabyle, de Si Said Rezzoug à Abdelouahab Abdjaoui (Rachid Baouche), Said et Mohamed Hilmi, Ali Abdoun, Amar Ouyacoub, Amar Ouhada, Mohand Rachid, (Si Mohand Mohand Al Rachid), Meziane Rachid (Yala M’hamed), Arezki Nabti, Cheikh Noureddine (Noureddine Meziane), Kadri Seghir, Djamila Bachène , Amari Maamar, Lla Cherifa, Kamal Hamadi (Larbi Zeggane), Farhat Omalou, H’nifa, Bahia Farah, Louisa, Djamila, Hami Chérif, Mme Lafarge, Zoheir Abdellatif, Madjid Bali, Abderrahmane Hacène L’Hadj et sa sœur Djamila, l’épouse du réalisateur Abderahmane Bouguermouh, Ourida Sider, El Djida Thamchtouhth, Anissa Mezaguer , Lla Yamina avec comme seul instrument le ‘’tbell » (bendir), Si Ahmed Aïmène, les Toualbi (Mohand Ameziane, Mohand Chérif, Zoubir, Si Smaïl), Cheikh Ali Chentir, Madjid Benacer, Zahia Kharfallah, Ben Mohamed (Mohamed Benhamadouche), Hamid Medjahed, Mohamed Guerfi, Belaid At Mejqan, Boudjema Rabah, Makhlouf Gouatsou, Mohamed Ben Hanafi (Mohamed Aït Tahar), Cherif Nadir, M’henni Amroun …
Puis intervient une brève interruption radiophonique pour des raisons que nous ignorons, de 1965 à 1966, Belkacem Messaoudi est responsable de l’agence A.N.E.P d’Oran, mais en 1967, il revient à la radio chaîne kabyle, après un bref passage à la chaîne 3.
Il a produit une pléthore d’émissions, dont, La voix du disque en 1968. Chanteurs amateurs en 1969, Touksa lxiq en1988, Nouba g iɣṛiben, avec Abdelkader Abdeladim dans les années 80, Club de la presse en 1990, Chronique du jour de 1998 à 2004, s’en suivent des émissions sportives.
En commentant des matchs de football, son expression fétiche est «yekker uɣebbaṛ deg waluḍ », une expression qui marqua les esprits.
L’écrivain poète journaliste Youcef Zirem se souvient de son ami, « Il adorait Hocine Ait-Ahmed, paix à son âme. Lorsque le général Zeroual était à la tête de l’Etat, il me demandait souvent de venir dans son émission ; je lui expliquais alors que je ne suis pas d’accord avec les choix du régime, cela pouvait lui causer des soucis. Et un jour, j’ai accepté son invitation. Nous avons fait une émission mémorable : de nombreux journalistes, de tous horizons, venaient nous écouter, en nous regardant, sur place, c’était un direct. Mais, le lendemain, son émission ne pouvait plus se faire en direct. Décision venue d’en haut… »
Il fut un homme généreux, un homme de convictions, un érudit défenseur de la langue tamazight, de la langue kabyle.
Belkacem Messaoudi fut le premier à inviter Mouloud Mammeri en 1972 et Matoub Lounès en 1977.
Bien que retraité, il fut rappelé récemment par la radio Chaîne 2 pour animer une chronique culturelle, sa chronique Awal était diffusée chaque matin à 09h50 du dimanche au mercredi. Il devait commencer une nouvelle émission culturelle, Nouba isefra, en septembre prochain, malheureusement le destin en a décidé autrement, sa disparition va nous laisser un grand vide.
L’inhumation a lieu le dimanche 13 août dans son village Tassaft Ouguemoun.
Brahim Saci
PS : Je remercie Hamid Ait Said, poète homme de radio et de télévision, Hanafi Moualfi homme de radio, Belaid At Mejqan (Belaid Tagrawla) chanteur animateur à la chaîne 2 et à berbère télévision, Makhlouf Gouatsou animateur à la chaine 2 et le chanteur Hocine Ouahioune pour leur aide précieuse.
Le Matin d’Algérie
samedi 12 août 2023
https://lematindalgerie.com/
_______________________________________________________
Marzouk Lattari, un chanteur musicien chaâbi virtuose
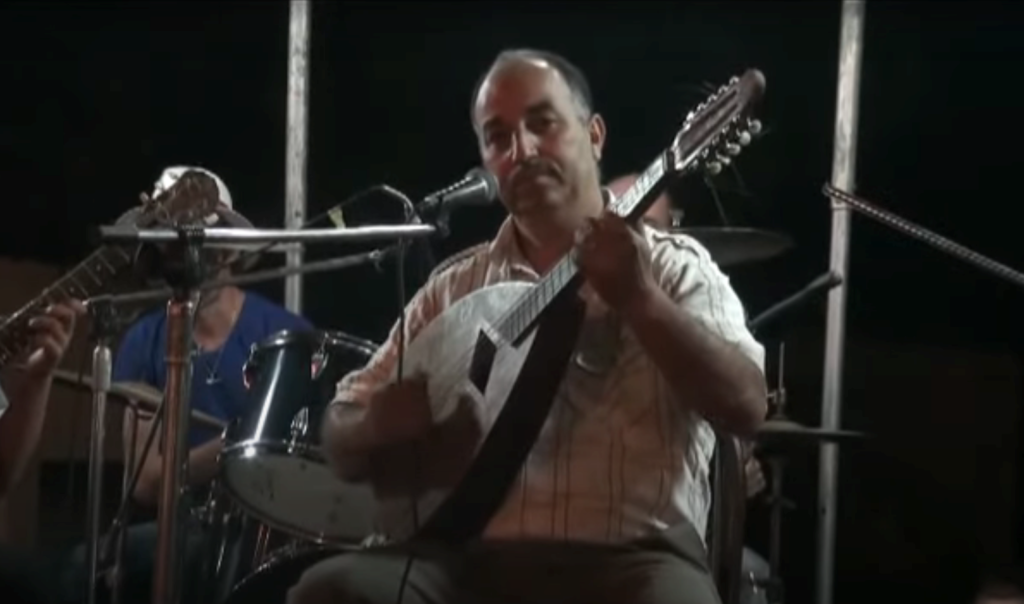
Dès son plus jeune son âge, Marzouk Lattari fut animé d’une grande passion pour la musique. Compositeur, musicien de génie, il a enregistré trois albums qu’on peut écouter sur Youtube.
Marzouk Lattari est natif du village Taourirt Moussa Ouamar, des Ath Douala, qui compte beaucoup d’artistes et de grands poètes dont le plus célèbre d’entre eux est le regretté Matoub Lounès. On peut citer aussi, Tiloua (Lounès Ladjadj) qui fait monter sur scène le jeune Matoub Lounès à l’âge de 16 ans en 1972, Matoub Moh Smaïl qui a chanté avec El Hasnaoui et Dahmane El Harrachi, Matoub Achour, Laichour Mokrane (Mokrane Lhadj Amar) que Matoub Lounès invitait régulièrement sur scène, Matoub Moussa, Matoub Hamid, Mehari Mustapha (Mustapha Ath Ouali), Loukan Ferhat (Ferhat Ait Aissi), Mohand Ou Bouzid, Messous Mohand Ouyidir (Mohand Ouyidir ath Amara), Krazem Mohand Ouamar (Mohand Ouamar Takrarth).
Marzouk Lattari est un artiste discret, comme le sont les plus grands. Il ne cherche pas la gloire il travaille pour l’art, d’ailleurs il joue pratiquement de tous les instruments, même si son instrument de prédilection, dont la difficulté pour la maîtrise n’est pas des moindres est le banjo, cet instrument majestueux est dérivé du luth Ouest-africain joué par les esclaves africains déportés aux Etats-Unis au dix-septième siècle, qu’on retrouve surtout dans le jazz et la country.
Le banjo fut introduit dans les années 40 dans le chaâbi par Hadj M’hamed El Anka qui est considéré comme le créateur du chaâbi actuel qui dérive du medh et de la musique arabo-berbéro-andalouse.
Hadj M’hamed El Anka a apporté sa propre touche au chaâbi en introduisant plusieurs instruments, le banjo, la mandole et le piano. On peut citer des grands noms dans la maîtrise du banjo, Cheikh Namous, Kaddour Cherchali, Dahmane Elharrachi, Hamid Lakrib, Mahboub Bati, Said Hennad, Ptit Moh, Mouloud Nait Ali, Marzouk Lattari.
En écoutant Marzouk Lattari, on est envahi par l’émotion qui s’en dégage, les chansons, la composition, l’orchestration témoignent d’une grande maîtrise à la fois rythmique et harmonique, nous sommes saisis par ce travail d’orfèvre et on sent tout de suite l’influence des grands maîtres du chaâbi.
Marzouk Lattari joue donc du banjo, de la mandole, du piano, du violon, de la flûte. Il a appris à écrire la musique grâce à un livre de solfège que son grand-père a ramené de Paris. En côtoyant les plus grands, il a considérablement perfectionné son jeu. Il a appris les modes au côté de Si Said Hennad, bras droit au banjo auquel il voue une très grande reconnaissance.
Marzouk Lattari a joué comme bras droit au banjo avec Cheikh Mehdi Tamache, élève de Hadj M’hamed El Anka, Kamel Messaoudi, au côté de son talentueux guitariste Mohamed El Amraoui, Matoub Lounès, Cherif Hamani son cousin, Kheloui Lounès, Moh Bouhanik, et d’autres. Il a côtoyé Moh Smail, Hacène Ahres, Moh Hessas, Lani Rabah, et d’autres…
En 1987, il fait une tournée avec Cherif Hamani comme bras droit au banjo. En 1988, il est le bras droit au banjo de Matoub Lounès au côté de Hamid Lakrib, ce dernier a marqué son époque, il s’est distingué par son jeu remarquable du banjo.
Hamid Lakrib était un musicien virtuose du banjo, dont la vie fut brève. Il décède en 1999 dans la solitude à 38 ans, il est originaire de Tala-Khelil, Ath Douala. Il accompagna de grands chanteurs, Akli Yahiatene, Amar Ezzahi, Kamel Bourdib, Mehdi Tamache, Youcef Abdjaou.
Marzouk Lattari fut le bras droit au banjo de Lounès Matoub de 1988 à 1992. Ce chanteur musicien de talent continue son chemin en créant, en composant. Il a toujours la soif d’apprendre, les projets foisonnent dans sa tête.
Marzouk Lattari est un artiste à découvrir ou à redécouvrir pour le plaisir de l’oreille, du cœur et de l’esprit.
Brahim Saci
PS :Je remercie Amar Laoudi pour son aide.
Le Matin d’Algérie
Mercredi 9 août 2023
https://lematindalgerie.com/
___________________________________________________________________
Le chanteur Mouloud, un talent parti trop tôt

lundi 5 juin 2023
Une pensée pour le chanteur Mouloud, (de son vrai nom Ahmed Ghezraoui).
Mouloud est originaire de Tizi-Ouzou, un grand artiste, universitaire, auteur compositeur, un fabuleux guitariste. Il a chanté le rock, le jazz, la country, la new wave, pop/rock, le reggae, le chaabi mais aussi le kabyle.
Il sort un 45 tour chez Déesse en 1979 en deuxième année de sociologie à l’université Paris 8. Il a fait beaucoup de concerts à travers toute la France et en Algérie, mais au niveau discographie c’est le parcours du combattant pour faire un album.
En 1987 il sort un album, « Retour aux sources sans frontières », qui lui a coûté en énergie et en sueurs, dont les chansons, Retour aux sources sans frontières – Rock Beur – Rain and tears – Yasmina…
De 1987 à 1992 ses chansons passent souvent à Radio Beur, surtout la célèbre chanson Yasmina. À partir de 1992 ses chansons restent régulièrement diffusées jusqu’à fin 90 à Beur FM.
Mouloud était un universitaire doué, un artiste, chanteur compositeur musicien brillant qui mérite qu’on se souvienne de lui.
J’ai eu la chance de le rencontrer début des années 90, je garde le souvenir d’un homme humble et discret, d’un artiste au grand talent, qui chantait aussi bien le rock, la new wave, pop/rock, la country, le jazz, le Reggae, que le kabyle.
En 1996, il a entrepris un travail colossal, l’enregistrement de reprises de 43 chansons algériennes kabyles et arabes ayant marqué plusieurs décennies, cette même année l’universitaire et poète Moh Cherbi l’invite dans son émission culturelle « Culturum » à laquelle je collaborais comme chroniqueur, c’est un souvenir mémorable. Les échanges avec Mouloud étaient de haute volée, un artiste éclectique d’un niveau musical épatant.
Triste destin pour ce passionné des arts, du chant et de la musique dans sa diversité, Mouloud s’est éteint bien trop tôt, le 23 décembre 2006, tragiquement des suites d’un arrêt cardiaque à l’aube de sa cinquantième année à Aubervilliers. Que sa belle âme repose en paix.
Le Matin d’Algérie
lundi 5 juin 2023
https://lematindalgerie.com/
___________________________________________________________________
Le café littéraire de L’Impondérable de Youcef Zirem revient

jeudi 16 mars 2023.
Le café littéraire de L’Impondérable de l’écrivain Youcef Zirem revient après une brève interruption qui nous a parue interminable tant ce rendez-vous littéraire parisien était devenu incontournable.
Cette rencontre a lieu tous les dimanches à 18h au café restaurant L’Impondérable situé au 320 rue des Pyrénées dans le vingtième arrondissement de Paris, dans un beau quartier populaire, depuis le 17 septembre 2017.
Les nouveaux patrons du lieu Mourad et Sofiane ont continué cette belle aventure littéraire en assurant le plus chaleureux des accueils.
Un café littéraire à portée de tous, l’entrée est libre et les débats se déroulent dans le respect des différences, un exemple pour le vivre ensemble.
La convivialité et l’amitié se côtoient avec bonheur dans ce lieu grâce à la générosité de Mourad et Sofiane et au génie de l’écrivain Youcef Zirem qui anime et assure la programmation chaque semaine depuis maintenant de longues années.
Le café littéraire de l’Impondérable de Youcef Zirem est devenu un rendez-vous parisien quasi mythique, il est le seul café littéraire hebdomadaire parisien.
Beaucoup ont essayé de créer des rencontres hebdomadaires mais en vain tant il est difficile d’assurer une programmation chaque semaine, mais Youcef Zirem réussit cet exploit, écrivain prolifique populaire aimé de tous, les auteurs se bousculent pour être invités.
Beaucoup d’écrivains, plusieurs poètes, plusieurs artistes sont passés dans ce café littéraire.
Vanessa Kientz, Akli Drouaz, Claire Barré, Djoudi Attoumi, Anne-Véronique Herter, Djamal Arezki, Youcef Allioui, Ferhat Mehenni, Nacer Ait-Ouali, Mourad Bakir, Hamid Salmi, Farid Benmokhtar, Mohamed Aouine, Mennad Bounadi, Alexandra Pasquer, Brahim Hadj Slimane, Makhlouf Bouaich, Mohamed Hassani, Mohand Nait Abdellah, Messaoud Gadi, Amuqran At Yettura, Djaffar Benmesbah, Uli Rohde, Aqcic At Uqasi, Nadia Agsous, Tayeb Abdelli, Mouloud Behiche, Sonia Fatima Cherfa Turpin, Mahmoud Boudarène, Claude Georges Picard, Mika Kanane, Laurence Biava, Gérard Lambert, Ahmed Medjeber, Mohamed Ghafir dit Moh Clichy, Hamid Ait Said, Sandra Cardot, Yves Michalon, Bahia Amellal, Ghanima Amour, Azeddine Lateb, Ali Ait Djoudi, Hakime Allouche, Pierre Vavasseur, Brahim Saci, Mathilde Panot, Farida Aït Ferroukh, Hacène Hirèche, Mouanis Bekari, Kacem Madani, Lynda Chouiten, Loïc Barrière, Aumer U lamara,Tarik Mira, Ahmed Bouhlal, Sadia Tabti, Ben Mohamed, Horia Bouayad, Farid Alilat, Ahmed Ait Bachir, Akila Kizzi, Luis Dapelo, Salah Oudahar, Farid Galaxie, Hamid Challal, Ali Guenoun, Aziz Tari, Kamel Mezani, Fazia Kati, Mohand Dahmous, Madjid Hallou, Moussa lebkiri, Youcef Medkour, Madjid Benchikh, Hamza Amarouche, Sanhadja Akrouf, Jamil Rahmani, Hassane Hacini, Nafa Moualek, Arezki Metref et Mokrane Gacem, Laakri Cherifi, Sofiane Nait Mouloud, Dominique Martre, A. Wamara, Louisa B, Yasmina Hamlat, Henri Touitou, Amar Yaici, Madjid Boumekla, Malik Kazeoui, Mehdi Bsikri, Madjid Soula, Alain Mahé, Yelas, Yamina Haifi, Abdelkarim Tazaroute, Akila Lazri, Said Kaced, Kada Sabri, Rabha Aissou, Stephan Ghreener, Ahviv Mekdam, Edouard Moradpour, Hocine Redjala, Abderrazak Larbi Chérif, Lili Oz Amelie Dalmazzo, Mohand Tilmatine, Fatima Kerrouche, Akram Belkaïd, Mohand Kacioui, Nora At Brahim, Rezki Rabia, Azar N-Ath Quodia, Azeddine Idjeri, Mahmoud Boudarene, Nacer Ait Ouali, Hassani Mhamed, Muhand Nait Abdellah, Azal Belkadi, Tayeb Abdelli, Madjid Boutemeur, Masin Ferkal, Ahmed Medjebeur.
Ce sont des rencontres qui transforment, cultivent et rendent meilleur, il y règne à chaque fois une atmosphère quasi fraternelle.
Chacun peut sans tabou échanger avec l’auteur dans le respect mutuel. La qualité des échanges émerveille toujours, et l’on voudrait que cela dure et se prolonge même tard dans la nuit.
Après le débat, place à la séance dédicace, puis les discussions se poursuivent autour d’un verre ou d’un couscous.
Nous sortons de là le cœur et l’esprit remplis de lumière et nous pensons déjà au dimanche suivant, hâte d’y être.
Brahim Saci
Le Matin d’Algérie
jeudi 16 mars 2023.
https://lematindalgerie.com/
_________________________________________________
Lâaldja, un vibrant hommage à une mère lumineuse
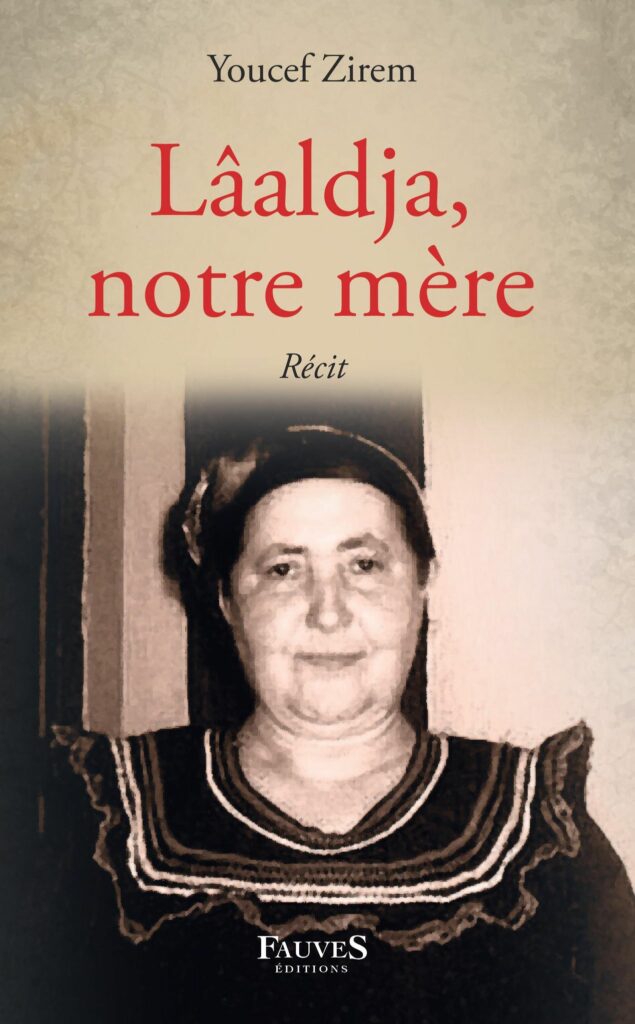
L’écrivain poète journaliste Youcef Zirem nous revient, après « Chaque jour est un morceau d’éternité » chez Douro, « Eveiller les consciences » chez Fauves, en publiant « Lâaldja, notre mère » chez Fauves éditions et nous surprend une nouvelle fois avec bonheur en nous ouvrant les portes de son cœur.
Ce livre est l’un des plus bels hommages, l’un des plus grands messages d’amour de la littérature d’un écrivain à sa mère.
Nombreux sont les écrivains, poètes, qui ont rendu hommage à leur mère, Alexandre Dumas fils, écrit : » Si jeune que l’on soit, le jour où l’on perd sa mère, on devient vieux tout à coup »
Albert Cohen dans « Le livre de ma mère » dédie une des odes les plus merveilleuses, des plus déchirantes à sa mère, « Soyez doux chaque jour avec votre mère. Aimez-la mieux que je n’ai su l’aimer…aucun fils ne sait vraiment que sa mère va mourir ».
Christian Bobin dit dans son livre, La Part manquante, « Les mères se laissent quitter par leurs enfants et l’absence vient, qui les dévore. On dirait une loi, une fatalité… »
C’est la plume tremblante que je tente d’écrire quelques lignes sur ce livre écorché, poignant, chargé d’émotions « Lâaldja, notre mère » de Youcef Zirem, tant cette femme lumineuse ressemble à ma mère disparue.
En 2018 j’étais de passage en Kabylie et je suis allé rendre visite à la famille de Youcef Zirem, accompagné de ses frères Mohand-Chérif, Zakkaria et mon frère si Mokrane, je n’oublierais jamais la générosité de ce regard, la lumière qui jaillissait du visage de cette femme, généreuse, Na Lâaldja, la maman, nous apportant le café et des gâteaux. J’ai passé une belle après-midi mémorable à échanger avec Hadj Ali Zirem le papa, sur l’histoire et la culture, dans cette maison sereine, bénie.
Dès la première page nous sommes saisis pas cette phrase qui donne le ton au livre « À la mémoire de ma mère Lâaldja, partie rejoindre la lumière éternelle, le 21 septembre 2022, à 16h10. À la mémoire de yemma, celle qui m’a tout appris, qui m’a guidé sur les chemins de l’humanisme, pour la remercier encore une fois et pour toujours. », puis c’est une citation de Romain Gary qui ouvre le récit. « Il n’est pas bon d’être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c’est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l’amour maternel, la vie vous fait à l’aube une promesse qu’elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger du pain froid jusqu’à la fin de ses jours. »
Youcef Zirem perd une maman qu’il n’a pas vue depuis 17 ans, les mots s’effacent lorsqu’il faut décrire ce qui ne peut être décrit, la détresse est incommensurable, devant l’inéluctable, la destinée qui s’abat comme un couperet sur celle qu’on ne reverra jamais.
L’exil est parfois cette prison qui n’a pas de nom, elle vous sépare de tout, elle vous broie, elle vous brûle à petit feu, le sort semble alors jouer resserrant les nœuds, le souffle peine et se raréfie.
Un récit limpide comme sait le faire Youcef Zirem, et nous sommes emportés par l’onde qu’aucun récif ne saurait arrêter, l’auteur essaie de relativiser, bref est notre passage sur terre, s’interroge, mais de tout temps l’homme cherche en vains des réponses sur le mystère de son existence, il faut accepter ce qu’on ne peut changer.
Nous avançons à côté de Youcef Zirem, partageant sa souffrance, ses larmes, son chagrin, une part en lui manque aujourd’hui indéniablement, même si elle a toujours manquée durant ces longues années d’un exil forcé, car Youcef Zirem est profondément humain, il aspire à liberté, à la démocratie pour les siens, à l’égalité, à une justice sociale pour tous, pour un pays qui mérite mieux, sans ces conditions, le retour semble improbable.
Comment supporter la douleur de la séparation, l’absence, de cette maman tant aimée, par ces enfants, sa famille, son village et au-delà ?
L’Akfadou tremble devant cette vie si généreuse qui s’éteint, mais il sait que le souvenir demeure comme une lumière éclairant la mémoire. L’humanisme transmis par cette maman hors du commun qui a vécu dans l’humilité, la compassion, le don de soi, donner sans rien attendre en retour continue de rayonner à travers ses enfants, sa famille, ses proches, pour que nul n’oubli Na Lâaldja, cette femme au regard d’un ange, au grand cœur, souriant à chaque jour naissant quel que soit le temps, soulageant les âmes.
À travers cet émouvant récit, on se rend compte que malgré les douleurs et les larmes, la beauté l’emporte, l’espoir, la lumière nous remplissent le cœur, on en sort que plus fort, plus humain.
Na Lâaldja fait partie de ces âmes « qui sans tambour battant inventent des bonheurs » Que sa belle âme repose en paix.
Brahim Saci
« Lâaldja, notre mère » de Youcef Zirem aux éditions Fauves.
Le Matin d’Algérie
1 mars 2023
LEMATINDALGERIE.COM
____________________________________________________________________________
« Slimane Azem, blessures et résiliences », de Hacène Hirèche
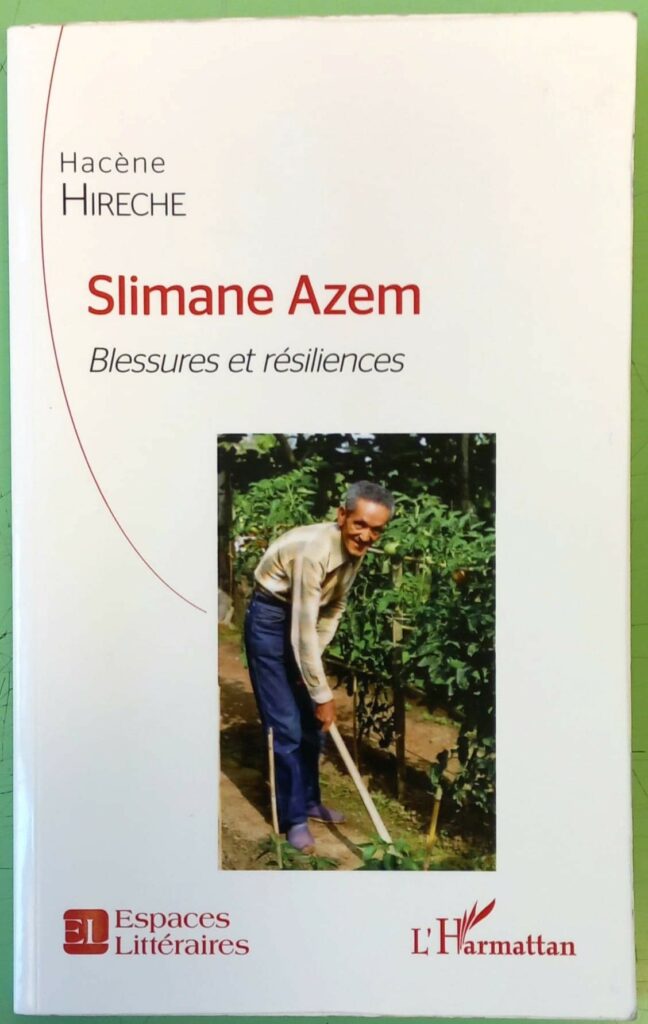
L’universitaire, l’intellectuel et militant, Hacène Hirèche, vient de nous surprendre avec bonheur avec une publication, qui est un émerveillement, Slimane Azem, Blessures et résiliences chez les éditions l’Harmattan.
Qui mieux que Hacène Hirèche pour écrire sur le légendaire Slimane Azem, ce poète, chanteur, visionnaire, génial, qui a marqué le vingtième siècle par sa verve poétique et son engagement artistique. Slimane Azem disait haut et fort ce que le peuple pensait tout bas, que ce soit sous le joug du colonialisme français ou sous la dictature de l’Algérie indépendante, luttant toute sa vie pour une Algérie plurielle, démocratique, dans sa dimension amazighe, dans sa diversité culturelle et linguistique. Son engagement lui valut de mourir en exil loin de la terre des ancêtres qu’il aimait tant.
Le livre s’ouvre sur une citation du philosophe français Jacques Derrida, « Ce qu’on ne peut pas dire, il faut surtout pas le taire, mais l’écrire ». Cette citation résonne et donne comme une tonalité au livre.
La préface de l’universitaire Mokrane Gacem, perspicace et incisive, nous plonge dans le génie littéraire de Hacène Hirèche et l’univers captivant, de son livre, Slimane Azem, Blessures et résiliences, et s’offre à l’esprit du lecteur comme une offrande bienfaitrice qui nous transporte dans l’univers créateur de Slimane Azem. Mokrane Gacem nous donne le ton et la cadence de ce livre touchant et poignant.
Dès les premières pages nous sommes transportés vers ce passé qui n’est pas si lointain, da Slimane c’était hier, c’est aujourd’hui, tant il continue de vivre dans nos cœurs, dans le cœur de cette Kabylie tant aimée. Slimane Azem a su transfigurer les affres de l’exil, les injustices subies, pour magnifier un élan poétique jamais égalé.
Des livres écrits sur Slimane Azem celui-ci semble le plus complet, le plus documenté, le plus dense aussi dans son analyse subtile qui élève sa portée, qui rend ce livre, attachant, qui nous émeut et nous transporte à travers la vie à la fois tragique, torturée et fascinante de Slimane Azem.
Un livre extraordinaire et passionnant, qui nous renseigne, nous éclaire, sur les interrogations, incompréhensions, incertitudes, l’arbitraire, l’injustice et la chape de plomb qui frappèrent le poète libre. Hacène Hirèche lève le voile, grâce à une recherche minutieuse sur la vie, l’itinéraire et le parcours du poète légendaire.
La société kabyle a fait sienne le verbe libre, source d’équilibre, d’harmonie avec la terre et le ciel, Slimane Azem en était le porte-parole pendant plus d’un demi-siècle. Si, Si Mohand Ou Mhand marqua la deuxième moitié du 19ème siècle, Slimane Azem marqua lui, la deuxième moitié du 20ème siècle.
Slimane Azem comme Si Mohand Ou Mhand, est entré dans la légende de son vivant, et continue de faire rêver des générations grâce à ses compositions de génie qui demeurent intemporelles. Son œuvre rayonne au-delà des frontières, plus le temps passe plus on redécouvre la portée exceptionnelle de son génie créateur.
Ce livre de Hacène Hirèche sur le légendaire Slimane Azem, finement écrit, émouvant, captivant, est un baume pour le cœur et l’intellect.
Brahim Saci
23/10/2022
LEMATINDALGERIE.COM
_____________________________________________________
Mouna Aguigui, un philosophe errant
André Dupont dit Mouna Aguigui, qui nous a quittés le 08 mai 1999, à l’âge de 87 ans, fut un philisophe errant que j’ai bien connu à Beaubourg, où je déssinais les touristes comme caricaturiste, portraitiste, dans les années 80.
Comme Jaber El Mahdjoub, il a marqué le quartier Beaubourg par son amour de la liberté. De tels hommes sont rares aujourd’hui où le matérialisme sauvage semble tout acheter, le coeur et l’esprit.
Mouna, homme libre, était là, pour éveiller les consciences. Il y avait toujours du monde autour de lui, des jeunes et moins jeunes, qui l’écoutaient et engageaient la conversation avec lui. À chaque fois je m’arrêtais pour l’écouter comme pour me ressourcer et reprendre des forces, avant de descendre sur le parvis pour dessiner.
Il disait qu’il faut toujours être libre quoi qu’il en coûte.
Un peu plus bas sur le parvis, Banana, un africain, faisait son spectacle, tournant en dérision un batteur chanteur de rock, il tape sur une banane accrochée comme une cymbale , et des couvercles de poubelles en guise de caisses claires, tout en criant, banana !
En haut du parvis, il y avait le théâtre de rue de John Guez au talent exceptionnel, mettant en scène le public, émerveillant des générations de passants. Il tenait une petite baguette qu’il maniait comme un chef d’orchestre pour faire jouer les personnages.
Une époque où la liberté avait encore un sens à Paris.
https://fr.cyclingheroes.com/fr/blog/aguigui-mouna-cycliste-clochard-philosophe
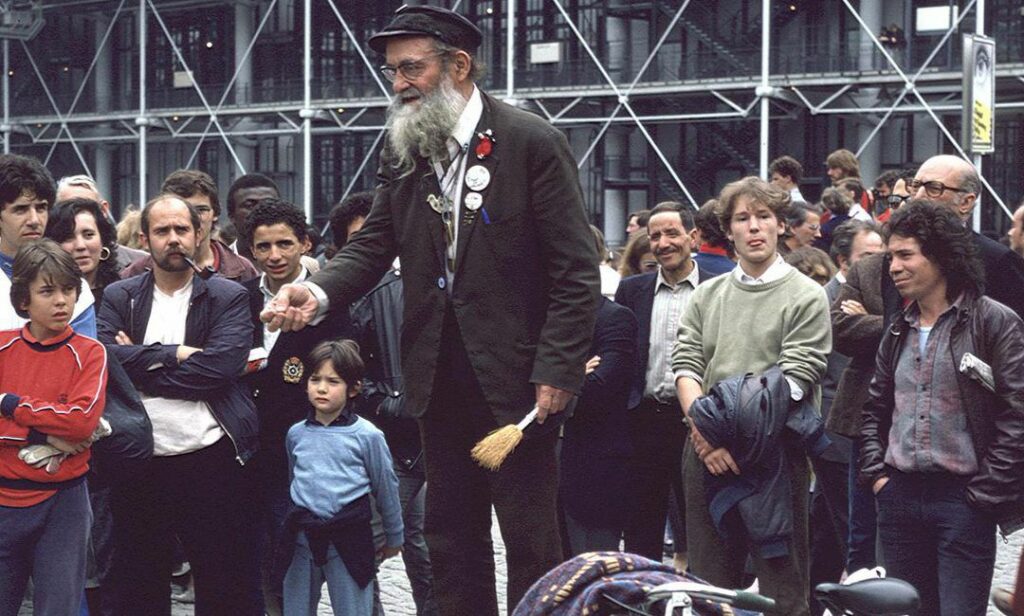
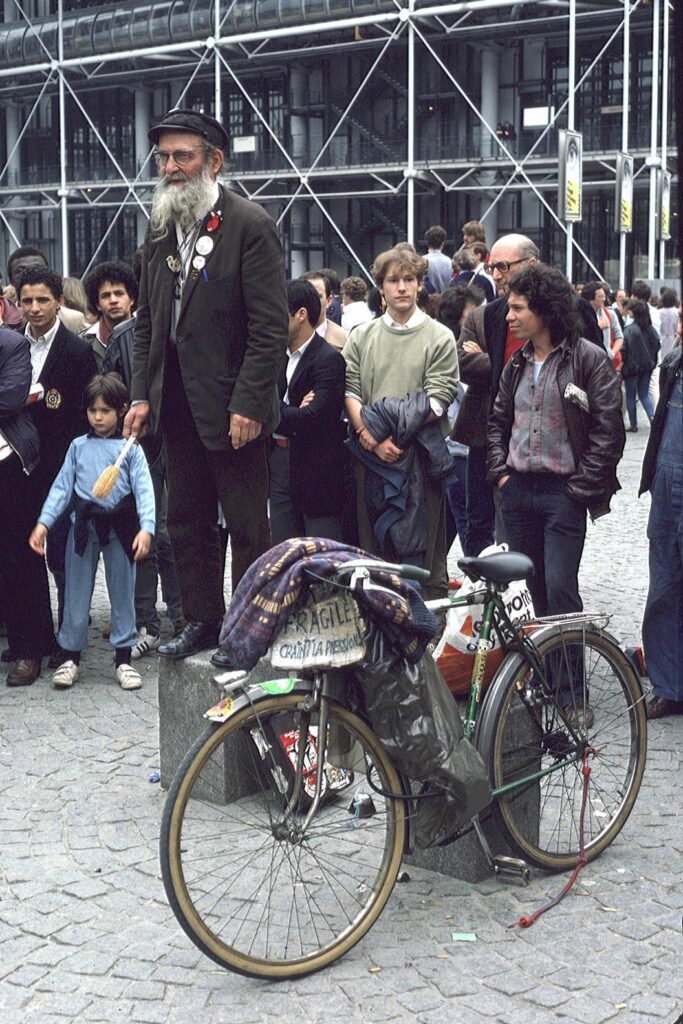
_____________________
Jaber El Mahjoub, artiste saltimbanque, philosophe errant
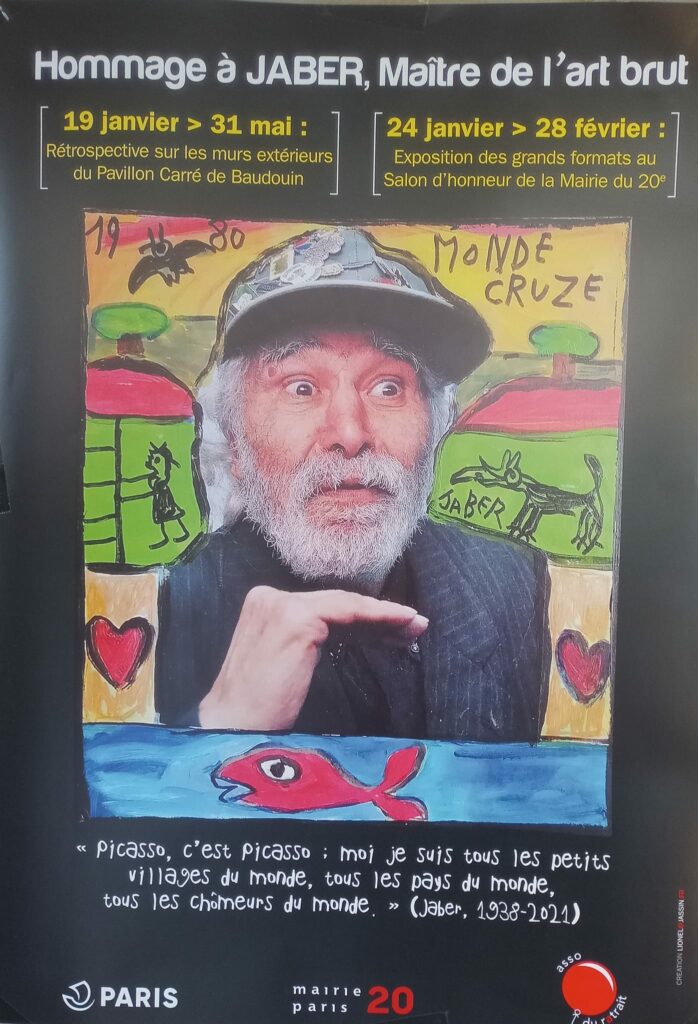
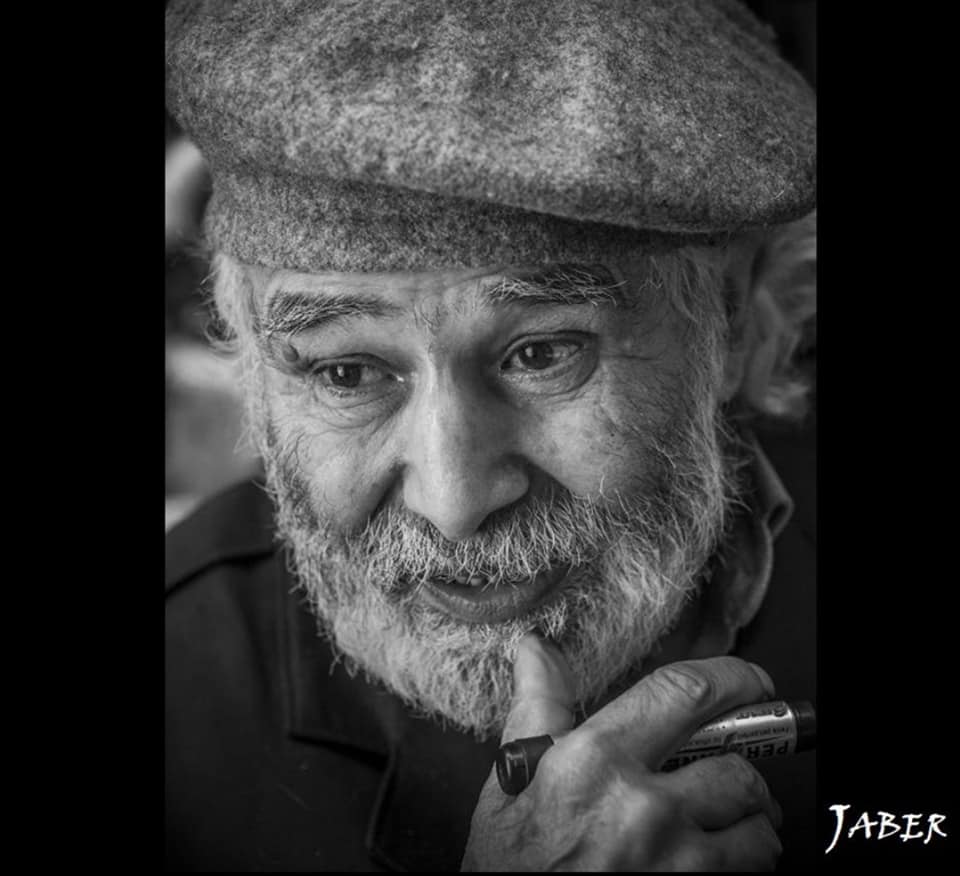
Jaber El Mahjoub, artiste saltimbanque, philosophe errant
L’artiste tunisien, peintre, musicien saltimbanque, auteur compositeur Jaber El Mahjoub s’est éteint à Paris le 21 octobre 2021 à l’âge de 83 ans, paix à son âme.
J’ai eu la chance de le connaître, je garde le souvenir d’un artiste libre, humble et généreux. Je l’ai connu début des années 80 à Beaubourg, il faisait de l’animation en chantant et en jouant du oud tout en tapant des pieds, il y avait chaque fois beaucoup de monde autour de lui. Je dessinais là-bas à l’époque comme caricaturiste portraitiste, chaque après-midi, le chant et le oud de Jaber résonnaient dans tout le quartier Beaubourg, il semait de la joie de vivre. Je restais souvent là, parfois des heures à l’écouter, les gens riaient, il nous rendait heureux.
Un peu plus bas sur le parvis, Banana, un africain, faisait son spectacle, tournant en dérision un batteur chanteur de rock, il tape sur une banane accroché comme une cymbale , et des couvercles de poubelles en guise de caisses claires, tout en criant , banana !
En haut du parvis, il y avait le théâtre de rue de John Guez au talent exceptionnel, mettant en scène le public, émerveillant des générations de passants. Il tenait une petite baguette qu’il maniait comme un chef d’orchestre pour faire jouer les personnages.
À cette époque la liberté avait encore un sens à Paris.
Quelques années avant sa mort, Jaber et moi, prenions souvent un café ensemble chez Said, au café, Aux Marronniers, au 347 rue des Pyrénées. Nous nous croisions aussi chez Azouz le libraire, vendeur de presse au 391 rue des Pyrénées. Jaber a connu à Paris beaucoup d’artistes kabyles, comme Slimane Azem, Oukil Amar et d ‘autres, lui aussi chantait dans sa jeunesse, il avait même enregistré un 45 tour » Ya madame Serbila ». Il aimait évoquer sa mère avec ses tatouages berbères, en disant ma mère était berbère.
Artiste reconnu de son vivant, humble et discret, ses peintures sont célèbres des états-unis à Paris. Trois mois après sa mort la mairie du vingtième arrondissent de Paris, lui rend un vibrant hommage en exposant ses tableaux, de janvier au mois de mai 2022.
Jaber El Mahdjoub a été inhumé M’Saken dans son pays natal, en Tunisie.
……………………………………………………………………………………………….
« Éveiller les consciences », la nouvelle publication de Youcef Zirem
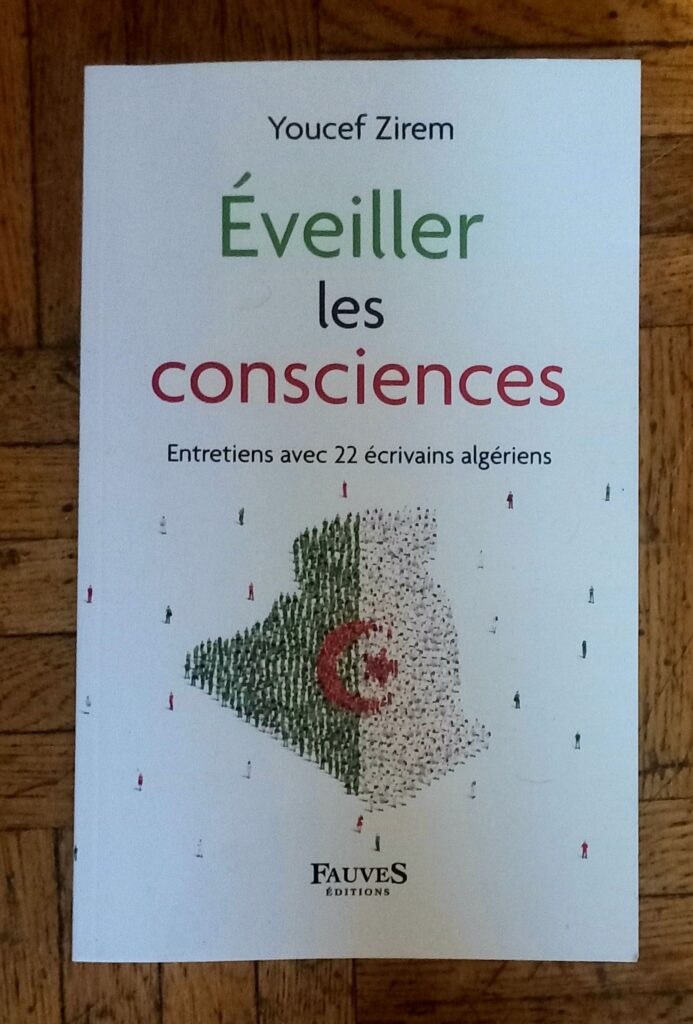
« Éveiller les consciences », la nouvelle publication de Youcef Zirem
Après «Chaque jour est un morceau d’éternité», paru aux éditions Douro, Youcef Zirem nous revient comme un enchantement avec un livre passionnant, «Éveiller les consciences», publié chez Fauves éditions.
Le titre interpelle tout esprit cherchant l’éclaircie dans l’obscurité qui tend à s’étendre aujourd’hui comme pour plonger la mémoire dans l’amnésie.
« Éveiller les consciences », arrive donc à point nommé, comme un éveil salvateur pour ne pas sombrer. Dès les premières pages, Youcef Zirem nous rappelle l’éveil pacifique du peuple Algérien, « Lorsque les jeunes et moins jeunes sont sortis dans la rue le 16 février 2019, à Kherrata, en Kabylie maritime, ils ne savaient pas que leur geste amorçait un nouveau cycle de luttes en Algérie, toute lutte sincère génère un éveil. De larges fractions de la population se sont éveillées et réclament désormais leur droit à la dignité, à la liberté, à la justice sociale ».
Ce livre se présente agréablement sous forme d’entretiens avec des écrivains algériens, qui apportent un nouveau souffle comme pour réchauffer et rafraîchir l’univers littéraire parisien. Youcef Zirem a cette originalité, celle de donner la parole à plusieurs écrivains entre 2004 et 2006, où chacun s’exprime et donne sa vision sur la littérature et l’actualité du monde dans lequel il vit.
C’est ainsi que vingt-deux écrivains prennent la parole, dont Mustapha Benfodil, Bachir Mefti, Chawki Amari, Akram Belkaid, Ali Malek, Habiba Djanine, Abdelmadjid Merdaci, Rachid Mokhtari, Slimane Ait Sidhoum, Boualem Sansal…
Nous ne pouvons nous empêcher de penser à l’inventeur des grands entretiens littéraires dans les années 50, aux entretiens radiophoniques de Jean Amrouche qui a réussi à convaincre et à donner la parole à de nombreux penseurs, écrivains, tels que, Gide, Claudel, Mauriac, Giono, Ungaretti, Pierre Emmanuel ou Jouhandeau.
Ce livre à l’écriture agréable est un moment de littérature. Le lecteur ne boudera pas son plaisir en tournant les pages avec lenteur pour faire durer le jaillissement de lumière qui se dégage de chaque entretien. Mais qui mieux qu’un poète peut mener ces entretiens ?
Dans une Algérie qui peine à se démocratiser, qui n’encourage ni la littérature ni les arts, l’écrivain tente tant bien que mal à décrire la réalité saisissante et celle cachée pour forger avec sa sueur un certain chemin du bonheur, qu’il sait fragile, mais ne plie pas, il essaie de dompter les obstacles et surmonter les difficultés.
Tant d’efforts et tant de peines consentis par des générations d’écrivains, pour tenter d’éveiller les consciences, espérer et tracer des perspectives heureuses pour un lendemain meilleur où l’élan démocratique pourra s’imposer comme seule lueur salvatrice.
Youcef Zirem a l’art de mener les débats, il sait trouver la bonne question pour amener l’écrivain à se dévoiler, à se confier, à livrer ses pensées les plus intimes. Boualem Sansal qui a acquis une renommée internationale dit « c’est le drame qui m’a amené à l’écriture », Ali Malek nous confie « écrire pour prolonger une certaine innocence », Bachir Mefti avoue « l’écriture est une question de survie ». Chacun de ces écrivains est allé au fond de lui-même pour répondre au poète journaliste écrivain Youcef Zirem.
Pour l’écrivain enseignant chercheur Abdelmadjid Merdaci, « Sans liberté de penser, il n’y a pas de littérature ». Magistral !
Brahim Saci
Le Matin D’Algérie
https://lematindalgerie.com
01/02/2022
___________________________
« Chaque jour est un morceau d’éternité », de Youcef Zirem
16/01/2022
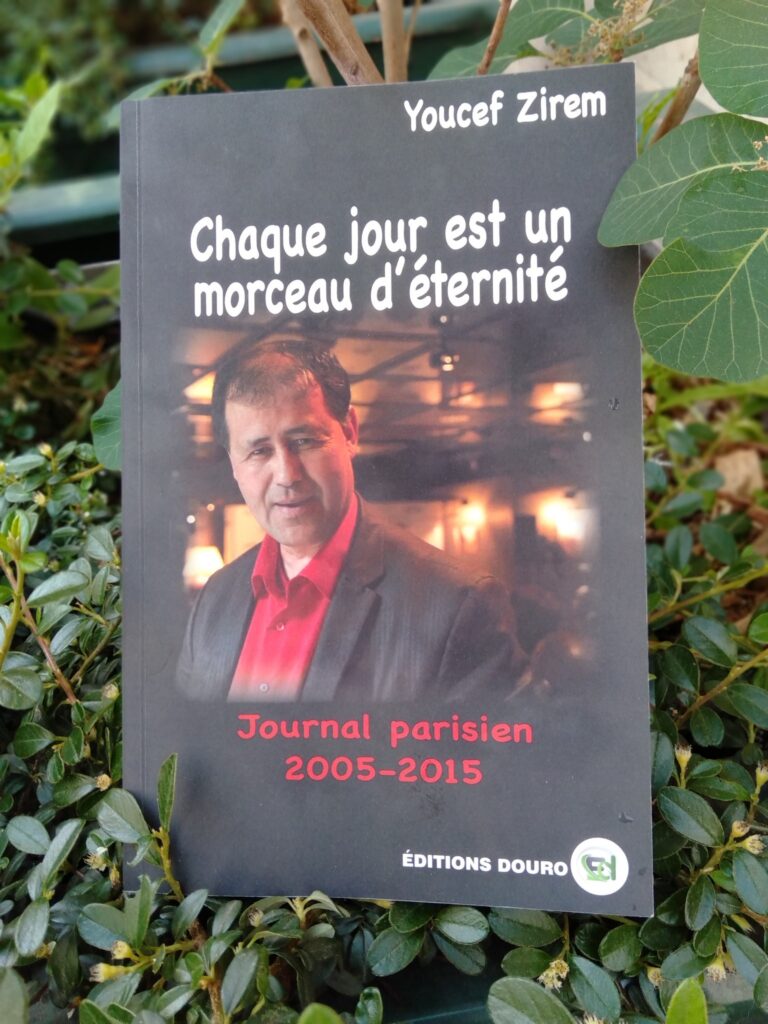
Cette nouvelle publication de Youcef Zirem arrive comme une bouffée d’air dans le paysage littéraire parisien. C’est un Ovni littéraire qui nous réconcilie avec l’écriture sensible et vagabonde qui vient chatouiller notre sensibilité.
L’écrivain Youcef Zirem, après « Libre comme le vent » publié par Fauves éditions et une quatrième édition de « histoire de Kabylie, le point de vue kabyle » publiée par les éditions Yoran Embanner, revient pour le plus grand bonheur des amoureux du livre avec « Chaque jour est un morceau d’éternité, journal parisien 2005-2015 » aux éditions Dourou.
Le livre s’ouvre sur une citation de Christian Bobin, qui donne un ton et un élan qui invite au voyage, à la réflexion, à la méditation. « Il n’y a rien d’autre à apprendre que soi dans la vie. Il n’y a rien d’autre à connaître. On n’apprend pas tout seul, bien sûr. Il faut passer par quelqu’un pour atteindre au plus secret de soi. Par un amour, par une parole, ou un visage ». Par cette élévation spirituelle et philosophique nous plongeons avec bonheur pour découvrir l’univers fabuleux de l’écrivain poète humaniste Youcef Zirem.
L’auteur a ce don et cette magie rare que partagent seulement les plus grands écrivains, comme Faulkner, Camus, Balzac, ou Feraoun, pour décrire l’humain et raconter la vie. Chaque jour est un morceau d’éternité, écrit sous forme de journal qui va de 2005 à 2015, avec des citations et des poèmes, nous transporte et nous émerveille.
Ce journal est une écriture aérée pleine de poésie et de lucidité qui invite le lecteur à suivre l’auteur, à s’interroger, à aimer. Il y a dans ce journal des rencontres, des quêtes, spirituelles, philosophiques. Chaque page apporte sa dimension poétique comme pour nous rappeler la beauté du monde malgré parfois des cieux lourds. « Je retrouve le Paris plein de rêves que la crise sanitaire obscurcit aujourd’hui ». On suit chacun des pas de l’auteur en essayant de ne rien perdre ni du regard ni de la pensée, l’on découvre que le meilleur est toujours possible.
Les pages semblent se tourner toutes seules comme pour ne pas troubler la quiétude qui émane de la narration, un peu plus loin nous sommes accueillis par une citation de Verlaine, « L’Art, mes enfants, c’est être absolument soi-même », pour magnifier l’élan poétique, la sensualité et le mysticisme qui se dégagent de chaque page. On ne peut s’empêcher de penser au Journal de Mouloud Feraoun, par l’humanité et l’émotion qui s’en dégage et le désir d’une liberté exigeante non négociable, comme un sursaut dans la conscience humaine.
La forme du livre est aussi des plus originales, les jours racontés portent un titre qui invite sans attendre à aller plus loin, pour ne perdre aucun pas, aucun regard du poète. Youcef Zirem nous rappelle les origines kabyles d’Alain Bashung, de Marcel Mouloudji, cet habitué de Saint-Germain-des-Prés. On retrouve une citation du poète chinois du huitième siècle, Tou Fou, surnommé le dieu de la poésie, aimé et admiré par Jacques Chirac.
Youcef Zirem nous raconte un concert donné par votre serviteur au conservatoire municipal Camille Saint-Saëns du huitième arrondissement de Paris le 7 juin 2006, il nous décrit l’ambiance chaleureuse de ce moment précieux du partage culturel, de la musique kabyle dans ce haut lieu de l’enseignement musical parisien. Il nous parle aussi du poète chanteur visionnaire Slimane Azem, cet immense artiste épris de liberté qui adorait Paris.
Il évoque aussi maintes fois l’Algérie qui peine à se démocratiser. La liberté et l’amour se côtoient entre illusions et désillusions, mais la poésie en sort toujours salvatrice pour ramener l’équilibre et l’harmonie. Le 16 juin 2015, Youcef Zirem écrit, « réhabiliter l’harmonie du monde, un titre quasi prophétique, qui sonne si juste aujourd’hui ».
Tout au long des pages de ce journal, on a l’impression de marcher à côté de Youcef Zirem dans Paris, on a envie de continuer la route avec lui, on ne veut pas s’arrêter. On veut que le poète continue à nous raconter. L’auteur cite Woody Allen : « Échouer à Paris, c’est mieux que réussir ailleurs ».
Brahim Saci
Chaque jour est un morceau d’éternité, journal 2005-20015 Éditions DOUROU Janvier 2022.
Le Matin d’Algérie
16/01/2022
_____________
Les étoiles se souviennent de tout» est le roman de Youcef Zirem paru aux éditions Fauves. Comment un groupe de résistants kabyles a sauvé des enfants juifs dans Paris sous l’occupation. Ce livre est une merveille de la littérature.
C’est un rafraîchissement poétique du style littéraire pour les passionnés du livre. Une immersion éblouissante dans le Paris et la Kabylie des années 1940.
Ce roman « Les étoiles se souviennent de tout » de Youcef Zirem, est le bienvenu dans le paysage littéraire. L’auteur vient une nouvelle fois nous surprendre pour notre plus grand bonheur avec un enchantement littéraire qui interpelle le cœur et l’esprit.
«Les étoiles se souviennent de tout » est une plongée dans l’histoire, le roman se déroule dans les années 40 entre Paris et la Kabylie. On retrouve des pans de l’histoire souvent méconnus, une histoire humaine poignante. Comme un magicien des mots Youcef Zirem sait si bien jongler entre le roman et l’histoire pour étancher la soif du lecteur. On se prend d’affection pour les personnages, on évolue avec eux dans cette époque trouble écorchée des années 40.
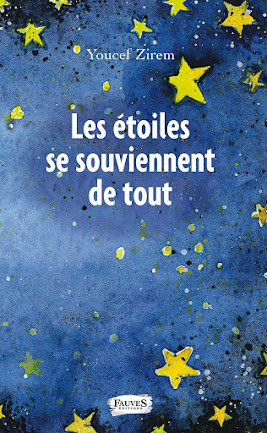
Ce roman raconte une épopée vraie, comment des résistants kabyles aidés par la grande mosquée de Paris et de son recteur le cheikh Si Kaddour Benghabrit ont redoublé d’efforts en dépit de tous les dangers pour sauver des enfants juifs dans Paris sous l’occupation.
Des tracts sont rédigés en langue kabyle pour ne pas éveiller les soupesons des nazis et de la Gestapo appellent les kabyles à aider les enfants juifs pour les sauver de la déportation, d’une mort certaine. Youcef Zirem réussit avec maîtrise et sobriété à nous immerger dans ces années obscures de l’occupation nazie en France. Le style épuré et fluide nous permet de mieux appréhender l’atmosphère étouffante de cette époque blessée.
Ce roman soulève des questions, apporte des réponses et nous aide à comprendre la complexité des situations humaines sous un regard philosophique pour dénouer les nœuds et enlever les brumes qui nous empêchent de voir certaines vérités et rendre hommage à certains engagements fraternels humains. Ce livre de Youcef Zirem nous éclaire et nous rend plus humains.
Samedi 26 septembre 2020
Auteur
Brahim Saci
Le Matin D’Algérie
______________________________________________
Youcef Zirem : « La Cinquième mascarade »
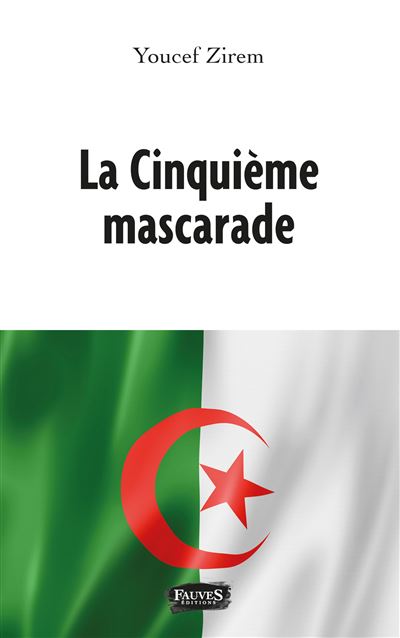
Youcef Zirem vient enrichir la littérature francophone avec son roman, la cinquième mascarade, chez Fauves Éditions. Nous pouvons dire que c’est un livre qui tombe à pic quand on voit le Hirak, la révolution qui se déroule en Algérie qui est porteuse d’espoir.
« La cinquième mascarade » est un roman qui émerveille par sa force et interpelle le cœur et l’esprit par sa lucidité. On retrouve des personnages qui se débattent dans les soucis de la vie de tous les jours, dans une société inégalitaire où même l’amour semble interdit. Un livre poignant, un hymne à la liberté, à l’espoir dans cette époque trouble de toutes les déchirures, où la lumière peine à percer les ténèbres imposées par l’absurde et le non-sens.
Un roman qui dépeint les illusions et les désillusions d’une jeunesse blessée de l’Algérie de l’indépendance à nos jours. Face à l’une des plus féroces dictatures au monde, la résistance est toujours là, l’amour aussi, la soif de liberté hante tous les esprits, ce qui laisse entrevoir un avenir qui peut être meilleur.
La folie et la déraison tentent de faire plier les cœurs et les esprits sans toutefois y parvenir. Le lecteur s’identifie parfois aux personnages et se sent proche de Sabrina, Malika, Khaled, Farid que nous n’avons pas envie de quitter tant nous sommes touchés par leur quête d’idéal et de justice.
L’histoire bien que romanesque paraît si réelle. Au fur et à mesure qu’on avance et qu’on tourne les pages on découvre le soleil sauvegardé au fond des cœurs qui donne l’énergie vitale pour œuvrer dans la bonne direction mais aussi la lutte pour effacer les atmosphères funèbres qui empoisonnent le quotidien.
Un peuple qui semble usé par les années noires d’obscurantisme où l’impensable, la démesure, nourrissent la terreur qui façonne le quotidien d’un pays livré aux hyènes où les valeurs sont déchiquetées. On évolue avec les protagonistes entre espoir et désespoir.
Mais malgré les impasses et les jours sombres, les yeux ne se tournent plus vers la terre à la recherche d’un tombeau, mais vers le ciel pour un renouveau, les corps usés courbés se redressent, comme pour renaître. Sabrina, Malika, Khaled, Farid ont appris par la force des choses à apprivoiser la souffrance et à vivre avec les blessures.
Mais les cicatrices sont là pour nous rappeler afin de chasser l’oubli et l’impunité. Celui qui se souvient par où il est passé saura où il va. Même par temps couvert et les hivers, il faut être lucide à tout prix pour ne pas sombrer. Les loups qui tiennent le pouvoir méprisent le peuple au point de le laisser dans la misère plus bas que terre. À la détresse morale s’ajoute l’injustice sociale qui touche surtout les plus faibles. La dictature a instauré la terreur et l’infamie. Les protagonistes réussissent malgré tout à tenir le cap à l’image d’une jeunesse sacrifiée mais toujours debout.
Youcef Zirem réussit avec art et magie un élan salvateur pour transfigurer les souffrances de tout un pays, dans un style limpide poétique et épuré qui nous rappelle les plus grands écrivains comme William Faulkner, Émile Zola, Mouloud Feraoun ou Albert Camus, où le verbe est porté, élevé, mis à nu pour ne dire que l’essentiel loin du superflus pour ne saisir que le vraisemblable, la vérité. Youcef Zirem malgré un style qui à première vue peut paraître des plus libres par sa fluidité applique au roman une rigueur quasi-scientifique pour peindre comme le peintre une fresque psychologique d’une société malade où les inégalités sociales sont criardes, où les maux sont multiples.
Youcef Zirem sait que le salut n’est pas dans la fuite lâche mais dans la résistance et la lutte pour se libérer des chaînes de la dictature qui érige l’oppression et la barbarie. Il sait que La vie l’emporte toujours et qu’un sursaut philosophique salvateur est toujours possible. L’injustice doit être combattue. Dans une société algérienne qui semble vouée au malheur depuis l’indépendance, l’esprit lucide doit dépasser l’échec pour ne plus se plier. Il interroge et s’interroge, décryptant par l’expérience humaine les conflits et les comportements qu’impose un système injuste, pour démystifier le réel parfois étouffant.
« La cinquième mascarade » nous apprend que malgré les incertitudes, l’espérance d’un avenir meilleur peut jaillir au bout du tortueux chemin. Youcef Zirem à travers ses personnages réussit à faire passer le message que le combat pour la dignité, la démocratie, n’est jamais perdu.
« La Cinquième mascarade », le roman de Youcef Zirem chez Fauves éditions.
Auteur
Brahim Saci
Samedi 17 octobre 2020
_____________________________________________
Matoub Lounès la fin tragique d’un poète », de Youcef Zirem

Matoub Lounès la fin tragique d’un poète, de Youcef Zirem est comme une lumière dans le paysage littéraire.
Youcef Zirem nous surprend une nouvelle fois avec joie par la publication d’un beau livre sur le légendaire Matoub Lounès aux éditions Fauves. La couverture du livre est originale, il s’agit d’un tableau,
une peinture portrait de Matoub Lounès, l’artiste peintre a connu le poète chanteur. Il n’est pas facile d’écrire sur ce géant de la culture Kabyle, poète, musicien, auteur-compositeur chanteur, militant infatigable des causes justes.À juste titre, l’approche de Youcef Zirem est des plus pertinente, un style épuré accrocheur, fluide, forgé par la clairvoyance et la volonté toujours vive d’écarter les superflus pour aller toujours vers l’essentiel, qui accapare dès les premières lignes l’attention du lecteur, le regard fixé sur les pages pour ne rien perdre ni de la lumière qui jaillit des mots et tournures ni du rythme apaisant dans une volupté poétique magnifiant la verve tranchante et éclairée du récit.
Youcef Zirem sait nous tenir en haleine. Youcef Zirem nous dévoile un poète vrai, ami de la muse, manipulant la langue kabyle avec grand art et une dextérité saisissante. Matoub Lounès était proche de son public. Ses admirateurs étaient émerveillés par des textes percutants, une voix grave particulière, un style musical travaillé, des mélodies envoûtantes, le tout dans une langue kabyle recherchée, où les mots sont choisis avec amour et l’expérience du vécu pour toucher le cœur et l’imaginaire kabyle en adéquation avec le réel, défi sans cesse renouvelé.
Recréer le monde par le langage poétique dans la recherche d’un idéal au-delà du réel, dans une société kabyle où la poésie est un art de vivre. Page après page, apparaît un poète généreux, amoureux des libertés, humble, fidèle en amitié, proche de son peuple. Nous découvrons un artiste écorché, meurtri dans une quête de l’absolu, d’un amour insaisissable, d’une justice sans cesse bafouée, dans un monde en mutation où les inégalités se creusent de plus en plus. Matoub Lounès, en ardent défenseur des libertés, criait haut et fort des vérités à l’instar du légendaire Slimane Azem auquel il vouait une admiration sans bornes.Comme Slimane Azem, il est resté libre, poète qu’aucune force n’a pu ni plié ni corrompre. Matoub Lounès tombe dans un guet-apens en Kabylie le 25 juin 1998 à quelques kilomètres de son village natal, la thèse de l’assassinat politique soulevée par ses fans semble aujourd’hui se préciser, Matoub dérangeait. Une vraie enquête reste à faire pour déterminer les vrais auteurs et les commanditaires du lâche assassinat de l’un des plus grands poètes algériens kabyles du XXe siècle.
Poète vrai incompris aux multiples blessures bravant l’incompréhension, la folie de son époque, Matoub Lounès a été l’ennemi d’une dictature bien établie avec ses rouages, ses valets, semant le mal et la destruction, érigeant la corruption en valeur, pour s’assurer la pérennité. Nous découvrons aussi les zones d’ombres entourant son assassinat, les intrigues les manipulations, les trahisons, du sommet du pouvoir jusqu’à l’entourage du poète.Des questionnements assaillent le lecteur désespéré à la recherche de réponses. Youcef Zirem a cette magie rare qu’ont seulement les plus grands écrivains, pour ne citer que Faulkner, Zola, Hugo ou Gabriel Garcia Marquez, pour cette grande liberté dans la narration, mais avec une rigueur scientifique, où s’élèvent des interrogations.
Une plume jaillissant, pourfendant les ombres dans une quête perpétuelle de lumière et de vérité. Youcef Zirem nous dépeint un témoignage poignant d’une époque mouvementée déchirée à travers cet artiste hors du commun qu’est Matoub Lounès dont l’œuvre influence et influencera bien des générations. « Matoub Lounès la fin tragique d’un poète » éditions Fauves, enrichit le paysage littéraire, un fabuleux livre à lire, à découvrir.
Auteur
Brahim Saci
Le Matin d’Algérie
Mardi 6 octobre 2020
___________________________________________

Libre, comme le vent » de Youcef Zirem : un hymne à la liberté, à l’amour « Libre, comme le vent » est une bouffée d’oxygène dans le paysage littéraire. Félicitations à ce grand poète romancier qui ne cesse de nous émerveiller avec de belles publications.
Ce fabuleux livre « Libre, comme le vent » est comme une éclaircie dans un ciel obscurci. Le poète est là heureusement pour nous rappeler quand tout semble pencher vers la nuit, qu’il est toujours possible de puiser au plus profond de soi les forces pour en tirer la lumière, pour être « libre, comme le vent ». Voici un titre évocateur, il interpelle le cœur et l’esprit de l’homme dont le mental est déchiré, enchaîné par les chaînes rouillées des désirs superficiels et éphémères qui font de lui l’esclave de l’illusion, où la quête effrénée pour satisfaire l’appétit vorace de l’ego, l’enferme dans l’incertitude grandissante d’une liberté qui semble impossible à atteindre. La poésie de Youcef Zirem forgée par l’expérience et les errances nous dit que le meilleur est toujours possible et que parfois un poème, un aphorisme, peut nous mener libres au bout du chemin.
La poésie de Youcef Zirem est comme cette source enchantée bénie par les dieux où coule la vérité, celle qui jaillit du fond des âges, éternelle, de toute beauté. Notre temps est court mais nous gaspillons l’énergie précieuse à courir derrière des chimères qui nous mènent vers le gouffre, et là, on ne peut s’empêcher de penser à Baudelaire, lui qui a sondé l’âme humaine. La poésie de Youcef Zirem nous donne des ailes, nous rend libres. Elle nous parle, nous approche comme une amie, comme pour nous murmurer à l’oreille qu’il est toujours temps de s’évader, de s’envoler. Youcef Zirem à travers ces vers libres nous libère de toute entrave et conditionnement. Ces aphorismes nous rappellent la brièveté de l’existence ou nous résument en peu de mots l’essentiel, la vérité fondamentale, éclairant ainsi le mental trop longtemps alourdi par une dialectique déformée par le monde matériel. Loin de chercher à convaincre, les aphorismes de Youcef Zirem sont hors du temps, ils paraissent comme une lueur d’espoir pour les âmes perdues qui ont peur du miroir, et ceux en quête de sens.
C’est une poésie qui se laisse boire jusqu’à satiété, mais en vérité celui qui plonge dans cette eau de la terre et du ciel voudrait y rester, pour ne plus en sortir, tant la béatitude de l’essentiel loin du superflu brille comme le soleil qui donne vie. Le poète a un regard juste sur le monde qui l’entoure. Il est témoin de son temps, il voit la folie du monde, (…Happé par la solitude, le joueur de saxophone s’arrête; son instrument détruit, il laisse le chaos se propager; dictatures imposées par le nouvel désordre mondial, les caravanes du mensonge s’emballent… Ivresse impossible, le papillon est déjà ors-jeu; tes neurones saccagés frétillent; seul le désir se plaît à trouver son chemin…).
Le poète est toujours à l’écoute du monde, Youcef Zirem rend un bel hommage au peuple algérien admirable, uni dans la fraternité et l’amour dans son identité berbère, amazigh, dans sa diversité culturelle et linguistique, pour libérer le pays de la dictature et instaurer enfin après tant de sacrifices une vraie démocratie, et retrouver la grandeur du soleil d’Afrique. (…Peuple algérien, tu es magnifique ! Laisse-moi te dire combien je t’aime, laisse-moi te dire combien je t’admire ! Laisse-moi te dire que je j’ai jamais douté de ta grandeur !…Par la force des choses je vis loin de toi…Mais je n’ai jamais cessé de penser à toi…L’exil est, parfois plus dur que la mort…je me sens renaître…aucune armée au monde ne peut s’opposer à ta soif de liberté, de dignité, de justice sociale…Ce qui se passe dans le pays va bouleverser toute l’Afrique du Nord…Peuple algérien, sois patient ta victoire est certaine…Peuple algérien, bientôt tu exerceras ta souveraineté, dans les règles de l’art, sans désir de vengeance, mais avec cet amour de l’autre qui a fait la force de nos ancêtres depuis la nuit des temps…Peuple algérien, tu as beaucoup souffert mais tu es en marche pour ta liberté. Peuple algérien, dans ta marche vers la lumière, tu es beau…)Cet hommage est un hymne à l’amour, à la liberté, comme un beau chant, un beau poème lyrique à la louange de cette révolution algérienne pacifique extraordinaire, saluée par le monde. Il y a dans ce beau livre des quêtes multiples, cherchant un sens, il y a aussi des interrogations qui vont au-delà de notre réalité terrestre, vers l’univers, tentant toujours de saisir un élan salvateur.
« Libre, comme le vent » de Youcef Zirem, chez les éditions Fauve.
Auteur
Brahim Saci
Jeudi 10 septembre 2020
Le matin d’Algérie
…………………………………………………………………………………
Merci Brahim SACI pour ces mots d’une grande justesse et d’une vérité touchante 🥳 Une merveilleuse critique pour découvrir le nouveau recueil de Youcef Zirem, une page qui chante la poésie dans ce qu’elle a de plus grand 🌬 «
Merci beaucoup Fauves Editions, ce nouveau livre du grand Youcef Zirem « Libre, comme le vent », est une pure merveille, c’est la poésie que j’aime, qui m’éclaire et qui m’interpelle .
___________________________________________________
Mohand Cherif Zirem : « Un écrivain authentique doit être un citoyen du monde »

Mohand Cherif Zirem Poète journaliste de talent, Mohand-Chérif Zirem a beaucoup écrit dans la presse, il a aussi plusieurs ouvrages à son actif. Universitaire, il est psychologue clinicien, il est donc de ceux à même de comprendre les bouleversements de la société dans laquelle il vit.
Le Matin d’Algérie :
Vous êtes un auteur prolifique parlez-nous de vos livres ?
Mohand Cherif Zirem :
J’écris depuis que j’avais 11 ans. J’ai débuté en arabe, puis en tamazight et puis en français. J’écris plusieurs livres dans ces trois langues. Certains de mes ouvrages ont été publiés, d’autres pas encore. J’ai publié entre autres : Les Nuits de l’absence, Brahim Saci sur les traces de Slimane Azem, L’Amour ne meurt pas et Je vais encore prendre le large. Je suis édité en Algérie et aux USA. Je suis traduit en italien. On peut dire que j’ai laissé quelques traces dans le monde fabuleux de l’écriture. En outre j’ai fait plusieurs préfaces pour nombre d’auteurs algériens et étrangers. J’écris pour témoigner, pour apporter un plus à mes lecteurs, un tant soit peu.
Vous avez étudié la psychologie, est-ce que cela vous aide dans votre écriture ?
Mohand Cherif Zirem :
Oui je suis psychologue clinicien, sorti de l’université d’Alger en 2004. J’ai soulagé les patients dans deux grands CHU de la capitale. Et depuis des années j’interviens comme psychologue dans la presse et dans mes conférences. La psychologie m’aide dans l’écriture. Je ne me contente pas de noircir les feuilles, mais je tente, toujours, de pénétrer dans l’âme humaine pour l’analyser et tenter de la décrypter. Ce n’est pas du tout facile de faire ça, mais je fais de mon mieux.
Dans un pays qui peine à se démocratiser, où les crises sont multiples, quelle est la place de l’écrivain ?
Mohand Cherif Zirem :
L’écrivain a du mal à se faire une place dans le monde d’aujourd’hui ; un monde qui se matérialise et qui se déshumanise démesurément. Notre beau pays traverse des crises multidimensionnelles depuis des décennies. Les nobles valeurs ont tendance à disparaître et les gens lisent de moins en moins. Cependant, l’écrivain a le devoir d’apporter un plus à sa société et au monde entier. Un écrivain authentique doit être un citoyen du monde qui est à l’écoute de tout ce qui touche l’humain. L’écrivain peut orienter, interpeller, accompagner ses lecteurs.
Le monde est secoué par des bouleversements sans précédents, la gestion de la crise sanitaire, freine les révolutions, en restreignant les libertés, en Algérie, la transition démocratique devient urgente, qu’en est-il du Hirak ?
Mohand Cherif Zirem :
La crise sanitaire complique la situation de l’Algérie, un pays déjà fragile et secoué par des crises qui semblent éternelles. Le Hirak est un mouvement singulier qui aspire à libérer notre chère patrie. Les millions de personnes qui manifestent dans la rue sont à saluer. Personnellement, je ne rate aucune occasion pour exprimer mes aspirations démocratiques dans la rue dans mes écrits, et ce, depuis
plusieurs années.
Actuellement, il est temps de penser à de nouvelles formes de protestation pacifiques pour que l’Algérie se démocratise. Notre combat pour la liberté doit
s’inscrire dans la durée. Le chemin sera encore long. Donc, il faut investir dans l’humain : via la culture, l’éducation et l’inculcation des valeurs humanistes aux générations montantes, des générations qui peinent à trouver leurs repères. Seule la démocratisation réelle de l’Algérie permettra l’évènement d’une nouvelle ère de liberté et de prospérité.
Nous devons, sans cesse, semer l’amour, la tolérance, le respect de l’autre et bien d’autres vertus, lesquelles vont nous permettre d’accéder à un lendemain meilleur.
Auteur
Entretien réalisé par Brahim Saci
Le Matin d’Algérie / Vendredi 6 novembre 2020
_________________________________________________
Hamza Zirem : « L’écrivain éloigné de son pays doit se recréer continuellement »

Hamza Zirem est né en 1968 à Akfadou. Il a enseigné la langue française pendant plusieurs années. En 2009, bénéficiant d’une bourse d’études dans le cadre du réseau international ICORN, il a été accueilli en Italie par la municipalité de Potenza. Depuis 2010, il entreprend la profession de médiateur interculturel et linguistique.
Hamza Zirem a collaboré avec plusieurs revues et journaux : Rencontres Artistiques et Littéraires, Algérie Littérature/ Action, La Grande Lucania, Controsenso Basilicata, La Pretoria, Territori della Cultura… Hamza Zirem est l’auteur d’une dizaine de livres. Il est co-auteur de la traduction des entretiens radiophoniques de Jean El Mouhoub Amrouche avec Giuseppe Ungaretti (UniversoSud, 2017).
Il a été nommé, par l’Universum Academy Switzerland, Ambassadeur de la Paix pour son précieux témoignage dans le domaine culturel. Il a obtenu de prestigieux prix littéraires en Italie: Premio Nuova scrittura attiva (Tricarico), Premio Europa (Porlezza), Premio Salvo D’Acquisto (Pescara), Premio Universum Basilicata (Potenza), Premio AlberoAndronico (Roma), Premio La Pulce Letteraria (Villa D’Agri) et Premio La Rosa d’Oro (Torre Alfina). Hamza Zirem a été nommé
membre du comité scientifique du Centre Universitaire Européen du Patrimoine Culturel. Ses textes ont été insérés dans de nombreuses anthologies.
Le Matin d’Algérie :
Après des études universitaires, vous avez enseigné pendant quelques années la langue française, j’essaie d’imaginer la difficulté d’exercer ce métier dans une Algérie où le pouvoir politique prône l’arabisation.
Hamza Zirem : L’enseignement est un métier très enrichissant et très exigeant. Il ne consiste pas seulement à aider les élèves à apprendre, l’éducation à l’école compte beaucoup et doit amener les apprenants à réfléchir à la manière dont ils peuvent contribuer à l’édification d’un monde meilleur. De mon expérience personnelle, je me rappelle surtout des textes de grands auteurs, qui ne faisaient pas partie du programme officiel, que j’étudiais avec mes élèves et qui nous transmettaient des regards observateurs sur la société ainsi qu’un sens profond des rapports humains. L’école algérienne a toujours été utilisée à des fins politiques.Les diverses «réformes scolaires», entamées au cours des années, n’ont pas vraiment pour objectif une refonte pédagogique, les idéologies planifiées du régime ont intentionnellement détérioré le système éducatif. Dans son étude intitulée « Crise linguistique en Algérie: les conséquences de l’ arabisation », l’universitaire Lily Keener a écrit en 2019 : « En ce qui concerne l’Algérie, qu’il soit de la langue ou de la religion, le gouvernement ne désire que monopoliser tout afin de garder le pouvoir, et de plus, il ne désire que le pouvoir. Il ne s’intéresse ni à la question de la langue, ni de la culture. La langue arabe a bien été exploitée comme un outil destiné à la domination des Algériens. Chez le gouvernement algérien n’existe qu’une histoire de corruption qui a conduit le problème islamiste jusqu’à la décennie noire ainsi que la politique d’arabisation jusqu’à l’empêchement de la modernisation ».
Pouvons-nous dire que ce sont les contradictions, le manque d’horizon d’un pays qui se referme sur lui-même qui vous a ouvert les portes de l’écriture et vous a poussé à partir ?
Hamza Zirem : J’ai grandi dans un milieu familial très propice à l’éveil culturel. Je me suis rapproché davantage de l’écriture suite à mes rencontres déterminantes avec certains copains durant les études universitaires, nous avions vécu des expériences très formatrices et les lieux que nous fréquentions étaient de véritables bouillonnements culturels. En outre, dpuis 1990, j’ai entamé une correspondance littéraire en échangeant les idées avec de nombreux écrivains francophones qui m’ont encouragé à publier mes propres textes.
Parmi eux, je peux citer Djamel Amrani, Michel Tournier, Jeannie Varnier et Michel Poissenot. Après avoir exercé pendant une quinzaine d’années dans le domaine de l’enseignement, j’ai quitté l’Algérie en 2007. J’ai vécu pendant plus d’une année en Norvège et puis je me suis installé en Italie. Abandonner son pays est toujours un choix douloureux. Les raisons qui poussent les Algériens à quitter le pays sont multiples.La situation actuelle de l’Algérie est désastreuse: le président de la république et les membres du gouvernement sont illégitimes, le chômage est grave et endémique, les émeutes sont récurrentes, la flambée des prix érode continuellement le pouvoir d’achat des familles et la majorité de la population vit sous le seuil d’une extrême pauvreté, il n’existe aucune liberté d’expression, l’absence de démocratie est totale, la violation des droits de l’homme est systématique, l’incessante détention des militants du Hirak est arbitraire, la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 est très mauvaise…
Vous vivez depuis plusieurs années en Italie, où vous avez réussi à vous imposer en publiant des livres en italien et en français, parlez-nous de vos ouvrages ?
Hamza Zirem : Ma première suite poétique, parue aux éditions françaises Clapàs, remonte à 1997 et depuis j’ai continué de publier des recueils de poèmes, quelques essais littéraires, des entretiens avec certains auteurs, des fables pour enfants et des romans. J’ai également écrit le texte d’une pièce théârale qui a été représentée par la troupe Gommalacca à l’occasion de l’inauguration de « Matera, capitale de la culture européenne 2019 ». Je suis aussi co-auteur de la traduction des entretiens radiophoniques de Jean El Mouhoub Amrouche avec le poète italien Giuseppe Ungaretti, un livre publié chez UniversoSud en 2017. Dans quelques mois paraitra mon nouveau recueil de poèmes intitulé « La persistance des vieux jours » avec une introduction de Philippe Poivret.
L’Italie vous a adopté, vous avez obtenu de prestigieux prix littéraires ainsi que des nominations de très haut niveau comme ambassadeur de la paix et membre du conseil scientifique du Centre Universitaire Européen du Patrimoine Culturel de Ravello. Parlez-nous de ces heureux événements ?
Hamza Zirem : On m’a attribué des prix littéraires et des nominations, et les différents motifs des reconnaissances sont minutieusement expliqués par les jurys responsables. J’avais bénéficié d’une bourse d’études dans le cadre du réseau international ICORN et je suis accueilli par la municipalité de Potenza au sud d’Italie, en Lucanie. Invité dans un cadre officiel m’a énormément aidé à organiser facilement beaucoup de rencontres culturelles pour parler de mes livres et d’autres sujets. J’avais, par exemple, organisé en 2009 avec le professeur Luigi Serra (un chercheur universitaire en études berbères et un ami de Mouloud Mammeri) un colloque international sur la Kabylie comme région emblématique de la Méditerranée. Oui la Lucanie m’a adopté. Cette région méridionale a accueilli de nombreuses et importantes civilisations méditerranéennes, des Grecs antiques aux hommes illustres du XXe siècle.
Une région riche en paysages qui, sur quelques kilomètres, changent considérablement : des côtes sableuses ou découpées, des lacs aux montagnes, des châteaux aux fermes ; elle offre des décors splendides très différents. Le sud d’Italie a su garder une réelle authenticité semblable à la Kabylie, avec des gens viscéralement attachés à leur terre, à leur culture et à leur langue.Les Lucaniens ont fièrement conservé leurs traditions aux rites anciens et ils ont su mettre à profit toutes les stimulations culturelles. Cette terre riche en produits gastronomiques est une gardienne excellente d’un patrimoine ancien et raffiné. Chaque commune est un haut lieu de valeurs culturelles d’où émergent des faits, des us et coutumes d’une grande richesse.
Le caractère de l’Italien du sud est souvent jovial, on peut discuter de tout avec lui, vu sa facilité d’approche et son humanité. Les Lucaniens sont ouverts au monde par tous leurs sens, ils sont admirablement armés pour recueillir le trésor illimité de sensations et de jouissance que la Lucanie met à leur disposition. Ils gardent en eux intacts la puissance, l’audace et le besoin d’appréhender le monde dans sa réalité physique, ils sont de vrais habitants de la terre. Ils vivent en harmonie avec l’univers en atteignant un haut niveau de plénitude morale. De cet accord profond et essentiel, entre la Lucanie et ses habitants, nait une parfaite grâce.Après avoir passé plus d’une année en Norvège où les personnes sont très froides comme leur climat, je me retrouve beaucoup mieux ici au sud de l’Italie dans le climat de la culture méditerranéenne, je ne me sens pas dépaysé et je découvre beaucoup de choses similaires entre l’Afrique du nord et le sud de l’Italie : les traditions et les us, certains faits historiques, les rythmes de la musique, la saveur culinaire, l’architecture, l’accueil des gens, la mentalité, la sympathie, la vie communautaire et même la langue dont beaucoup de termes arabes et berbères sont utilisés dans les dialectes lucaniens.
Y a-t-il des reconnaissances ou des évènements culturels importants auxquels vous aviez participé qui vous tiennent particulièrement à cœur ?
Je suis parfois invité par des universités, des établissements scolaires et des associations culturelles pour participer à des événements culturels. Chaque rencontre me procure de grandes satisfactions. Je cite quelques épisodes qui me viennent à l’esprit en ce moment.
Lors d’un festival de la poésie des pays méditerranéens qui s’est tenu à Nusco le 24 octobre 2009, les élèves de cinq lycées d’Irpinia dirigés par leurs professeurs ont étudié et traduit mes poèmes du français vers l’italien et même du français vers le latin. Ils m’ont consacré d’admirables critiques littéraires qui ont été publiées dans le numéro 4 de la revue «Il Monte». Ma suite poétique intitulée «Saisir le présent », parue dans la revue Algérie Littérature / Action en 2005, a été traduite en norvégien par le traducteur de Nedjma de Kateb Yacine : Kjell Olaf Jensen et a été publiée en 2008 à Stavanger. Mon roman « Inno alla libertà di espressione » a été étudié à l’Université de la Basilicate par les étudiants du département des sciences humaines.En décembre 2010, un de mes textes est publié à Florence dans une anthologie, consacrée au thème de la liberté des idées, imprimée en 7000 copies et distribuée gratuitement dans tous les instituts scolaires du cycle secondaire de la Toscane. Dans un de ses livres, le grand écrivain italien Rocco Brindisi me cite dans plusieurs passages une trentaine de fois. Après avoir lu mon roman
intitulé « L’exil norvégien d’un écrivain kabyle », le poète Oudjedi Khellaf m’a écrit un long commentaire, voici un petit extrait : « La première impression qui se dégage de ce roman est la poésie dont il regorge. (…) Ton écriture ressemble à celle de Mouloud Feraoun ou Albert Camus par sa simplicité, à celle de Mouloud Mammeri par sa poésie et à celle de Kateb Yacine par sa profondeur humaine ».
Est-ce que vous pourriez mettre en évidence quelques brefs extraits de votre roman que vous venez de citer pour donner une idée bien précise, aux lecteurs de notre journal, de ce que vous écrivez ?
« Le rôle de Massi en tant qu’écrivain est d’ouvrir son cœur et ses idées à ses interlocuteurs, d’exprimer sa vision des choses, ses craintes et ses aspirations. L’acte d’écrire est, d’une certaine manière, un acte risqué qui suppose beaucoup de courage et d’abnégation dans le contexte où il vivait. Répondant aux questions qu’on lui pose, Massi évoque sa collaboration au journal Akfadou News et savoure encore ces temps durant lesquels il s’efforçait de sensibiliser les lecteurs sur des questions de morale, sur l’importance de la citoyenneté souveraine et sur le déclin de l’ouverture démocratique qui a gangréné l’Algérie jusque dans ses moindres recoins.Face à l’oppression, ses articles se sont faits virulents, ce qui lui a valu un emprisonnement. L’écriture journalistique l’a fait voyager abondamment. Sa cause était juste et son combat était indispensable. Sa conscience demande à ce que quelqu’un le comprenne et poursuive sa lutte. Peut-être qu’un jour ses signaux seront plus forts que l’inhumanité de ceux qui l’ont poussé à l’exil. (…) Massi est un terrien, qui s’est nourri de vérités simples. C’est cela qu’il tente de traduire dans ses livres, par besoin de le rappeler au monde qui l’oublie, quand il ne se désintéresse pas, préférant les plaisirs et les vanités.
Massi est quelqu’un qui a besoin du ciel mais dont les pieds demeurent ancrés dans le sol, il a besoin du concret, de toucher, de sentir, de voir et d’entendre avec les mots de tous les jours. Ses sentiments s’appuient sur des valeurs qui ne visent que ce qui peut rendre le monde et les hommes meilleurs. L’encre dans laquelle il plonge sa plume n’est pas celle qui rédige les savants dictionnaires, mais celle où le cœur puise ce qui le fait battre. (…) C’est quoi l’exil ? Une omniprésence d’un état d’esprit énigmatique. Vidée de sa substance vivante, l’âme s’engourdit et s’éteint dans un profond sommeil. Comme le vent qui souffle nerveusement sur le no man’s land, le bateau de Massi a du mal à trouver son port. Les flashbacks douloureux l’empêchent d’oublier les temps malfaisants et les périples âpres. (…) L’expérience de l’expatriation est une épreuve douloureuse et éprouvante.L’écrivain éloigné de son pays doit se recréer continuellement une ambiance avec des couleurs imprécises. Massi reconsidère son exil dans ce qu’il contient d’épaisseur de survie, de souffrance, de joie inventée et de liberté recherchée. L’exil est une tension qui vise à fragmenter tant d’expériences humaines. Le regard de Massi est braqué vers un avenir de sentiments blafards. Sa vision est déroutante dans un mélange de symboles et d’interprétations confuses. La déraison de son époque l’a contraint à consommer la bêtise des jours contrariés. Il reconnaît l’inanité de son cheminement décérébré ».
En France, les écrivains algériens souffrent du manque de visibilité pour la majorité car l’accès aux médias est souvent impossible. Pensez-vous que l’Italie offre plus l’ouverture et plus de perspectives de réussite aux auteurs étrangers ?
Oui l’Italie offre certainement plus de possibilités aux écrivains étrangers par rapport à la France. Au fil des années, la reconnaissance des différentes cultures et l’écoute des témoignages d’auteurs étrangers deviennent de plus en plus importants. L’intérêt pour la littérature produite par des auteurs d’origine étrangère en Italie est né dans le cadre d’un cours universitaire sur la communication interculturelle, initié par l’enseignante Paola Ellero qui avait déclaré : «Les productions culturelles des étrangers constituent, au-delà de leur valeur littéraire, un outil pour dépasser les frontières qui conditionnent encore notre façon de penser et de vivre le phénomène migratoire et la présence de citoyens immigrés dans notre pays. Ils nous invitent à regarder la réalité, souvent entachée de stéréotypes, à travers les yeux de ceux qui ont cherché et trouvé l’hospitalité parmi nous, parvenant également à s’intégrer.
Face à l’augmentation des flux migratoires de ces dernières années, à l’image transmise par les médias, un changement de perspective dans notre façon de voir l’immigré est de plus en plus nécessaire. La littérature des migrants en langue italien peut jouer un rôle important dans ce processus, car elle reflète dans le présent de ces nouveaux voisins notre passé, pas substantiellement différent, même s’il est refoulé, d’hommes et de femmes qui ont dû abandonner leur terre pour chercher ailleurs une meilleure vie ».
L’Italie n’est pas épargnée par la crise sanitaire mondiale, comment vivez-vous cela ?
On résiste en espérant que les choses rentreraient dans l’ordre après la saison hivernale. On se rend compte que la première vague de la pandémie n’a pas servi de leçon aux gouvernants, on se retrouve une nouvelle fois avec un manque flagrant de préparation. La deuxième vague du coronavirus est brutale, elle dévoile les disparités du système sanitaire italien et les hôpitaux du sud risquent de chavirer. Pour le moment, les autorités ont catalogué les vingt régions en zones jaunes, oranges et rouges, impliquant différentes restrictions.
Quel regard portez-vous en Italie sur la révolution pacifique algérienne du Hirak ?
Un collectif d’Algériens résidents en Italie a été créé pour soutenir le Hirak. Il organise souvent des activités à la place Cordusio de Milan et rassemble des dizaines de personnes très actives qui se solidarisent avec les manifestants en Algérie et sensibilisent l’opinion italienne. Les protestations menées par le Hirak algérien étaient très impressionnantes. Les messagers de la révolution du sourire, depuis le mois de février deux mille dix-neuf et pendant plus d’une année, ont organisé des manifestations de masse plusieurs fois chaque semaine en Algérie et dans plusieurs pays étrangers où résident nos concitoyens. Ils ont hissé notre âme que l’on tente d’assujettir, ils continuent à réclamer un état civil et non militaire, ils ont brandi des slogans captivants, leurs chansons improvisées valent mieux que mille discours.
Ils ont mis l’intérêt collectif au dessus de tout, ils se sont rappelé des sacrifices de nos martyrs, ils ont traversé toutes les villes et tous les bourgs pour libérer nos âmes enchainées et abattre les injustices qui ont perduré. Ils ont franchi des océans en démence et des territoires consternés pour allumer sur nos fronts la flamme de l’espoir. Ils supportent encore de longues attentes pour tracer d’authentiques chemins, ils résistent aux aléas des quatre saisons pour figurer l’arc-en-ciel. Ils affrontent constamment de très grandes difficultés causées par le régime dictatorial des militaires. Beaucoup de personnes sont arrêtées et arbitrairement emprisonnées à cause de leurs opinions, même le drapeau amazigh dérange ceux qui ont renié notre identité. Les hirakistes sont des militants vigoureux et ils s’expriment pacifiquement en réinventant nos aspirations avec de géniales trouvailles. Ils s’efforcent de garantir des lendemains qui chantent pour ouvrir les fenêtres du pays sur la promesse de l’aube. L’Algérie libérée des tyrans est une espérance pour tous. Les messagers de la révolution du sourire ont désobéi à la mort programmée de l’Algérie pour déjouez les ivresses et les fureurs des décideurs illégitimes. Les agents du désordre ne peuvent brouiller les pistes perpétuellement. Après la pause forcée, due à la pandémie, les hirakistes renaitront avec de nouvelles formes de lutte. Avec leur détermination, ils résisteront jusqu’à l’instauration d’une transition démocratique et iront jusqu’au bout avec le projet du changement radical pour éteindre l’incendie causée par les pyromanes du pouvoir. Cette révolution extraordinaire, ignorée par presque tout l’Occident, se poursuivra certainement jusqu’à la chute de la dictature des généraux. Les revendications de liberté et de démocratie soulevées dans le plus grand pays africain entraîneront des changements majeurs dans l’ordre géopolitique de l’Afrique du Nord et auront un impact sur le monde entier. Ces changements seront d’une importance fondamentale en ce qui concerne notamment l’avenir de la
politique étrangère des différents pays européens.
Auteur
Entretien réalisé par Brahim Saci
Le Matin d’Algérie
Jeudi 19 novembre 2020
____________________________________________
Café littéraire parisien L’Impondérable, le rendez-vous incontournable de Youcef Zirem

Paris compte cinq cafés littéraires historiques, « Les DeuxMagots » à Saint Germains des prés, que fréquentaient jadis Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, un lieu de rendez-vous d’artistes et d’intellectuels, Guillaume Apollinaire, Elsa Triolet, Louis Aragon, André Gide, Picasso et d’autres.
« Le Procope » dans le 6ème arrondissement de Paris, La fontaine, Racine, Diderot, d’Alembert, Beaumarchais, Voltaire, Balzac, Nerval, Hugo, George Sand, Musset et Verlaine s’y sont attablés. Aujourd’hui Amélie Nothomb, Éric-Emmanuel Schmitt fréquentent ce lieu.
« Le Café de la Paix », place de l’opéra dans le 9è arrondissement, fréquenté par de nombreux intellectuels, écrivains, Maupassant, Victor Hugo, Émile Zola, Oscar Wilde, Paul Valéry, André Gide, Marcel Proust.« Le Café de Flore » dans le 6ème arrondissement, fréquenté par Guillaume Apollinaire, Picasso, Boris Vian, Serge Reggiani, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Ionesco.
« La Closerie des Lilas » dans le 6ème arrondissement, Bazille, Renoir, Monet, Sisley, Pissarro, Émile Zola, Paul Cézanne, Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Edmond de Goncourt, Paul Verlaine, Paul Fort, Lénine Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry. Amedeo Modigliani, Germaine Tailleferre, Paul Fort, André Breton, Louis Aragon, Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre, André Gide, Paul Éluard, Oscar Wilde, Samuel Beckett, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Henry Miller, ont fréquenté cet endroit.Le café littéraire de L’Impondérable de l’écrivain Youcef Zirema lieu tous les dimanches depuis plus de deux ans dans le 20ème arrondissement de Paris, plus précisément au 320, rue des Pyrénées. Beaucoup d’artistes, d’intellectuels, d’écrivains s’y côtoient chaque dimanche. Mais bien que ce soit le seul café littéraire qui a lieu chaque semaine à Paris, la presse française, curieusement, n’en parle pas.
Ce café littéraire est pourtant un exemple pour le vivre ensemble et l’ouverture culturelle. C’est un lieu convivial, où les échanges se font dans la curiosité, l’amitié, et la bonne humeur. Les poètes, les écrivains, les artistes en général, sont toujours les bienvenus.
Mathilde Panot, députée de la France insoumise est venue parler de la situation sociale en France, elle a évoqué la lutte des gilets jaunes, du « Hirak » la révolution du peuple algérien dite du sourire, puisqu’elle a été en Algérie, en Kabylie, rencontrer les révolutionnaires. Mathilde Panot a aussi parlé des mouvements révolutionnaires en Amérique latine et à travers le monde.
Les artistes, le écrivains, les intellectuels de tous bords viennent parler de leurs publications. L’écrivain Youcef Zirem assure la programmation et anime toujours les débats avec brio.Après une présentation et un échange entre l’invité et Youcef Zirem, la parole est donnée au public. Chacun est libre d’intervenir et de poser la question qu’il veut, même celui qui vient de rentrer, qui n’a rien suivi, tout le monde l’écoute avec bienveillance et l’invité lui répond, tout se passe dans le respect du vivre ensemble.
Ce café littéraire situé dans un quartier populaire joue un rôle éducatif. Les rencontres sont toujours chaleureuses et conviviales. Un repas est souvent offert après la rencontre. Les gens restent souvent très tard et en profitent pour échanger autour d’un verre entre eux et avec l’invité.Moise Kemmache le patron du lieu contribue aux côtés de Youcef Zirem à faire vivre ce café littéraire, on leur dit un merci et un grand bravo ! C’est vraiment un exemple d’ouverture culturelle dans le respect de la diversité et du vivre ensemble.
Dans une société parisienne qui a tendance à se refroidir dans un individualisme grandissant dans un repli sur soi effrayant, le café littéraire de l’Impondérable est comme une oasis dans un désert brûlant, ou un coin du feu dans un hiver glacial.Certains m’ont dit attendre chaque dimanche avec impatience. Ce rendez-vous est devenu incontournable pour beaucoup de parisiens et non parisiens.
Auteur
Brahim Saci
Dimanche 6 septembre 2020
Le Matin d’Algérie
____________________________________________
YOUCEF ZIREM
UNE VIE VOUÉE À L’ÉCRITURE
L’écrivain poète journaliste Youcef Zirem, un écrivain talentueux, dont l’aura dépasse les frontières, parfois me rappelle Faulkner, parfois il me rappelle Camus, Mouloud Feraoun ou Gabriel Garcia Marquez.
Sil peut nous paraître quelquefois en marge, il n’en est rien en vérité, car il est parfaitement attentif et à l’écoute de la société dans laquelle il vit et suit les bouleversements du monde, son esprit perspicace et lucide comprend les enjeux, et tente bien des fois d’alerter et prévenir la conscience humaine.
Si sa vison métaphysique semble hors du temps, elle est aussi bien de son temps, conscient des flux volontaires et involontaires de l’époque qui semblent échapper au pouvoir humain. Ses écrits et sa façon d’être, sont un enseignement. Il sait que le présent façonne l’avenir avec les leçons du passé. Il ne cessera d’œuvrer à dégager la pensée dépoussiérée, de toute soumission. Il n’est pas rare de le voir à une terrasse parisienne, un café et un journal, parfois même en train de griffonner une pensée, un poème.
Youcef Zirem a cette manière étrange et mystérieuse de saisir l’inspiration et de ciseler les mots à la manière d’un orfèvre pour en retirer tout ornement superflus pour en retenir que l’essentiel. Sa vie est remplie de poésie, le regard du poète ne le quitte jamais , même à travers ces romans où il est souvent lui même l’un des personnages. Sil transfigure parfois la réalité c’est toujours pour la rendre plus réelle, à la portée de tous, afin que nul n’oublie.
Youcef Zirem connaît le poids de l’exil celui que ressent tout être incompris où qu’il soit, et la solitude qu’il apprivoise pour la rendre féconde, car c’est peut-être seulement là que l’âme est libérée, où la plume peut sans entraves s’exprimer. Il n’aura de cesse de tenter de briser les silences, bousculer les absences pour s’élever contre toutes les formes d’oppression. Il sait la fragilité des choses, ses écrits nous mettent en garde contre l’absurde qu’on tend à ériger en certitude.
Il est l’humaniste, l’ami. Youcef Zirem connaît les chemins justes, il essuie les larmes du faible, il connaît aussi les sentiers sinueux des méchants, des arrogants, il fustige et dénonce l’impunité des puissants. Il est de tous les combats qui mènent à la libération des peuples. Il aime les petits cafés parisiens, comme la plupart des grands poètes et écrivains car là les échangent sont sincères, les regards sont libres, les gens laissent leurs armures à l’extérieur, la vie est vraie.
Son livre, « Libre, comme le vent », le résume très bien, la liberté n’est pas pour lui un simple credo mais une façon de vivre, c’est un état d’être. Il sème des graines de lumière sur son passage, il éclaire ceux qui le lisent, il redonne l’espoir à ceux qui l’approchent. Il aime flâner dans les rues de Paris, cette ville lumière des poètes et des écrivains.
On le croirait tiré d’un personnage de roman, il est la pensée libre sans concession, il milite depuis de longues années pour la démocratisation de l’Algérie, et la liberté des peuples opprimés. IL aime aussi prendre des photos de cette ville des arts, pour fixer ces instants éternels parisiens. Si j’ai publié plusieurs livres de poésie, c’est en partie grâce à ses encouragements, et il m’a à chaque fois honoré d’une belle préface dont il a la magie. Rares sont les auteurs qui ont sa sagesse et sa générosité. Je suis heureux d’être son ami et j’attends à chaque fois avec impatience ses nouvelles publications.
Brahim Saci
Le Matin d’Algérie
Le 20 juin 2020

_______________________________ __________________
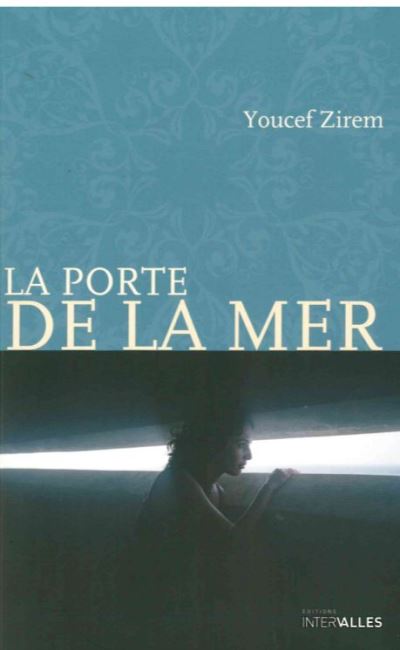
Le roman «la porte de la mer» de Youcef Zirem vient de paraître aux éditions Intervalles, un hymne à la vie, à la liberté.
Le roman «La porte de la mer» de Youcef Zirem nous interpelle à plus d’un titre. Dès le début nous sommes frappés par le titre très évocateur, nous pensons tout de suite à la liberté mais la photo nous montre une femme enfermée qui ne voit le monde extérieur qu’a travers une fente, une déchirure.
Il y a de prime abord une dualité entre cette photo de couverture qui montre une femme désespérée et le titre qui est plein d’espoir, le lecteur est alors envahi d’une impatience inouïe pour ouvrir le livre et entrer dans l’histoire qu’il pressent écorchée vive et plonger dans cette mer inconnue.
Dès la première page on constate que le roman est dédié au poète chanteur compositeur Brahim Saci, » A brahim Saci, pour la clairvoyance de son regard, pour sa poésie qui sait saisir l’essentiel, pour ses chansons toutes enrobées d’un humanisme serein et toujours en mouvement. » qui est comme une clé ouvrant une petite porte pour découvrir un peu plus ce roman. Puis l’auteur cite une phrase de Fernando Pessoa, « J’ai conquis, un petit pas après l’autre, le territoire intérieur qui était mien de naissance. J’ai réclamé, un petit espace après l’autre, J’ai accouché de mon être infini, mais j’ai dû m’arracher de moi-même au forceps. » comme pour nous donner une deuxième clé ouvrant une autre porte de compréhension pour mieux aborder le livre.
Nous découvrons une histoire tragique émouvante dans une Algérie déchirée qui se recherche. Les protagonistes sont tantôt perdus dans une société en effervescence où parfois la folie dicte ses lois, tantôt lucides pour panser ses blessures, se frayer un chemin et réinventer l’espoir. L’auteur dans une transfiguration de la réalité en allégorie de la critique d’une société algérienne extrêmement corrompue, une méthodologie stricte de l’observation, de la description, qui nous rappelle l’écriture d’Émile Zola.
Dans ces vives descriptions des inégalités sociales génératrices des passions les plus viles, à travers des personnages attachants que la misère ne plie pas, nous ne pouvons nous empêcher de penser à Honoré de Balzac tant le héros balzacien est un observateur révolté qui contemple impuissant. La forme narrative parfois hachée parfois fluide nous rappelle aussi par moments William Faulkner.
Ainsi l’héroïne Amina consciente de son impuissance mais ne baisse pas les bras, elle avance pour ne pas oublier, dans une Algérie qui cultive l’oubli de peur de se regarder dans le miroir.
Amina me fait penser à Nedjma de Kateb Yacine dans la transfiguration de l’Algérie tant elle témoigne d’une Algérie défigurée, meurtrie.
Brahim SACI
8 Juil 2025
lematindalgerie.com
_____________________________________________________
SANDRA CARDOT, LE BONHEUR À TOUT PRIX – AFRIQUE DU NORD NEWS
25 Octobre 2018
Sandra Cardot, le bonheur à tout prix
Sandra Cardot, est une personne lumineuse que chacun devrait lire. Toujours souriante et joviale, toujours dans le don de soi, le partage et l’abandon, son simple regard vous fait aimer la vie.
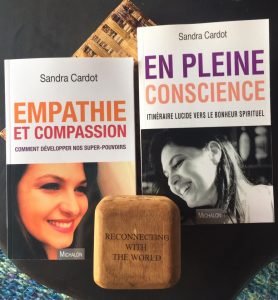
Après son livre « En pleine conscience, itinéraire lucide vers le bonheur spirituel » publié aux éditions Michalon, dont on a beaucoup parlé, où elle nous éclaire sur les pouvoirs immenses cachés en nous et comment l’amour, l’empathie et la compassion arrivent comme par magie à les libérer, pour nous libérer, toujours pour le meilleur, améliorer notre vie, en parfaite communion avec les autres et le monde qui nous entoure, Sandra revient avec une nouvelle publication « Empathie et compassion ».
Sandra Cardot revient donc renforcer sa vision du monde avec une grande lucidité et une verve poétique qui semble inépuisable avec cette deuxième publication « Empathie et compassion » publiée aux éditions Michalon, qui est comme un rayon de soleil dans le paysage littéraire.
Sandra Cardot vient nous émerveiller avec ce livre pour le plaisir des lecteurs en quête de sens et de lumière, où lucide, perspicace et pédagogue elle nous ouvre les yeux sur le chemin du bonheur, de la spiritualité et nous donne des outils tels des clés pour ouvrir les portes conduisant à l’épanouissement personnel.
« Empathie et compassion » est un livre qui nous aide à respirer dans cette époque où tout va trop vite, où l’homme s’oublie, esclave de ses désirs entraînant derrière lui le chaos. Sandra Cardot nous offre la voie salvatrice de la spiritualité, de la méditation pour guérir le mental et redonner un souffle, un sens, aux esprits écorchés, aux cœurs torturés, qui portent le joug offert par le monde matériel.
Le monde tend à imposer le superflu et le non-sens, les ténèbres qu’il tisse voilent le vrai sens de la vie et notre raison d’être qui est d’être heureux, un bonheur que nous avons tous en nous même si l’éblouissement des lumières artificielles extérieures tend à nous le faire oublier.
Il faut beaucoup défricher, semer et aimer dans l’abandon, sans jamais rien attendre, c’est seulement là que peuvent commencer à apparaître des éclaircies dans le mauvais temps dont nous sommes le plus souvent responsables, et voir le chemin qui mène à la réalisation spirituelle en évitant les pièges de l’ego.
Sandra Cardot nous montre que notre plus grand ennemi est l’ego et nous donne des outils pour le combattre. Elle nous montre aussi combien tout ce qui est vivant est lié toujours pour célébrer la vie où tant de forces interréagissent dans l’amour et la compassion et qu’il est possible de changer nos comportements et nos réflexes hérités des générations qui nous ont précédées et d’aller vers l’amour absolu du vivant.
La nature est pleine d’enseignements pour ceux qui regardent avec le cœur loin des barrières, œillères, préjugés, terreur, inégalités, pauvreté, peurs et interdits que la société nous impose avec ses rois et ses vassaux pour pérenniser les forces obscures sous le règne du Veau d’Or afin de barrer la route à l’amour, au partage, à la compassion.
En nettoyant son cœur chaque jour, en souriant, en acceptant les événements de notre vie avec sérénité nous renforçons les forces positives qui participent à l’équilibre du monde, de la nature et de l’univers. Ce livre nous aide à mieux voir la vie, il nous montre comment aller vers l’essentiel, accepter ses peurs qu’engendrent les désirs pour pouvoir en sortir.
« Empathie et compassion » et « En pleine conscience, itinéraire lucide vers le bonheur spirituel » sont deux livres qui nous éclairent et nous ouvrent la voie vers la méditation pour une ascension spirituelle vers le langage libérateur du cœur.
Sandra Cardot nous apprend à nous libérer des ruses du mental et des pièges de l’ego, à cultiver le pardon pour retrouver l’équilibre enfoui au fond de chacun, en nous donnant des outils simples qui nous aideront au jour le jour à écarter les brumes du superflu qui viennent de l’extérieur.
Les livres de Sandra Cardot « Empathie et compassion » et « En pleine conscience, itinéraire lucide vers le bonheur spirituel » nous accompagnent comme une lumière bienfaitrice, éclairant notre quotidien, nous aidant à voir plus clair dans la nuit ou en plein jour, pour un éveil de la conscience tourné vers le cœur pour une élévation spirituelle et une plénitude intérieure, pour comprendre que l’amour, l’empathie, la compassion et le pardon sont les clés du bonheur.
adn-news.com
25 Octobre 2018
________________________________________________
KATIA TOUAT, UNE POÉSIE QUI INTERPELLE LE CŒUR ET L’ESPRIT.
14 Novembre 2018

Katia Touat, une poésie qui interpelle le cœur et l’esprit
« Ijeɣlalen n tudert » est un magnifique recueil de poésie en langue kabyle de Katia Touat publié aux éditions Achab, disponible en Algérie.
En ouvrant le recueil, nous sommes de prime à bord éblouis par la beauté qui s’en dégage comme un baume apaisant pour supporter les tiraillements subis par la pensée afin d’en écarter les ombres pour plus d’éclaircies.
L’attention est tout de suite happée par la liberté du style poussée à son paroxysme comme pour mieux retenir le lecteur dans une tentative hâtive de réduire toute réticence et résistance du mental pour une libération du regard des contingences de la condition humaine. Sortir de la forme vers d’autres configurations et styles, dans une volonté d’attiser la curiosité de l’esprit pour une poésie sans cesse renouvelée.
Les vers s’articulent parfois empreints d’une grande mélancolie, mais sans exagération, car l’imaginaire kabyle rend tout cloisonnement et enfermement quasi impossibles. Une poésie moderne par sa musicalité et le rythme tirant sa force dans un décloisonnement de la pensée libérant l’esprit. Katia Touat ne s’accommode pas des influences et des représentations, curieuse et surmontant les difficultés, elle essaie d’aller au plus profond d’elle-même pour saisir les éléments nécessaires pour dépeindre avec bienveillance la complexité de l’existence.
Les poèmes se succèdent dans un jaillissement de lumière surprenant, magnifiant, élevant l’esthétique de cet art littéraire que cisèle Katia Touat avec la force du cœur. L’effort se précise avec dextérité dans un élan stylistique singulier et irrégulier qui à première vue peut paraître hyperbolique dans son expression.
Au fur et à mesure que l’on avance dans la lecture du livre, une poésie profonde s’offre à nous parfois pour nous surprendre par un renouveau du genre et du style qui interpelle, bouscule, éclaire et élève l’esprit. Katia Touat sort des sentiers battus, elle ne se perd pas dans des descriptions et développements inutiles et superflus.
La langue kabyle est merveilleusement ciselée, travaillée, pour transfigurer les douleurs, les déchirures du cœur, de l’âme, dans un élan poétique bienveillant et salutaire.
Brahim SACI
14 novembre 2018
adn-news.com
___________________________________________________________
HISTOIRE DE KABYLIE, LE POINT DE VUE KABYLE», DE YOUCEF ZIREM.
31 octobre 2018
« Histoire de Kabylie » livre de Youcef Zirem

Histoire de Kabylie, le point de vue kabyle», de Youcef Zirem.
Une traversée de l’histoire de la Kabylie de l’antiquité à nos jours.
«Histoire de Kabylie, le point de vue kabyle», de Youcef Zirem aux éditions Yoran Embanner, est un livre passionnant, si étonnant par la force de la narration qu’on s’y croirait. On peut dire que l’écrivain Youcef Zirem nous a surpris avec ce livre d’histoire écrit par un kabyle sur cette région d’Algérie habitée par les berbères kabyles depuis la préhistoire. Jusqu’ici nous étions habitués à voir des auteurs étrangers à notre culture écrire sur notre histoire.Youcef Zirem est le premier kabyle à écrire sur l’histoire de son peuple dont les origines remontent à la nuit des temps. Les Kabyles sont un peuple pacifique qui a fait de la liberté et de la poésie depuis des milliers d’années un art de vivre où les contes, les chants, font partie du quotidien. Le livre se présente comme un résumé condensé exhaustif de l’histoire de la Kabylie.
La couverture de la première édition du livre est un dessin représentant Si Mohand Ou Mhand, le célèbre poète kabyle de l’errance et de la révolte, de la confédération des Aït Iraten. Il est né entre 1840 et 1845 à Icheraiouen, à Larbaâ Nath Irathen, et mourut le 28 décembre 1906 à l’hôpital des Sœurs blanches, près de Michelet (Aïn- El-Hammam) il est enterré au cimetière de Tikorabin, Asqif Netmana (le portique de la sauvegarde), dans le coin réservé aux étrangers. Si Mohand Ou Mhand a marqué la deuxième moitié du 19ème siècle et le début du 20ème siècle.Si Mohand Ou Mhand a été poussé sur les routes après la destruction de son village par les français. Il n’accepta pas le nouvel ordre dicté par l’occupant refusant toute compromission avec la présence coloniale, il vécut en poète errant libre, égrainant des rimes, jamais soumis, maniant le verbe kabyle avec grand art, dénonçant le colonialisme et les travers de son temps.
Si Mohand Ou Mhand est entré dans la légende de son vivant comme ce fut le cas du poète chanteur kabyle Slimane Azem dans la deuxième moitié du 20ème siècle qui refusa toute compromission avec le pouvoir autoritaire de l’Algérie indépendante qui allait museler les libertés démocratiques et tenter d’effacer l’identité millénaire berbère. En fervent défenseur des libertés démocratiques et de son identité kabyle berbère occultée par l’Algérie indépendante, Slimane Azem fut contraint à l’exil. Il mourut en France en 1983. La couverture de la réédition du livre est un dessin représentant l’héroïne guerrière kabyle Fadhma N’Soumer qui a résisté à la conquête française de 1849 à 1857. Elle est née en 1830 dans le village de Werja (Ouerdja), situé sur la route menant d’Aïn El Hemmam vers le col de Tirourda. Elle mena une résistance armée acharnée contre les Français. Le 27 juillet 1857, elle fut arrêtée au village Takhlicht Nath Atsou. Fadhma N’Soumer meurt en captivité en septembre 1863 à l’âge de 33 ans à Tablat. Ses cendres ont été transférées en 1994 à El Alia à Alger.
Il n’est pas aisé d’être le premier kabyle à écrire l’histoire de cette région et pourtant Youcef Zirem l’a fait avec le talent et la magie féconde pour nous captiver et nous émerveiller, dans un élan poétique de conteur, qu’ont seulement les plus grands écrivains. Les kabyles sont un peuple épris de liberté, véhiculant les plus hautes valeurs humaines, d’entraide, d’hospitalité, de démocratie, de droit d’asile, où la prison n’existe pas, où le fonctionnement du pouvoir ne génère aucun salaire. Les kabyles sont un peuple berbère constitué en tribus, en villages, en fédérations et confédérations. « Histoire de Kabylie » est donc une plongée dans l’histoire millénaire de cette partie d’Afrique du nord, la partie Algérienne, la Kabylie, à travers l’histoire si riche de cette Afrique du nord berbère. Le Kabyle a toujours défendu sa langue, sa culture et sa liberté depuis des millénaires. Cette terre africaine du soleil, de toutes les richesses, était très convoitée, les envahisseurs furent nombreux. Le peuple kabyle a résisté depuis des siècles aux différentes invasions, en préservant sa langue et sa culture qui sont toujours vivaces de nos jours. Il n’a jamais plié jusqu’à l’arrivé des français. Le kabyle qui a vécu en harmonie avec la nature qui l’entoure n’a pas résisté à la politique de la terre brûlée organisée par ceux-ci.
C’est vers l’an 1000 avant J-C, que les Phéniciens installent des comptoirs le long de la côte nord-africaine pour asseoir leur domination commerciale en méditerranée, s’accommodant avec les royaumes numides avant que les Romains en fins stratèges, concurrents militaires et commerciaux ne viennent à leur tour tenter d’imposer leur domination sur l’Afrique du Nord berbère. Les kabyles comme les autres peuples berbères ont résisté à leur pénétration. Mais la convoitise de cette Afrique du nord va grandissante et la Kabylie va subir d’autres invasions, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Espagnols, les Turcs et les Français. Islamisés les kabyles vont participer à la fondation de plusieurs dynasties berbères musulmanes dont la dynastie des fatimides qui fonda le Caire en l’an 969.La domination turque n’a pas réussi à soumettre la Kabylie et les français ne viennent à bout de la résistance Kabyle qu’en 1872. «Lorsque la guerre d’Algérie éclate, la Kabylie est l’un des plus grands bastions de cette lutte pour la liberté. Mais une fois l’indépendance acquise, le régime d’Alger n’a de cesse de marginaliser cette région qui ne se laisse pas faire. La Kabylie se bat toujours pour ses valeurs, sa langue et sa culture.»Youcef Zirem traverse l’histoire avec élégance relatant avec finesse l’essentiel. On apprend aussi énormément sur l’histoire contemporaine de la Kabylie, de l’indépendance à nos jours. Si aujourd’hui l’obscurantisme tente de lui faire perdre ses repères, son esprit libre et démocratique, il n’y parviendra pas, car les kabyles sont conscients du danger et semblent vouloir prendre leur destin en main. La Vérité, la liberté en sortiront vainqueurs, la lumière effacera les oppresseurs. Youcef Zirem réussit un coup de génie pour un livre d’histoire, donner la parole à quelques intellectuels pour donner leur point de vue sur l’histoire de la Kabylie et réactualiser le livre en l’augmentant de plusieurs pages à chaque nouvelle réédition.
Brahim SACI
Le 31 octobre 2018
Le Matin d’Algérie
__________________________________________________________
Une pensée pour mon ami le regretté Achour Badache, paix à son âme !
Mon grand ami Achour Badache était une grande âme qui s’en est allée bien trop tôt, le 23 juillet 2018 à l’âge de 52 ans. La nouvelle de sa mort survenue à Alger était tombée comme un couperet.
Je n’arrivais pas à y croire, nous devions manger ensemble à Azazga, il m’avait proposé de m’y rejoindre en voiture pour nous restaurer dans cette ville kabyle située à 135 km d’Alger, cette ville célèbre pour ses restaurants et son accueil légendaire.
La distance n’avait peu d’importance pour lui lorsqu’il s’agit de rejoindre un ami. J’ai rarement rencontré un homme aussi fidèle en amitié et à la parole donnée.
D’une mère française et d’un père kabyle, il était l’exemple même de la double culture.
Il maîtrisait admirablement la langue kabyle et était très attaché aux valeurs légendaires qu’elle véhicule. Il aimait la Kabylie, il aimait l’Algérie qu’il désirait plus que tout voir se démocratiser pour le bonheur du peuple algérien. Je sais qu’il aurait aimé assister au réveil de ce grand peuple, à toutes ces manifestations pacifiques saluées par le monde entier.
Achour Badache était plein d’amour, il aimait tant la vie. Toujours jovial, d’une immense générosité toujours prêt à rendre service, un grand homme de culture, un grand humaniste, un homme merveilleux qui nous manquera toujours.
Achour Badache aimait les livres, les arts. Nous nous retrouvions souvent au café littéraire l’impondérable animé par Youcef Zirem. En compagnie de Youcef Zirem, nous partagions le verre de l’amitié, nous discutions avec joie du livre et nos échanges étaient à chaque fois des plus profonds et d’une grande portée littéraire.
Il aimait mes chansons, il avait tous mes livres ainsi que les livres de Youcef Zirem, Sa générosité était immense, il achetait un grand nombre d’exemplaires qu’il offrait toujours avec plaisir.
A chaque fois qu’il venait au café littéraire il achetait évidemment les livres de l’auteur invité et il ne manquait jamais de poser des questions pertinentes pour enrichir l’échange intellectuel toujours avec douceur et gentillesse sans jamais froisser l’invité mais au contraire encourageant toujours.
Il a aidé beaucoup de jeunes artistes en difficulté tant il aimait l’art avec cette volonté majestueuse de vouloir toujours aider. Toujours prêt à rendre service.
Il me parlait souvent de sa famille, de ses enfants qu’il aimait tant qu’il était impatient de voir grandir. Malheureusement le destin en a décidé autrement.
Que dieu tout puissant t’accueille dans son vaste paradis.
Sur terre tu étais un exemple, tu portais en toi les plus hautes valeurs humaines, l’amour des autres, la solidarité, l’entraide, la générosité, donner sans rien attendre en retour en digne héritier de la sagesse et des valeurs nobles kabyles d’antan.

16 Avril 2019
_____________________________________________
Une pensée pour le poète Meziane El Djouzi qui nous a quitté le 21 mars 2019 à 68 ans, paix à son âme.
Mon ami le poète Meziane El Djouzi nous laisse un grand vide, il était un homme généreux, humaniste, il nous manquera toujours. Il aimait les livres, il savait combien la lecture éclaire, nourrissant le cœur et l’esprit.
Meziane El Djouzi aimait les livres, il était un fidèle lecteur de mes poésies et des romans de mon ami Youcef Zirem. N’habitant pas Paris, je me souviens qu’il était venu de la campagne spécialement pour nous rencontrer et a affectueusement insisté pour nous inviter Youcef Zirem et moi à dîner à Paris. Un soir, nous nous sommes retrouvés avec joie dans un restaurant kabyle célèbre au 85 rue de Buzenval dans le XXè arrondissement de Paris, autour d’un bon couscous kabyle. Je me souviens combien nos échanges culturels, autour des livres, de la poésie, étaient élevés et enrichissants.
Il nous parla de l’Algérie, de la Kabylie avec beaucoup d’émotion et de nostalgie. Il nous confia combien la guerre d’Algérie a marqué son enfance. Mais même s’il a quitté l’Algérie enfant, il resta très attaché à la Kabylie, il maîtrisait d’ailleurs parfaitement la langue kabyle.
Il est venu plusieurs fois assister au café littéraire de l’Impondérable qu’anime mon ami l’écrivain poète journaliste Youcef Zirem tous les dimanches au 320 rue des Pyrénées dans le 20ème arrondissement de Paris. IL était à chaque fois très enthousiasmé, heureux, transporté par les échanges entre les auteurs et le public. Il n’hésitait pas en homme de lettres, éclairé, soucieux d’apporter quelques choses, de poser des questions enrichissantes en toute convivialité aux auteurs invités. Les discussions continuaient chaleureusement autour d’un verre qu’il aimait offrir généreusement, jusqu’au bout de la nuit.
Je garde le souvenir d’un homme jovial, sensible, cultivé, généreux. IL aimait la vie, les amis, le partage.IL avait lui même une belle plume avec une âme de poète, je l’avais encouragé à maintes reprises à publier ses écrits. Il est parti hélas bien trop tôt.
Meziane El Djouzi fut un poète humble, un homme bon proche de tous, il continue à vivre dans la mémoire de ceux qui l’ont connu.
Brahim SACI
22 Mars 2020

________________________________________________
Une pensée pour l’homme de culture Chérif Messaouden, paix à son âme.

Tu étais un grand homme de culture, un grand militant, un homme généreux qui connaissait la valeur de l’amitié, tu nous as quittés le 18 avril 2010 bien trop tôt, des suites d’une longue maladie, à l’âge de 44 ans. Chérif Messaouden a dirigé le Cercle culturel Igelfan de la commune de Bouzeguene, le premier novembre 2004 il lança le journal » Echos de Bouzeguene », une publication culturelle d’ouverture dans la perspective enrichissante de débats démocratiques. Il avait écrit « Notre association fait sienne cette citation de Saint-Exupéry, celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit ».
Chérif Messaouden réalisa en 2008 un documentaire » Mémoire d’un boycott », où il revient sur la grève du cartable 1994/1995.
En effet en 1994, le MCB (mouvement culturel berbère appelle à la grève du cartable pour la reconnaissance officielle de la langue berbère, (tamazight), pour qu’elle soit enseignée dans les écoles et les universités. Il dit à propos de son documentaire, « Lors du boycott scolaire qui avait été lancé par le mouvement culturel berbère (MCB) pour la reconnaissance officielle de la langue tamazight et son introduction dans l’enseignement de l’école à l’université, j’ai participé à plusieurs manifestations pendant cette période de « dissidence scolaire » de l’année 1994/1995. Beaucoup d’encre a coulé. C’est pour mieux comprendre cette épopée à inscrire à l’actif du long combat pour l’amazighité que j’ai décidé de porter un regard critique de la réalité vécue de cette période avec toute la liberté et tout le recul nécessaire à travers l’image. » Le centre culturel de Bouzeguene que tu as dirigé en tant que directeur rayonnait. Je n’oublierais jamais ce jour de 2007 où tu m’as accompagné à radio Soummam.Il y avait avec nous un autre grand ami, le journaliste Salem Hammoum, une belle plume, un des rares esprits libres du journalisme algérien, qui t’a rejoint dans l’éternité à l’âge de 65 ans le 21 septembre 2015, lui aussi des suites d’une grande maladie, paix à son âme.
Cette journée reste gravée dans mon âme. Toi et Salem, vous avez laissé un grand vide, j’ai perdu deux grands amis mais vous restez vivants dans ma mémoire. J’ai chaque jour une pensée pour vous. Tant de souvenirs s’entrechoquent dans ma tête, à chaque fois que je venais en vacances en Algérie, nous nous retrouvions souvent avec Salem Hammoum à Azazga, cette ville de Kabylie chaleureuse, célèbre pour ces restaurants.
Attablés dans un de ces bons restaurants, autour d’un bon plat nous échangions des idées culturelles, des réflexions. Nous sortions toujours de là heureux, l’esprit plus éclairé, enrichi, l’amitié agrandie. Peu de temps avant ta disparition tragique, je t’avais parlé du docteur Aziz Saibi, un chercheur libre, pluridisciplinaire, un grand homme de culture, un grand militant de la cause berbère, que j’ai bien connu à Paris, originaire de Houra, le chercheur qui a émis l’hypothèse selon laquelle la langue berbère serait
la mère des langues, qui nous a quitté le 16 juillet 2006 à l’âge de 56 ans, lui aussi des suites d’une longue maladie, paix à son âme.Tu m’avais proposé de lui rendre hommage avec le centre culturel de Bouzeguene, en associant Houra son village natal et les départements de recherche linguistique de l’université de Tizi-ouzou et de l’université de Bgayet.
Mais le sort s’est acharné, le destin en a décidé autrement, tu es parti prématurément, sans avoir pu réaliser ce projet.
Brahim SACI
22 Avril 2020
________________________________________________
Une pensée pour l’ingénieur homme de culture Kaci AZEM

Une pensée pour l’ingénieur homme de culture Kaci AZEM
Kaci Azem nous a quittés prématurément le 15 décembre 2019 à l’âge de 60 ans, paix à son âme. Il est décédé accidentellement, en tombant d’un olivier dans son champ, dans son village Agouni Gueghrane en Kabylie. Triste destin que celui de cet ingénieur, érudit, homme de culture, aimé de tous, ouvert sur le monde.
Une disparition tragique qui laisse sans voix, plongeant une famille, un village, ses proches et tous ceux qui l’ont connu dans la douleur et l’incompréhension. Je me souviendrais toujours de nos échanges amicaux, fraternels, éclairés,
sur les réseaux sociaux et par mails. Je garde en mémoire le souvenir d’un homme attentif, cultivé, d’une grande sagesse, d’une grande générosité, curiosité, à l’écoute de tous, de sa société et du monde.
Kaci Azem était d’un optimisme naturel orné d’une grande bonté, d’un esprit élevé, plein d’espoir, confiant en un avenir meilleur.
Nous échangions souvent sur les réseaux sociaux, des idées, des réflexions, nous évoquions souvent le légendaire Slimane Azem, dont nous partagions l’admiration.
Un jour je lui avais demandé s’il pouvait prendre quelques photos de la maison natale de Slimane Azem ainsi que des terres familiales, il a accepté avec joie. Quelques temps après, il a eu la gentillesse de m’envoyer quelques photos.
Le 23 novembre 2019, soit vingt-deux jours avant sa disparition tragique, il publia sur facebook :
(L’heure est-elle écrite, peut-on la fuir ce soir à Samarcande? Puis il cita Le poète mystique persan Farid ud-Dîn Attar (1140-1230).
(Il y avait une fois, dans Bagdad, un Calife et son Vizir. Un jour, le Vizir arriva devant le Calife, pâle et tremblant :«
Pardonne mon épouvante, Lumière des Croyants, mais devant le Palais une femme m’a heurté dans la foule. Je me suis retourné et cette femme au teint pâle, aux cheveux sombres, à la gorge voilée par une écharpe rouge était la Mort. En me voyant, elle a fait un geste vers moi. Puisque la mort me cherche ici, Seigneur, permets-moi de fuir me cacher loin d’ici, à Samarcande. En me hâtant, j’y serai avant ce soir »
Sur quoi il s’éloigna au grand galop de son cheval et disparu dans un nuage de poussière vers Samarcande. Le Calife sortit alors de son Palais et lui aussi rencontra la Mort. Il lui demanda :« Pourquoi avoir effrayé mon Vizir qui est jeune et bien-portant ? »
– Et la Mort répondit :
« Je n’ai pas voulu l’effrayer, mais en le voyant dans Bagdad, j’ai eu un geste de surprise, car je l’attends ce soir à Samarcande »).
Kaci Azem nous invite à la réflexion et à la méditation par cette pensée à la portée mystique et philosophique qui interpelle le coeur et l’esprit humain, comme pour nous rendre meilleurs. La nouvelle de sa mort tragique est tombée comme un couperet.
Nous n’oublierons jamais cet homme, cultivé, au sourire plein de bonté, aimé de tous.
Brahim SACI
Le 09 mai 2020
lematindalgerie.com
_____________________________________________

